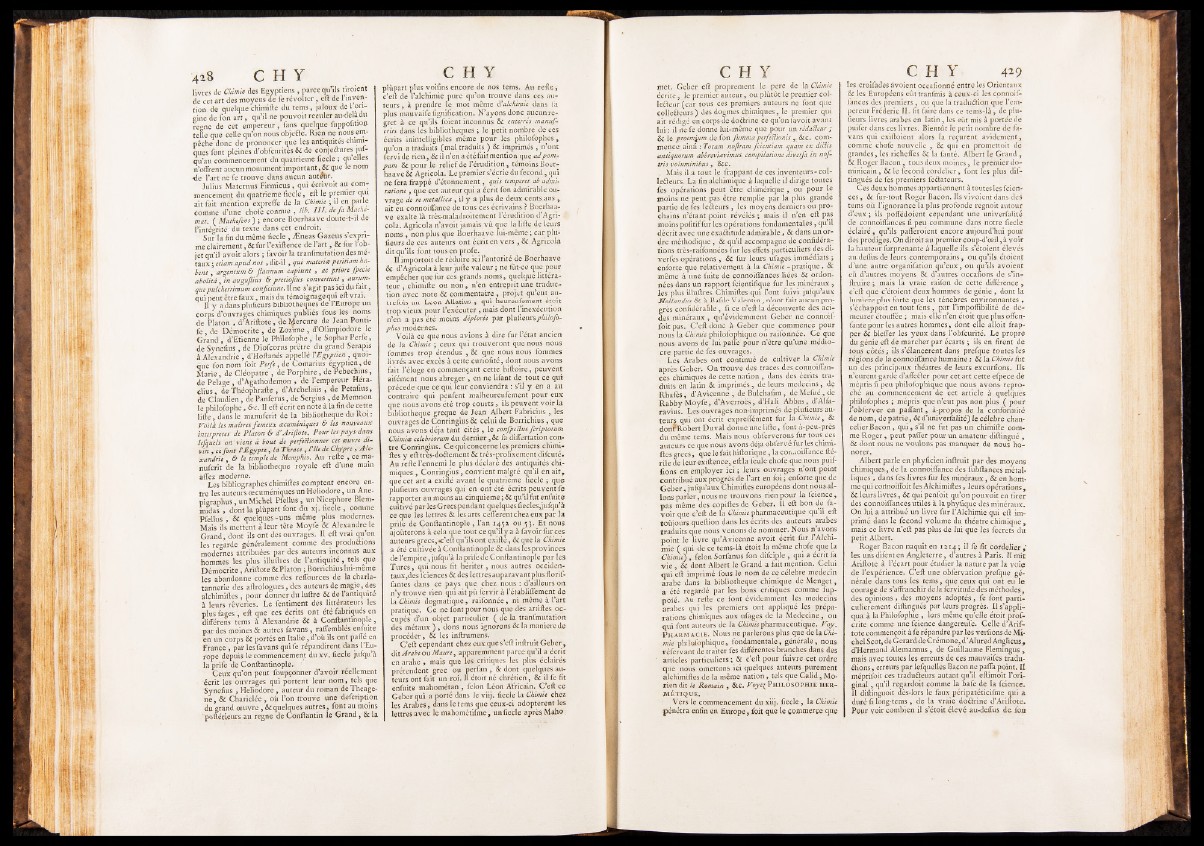
livres de Chimie des Egyptiens, parce qu’ils tiraient
de cet art des moyens de fe révolter, eft de l’invention
de quelque chimifte du tems, jaloux de l origine
de fon art, qu’il ne pouvoir reeuler au-delà du
régné de cet empereur, fans quelque fuppofition
telle que celle qu’on nous objeCte. Rien ne nous empêche
donc de prononcer que les antiquités chimiques
font pleines d’obfcurités 5c de conjectures jusqu'au
commencement du quatrième fiecle ; qu elles
n’offrent aucun monument important, & que le nom
•de l’art ne fe trouve dans aucun autlhr.
Julius Maternus Firmicus , qui écrivoit au commencement
du quatrième fiecle, eft le premier qui
ait fait mention expreffe de la Chimie ; il en parle
comme d’une chofe connue , lih. I I I . defaMathe-
mat. ( Matkefeos ) ; encore Boerhaave doute-t-il de
l’intégrité du texte dans cet endroit.
Sur la fin du même fiecle, Æneas Gazeus s’exprime
clairement, & fu r l’exiftence de l’a r t , & fur l’objet
qu’il avoit alors ; favoirla tranfmutation des métaux
\ etiam apud nos , dit-il , qui materiez peritiam ha-
bent, argentum & Jlannum capiunt , ac priore fpecie
abolitâ y in auguftius & pretiojîus conyertunt , aurum-
quepulcherrimum conjiciunt. Ilne s’agit pas ici du fait,
qui peut être faux, mais du témoignage qui eft vrai.
Il y a dans plufieurs bibliothèques de l’Europe un
corps d’ouvrages chimiques publiés fous les noms
de Platon , d’Ariftote, de gerçure de Jean Pontife
, de Démocrite , de Zozime , d’Olimpiodore le
Grand , d’Etienne le Philofophe , le Sophar Perfe,
de Synefius , de Diofcorus prêtre du grand Serapis
à Alexandrie , d’Hoftanés appellé {'Egyptien , quoique
fon nom foit Perfe, de Comarius égyptien, de
Marie, de Cléopâtre , de Porphire, de Pebechius,
de Pelage , d’Agathodemon , de l’empereur Héra-
clius, de Théophrafte , d’Archelaüs , de Petafius,
de Claudien, de Panferus, de Sergius , de Memnon
le philofophe, &c. Il eft écrit en note à la fin de cette
lifte, dans le manuferit de la bibliothèque du Roi :
Voilà Les maîtres fameux acuméniques & les nouveaux
interprètes de Platon & d’Ariftote. Pour lespaysdans
lefquels on vient à bout de perfectionner cet oeuvre divin
y ce font C Egypte , la Thrace , Vîle de Chypre , Alexandrie
y & le temple de Memphis. Au refte , ce manuferit
de la bibliothèque royale eft d’une main
affez moderne.
Les bibliographes chimiftes comptent encore entre
les auteurs oecuméniques un Heliodore, un Ane-
pigraphus, un Michel Piellus , un Nicephore Blem-
midas , dont la plupart font du xj. fiecle , comme
Pfellus , 5c quelques-uns même plus modernes.
Mais ils mettent à leur tête Moyfe & Alexandre le
Grand, dont ils ont des ouvrages. Il eft vrai qu on
les regarde généralement comme des productions
modernes attribuées par des auteurs inconnus aux
hommes les plus illuftres de l’antiquité, tels que
Démocrite , Ariftote 5c Platon ; Borrichius lui-même
les abandonne comme des reffources de la charla-
tannerie des aftrologues, des auteurs de magie, des
alchimiftes , pour donner du luftre 5c de l’antiquité
à leurs rêveries. Le fentiment des littérateurs les
plus fages , eft que ces écrits ont été fabriqués en
différens tems à Alexandrie 5c à Conftantinople,
par des moines & autres favans, raffemblés enfuite
en un corps 5c portés en Italie, d’où ils ont paffe en
France , par les favans qui fe répandirent dans 1 Europe
depuis le commencement du xv. fiecle jufqu à
la prifé de Conftantinople.
Ceux qu’on peut foupçonner d’avoir réellement
écrit les ouvrages qui portent leur nom, tels que
Synefius , Heliodore, auteur du roman de Theage-
n e , 5c Chariclée , où l’on trouve une defeription
du grand oeuvre , & quelques autres, font au moins
'poftérieurs au régné de Conftantin le Grand, & la
plupart plus voifins encore de nos tems. Au refte *
c’eft de l’alchimie pure qu’on trouve dans ces auteurs
, à prendre le mot même d'alchimie dans la
plus mauvaife fignification. N’ayons donc aucunre-
gret à ce qu’ils foient inconnus 5c enterres tnanuf-
crits dans les bibliothèques ; le petit nombre de ces
écrits inintelligibles même pour les philofophes,
qu’on a traduits (mal traduits ) 5c imprimés, n’ont
fervi de rien, & il n’en a été fait mention que ad pont-
pam 5c pour le relief de l’érudition, témoins Boerhaave
5c Agricola. Le premier s’écrie du fécond, qui
ne fera frappé d’étonnement, quis ttmperet ab admi-
ratione , que cet auteur qui a écrit fon admirable ouvrage
de re metallica , il y a plus de deux cents.ans ,
ait eu connoiffance de tous ces écrivains ? Boerhaave
exalte là très-maladroitement l’érudition d’Agri-
cola. Agricola n’avoit jamais vu que la lifte de leurs
noms , non plus que Boerhaave lui-même ; car plufieurs
de ces auteurs ont écrit en vers , 5c Agricola
dit qu’ils font tous en profe.
Il importoit de réduire ici l’autorité de Boerhaave
& d’Agricola à leur jufte valeur ; ne fût-ce que pour
empêcher que fur ces grands noms, quelque littérateur
, chimifte ou non, n’en entreprît une traduction
avec note 5c commentaire , projet qu’eut autrefois
un Leon Allatius , qui heureufement étoit
trop vieux pour l’exécuter , mais dont l’inexécution
n’en a pas été moins déplorée par plufieurs philofophes
modernes.
Voilà ce que nous avions à dire fur l’état ancien
de la Chimie ; ceux qui trouveront que nous nous
fommes trop étendus , 5c que nous nous fommes
livrés avec excès à cette curiofité, dont nous avons
fait l’éloge en commençant cette hiftoire, peuvent
aifément nous abréger , en ne lifant de tout ce qui
précédé que ce qui leur conviendra : s’il y en a ait
contraire qui penfent malheureufement pour eux
que nous avons été trop courts * ils peuvent voir la
bibliothèque greque de Jean Albert Fabricius , les
ouvrages de Conringius 5c celui de Borrichius, que
nous avons déjà tant cités , le confpeclus feriptorum
Chimioe celebriorum du dernier, 5c fa differtation contre
Conringius. Ce qui concerne les premiers chimiftes
y eft très-doCtement 5c très-prolixement difeuté.
Au refte l’ennemi le plus déclaré des antiquités chimiques
, Conringius, convient malgré qu’il en ait,
que cet art a exifté avant le quatrième fiecle ; que
plufieurs ouvrages qui en ont été écrits peuvent fe
rapporter au moins au cinquième ; 5c qu’il fut enfuite
cultivé par les Grecs pendant quelques fiecles,jufqu’à
ce que les lettres & les arts cefferentchez eux par la
prife de Conftantinople, l’an 1451 ou 53. Et nous
ajouterons à cela que tout ce qu’il y a à favoir fur ces
auteurs grecs,«c’elt qu’ils ont exifté, 5c que la Chimie
a été cultivée à Conftantinople 5c dans les provinces
de l’empire, jufqu’à la prife de Conftantinople par les
Turcs, qui nous fit hériter, nous autres occidentaux,
des feiènees 5c des lettres auparavant plus florif-
fantes dans ce pays que chez nous : d’ailleurs on
n’y trouve rien qui ait pu fervir à l’établiffement de
la Chimie dogmatique, raifonnée, ni même à l’art
pratique. Ce ne font pour nous que des artiftes occupés
d’un objet particulier ( de la tranfmutation
des métaux ) , dons nous ignorons 5c la maniéré de
procéder, 5c les inftrumens.
C’eft cependant chez eux que s’eftinftruit Geber,
dit Arabe ou Maure, apparemment parce qu’il a écrit
en arabe, mais que les critiques les plus éclairés
prétendent grec ou perfan , & dont quelques auteurs
ont fait un roi. Il étoit né chrétien, & il fe fit
enfuite mahométan , félon Léon Africain. C ’eft ce
Geber qui a porté dans le viij. fiecle la Chimie chez
les Arabes, dans le tems que ceux-ci adoptèrent les
lettres avec le mahométifme, un fiecle après Maho
met. Geber eft proprement le pere de la Chimie
écrite, le premier auteur, ou plutôt le premier collecteur
(car tous ces premiers auteurs ne font que
collecteurs ) des dogmes chimiques, le premier qui
ait rédigé en corps ae doCtrine ce qu’onlavoit avant
lui : il ne fe donne lui-même que pour un rédacteur ;
5c le proem'ÿtm de fon fummaperfeclionis &c. commence
ainfi : Totam nofiram Jcientiam quam ex diclis
antiquorum abbreviavimus compilatione diverfa in nof-
tris voluminibus, &c.
. Mais il a tout le frappant de ces inventeurs -c o llecteurs.
La fin alchimique à laquelle il dirige toutes
fes opérations peut être chimérique , ou pour le
moins ne peut pas être remplie par la plus grande
partie de fes leCteurs , les moyens derniers ou prochains
n’étant point révélés \ mais il n’en eft pas
moins pofitiffur les opérations fondamentales, qu’il
décrit avec une exactitude admirable, & dans un ordre
méthodique, & qu’il accompagne de confidera-
tions très-raifonnées fur les effets particuliers des di-
verfes opérations , 5c fur leurs ufages immédiats ;
enforte que relativement à la Chimie - pratique, &
même à une fuite de connoilfances liées 5c ordonnées
dans un rapport feientifique fur les minéraux ,
les plus illuftres Chimiftes qui l’ont fuivi jufqu’aux
Hollandus 5c à Bafile Valentin, n’ont fait aucun progrès
considérable, fi ce n’eft la découverte des acides
minéraux , qu’évidemment Geber ne connoif-
foit pas. C ’eft donc à Geber que commence pour
nous la Chimie philofophique ou raifonnée. Ce que
nous avons de lui paffe' pour n’être qu’une médiocre
partie de fes ouvrages.
Les Arabes ont continué de cultiver la Chimie
après Geber. On trouve des traces des connoiffan-
ces chimiques de cette nation , dans des écrits traduits
en latin & imprimés, de leurs médecins , dç
Rhafès, d’Avicenne j de Bulchafim, de M efué, de
Rabby Moyfe, d’Averroès, d’Hali Abbas, d’Alfa-
ravius. Les ouvrages non-imprimés de plufieurs auteurs
qui ont écrit expreffément fur la Chimie, &
donrRobert D uval donne une lifte, font à-peu-près
du même tems. Mais nous obferverons fur tous ces
auteurs ce que nous avons déjà obferyé fur les chimiftes
grecs, que le faithiftorique, la conaoiffance fté-
rile de leur exiftence,.eftla feule ehofe que nous puif-
fions en employer ici ; leurs ouvrages n’ont point
contribué aux progrès de l’art en foi ; enforte que de
G eb er , jufqu’aux Chimiftes européens dont nous allons
parler, nous ne trouvons rien pour la fcience,
pas même des copiftes de Geber. 11 eft bon de favoir
que c’eft de la Chimie pharmaceutique qu’il eft
toujours queftion dans les écrits des auteurs arabes
traduits que nous venons de nommer. Nous n’avons
point le livre qu’Avicenne avoit écrit fur l’Alchimie
( qui de ce tems-là étoit la même chofe que la
Chimie) ., félon Sorfanus fon difciple, qui a écrit fa
vie , 5c dont Albert le Grand a fait mention. Celui
qui eft imprimé fous le nom de ce célébré médecin
arabe dans la bibliothèque chimique de Menget,
a été regardé par les bons critiques comme fup-
polé. Au refte ce font évidemment les médecins
arabes qui les premiers ont appliqué les préparations
chimiques aux ufages de îa Medecine, ou
qui font auteurs de la Chimie pharmaceutique. Voy.
P h a rm a c ie . Nous ne parlerons plus que delaCAi-
mie philofophique, fondamentale, générale, nous
réfervant de traiter fes différentes branches dans des
' articles particuliers ; & c’eft pour fuivre cet ordre
que nous omettons ici quelques auteurs purement
alchimiftes de la même nation, tels que Calid, Mo-
riendit le Romain , &.C. V >ye^ PHILOSOPHIE herm
é t iq u e . •
Vers le commencement du xiij. fiecle , la Chimie
pénétra enfin en Europe, foit que le commerce que
les croifades âvoient occafionné entre les Orientaux
& les Européens eût tranfmis à ceux-ci les connoif-
fances des premiers, ou que la traduélion que l’empereur
Frédéric II. fit faire dans ce tems-là, de plufieurs
livres arabes en latin, les eût mis à portée de
puifer dans ces livres. Bientôt le petit nombre de favans
qui exiftoient alors la reçurent avidement,
comme chofe nouvelle , 5c qui en promettoit de
grandes, les richeffes 5c la fanté. Albert le Grand ,
5c Roger Bacon, tous deux moines, le premier dominicain,
5c le fécond cordelier, font les plus distingués
de fes premiers feftateurs.
Ces deux hommes appartiennent à toutes les feien-
ce s, & fur-tout Roger Bacon. Ils vivoientdans des
tems où l’ignorance la plus profonde regnoit autour
d’eux ; ils poffédoient cependant une univerfalité
de connoiffances fi peu commune dans notre fiecle
éclairé, qu’ils pafferoient encore aujourd’hui pour
des prodiges. On diroit au premier coup-d’oe il,à voir
la hauteur furprenante à laquelle ils s’étoient élevés
au-deffus de leurs contemporains, ou qu’ils étoient
d’une autre organifation qu’eu x, ou qu’ils a voient
eu d’autres moyens 5c d’autres occafions de s’in-
ftruire ; mais la vraie raifon de cette différence ,
c’eft que c’étoient deux hommes de génie , dont la
lumière plus forte que les ténèbres environnantes ,
s’échappait en tout fens , par l’impoffibilité de demeurer
étouffée ; mais elle n’en étoit que plus pffen-
fante pour les autres hommes, dont elle ailoit frapper
5c bleffer les yeux dans l’obfcurité. Le propre
du génie eft de marcher par écarts ; ils en firent de
tous côtés ; ils s’élancèrent dans prefque toutes les
régions de la connoiffance humaine : 5c la Chimie fut
un des principaux théâtres de leurs excurfions. Ils
n’eurent garde d’affefter pour cet art. cette efpece de
mépris fi peu philofophique que nous avons reproché
au commencement de cet article à quelques
philofophes ; mépris que n’eut pas non plus ( pour
l’obferver en paffant, à-propos de la conformité
de nom, de patrie, 5c d’uni verfalité) le célébré chan-
celierBacon, qui , s’il ne fut pas un chimifte comme
Roger, peut paffer pour un amateur diftingué ,
5c dont nous ne voulons pas manquer de nous honorer*
Albert parle en phyficien inftruit par des moyens
chimiques, de la connoiflànce des fubftances métalliques
, dans fes livres fur les minéraux, 5c en homme
qui cortnoiffoit les Alchimiftes , leurs opérations,
5c leurs livres, 5c qui penfoit qu’on pouvoit en tirer
des connoiffances utiles à la pnyfique des minéraux.
On lui a attribué un livre fur l’Alchimie qui eft imprimé
dans le fécond volume du théâtre chimique ,
mais ce livre n’eft pas plus de lui que les fecrets du
petit Albert.
Roger Bacon naquit en 12 14; il fe fit cordelier ,’
les uns difent en Angleterre, d’autres à Paris. II mit
Ariftote à l’écart pour étudier la nature par la voie
de l’expérience. C ’eft une obfervation prefque générale
dans tous les tems, que ceux qui ont eu le
courage de s’affranchir delà fervitude des méthodes,
des opinions, des moyens adoptés, fe font particulièrement
diftingués par leurs progrès. Il s’appliqua
à la Philofophie , lors même qu’elle étoit prof-
crite comme une fcience dangereufe. Celle d’Ariftote
commençoit à fe répandre par les verfions de Michel
Scot, de Gérard de Crémone, d’Alured Anglicus ,
d’Hermand Alemannus , de Guillaume Flemingus,
mais avec toutes les erreurs de ces mauvaifes traductions,
erreurs par lefquelles Bacon ne paffa point. II
méprifoit ces traducteurs autant qu’il eftimoit l’original
, qu’il regardoit comme la bafe de la fcience.
Il diftinguoit dès-lors le faux péripatéticifme qui a
duré fi long:tems , de la vraie doCtrine d’Ariftote.
Pour voir combien il s’étoit élevé au-deffus d e foa