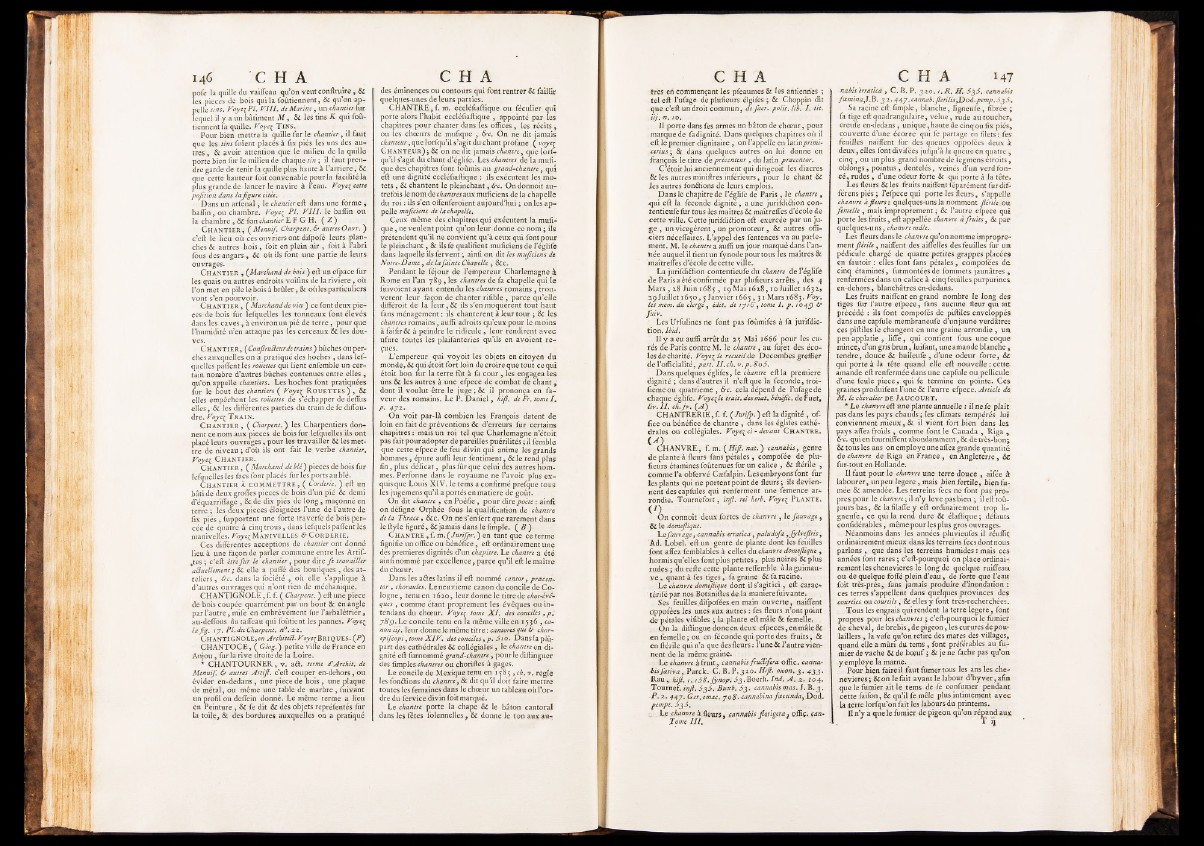
pofe la quille du vaiffeau qu’on veut conftruire, ÔC
les pièces de bois qui la foûtiennent, ôc qu’on appelle
tins. Voye^Pl. VIII. de Marine , un chantier (m
lequel il y a un bâtiment M , & les tins K qui foûtiennent
la quille. Voyt^ T ins.
Pour bien mettre la quille fur le chantier, il faut
que les tins foient placés à lix pies les uns des autres
, ôc avoir attention que le milieu de la quille
porte bien fur le milieu de chaque tin ; il faut prendre
garde de tenir la quille plus haute à l'arriéré , ôc
que cette hauteur foit convenable pour la facilité la
plus grande de lancer le navire à l’eau. Voye%_ cette
pofition dans lafigure citée.
Dans un arfenal, le chantier eft dans une forme ,
baffin, ou chambre. Voye^ PI. V III. le baffin ou
la chambre , ôc fon chantier E F G H . ( Z )
C h a n t ie r , ( Menuif. Charpent.& autres O uvr. )
c’eft le lieu oh ces ouvriers ont difpofé leurs planches
ôc autres bois , foit en plein air , foit à l’abri
fous des angars, 6c où ils font une partie de leurs
ouvrages.
C hant ier , (Marchand de bois ) eft un efpace fur
les quais ou autres endroits voifins de larivie re, ou
l’on met en pile le bois à brûler, & où les particuliers
vont s’en pourvoir.
C hantier , ( Marchand de vin ) ce font deux pièces
de bois fur lefquelles les tonneaux font élevés
dans les caves, à environ un pié de terre, pour que
l’humidité n’en attaque pas les cerceaux 6c les dour
ves.C
hant ier, ( Conflructeurde trains ) bûches ou perches
auxquelles on a pratiqué des hoches , dans lefquelles
paffent les roüettes qui lient enfemble un certain
nombre d’autres bûches contenues entre elles ,
qu’on appelle chantiers. Les hoches font pratiquées
fur le bout des chantiers ( Voye{ Ro üet te s ) , 6c
elles empêchent les roüettes de s’échapper de deffus
elles, 6c les différentes parties du train de fe diffou-
dre. Voye^ T ra in .
C hant ier , ( Charpent. ) les Charpentiers donnent
ce nom aux pièces de bois fur lefquelles ils ont
placé leurs ouvrages, pour les travailler ôc les mettre
de niveau ; d’où ils ont fait le verbe chantier.
Voyei C hant ier.
C hantier , ( Marchand de blé') pièces de bois fur
lefquelles les facs font placés fur les ports au blé.
C hantier à c o m m e t t r e , ( Corderie. ) eft un
bâti de deux groffes pièces de bois d’un pié 6c demi
d’équarriffage , 6c de dix piés de long, maçonné en
terre ; les deux pièces éloignées l’une de l’autre de
fix piés , fupportent une forte traverfe de bois percée
de quatre à cinq trous, dans lefquelspaffentles
manivelles. Voyer^ Manivelles & C o rderie.
Ces différentes acceptions de chantier ont donné
lieu à une façon de parler commune entre les Artif-
tes ; c ’eft être fur le chantier, pour dire fe travailler
actuellement ; ôc elle a paffé des boutiques , des at-
teliers, &c. dans la fociété , où elle s’applique à
d ’autres ouvrages qui n’ont rien de méchanique.
CHANTIGNOLE, f. f. ( Charpent. ) eft une piece
de bois coupée quarrément par un bout & en angle
par l’autre, mife en embrevement fur l’arbalétrier ,
au-deffous du taffeau qui foûtient les pannes. Vcye^
lafig. iy. PL du Charpent. n°. 22.
CHANTIGNOLE,en Architect. J'oyeçBRIQUES. (P)
CHANTOCÉ, ( Géog.) petite ville de France en
Anjou, fur la rive droite de la Loire.
* CHANTOURNER, v . a£t. terme d'Archit. de
Menuif. & autres Artifi. c’eft couper en-dehors, ou
évider en-dedans , une piece de bois , une plaque
de métal, ou même une table de marbre , fuivant
un profil ou deffein donné. Le même terme a lieu
en Peinture , 6c fe dit 6c des objets repréfentés fur
la toile., & des bordures auxquelles on a pratiqué
des éminences ou contours qui font rentrer ôc faillir
quelques-unes de leurs parties.
CHANTRE, f. m. eccléfiaftique ou féculier qui
porte alors l’habit eccléfiaftique , appointé par les
chapitres pour chanter dans les offices , les récits,
ou les choeurs de mufique , &c. On ne dit jamais
chanteur, que lorfqu’il s’agit du chant profane ( voyeç
C hanteur) ; ôc on ne dit jamais chantre, que lorfqu’il
s’agit du chant d’églife. Les chantres de la njuftj
que des chapitres font foûmis au grand-chantre, qui
eft une dignité eccléfiaftique : ils exécutent les motets
, 6c chantent le pleinchant, &c. On donnoit autrefois
le nom de chantres aux muficiens de la chapelle
du roi : ils s’en offenferoient aujourd’hui ; on les appelle
muficiens de la chapelle.
Ceux même des chapitres qui exécutent la muli-
que, ne veulent point qu’on leur donne ce nom ; ils
prétendent qu’il ne convient qu’à ceux qui font pour
le pleinchant, & ils fe qualifient muficiens de l’églife
dans laquelle ils fervent ; ainfi on dit les muficiens de
Notre-Dame, de la fainte Chapelle , ÔCC.
Pendant le féjour de l’empereur Charlemagne à
Rome en l’an 78 9, les chantres de fa chapelle qui le
ftiivoient ayant entendu les chantres romains , trouvèrent
leu r . façon de chanter rifible , parce qu’elle
différoit de la leur, 6c ils s’en moquèrent tout haut
fans ménagement : ils chantèrent à leur tour ; ôc les
chantres romains, auffi adroits qu’eux pour le moins
à faifir ôc à peindre le ridicule, leur rendirent avec
ufure toutes les plaifanteries qu’ils en avoient reçues.
L ’empereur qui voyoit les objets en citoyen du
monde, ôc qui étoit fort loin de croire que tout ce qui
étoit bon nir la terre fut à fa cour , les engagea les
uns ôc les autres à une efpece de combat de chant
dont i f voulut être le juge; 6c il prononça en faveur
des romains. Le P. Dan iel, hiß. de Fr. tome I .
P• 4 7 2 .
On voit par-là combien les François datent de
loin en fait de préventions ôc d’erreurs fur certains
chapitres : mais un roi tel que Charlemagne n’étoit
pas fait pour adopter de pareilles puérilités ; il femble
que cette efpece de feu divin qui anime les grands
hommes, épure auffi leur fentiment, ôc le rend plus
fin, plus délicat, plus fûr que celui des autres hommes.
Perfonne dans le royaume ne l’avoit plus exquis
que Louis XIV. le tems a confirmé prefque tous
les jugemens qu’il a portés en matière de goût.
On dit chantre , en Poéfie, pour dire poète : ainfi
on défigne Orphée fous la qualification de chantre
de la Thrace , ôcc. On ne s’enfert que rarement dans
le ftyle figuré, ôc jamais dans le fimple. ( B )
C hantre , f. m .(Jurifpr. ) en tant que ce terme
lignifie un office ou bénéfice, eft ordinairement une
des premières dignités d?un chapitre. Le chantre a été
ainfi nommé par excellence, parce qu’il eft le maître
du choeur.
Dans les aétes latins il eft nommé cantor, proecen-
tor, chôraules. Le neuvième canon du concile de Cologne
, tenu en 1620, leur donne le titre de chor-évê-
ques , comme étant proprement les évêques ou in-
tendans du choeur. Voye[ tome X I . des conciles, p i
789 . Le concile tenu en la même ville en 1556 , canon
iij. leur donne le même titre : cantores qui & chor-
epifeopi, tome X IV . des conciles, p. S10. Danslaplû-
part des cathédrales ôc collégiales, le chantre en dignité
eft furnommé grand-chantre, pourlediftinguer
des Amples chantres ou choriftes à gages.
Le concile de Mexique tenu en 1585 ,ch .v. regle
les fonctions du chantre, ôc dit qu’il doit faire mettre
toutes les femaines dans le choeur un tableau où l’ordre
du fervice divin foit marqué.
Le chantre porte la chape ôc le bâton cantoral
dans les fêtes folennelles, ôc donne le ton aux autrès
eri commençant les pfeaumes ôc les aritiennes ;
tel eft l’ufage de plufieurs élgifes ; ôc Choppin dit
que c’eft un droit commun, de facr. polit, lib. I. lit.
. i ij. n .ro .
Il porte dans fes armes un bâton de choeur, pour
marque de fa dignité. Dans quelques chapitres où il
eft le premier dignitaire , on l’appelle en latinprimi-
.ctrius ; de dans quelques autres on lui donne en
françois le titre de précenteur , du latin proecentor.
C ’étoit lui anciennement qui dirigeoit les diacres
ôc les autres miniftres inférieurs, pour le chant ôc
les autres fondions de leurs emplois.
Dans le chapitre de l’églife de Paris , le chantre ,
.qui eft la fécondé dignité , a une jurifdiétion con-
tentieufe fur tous les maîtres 6c maîtreffes d’école de
cette ville. Cette jurifdiétion eft exercée par un juge
, un vicegérent, un promoteur, ôc autres officiers
néceffaires. L’appel des fentences va au parlement.
M. le chantre a auffi un jour marqué dans l’an-
hée auquel il tient un fynode pour tous les maîtres &
maîtreffes d’école de cette ville,
La jurifdiétion contentieufe du chantre de l’églifô
de Paris a été confirmée par plufieurs arrêts , des 4
Mars , 28 Juin 1685 » *9 Mai 1628,10 Juillet 1632»
29 Juillet 1650,5 Janvier 166 5, 31 Mars 1683. Voy.
les mèm. du clergé, édit, de 1716', tome I. p. 1049 &
fuiv.
Les Urfulines ne font pas feumifes à fa jurifdic-
tion. Ibid.
Il y a eu auffi.arrêt du 25 Mai 1666 pour les curés
de Paris contre M. le chantre , au fujet dès écoles
de charité. Voye£ le recueil.de Decombes greffier
de l’officialité, part. II.ch. v.p. 8o5.
Dans quelques églifes, le chantre eft la première
dignité ; dans d’autres il rfeft que la fécondé, troisième
ou quatrième , &c. cela dépend de l’ufage de
chaque églife. Voyelle trait, des mat. bénéfit. deFuet,
Uv. II. ck.jv. ( A )
CH ANTRERIE, f. f. ( Jurifp. ) eft la dignité , office
ou bénéfice de chantre , dans les églifes cathédrales
ou Collégiales. Voye^ ci - devant C hantre.
( ^ )
CHANVRE, f. m. ( Hiß. nat.) cannabis, genre
de plante à fleurs fans pétales , compofée de plufieurs
étamines foûtenues fur un calice , ôc ftérile ,
Comme l’a obfervé Cæfalpin. Les embryons font fur
les plants qui ne portent point de fleurs ; ils deviennent
des capfules qui renferment une femence arrondie.
Tournëfort, infi. rei herb. Voye{ Plan t e .
( O
On connoît deux fortes de chanvre , le fauvage,
& le domefiique.
Lefauvage , cannabis trratica, paludofa ,Jylvefiris,
Ad. Lobel. eft un genre de plante dont les feuilles
font affez femblables à celles du chanvre domefiique ,
hormis qu’elles font plus petites > plus noires ôc plus
rudes ; du refte cette plante reffemble à la guimauv
e , quant à fes tiges, fa graine ôc fa racine.
Le chanvre domefiique dont il s’agit i c i , eft carac»
tërifé par nos Botaniftes de la maniéré fuivante.
Ses feuilles.difpofées.en main ouverte, naiffent
oppofées les unes aux autres : fes fleurs n’ont point
d e pétales vifibles ; la plante eft mâle ôc femelle.
O n ia diftingue donc en deux efpeces,enmâleôc
en femelle ; ou en féconde qui porte des fruits, ôc
en ftérile qui n’a que des fleurs : l’une Ôc l’autre viennent
de là même graine.
Le chanvre à fruit, cannabis fructifiera offic. canna-
■ bisfativa, Parck. C . B. P. 320. Hifi. oxon. 3 . 433.
-R.au, hifi. 1. i$8.fynopi ^j.Boerh. Ind. A . 2. .104.
Tournef. infi. 5 j i . Buxb. Sg. cannabis mas. J. B. j .
-P. 2. 447. Ger. emac. 708• cannabina foecunday Dod.
pempt. 5g 5. .
o Le chanvre à fleurs, cannabis florigera^ offiç. çan-
Tome III.
nabis erraticâ , G. B. P. 320. t .R . ït . 5$5. cannabis
foeminafi.B. 3 2 .4 4 7 . cannab.fierilisyDod.pemp.536 .
Sa racine eft fimple, blanche, ligneufe , fibrée ;
fa tige eft quadrangulaire, velue, rude au toucher*
creufe en-dedans, unique, haute de cinq ou fix piés*
couverte d’une écoree qui fe partage en filets : fes
feuilles naiffent fur des queues oppofées deux à
deux, elles fontdivifées jufqu’à la queue en quatre *
cinq , ou un plus grand nombre de fegmens étroits,
oblongs, pointus , dentelés, veinés d’un verd foncé
, rudes , d’une odeur forte ôc qui porte à la tête.
Les fleurs ôcles fruits naiffent féparément furdif-
férens piés ; l’efpece qui porte les fleurs, s’appelle
chanvre à fleurs î quelques-uns la nomment fiérilejo\x
femelle , mais improprement ; ôc l’autre efpece qui
porte les fruits, eft appellée chanvre à fruits, ôc par
quelques-uns, chanvre mâle.
Les fleurs dans le chanvre qu’on nomme improprement
ftérile, naiffent des aiffelles des feuilles fur un
pédicule chargé de quatre petites grappes placées
en fautoir : elles font fans pétales , composées de
cinq étamines, furmontéesde fommets jaunâtres *
renfermées dans ùn calice à cinq feuilles purpurines
en-dehors, blanchâtres en-dedans.
Les fruits naiffent en grand nombre le long des
tiges fur l’autre efpece , fans aucune fleur qui ait
précédé : ils font compofés de piftiles enveloppés
dans une capfule membraneufe d’un jaune verdâtre;
ces piftiles fe changent en une graine arrondie , un
peu applatie , liffe , qui contient fous une coque
mince, d’un gris brun, luifant, une amande blanche ,
tendre, douce ôc huileufe, d’une odeur forte, ôc
qui porte à la tête quand elle eft nouvelle : cette
amande eft renfermée dans une capfule ou pellicule
d’une feule piece, qui fe termine en pointe. Ces
graines produifent l’une ôc l’aurre efpece. Article de.
M. le chevalier DE JAUCOURT.
* Le chanvre eft line plante annuelle : il. ne fe plaît
pas dans les pays chauds ; les climats tempérés lui
conviennent mieux, Ôc il rient fort bien dans les
pays affez froids , comme font le Canada , Riga %
&c. qui en fourniffent abondamment, ôc de très-bon;
ôc tous les ans on employé une affez grande quantité
de chanvre de Riga en France , en Angleterre, ôc
fur-tout en Hollande.
Il faut pour le chanvre une terre douce , aifée à
labourer, un peu legere , mais bien fertile, bien fumée
ôc amendée. Les terreins fecs ne font pas propres
pour le chanvre ; il n’y leve pas bien ; il eft toû-
joursbas, ô c lafilaffe y eft ordinairement trop li-
gneufe, ce qui la rend dure ôc élaftique ; défauts
confidérables, même pour les plus gros ouvrages.
Néanmoins dans; les années pluvieufes ii réuffiÇ
ordinairement mieux dans les terreins fecs dont nous
parlons , que dans les terreins humides : mais ces
années font rares ; c’eft-pourquoi ori place o rdinal
rement les chenevières le long de quelque ruiffeau
ou de quelque foffé plein d’eau, de forte que l ’eau
foit très-près, fans jamais produire d’inondation ;
ces terres s’appellent dans quelques provinces des
courties ou courtils, ôc elles y font très-recherchées.
Tous les engrais qui rendent la terre legerè, font
propres pour les chanvres ; c’eft-pourquoi le fumier
de cheval, de brebis, de pigeon, les curures de poulaillers
, la vafe qu’on retire des mares des villages,
quand elle a mûri du tems, font préférables au fu*
mier de vache ôc de boeuf ; ôc je ne fâche pas qu’on
y employé la marne.
Pour bien faire il faut fumer tous les ans les che-
nevieres; ôcon le fait avant le labour d’hy v e r , afin
que le fumier ait le tems de fe confumer pendant
cette faifon , ôc qu’il fe mêle plus intimement avec
. la terre lorfqu’onfait les labours du printems.
Il n’y a que le fumier de pigeon qu’on répand aux