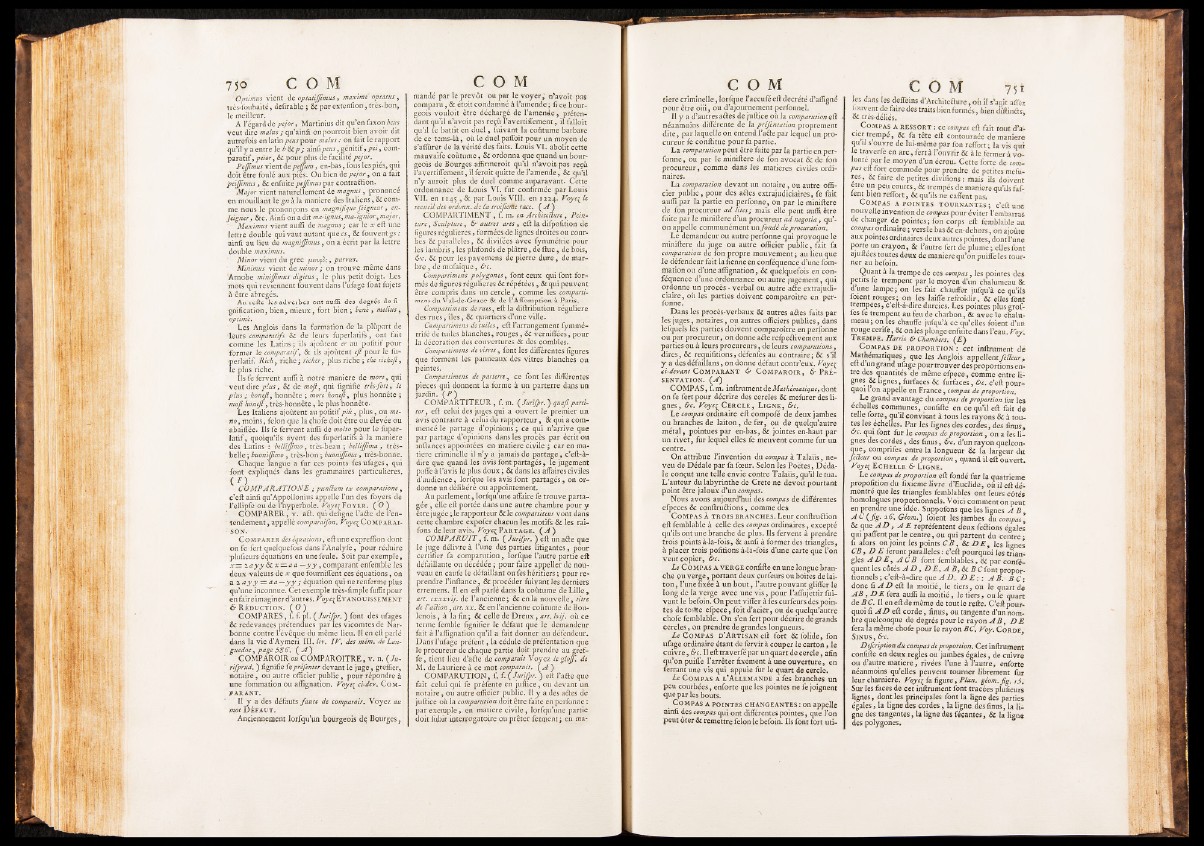
75° C O M
Optimus vient de optatifiimus, maxime optatus,
très-fouhaité, defirable ; & par extenfion, très-bon,
le meilleur. ^
A l’égard de pejor, Martinius dit qu’en faxon beus
Veut dire malus ; qu’ainfi onpourroit bien avoir dit
autrefois en latin /»««^pour malus : on fait le rapport
qu’il y a entre le b 6cp ; ainfipeus, génitif , pei, comparatif,
peior, & pour plus de facilité pejor.
PeJJimus vient de pejfum, en-bas, fous les pies, qui
doit être foulé aux piés. Ou bien de pejor, on a fait
peiffimus, & enfuiteptjjîmus par contrattion.
Major vient naturellement de magnus, prononce
en mouillant le gn à la maniéré des Italiens, & comme
nous le prononçons en magnifique Jeigneur, en-
Jeigner, &c. Ainfi on a dit ma-ignus} ma-ïgnior, major,
Maximus vient auflï de magnus; car le x eft une
lettre double qui vaut autant q u e « , & fou vent g.? :
ainfi au lieu de magnijfimus, on a écrit par la lettre
double maximus.
Minor vient du grec /juwpoç, parvus.
Minimus vient de minor ; on trouve même dans
Arnobe minififimus digitus, le plus petit doigt. Les
mots qui reviennent fouvent dans l’ufage font fujets
à être abrégés.
Au refte les adverbes ont aufli des degrés de lignification
, bien, mieux, fort bien ; bene , melius,
optitriè.
Les Anglois dans la formation de la plupart de
leurs comparatifs &c de leurs fuperlatifs, ont fait
comme les Latins ; ils ajoûtent er au pofitif pour
former le comparatif , & ils ajoutent ejl pour le fu-
perlatif. Rick, riche ; richer, plus riche ; the riche f i y
le plus riche.
Ils fe fervent auflià notre maniéré de morey qui
veut dire plus, & de mofiy qui fignifie très-fort, le
plus honefi, honnête ; more honefi, plus honnête ;
mofi honefi, très-honnête, le plus honnête.
Les Italiens ajoutent au pofitif piu, plus, ou me-
noy moins, félon que la chofe doit être ou élevée ou
• abaiffée. Ils fe fervent auflï de molto pour le fuper-
la tif, quoiqu’ils ayent des fuperlatifs à la maniéré
des Latins : bellijjimo, très-beau ; bellijfima, très-
' belle ; buoniffimo, très-bon ; buoniffima, très-bonne.
Chaque langue a fur ces points fes ufages, qui
• font expliqués dans les grammaires particulières,
i n
COMPARATIONE ; punctum ex comparatione ,
c’eft ainfi qu’Appollonius appelle l’un des foyers de
l’ellipfe ou de l’hyperbole. Voye^ Fo yer . ( O )
COMPARER, v . aft. qui defigne l’atte de l’entendement
, appellé co/72/wYii/Ô7z. ^qye^CoMPARAi-
- SON.
C omparer des équations, eftuneexpreflion dont
on fe-fert quelquefois dans l’Analyfe, pour réduire
plufieurs équations en une feule. Soit par exemple,
x = i a y y ô c x— aa —y y , comparant enfemble les
deux valeurs de x que fourniffent ces équations, on
a 2 a y y = a a—y y ; équation qui ne renferme plus
qu’une inconnue. Cet exemple très-fimple fuffitpour
en faire imaginer d’autres. Voye^ Ev anO uisseMent
& R éd u ct io n . ( O )
COMPARES, f. f. pl. ( Jurifpr. ) font des ufages
& redevances prétendues par les vicomtes de Narbonne
contre l’évêque du même lieu. Il en eft parlé
' dans la vie d’Aymeri III. liv. IV. des mém. de Languedoc
, page 586. ( A )
COMPAROIR ou COMPAROITRE, v . n. ( /«-
rifprud. ) fignifie fepréfenter devant le juge, greffier,
notaire, ou autre officier public, pour répondre à
une fommation ou aflignation. Voye{ ci-dev. C omp
a r a n t .
Il y a des défauts faute de comparoir. Voyez au
mot D é faut.
Anciennement lorfqu’un bourgeois de Bourges,
C O M
mandé par le prévôt ou par le voyer,' n’avoit pas
comparu, & étoit condamné à l’amende ; fi ce bourgeois
vouloir être déchargé de l’amende, prétendant
qu’il n’avoit pas reçu l ’avertiffement, il falloit
qu’il fe battît en duel, fuivant la coûtume barbare
de ce tems-là, oit le duel pafloit pour un moyen de
s’affûrer de la vérité des faits. Louis VI. abolit cette
mauvaife coûtume, & ordonna que quand un bourgeois
de Bourges affirmeroit qu’il n’avoit pas reçu
l ’a vertiflement, il feroit quitte de l’amende, & qu’il
n’y auroit plus de duel comme auparavant. Cette
ordonnance de Louis VI. fut confirmée par Louis '
VII. en 1 145 , & par Louis VIII. en 1224. Voye{ le
recueil des ordonn. de la troifierfte race. ( A )
COMPARTIMENT , f. m. en Architecture, Peinture
, Sculpture, &' autres arts , eft la difpofition de
figures régulières, formées de lignes droites ou courbes
8c parallèles, 8c divifées avec fymmétrie pour
les lambris, les plafonds de plâtre, de ftuc, de bois,
&c. 8c pour les payemens de pierre dure, de marbre
, de mofaïque, &c.
Compartimens polygones, font ceux qui font formés
de figures régulières 8c répétées, & qui peuvent
être compris dans un cercle , comme; les compartimens
du Val-de-Grace & de l’Aflomption à Paris.
Compartimens de rues, eft la diftribution réguliere
des rues, îles , 8c quartiers d’une ville.
Compartimens de tuiles, eft l’arrangement fymmé-
trifé de tuiles blanches, rouges, 8c verniffées, pour
la décoration des couvertures & des combles.
Compartimens de vitres, font les différentes figures
que forment les panneaux des vitres blanches ou
peintes,
Compartimehs de parterre, ce font les différentes
pièces qui donnent la forme à un parterre dans un
jardin.'-(«P) •*
COMPARTITEUR, f. m. ( Jurifpr. ) qitafi parator
, eft celui des juges qui a ouvert le premier un
avis contraire à celui du rapporteur, & qui a commencé
le partage d’opinions ; ce qui n’arrive que
par partage d’opinions dans les procès par écrit ou
inftances appointées en matière civile ; car en matière
criminelle il n’y a jamais de partage, c’eft-à-
dire que quand les avis font partagés , le jugement
paffe à l’avis le plus doux ; 8c dans les affaires civiles
d’audience, lorfque les avis font partagés, on ordonne
un délibéré ou appointement.
Au parlement, lorfqu’une affaire fe trouve partagée^,
elle eft portée dans une autre chambre pour y
être jugée ; le rapporteur & le comparateur vont dans
cette chambre expofer chacun les motifs 8c les rai-
fons de leur avis. Voye^ Pa r t a g e . ( ^ )
CO MP A R U IT , f. m. ( Jurifpr. ) eft un atte que
le juge délivre à l’une des parties litigantes, pour
certifier fa comparution, lorfque l’autre partie eft
défaillante ou décédée ; pour faire appeller de nouveau
en caufe le défaillant ou fes héritiers ; pour reprendre
l’inftance, & procéder fuivant les derniers
erremens. Il en eft parlé darts la coûtume de Lille ,
art. cxxxvij. de l’ancienne ; & en la nouvelle, titre
de l'action, art. x x . 8c en l’ancienne coûtume de Boulenois,
à la fin; & celle de D reu x, art, Ivij. où ce
terme femble fignifier le défaut que le demandeur
fait à l’aflignation qu’il a fait donner au défendeur.
Dans l’ufage préfent, la cédule de préfentation que
le procureur de chaque partie doit prendre au greffe
, tient lieu d’atte de comparuit Voyez le glojj', de
M. de Lauriere à ce mot comparuit. ( A )
COMPARUTION, f. f. ( Jurifpr. ) eft l’atte que
fait celui qui fe préfente en juftice, ou devant un
notaire, ou autre officier public. Il y a des attes dç
juftice où la comparution doit être faite en perfonne :
par exemple, en matière civile, lorfqu’une partie
doit fubir ioterrogatoire ou prêter ferment ; en ma-
C O M
tiere criminelle, lorfque l’accufé eft décrété d’afligné
pour être oiii, ou d’ajournement perfonnel.
Il y a d’autres attes de juftice où la comparution eft
néanmoins différente de la préfentation proprement
dite, par laquelle on entend l’atte par lequel un procureur
fe conftitue pour fa partie.
La comparution peut être faite par la partie en perfonne,
ou par le miniftere de fon avocat 8c de fon
procureur, comme dans les matières civiles ordinaires.
La comparution devant un notaire, ou autre officier
public, pour des attes extrajudiciaires, fe fait
aufli par la partie en perfonne, ou par le miniftere
de fon procureur ad lites; mais elle peut aufli être
faite par le miniftere d’un procureur ad negotia, qu’on
appelle communément un fondé de procuration.
Le demandeur ou autre perfonne qui provoque le
miniftere du juge ou autre officier public, fait fa
comparution de fon propre mouvement ; au lieu que
le défendeur fait lafienneen conféquence d’une fommation
ou d’une aflignation, & quelquefois en conféquence
d’une ordonnance ou autre jugement, qui
ordonne un procès - verbal ou autre atte extrajudiciaire,
où les parties doivent comparoître en perfonne.
Dans les procès-verbaux & autres attes faits par
les juges, notaires, ou autres officiers publics, dans
lefquels les parties doivent comparoître en perfonne
ou par procureur, on donne atte refpettivement aux
parties ou à leurs procureurs, de leurs comparutions ,
dires, & requifitions, défenfes au contraire; & s ’il
y a des défaillans, on donne défaut contr’eux. Voye{
ci-devant C omparant & C om p a r o ir , 6* Présen
ta t io n . (A')
COMPAS, f. m. inftrument de Mathématique, dont
on fe fert pour décrire des cercles & mefurer des lignes,
&c. Voye{ C e r c l e , Lig n e , & c.
Le compas ordinaire eft compofé de deux jambes
ou branches de laiton, de fer, ou de quelqu’autre
métal, pointues par en-bas, & jointes en-haut par
un rivet, fur lequel elles fe meuvent comme fur un
centre.
On attribue l’invention du compas à Talaiis, neveu
de Dédale par fa foeur. Selon les Poètes, Dédale
conçut une telle envie contre Talaiis, qu’il le tua.
L ’auteur du labyrinthe de Crete ne devoit pourtant
point être jaloux d’un compas.
Nous avons aujourd’hui des compas de différentes
efpeces & conftruttions, comme des
C ompas à tr o is bran ch es . Leur conftruttion
eft femblable à celle des compas ordinaires, excepté
qu’ils ont une branche de plus. Ils fervent à prendre
trois points à-la-fois, & ainfi à former des triangles,
à placer trois pofitions à-Ia-fois d’une carte que l’on
.veut copier, &c.
Le C ompas a ve r g e confifte en une longue branche
ou verge, portant deux curfeurs ou boîtes de laiton
, l’une fixée à un bout, l’autre pouvant glifler le
long de la verge avec une v is , pour l ’affujettir fuivant
le befoin. On peut viffer à fes curfeurs des pointes
de toiïte efpece, foit d’acier, ou de quelqu’autre
chofe femblable. On s’en fert pour décrire de grands
cercles, ou prendre de grandes longueurs.
Le C ompas d’Ar t isan eft fort & folide, fon
ufage ordinaire étant de fervir à couper le carton, le
cuivre, &c. Il eft traverfé par un quart de cercle, afin
qu’on puiffe l’arrêter fixement à une ouverture, en
ferrant une vis qui appuie fur le quart de cercle.
Le C ompas a l’A llemande a fes branches un
peu courbées, enforte que les pointes ne fe joignent
que par les bouts.
C ompas a pointes changeantes : on appelle
ainfi des compas qui ont différentes pointes, que l’on
peut ôter & remettre félon le befoin. Ils font fort utic
o m m
les dans les defleins d’Architetture, où il s’agit aflèz
fouvent de faire des traits bien formés, bien diïlintts,
& très-déliés.
qu il s ouvre de lui-même par fon reffort ; la vis qui
le traverfe en arc, fert à l’ouvrir & à le fermer à vo lonté
par le moyen d’un écrou. Cette forte de com~
pas eft fort commode pour prendre de petites mefu-
res, & faire de petites divifions : mais ils doivent
etre un pey courts, & trempés de maniéré qu’ils faf-
lent bien reffort, & qu’ils ne caffent pas;
C ompas a poin te s tournantes ; c’eft une
nouvelle invention de compas pour éviter l’embarraâ
de changer de pointes; fon corps eft femblable au
compas ordinaire ; vers le bas & en-dehors, on ajoûte
aux pointes ordinaires deux autres pointes, dont l’une
porte un crayon, & l’autre fert de plume ; elles font
ajuftees toutes deux de maniéré qu’on puiffe les tourner
au befoin.
Quant à la trempe de ces compas, les pointes des
petits fe trempent par le moyen d’un chalumeau &
dune lampe; on les fait chauffer jufqu’à ce qu’ils
foient rouges; on les laiffe refroidir, & elles font
trempées, c ’eft-à-dire durcies. Les pointes plus greffes
fe trempent au feu de charbon, & avec le chalumeau;
on les chauffe jufqu’à ce qu’elles foient d’uri
rouge cerife, & on les plonge enfuite dains l’eau. Voy '.
T rempe. Harris & Chambers. ( E j
C ompas de pr o po r t io n : cet inftrument dé
Mathématiques, que les Anglois appellentfeckur±
eft d’un grand ufage pour trouver des proportions entre
des quantités de même efpece, comme entre lignes
& lignes, furfaces Sc furfaces, &c. c’eft pourquoi
l’on appelle en France, compas de proportion.
| Le grand avantage du compas de proportion fur les
echelles communes, confifte en ce qu’il eft fait de
telle forte, qu’il convient à tous les rayons & à toutes
les echelles. Par les lignes des cordes, des finus,
&c. qui font fur le compas de proportion, on a les lignes
des cordes, des finus, &c. d’un rayon quelconque,
comprifes entre la longueur & la largeur du
fecteur ou compas de proportion, quand il eft ouvert.
Voyei Echelle & Lign e.
Le compas de proportion eft fondé fur la quatrième
proportion du fixieme livre d’Euclide, où il eft démontré
que les triangles femblables ont leurs côtés
homologues proportionnels. Voici comment on peut
en prendre une idée. Suppofons que les lignes A B
-A c (J%* x<$' Géom.) foient les jambes du compas *
& que A D , A E repréfentent deux fettions égales
qui paffent par le centre, ou qui partent du centre ;
fi alors on joint les points C B , 8c D E , les lignes
CB y D E feront parallèles : c’eft pourquoi les triangles
A D E , A C B font femblables, & par confé-
quentles côtés A D ,D E ,A B ,& c B C font proportionnels
; c’eft-à-dire que A D . D E : : A B . B C i
donc fi A D eft la moitié, le tiers, ou le quart de
A B y D E fera aufli la moitié, le tiers, ou le quart
de B C. Il en eft de même de tout le refte. C’eft pourquoi
fi A D eft corde, finus, ou tangente d’un nombre
quelconque de degrés pour le rayon A B , D E
fera la même chofe pour le rayon BC. Voy. C orde,
Sinus , &c.
Defcription du compas de proportion. Cet inftrument
confifte en deux réglés ou jambes égales, de cuivre
ou d’autre matière , rivées l’une à l’autre, enforte
néanmoins qu’elles peuvent tourner librement fur
leur charnière. Voye^ fa figure, Plan, géom.fig. i5;
Sur les faces de cet inftrument font tracées plufieurs
lignes, dont les principales font la ligne des parties
égales, la ligne des cordes, la ligne.des finus, la ligne
des tangentes, la ligne des fécantes, & la ligne
des polygones.