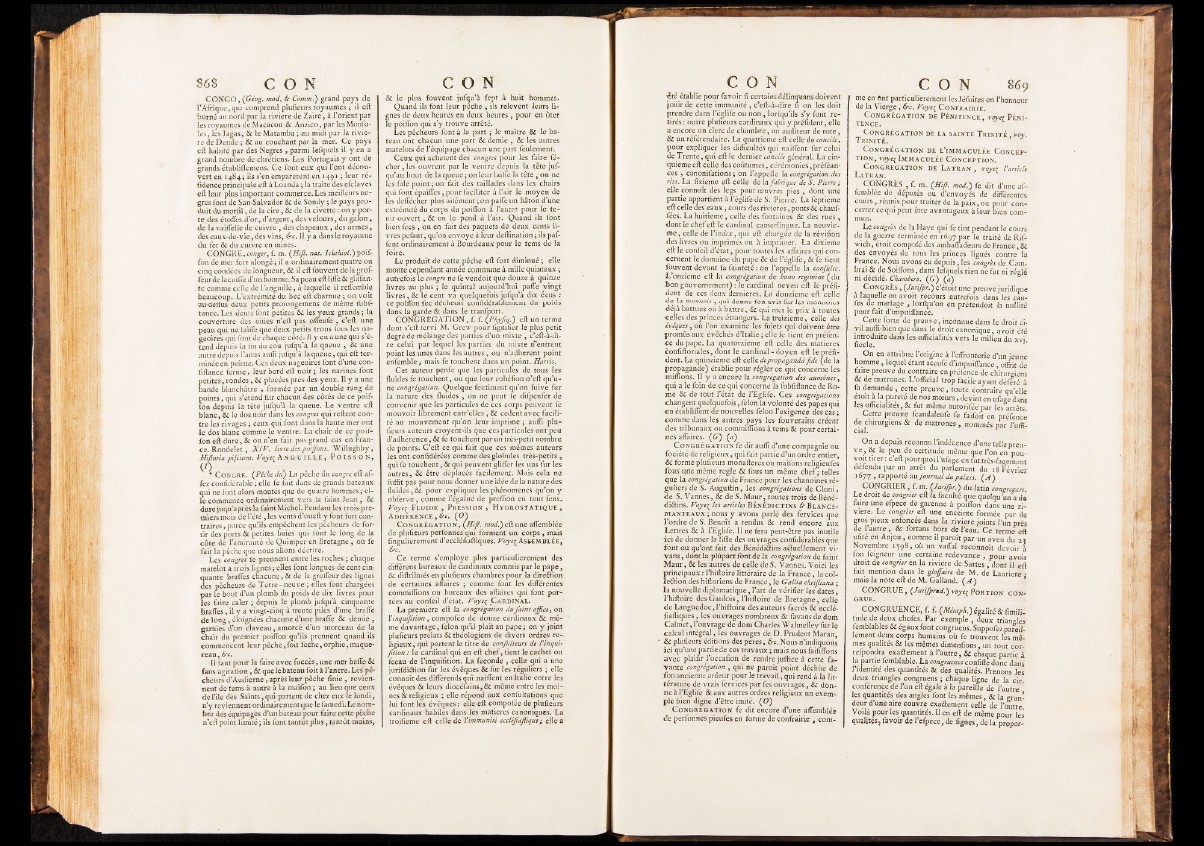
CO NGO, ( Géog. mod. & Comm.) grand pays de
l ’Afrique, qui comprend plufieurs royaumes ; il eft
io rn é au nord par la riviere-de Z aïre, à l’orient par
les royaumes de Macacou .& Anzico * par les Monfo-
les, les Jagas, & le Matamba ; au midi par la rivière
de Den.de ; & au couchant par la mer. Ce pays
eft habité par des Negres, parmi lefquels il y en a
grand nombre de chrétiens. Les Portugais y ont de
grands établifl'emens. Ce font eux qui l’ont découvert
en 1484; ils s’en emparerent en 1491 ; leur ré-
fidence principale eft à Loanda ; la traite des efclaves
eft leur plus important commerce. Les meilleurs negres
font de San-Saivador & de Sondy ; le pays produit
du morfil, de la c ire, 6c de la civette : on y porte
des étoffes d’or, d’argent, des velours, du galon,
de la vaiffelle de cuivre, des chapeaux, des armes,
des eaux-de-vie, des vins, &c. Il y a dans le royaume
du fer & du cuivre en mines.
CONGRE, conger, f. m. {HiJÎ. nat. Ichthiol.') poif-
fon de mer fort alongé ; il a ordinairement quatre ou
cinq coudées de longueur, & il eft fouvent de la grof-
feur de lacuiffe d’un homme. Sa peau eft liffe & gliffan-
. te comme celle de l ’anguille, à laquelle il reltemble
beaucoup. L’extrémité du bec eft charnue ; on voit
au-deffus deux petits prolongemens de même fubf-
tance. Les dents font petites & les yeux grands ; la
couverture des oiües n’ eft pas offeufe , c’eft une
peau qui ne laiffe que deux petits trous fous les nageoires
qui font de chaque côté. Il y en a une qui s e-
tend depuis la fin du cou jufqu’à la queue , & une
autre depuis l’anus aufli jufqu’à la queue, qui eft terminée
en pointe. Ces deux nageoires font d’une con-
fiftance ferme, leur bord eft noir ; les narines font
petites, rondes, 6c placées près des yeux. Il y a une
bande blanchâtre , formée par un double rang de
points, qui s’étend fur chacun des côtés de ce poif-.
fon depuis la tête jufqu’à la queue. Le ventre eft
blanc, & le dos noir dans les congres qui reftent contre
les rivages ; ceux qui font dans la haute mer ont
le dos blanc comme le ventre. La chair de ce poiffon
eft dure, & on n’en fait pas grand cas en France.
Rondelet, X IV . livre des poiffions. Willughby,
Hiftoria piÇcium. V>ye\ A N G U IL L E , PO IS SO N ,
( / )
* CONGRE. (Pêche du) La pêche du congre eft af-
fez conftdérable ; elle fe fait dans de grands bateaux
qui ne font alors montés que de quatre hommes ; elle
commence ordinairement vers la faint Jean , &
dure juqu’après la faint Michel. Pendant les trois premiers
mois de l’é té , les vents d’oueft y font fort contraires
, parce qu’ils empêchent les pêcheurs de for-
tir des ports & petites baies qui font le long de la
côte de l’amirauté de Quimper en Bretagne , où fe
fait la pêche que nous allons décrire.
Les congres fe prennent entre les roches ; chaque
matelot a trois lignes ; elles font longues de cent cinquante
braffes chacune, & de la groffeur des lignes
des pêcheurs de Terre-neu ve ; elles font chargées
par le bout d’un plomb du poids de dix livres pour
les faire caler ; depuis le plomb jufqu’à cinquante
braffes, il y a vingt-cinq à trente piles d’une braffe
de long, éloignées chacune d’une braffe &c demie ,
garnies d’un claveau, amorcé d’un morceau de la
chair du premier poiffon qu’ils prennent quand ils
commencent leur pêche,foit feche,orphie,maquereau
, &c.
Il- faut pour la faire avec fuccès, une mer baffe &
fans agitation, & que le bateau foit à l’ancre. Les pêcheurs
d’Audiernè, après leur pêche finie, reviennent
de tems à autre à la maifon ; au lieu que ceux
de l’île dès Saints, qui partent de chez eux le lundi,
n’y reviennent ordinairement que le famedi. Le nombre
des équipages d’un bateau pour faire cette pêche
n’eft point limité ; ils font tantôt plus, tantôt moins,
& le plus fouvent jufqu’à fept à huit hommes»
Quand ils font leur peche , ils relèvent leurs lignes
de deux heures en deux heures , pour en ôter
le poiffon qui s’y trouve arrêté.
Les pêcheurs font à la part ; le maître & le bateau
ont chacun une part & demie , & lés autres
matelots de l’équipage chacun une part feulement.
Ceux qui achètent des congres pour les faire fé-
cher, les ouvrent par le ventre depuis la tête juf-
qu’au bout de la queue ; on leur laifl'e la tê te , on ne
les fale point ; on fait des taillades dans les chairs
qui font épaiffes, pour faciliter à l’ air le moyen de
les deffécher plus àifément ; on paffe un bâton d’une
extrémité du corps du poiffon à l’autre pour le tenir
ou v e r t, & on le pend à l’air. Quand ils font
bien fecs , on en fait des paquets de deux cents livres
pefant, qu’on envoyé à leur deftination ; ils paf-
fent ordinairement à Bourdeaux pour le tems de la
foire.
Le produit de cette pêche eft fort diminué ; elle
monte cependant année commune à mille quintaux ;
autrefois le congre ne fe vendoit que douze à quinze
livres au plus ; le quintal aujourd’hui paffe vingt
livres, & le cent va quelquefois jufqu’à dix écus :
ce poiffon fec décheoit confidérablement du poids
dans la garde & dans le tranfport.
CONGRÉGATION, f. f. (Phyfiqé) eft un terme
dont s’eft fervi M. Grew pour lignifier le plus petit
degré de mélange des parries d’un mixte , c’eft-à-di-
re .celui par lequel les parties du mixte ri*entrent
point les unes dans les autres, ou n’adherent point
enfemble > mais fe touchent dans un point. Harris.
Cet auteur penfe que les particules de tous les
fluides fe touchent, ou que leur cohéfion n’eft qu’une
congrégation. Quelque fentiment qu’on fuive fur
la nature des fluides , on ne peut fe difpenfer de
convenir que les particules de ces corps peuvent fe
mouvoir librement entr’elles, & cedent avec facilité
au mouvement qu’on leur imprime ; aufli plufieurs
auteurs croyent-ils que ces particules ont peu
d’adhérence, & fe touchent par un très-petit nombre
de points. C’eft ce qui fait que ces mêmes auteurs
les ont confidérées comme des globules très-petits ,
qui fe touchent, & qui peuvent glifl'er les uns fur les
autres, & être déplacés facilement. Mais cela ne
fuffit pas pour nous donner une idée de la nature des
fluides, & pour expliquer les phénomènes qu’on y
obferve, comme l’égalité de preflion en tout fens.
Voye{ Fluide , Pression , Hydrostatique ,
A dhérence , (O)
C ongrégation, ( Hi/l. mod.') eft une affemblée
de plufieurs perfonnes qui forment un corps , mais
fingulierement d’eccléfiaftiques. Voye% Assemblée,
&c.C
e terme s’employe plus particulièrement des
différens bureaux de cardinaux commis par le pape,
& diftribués en plufieurs chambres pour la dire&ion
de certaines affaires ; comme font les différentes
commiflions ou bureaux des affaires qui font portées
au confeil d’état. Voye^ C ardinal.
La première eft la congrégation du faint office, ou
Yinquifition, compofée de douze cardinaux & même
davantage, félon qu’il plaît au pape ; on y joint
plufieurs prélats & théologiens de divers ordres re-.
ligieux, qui portent le titre de confulteurs de l'inqui-
Jition : le cardinal qui en eft chef, tient le cachet ou
fceau de l’inquifition. La fécondé , celle qui a une
jurifdittion fur les évêques & fur les réguliers ; elle
connoît des différends qui naiffent en Italie entre les-
évêques & leurs diocéfains, & même entre les moines
& religieux ; elle répond aux confultations que
lui font les évêques : elle eft compofée de plufieurs
cardinaux habiles dans les matières canoniques. La
troifieme eft celle de Y immunité eccléjîaflique ; elle a
ieté établie pour favoir fi certains délinquans doivent
joiiir de cette immunité , c’eft-à-dire fi on les doit
prendre dans l’églife ou n on, Iorfqu’ils s’y font retirés:
outre plufieurs cardinaux qui y préüdent, elle
a encore un clerc de chambre, un auditeur de rote,
& un référendaire. La quatrième eft celle du concile,
pour expliquer les difficultés qui naiffent fur celui
de T rente, qui eft le dernier concile général. La cinquième
eft celle des coûtumes, cérémonies, préféan-
ces , canonifations ; on l’appelle la congrégation des
rits. La fixieme eft celle de la fabrique de S. Pierre ;
elle connoît des legs pour oeuvres pies , dont une
partie appartient à l ’églife de S. Pierre. La feptieme
eft celle des eaux, cours des rivières, ponts & chauffées.
La huitième, celle des fontaines & des rues ,
dont le chef eft le cardinal camerlingue. La neuvième,
celle de Y index, qui eft chargée de la révifion
des livres ou imprimés ou à imprimer. La dixième
eft le confeil d’état, pour toutes les affaires qui concernent
le domaine du pape & dé l’églife, & fe tient
fouvent devant fa fainteté : on l’appelle la confulté.
L onzième eft la congrégation de bono regimine ( du
bon gouvernement) : le cardinal neveu eft le préfi-
dent de ces deux dernieres. La douzième eft celle
de la monnaie , qui donne fon avis fur les monnoies
déjà battues où à battre, & qui met le prix à toutes 1
celles des princes étrangers. La treizième, celle des
évêques, où l’on examine les fujets qui doivent être
promus aux évêchés d’Italie ; elle fe tient en préfen-
ce du pape. La quatorzième eft celle des matières
confiftoriales, dont le cardinal - doyen eft le préfi-
dent. La quinzième eft celle depropagandâ fide (de la
propagande) établie pour régler ce qui concerne les
mimons. Il y a encore la congrégation des aumônes,
qui a le foin de ce qui concerne la fubfiftance de Rome
& de toiit l’état de l’Eglife. Ces. congrégations
changent quelquefois, félon la volonté des papes qui
en établiffent de nouvelles félon l’exigence des cas ; :
comme dans les autres pays les fouverains créent
des tribunaux ou commiflions à tems & pour certaines
affaires. (G) (a)
C ongrégation fe dit aufli d’une compagnie ou
fociété de religieux, qui fait partie d’un ordre entier,
& forme plufieurs monafteres ou maifons religieuses
fous une même réglé & fous un même chef ; telles
que la congrégation de France pour les chanoines réguliers
de S. Auguftin, les congrégations de Cluni,
de S. Vannes, & de S. Maur, toutes trois de Bénédictins.
Voye^ les articles Bénédictins & Blancs-
manteaux; nous y avons parlé des fervices que
l’ordre de S. Benoît a rendus & rend encore aux
Lettres & à l’Eglife. Il ne fera peut-être pas inutile
ic i de donner la lifte des ouvrages confidérables que
font ou qu’ont fait des Bénédiélins actuellement vi-
vans, dont la plûpart font de la congrégation de faint
Maur, & les autres de celle de S. Vaniies. Voici les
principaux : l’hiftoire littéraire de la France, la collection
des hiftoriens de France, le Gallia chriffiana ;
la nouvelle diplomatique, l’art de vérifier les dates,
l’hiftoire des G aulois, l’hiftoire de Bretagne, célle
de Languedoc, l’hiftoire des auteurs facrés & ecclé-
fiaftiques, les ouvrages nombreux & favans de dom
Calmet, l’ouvrage de dom Charles ‘Walmefley fur le
calcul intégral, les ouvrages de D. Prudent Maran,
' & plufieurs éditions des peres, &c. Nous n’indiquons
ici qu’une partie de ces travaux ; mais nous faififfons
. avec plaifir l’occafion de rendre juftice à cette fa-
vante congrégation, qui ne paroît point déchue de
fon ancienne ardeur pour le travail, qui rend à la littérature
de vrais fervices par fes ouvrages, & donne
à l’Eglife & aux autres ordres religieux un exemple
bien digne d’être imité. (O)
C ongrégation fe dit encore d’une affemblée
de perfonnes pieufes en forme de confrajric , eomme
en Ont particulièrement les Jéfuites en l’honneur
de la Vierge, &c. Voye{ C onfrairie.
C o n g r ég a t io n de Pén itence, voyez Pénitence.
C o n g r ég a t io n de l a sainte T rinité voy.
T rin ité.
C o n g r ég a t io n de l’im m aculé e C oncept
io n , voye^ Im m a cu l é e C o n c e pt io n .
C ong rég a tion de L a tr an , voye^ Ûarticle
La tr an .
/ CONGRÈS , f. m. (Hifi. mod.) fe dit d’une af-'
femblee tle députés ou d’envoyés de différentes
cours, réunis pour traiter de la paix,ou pour concerter
ce qui peut être avantageux à leur bien commun.
Le congrès de la Haye qui fe tint pendant le cours
de la guerre terminée en 1697 par le traité de Rif-
wich, étoit compofé des ambaffadeurs de France, &:
des envoyés de tous les princes ligués contre la
France. Nous avons eu depuis, les congrès de Cambrai
& de Soiffons, dans lefquels rien ne fut ni réglé
ni décidé. Chambers. (G) (a)
C ongrès , ( Jurifpr.) c ’étoit une preuve juridique
à laquelle on avoit recours autrefois dans les cau-
fes de mariage , lorfqu’on en prétendoit la nullité
pour fait d’impuiffance.
Cette forte de preuve, inconnue dans le droit civil
aufli-bien que dans le droit canonique, avoit été
introduite dans les officialités vers le milieu du xvi.
fiecle. '*
On en attribue l’origine à l’effronterie d’un jeune
homme, lequel étant accufé d’impuiffance, offrit de
faire preuve du contraire en préfence de chirurgiens
& de matrones. L’official trop facile ayant déféré à
fa demande , cette preuve, toute contraire qu’elle
etoit à la pureté de nos moeurs, devint en ufage dans
les officialités, & fut même autorifée par les arrêts.
Cette preuve fcandaleufe fe faifoit en préfence
de chirurgiens & de matrones , nommés par l ’official.
■
On a depuis, reconnu l’indécence d’une telle preuv
e , & le peu de certitude même que l’on en pou-
voittirer : c’eft pourquoil’ufaee en futtrès-fage^ent
défendu par un arrêt du parlement du 18 Février
1Ê77 , rapporté au journal du palais. ( A j
\ CONGRIER. f. m. (Jurifpr j du latin congrrgare.
Le droit de congrier eft la faculté que quelqu'un a de
faire,une efpccé de garenne à poiffon dans une rivière.
L e congrier eft une enceinte, formée par de
gros pieux enfoncés dans la riviere joints l ’un près
de l’autre , & fortans hors de l’eau. Ce terme eft
lifité en Anjou, comme il paroît par un aven du i l
Novembre 1598 , oh un vaffal reconnoît devoir à
fon feigneur une certaine redevance , pour avoir
droit de congrier en la riviere de Sartes, dont il. eft
fait mention dans le glojfaire de M. de Lauriers s
mais la note eft de M. Galland. (A')
CONGRUE, (Jurlfpr.Jdj voyir P0RU0.V CONGRUE.
Co n g r u e n c e , l f. (Mirapi.') égalité & îîmiiitude
de deux chofes. Par exemple , deux triangles
femblabies & égaux font congruens. Suppofez pareillement
deux corps humains oh fe trouvent les mêmes
qualités &c les mêmes dimenlîons, un tout cor-
refpondra exaSement à l’autre, & chaque partie à
la partie femblable. Là congruence confifte donc dans
l’identité des quantités & des qualités. Prenons les
deux triangles congruens ; chaque ligne de la circonférence
de l’un eft égale à la pareille de l’autre
les quantités des angles font les mêmes, & la grandeur
d’une aire couvre exaâemem celle de l’autre
Voilà pour les quantités. Il en eft de même pour les"
qualités, favoir de l’efpece, de figues, de la prbpor