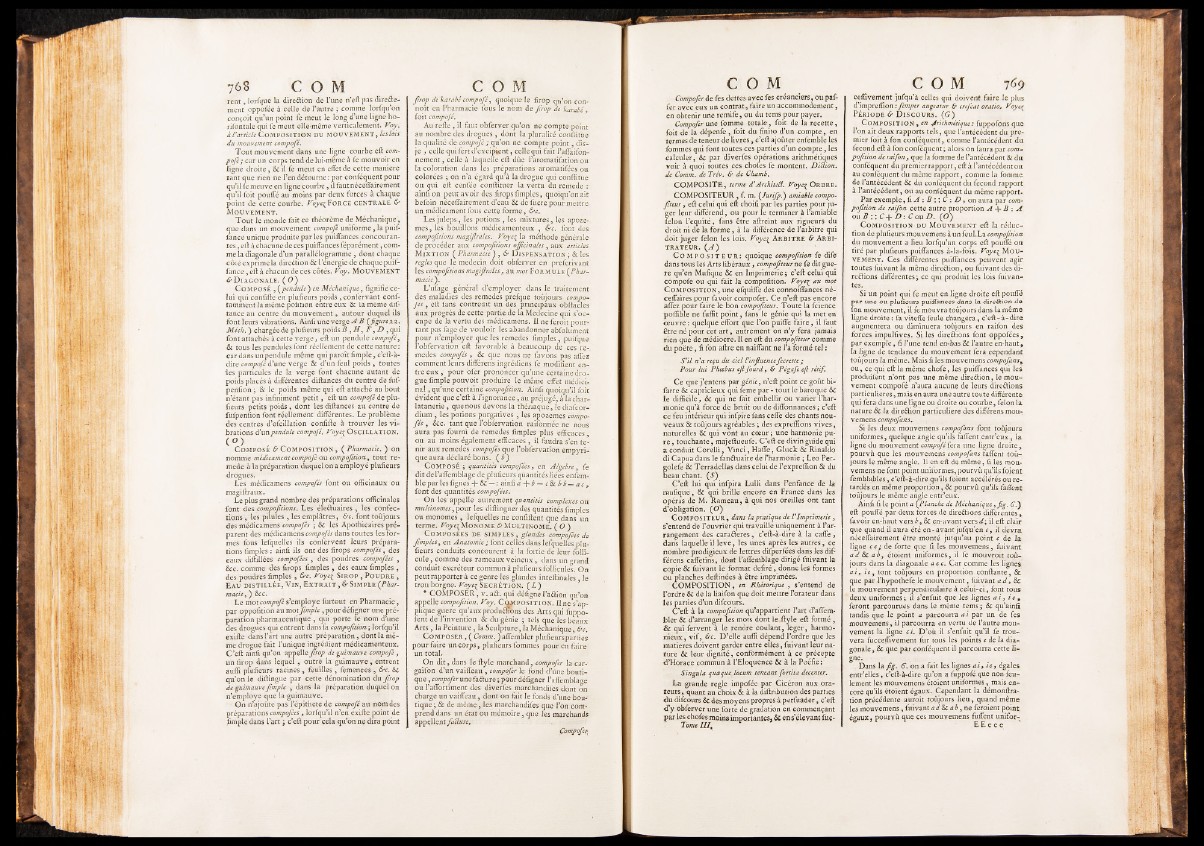
ren t, Iorfque la direction de l’une n’eft pas direéte-
ment oppofée à celle de l’autre ; comme lorfqu’on
conçoit qu’un point fe meut le long d’une ligne ho-
rifontale qui fe meut elle-même verticalement. Voy.
à L'article COMPOSITION DU MOUVEMENT, les lois
du mouvement compofé.
Tout mouvement dans une ligne courbe eft compofé;
car un corps tend de lui-même à fe mouvoir en
ligne droite, & il fe meut en effet de cette maniéré
tant que rien ne l’en détourne : par conféquent pour
qu’il le meuve en ligne courbe, il fautnéceffairement
qu’il foit pouffé au moins par deux forces à chaque
point de cette courbe. Voye{ Fo rce centrale 6*
Mo u v em en t .
Tout le monde fait ce théorème de Méchanique,
que dans un mouvement compofé uniforme, la puif-
fance unique produite par les puiffances concourantes
, eft à chacune de ces puiffances féparément, comme
la diagonale d’un parallélogramme , dont chaque
côté exprime la direétion & l’énergie de chaque puif-
fance, eft à chacun de ces côtés. Voy. Mouvement
& D iag on al e. (O )
COMPOSÉ , ( pendule ) en Méchanique, lignifie celui
qui confifte en plufieurs poids , confervant conf-
tamment la même pofition entre eux & la même dif-
tance au centre du mouvement, autour duquel ils
font leurs vibrations. Ainfi une verge A B (figure z z .
Méch. ) chargée de plufieurs poids B , H , F ,D , qui
font attachés-à cette verge, eft un pendule compofé,
& tous les pendules font réellement de cette nature:
car dans un pendule même qui paroît fimple, c’eft-à-
dire compofé d’une verge & d’un feul poids , toutes
les particules de la verge font chacune autant de
poids placés à différentes diftances du centre de fuf-
penfion ; & le poids même qui eft attaché au bout
n’étant pas infiniment p e tit, eft un compofé de plufieurs
petits poids , dont les diftances au centre de
fufpenfion font réellement différentes. Le problème
des centres d’ofcillation confifte à trouver les vibrations
d’un pendule compofé. Voyer^ O scil la tio n .
( ° )
C omposé & C om po s it io n , ( Pharmacie. ) on
nomme médicament compofé ou compofition, tout re-
mede à la préparation duquel on a employé plufieurs
drogues.
Les médicamens compofés font ou officinaux ou
magiftraux.
Le plus grand nombre des préparations officinales
font des çompofitions. Les éleétuaires, les confections
, les pilules , les emplâtres, &c. font tôûjours
des médicamens compofés ; & les Apothicaires préparent
des médicamens compofés dans toutes les formes
fous lefquelles ils confervent leurs préparations
fimples : ainfi ils ont des firops compofés, des
eaux diftillées compofées , des poudres compofées ,
& c . comme des firops fimples , des eaux fimples ,
des poudres fimples , &c. Voyei Siro p , Poudre ,
Eau d istillée, V in, Ex t r a it , & Simple (Pharmacie,')
&c.
Le mot compofé s’employe furtout en Pharmacie,
par oppofition au mot fimple ,pourdéfigner une préparation
pharmaceutique , qui porte le nom d’une
des drogues qui entrent dans fa compojîtion ; lorfqu’il
exifte dans l’art une autre préparation, dont la même
drogue fait l’unique ingrédient médicamenteux.
C ’eft ainfi qu’on appelle firop de guimauve compofé,
un firop dans lequel , outre la guimauve , entrent
auffi plufieurs racines , feuilles , femences , &c. &
qu’on le diftingue par cette dénomination du firop
de guimauve fimple , dans la préparation duquel on
n’employe que la guimauve.
On n’ajoûte pas l’épithete de compofé au nom des
préparations compofées, lorfqu’il n’en exifte point de
fimple dans l’art •, c’eft pour cela qu’on ne dira point
firop de karabé compofé, quoique le firop qu’on con-
noît en Pharmacie fous le nom de firop de karabé,
foit compofé.
Au refte ., il faut obferver qu’on ne compte point
au nombre des drogues , dont la pluralité conftitue
la qualité de compofé ; qu’on ne compte point, dis-
je , celle qui fert d’excipient, celle qui fait l’affaifon-
nement, celle à laquelle eft due l’aromatifation ou
la coloration dans les préparations aromatifées ou
colorées ; on n’a égard qu’à la drogue qui conftitue
ou qui eft cenfée cônftituer la vertu du remede :
ainfi on peut avoir des firops fimples, quoiqu’on ait
befoin néçeffairement d’eau & de fucre pour mettre
un médicament fous cette forme, &c.
Les juleps, les potions , les mixtures, les apoze-
mes, les bouillons médicamenteux , &c. font des
çompofitions magifiraies. Voye^ la méthode générale
de procéder aux çompofitions officinales, aux articles
Mix t io n ( Pharmacie ) , & D ispensation ; & les
réglés que le médecin doit obferver en prefcrivant
les çompofitions magifirales, aù mot Formule ( PharmacieJ.
L’ufage général d’employer dans le traitement
des maladies des remedes prefque toujours compofés
, eft fans contredit un des principaux obftacles
aux progrès de cette partie.de la Medecine qui s’occupe
de la vertu des médicamens. Il ne feroit pourtant
pas fage de vouloir les abandonner abfolument
pour n’employer que les remedes fimples, puifque
l’obfervation eft favorable à beaucoup de ces re-,
medes compofés , & que nous ne favons pas affez
comment leurs différens ingrédiens fe modifient entre
eux , pour ofer prononcer qu’une certaine drogue
fimple pouvoit produire le même effet médicinal
, qu’une certaine compojîtion. Ainfi quoiqu’il foit
évident que c’eft à l’ignorance, au préjugé, à la char-
latanerie, que nous devons la thériaque, le diafcor-
dium , les potions purgatives , les apozemes compofés
, Sec. tant que l’obfervation raifonnée ne nous
aura pas fourni de remedes fimples plus efficaces,
ou au moins également efficaces , il faudra s’en tenir
aux remedes compofés que l’obfervation empyri-
queaura déclaré bons, ( b )
COMPOSÉ ; quantités compofées, en Algèbre, fe
dit del’affemblage de plufieurs quantités liées enfem-
ble par les lignes + & — : ainfi a -|-b — c&. b b— ac ,
font des quantités compofées.
On les appelle autrement quantités complexes ou
muLtinomes ,pour les diftinguer des quantités fimples
ou monomes , lefquelles ne confiftent que dans un
terme. Voye^ Monome & Mu ltin om e. ( O )
C omposées de s im p l e s , glandes compofées do
fimples, en Anatomie ; font celles dans lefquelles plufieurs
conduits concourent à la fortie de leur follicule
, comme des rameaux veineux, dans un arand
conduit excréteur commun à plufieurs follicules. On
peut rapporter à ce genre les glandes inteftinales, le
trou borgne. Voye.i Se cr É t io n . ( L )
* COMPOSER, v. aét. qui défigne l’aétion qu’on
appelle compojîtion. Voy. C om po s it io n . Ilne s’applique
guere qu’aux productions des Arts qui fuppo-
lent de l’invention & du génie ; tels que les beaux
Arts , la Peinture, la Sculpture, la Méchanique, &c.
C omposer , ( Comm. ) affembler plufieurs parties
pour faire un corps, plufieurs fommes pour en faire
un total.
On dit, dans le ftyle marchand, compofer la car-
gaifon d’un vaiffeau , compofer le fond d’tine boutique
, compofer une faéture ; pour défigner l ’affemblage
ou l’affortiment des diverfes marchandifes dont on
charge un vaiffeau, dont on fait le fonds d’une boutique
; & de même, les marchandifes que l’on comprend
dans un état ou mémoire, que les marchands
appellent facture,
Compofer^
Compofer de fes dettes avec fes créanciers, ou paf-
fer avec eux un contrat, faire un accommodement,
en obtenir une remife, ou du tems pour payer.
Compofer une fomme totale, foit de la recette,
foit de la dépenfe, foit du finito d’un compte, en
termes de teneur de livres, c’eft ajouter enfemble les
fommes qui font toutes ces parties d’un compte, les
calculer, & par diverfes opérations arithmétiques
voir à quoi toutes ces chofes fe montent. Diction,
de Comm,. de Trév. & de Chamb.
COMPOSITE, terme d'Architect. Voye%_ Ordre.
COMPOSITEUR, f. m. (Jurifp.) amiable compo-
fiteur, eft celui qui eft choiû par les parties pour juger
leur différend, ou pour le terminer à l’amiable
félon l’équité , fans être aftreint aux rigueurs du
droit ni de la forme, à la différence de l’arbitre qui
doit juger félon les lois. Voye^ Arbitre & Arbi-
trateur. (A )
C o m p o s i t e u r : quoique compojîtion fe dife
dans tous les Arts libéraux, compofiteur ne fe dit guere
qu’en Mufique & en Imprimerie ; c’eft celui qui
compofé ou qui fait la compofition. Voyeç au mot
C omposition, une efquiffe des connoiffances né-
ceffaires pour favoir compofer. Ce n’eft pas encore
affez pour faire le bon compofiteur. Toute la fcience
poffible ne fuffit point j fans le génie qui la met en
oeuvre : quelque effort que l’on puiffe faire, il faut
être né pour cet art, autrement on n’y fera jamais
rien que de médiocre. Il en eft du compofiteur comme
du poëte, fi fon aftre en naiffant ne l’a formé tel :
S'il n'a reçu du ciel Ûinfluence fecrette ;
Pour lui Phoebus eft four d , & Pégafe eft rétif.
Ce que j’entens par génie, n’eft point ce goût bi-
farre & capricieux qui feme par - tout le baroque &
le difficile , & qui ne fait embellir ou varier l’harmonie
qu’à force d'e brTiit ou de diffonnances ; c’eft
ce feu intérieur qui infpire fans ceflê des chants nouveaux
& toujours agréables ; des expreffions v iv es,
naturelles & qui vont au coeur ; une harmonie pure
, touchante, majeftueufe. C’eft ce divin guide qui
a conduit Corelli, V in c i, Haffe, Gluck & Rinaldo
di Capua dans le fanétuaire de l’harmonie ; Léo Per-
golefe & Terradellas dans celui de l’expreffion & du
beau chant. (51)
C ’eft lui qui infpira Lulli dans l’enfance de la
mufique, & qui brille encore en France dans les
opéras de M. Rameau, à qui nos oreilles ont tant
d’obligation. (O)
COMPOSITEUR, dans la pratique de l'Imprimerie ,
s’entend de l’ouvrier qui travaille uniquement à l’arrangement
des caraéteres, c’eft-à-dire à la caffe ,
dans laquelle il le v e , les unes après les autres, ce
nombre prodigieux de lettres difperfées dans les différens
caffetins, dont l’affemblage dirigé fuivant la
copie & fuivant le format defiré, donne les formes
ou planches deftinées à être imprimées.
COMPOSITION, en Rhétorique , s’entend de
l’ordre & de la liaifon que doit mettre l’orateur dans
les parties d’un difcours.
C ’eft à la compofition qu’appartient l’art d’affem-
bler & d’arranger les mots dont le.ftyle eft formé ,
& qui fervent à le rendre coulant, leger, harmonieux
, v if , &c. D’elle auffi dépend l’ordre que les
matières doivent garder entre elles, fuivant leur nature
& leur dignité, conformément à ce précepte
d’Horace commun à l’Eloquence & à la Poéfie :
Singula quoique, locum teneant fortita decenter.
La grande réglé impofée par Cicéron aux orateurs,
quant au choix & à la diftribution des parties
du difcours & des moyens propres à perfuader, c’eft
d’y obferver une forte de gradation en commençant
par les chofes moins importantes, & en s’élevant fuç-
Tome III,
ceffivement jufqu’à celles qui doivent faire le plus
d’impreffion : femper augeatur & crefcat oratio, Voye£
Période & D iscours. (G)
C omposition , en Arithmétique: fuppofons que
l’on ait deux rapports tels, que l’antécédent du premier
foit à fon conféquent, comme l’antécédent du
fécond eft à fon conféquent ; alors on faura par compofition
de raifon , que la fomme de l’antécédent & du
conféquent du premier rapport, eft à l’antécédent ou
au conféquent du même rapport, comme la fomme
de l’antécédent & du conféquent du fécond rapport
à l’antécédent, ou au coniéquent du même rapport.
Par exemple , { iA : B :: C : D , on aura par compofition
de raifon cette autre proportion A + B : A
ou B : : C-\- D : C ou D. (O)
Composition du Mouvement eft la réduction
de plufieurs mouvemens à un feul.La compofition
du mouvement a lieu lorfqu’un corps eft pouffé ou
tiré par plufieurs puiffances à-la-fois. Voye[ Mouvement.
Ces différentes puiffances peuvent agir
toutes fuivant la même direétion, ou fuivant des direétions
différentes j ce qui produit les lois fuivan-
tes.
Si un point qui fe meut en ligne droite eft pouffé
par une ou plufieurs puiffances dans la direétion de
ton mouvement, il fe mouvra toujours dans la même
ligne droite : fa vîteffe feule changera, c’eft-à-dire
augmentera ou diminuera toujours en raifon des
forces impulfives. Si les direétions font oppofées ,
par exemple, fi l’une tend en-bas & l’autre en-haut,
la ligne de tendance du mouvement fera cependant
toujours la même. Mais fi les mouvemens compofans,
ou, ce qui eft la même chofe, les puiffances qui les
produifent n’ont pas une même direétion, le mouvement
compofé n’aura aucune de leurs direétions
particulières, mais en aura une autre toute différente
qui fera dans une ligne ou droite ou courbe, félon la
nature & la direétion particulière des différens mou-
vemens compofans.
Si les deux mouvemens compofans font toujours
uniformes, quelque angle qu’ils faffent entr’eu x, la
ligne du mouvement compofé fera une ligne droite ,
pourvu que les mouvemens compofans Faffent toujours
le même angle, li en eft de même, fi les mouvemens
ne font point uniformes, pourvu qu’ils l'oient
femblables, c’eft-à-dire qu’ils foient accélérés ou retardés
en même proportion, &c pourvu qu’ils faffent
toujours le même angle entr’eux.
Ainfi fi le point a (Planche de Méchanique , fig. (T.)
eft pouffé par deux forces de direétions differentes ,
favoir en-haut vers b, & en-avant vers il eft clair
que quand il aura été en-avant jufqu’en c , il devra
néçeffairement être monté julqu’au point c de la
ligne c e ; de forte que fi les mouvemens, fuivant
ad & ah, étoient uniformes, il fe mouvroit toujours
dans la diagonale a e c. Car comme les lignes.
a i , ie , font toujours en proportion confiante, &
que par l’hypothefe le mouvement, fuivant a d , &c
le mouvement perpendiculaire à celui-ci, font tous
deux uniformes ; il s’enfuit que les lignes a i , ie ,
feront parcourues dans le même tems ; & qu’ainfi
tandis que le point a parcourra a i par un de fes
mouvemens, il parcourra en vertu de l’autre mouvement
la ligne ci. D ’où il s’enfuit qu’il fe trouvera
fucceffivement fur tous les points e de la diagonale,
& que par conféquent il parcourra cette li-
gne.
Dans la fig. C. on a fait les lignes a i , i e , égales
entr’elles, c’eft-à-dire qu’on a fuppofé que non-feulement
les mouvemens étoient uniformes, mais encore
qu’ils étoient égaux. Cependant la démonftra-
tion précédente auroit toujours lieu, quand même
les mouvemens, fuivant ad&cab, ne feroient point;
égaux, pourvu que ces mouvemens fiiffent unifor