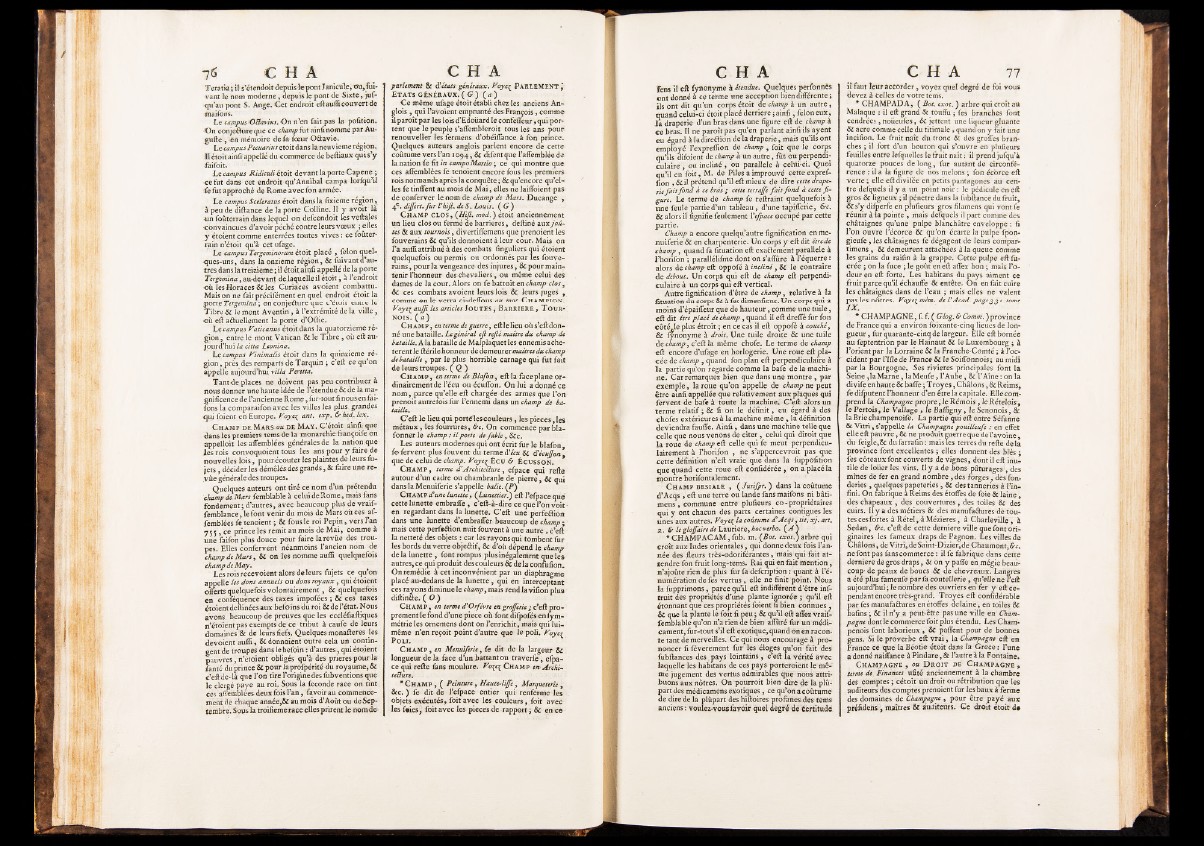
Teratia; il s’étendoit depuis le pont Janicûle,ou,fuI-
vant le nom moderne, depuis le pont de Sixte, juf-
qu’au pont S. Ange. C e t endroit eft auffi couvert de
maifons.
Le capipiis Ocfavius. On n ’en fait pas la pofition.
On conje&ure que ce champ fut ainli nommé par Au-
gufte , en mémoire de là foeur O&avie.
Le campusPecuarius etoit dans la neuvième région.
I l étoit ainfi appelle du commerce de beftiaux qui s’y
fai (oit.
Lecampus Rldïculi c toit devant la porte Capene ;
■ ce fut dans cet endroit qu’Annibal campa lorfqu’il
4e fut approché de Rome avec fon armée.
Lecampus Scélérat us étoit dans la fixieme région,
à peu de diftance de la porte Colline. Il y avoit là
-un foûterrain dans lequel on defeendoit les veftales
-convaincues d’avoir péché contre leurs voeux ; elles
y étoient comme enterrées toutes vives : ce foûterrain
n’étoit qu’à cet ufage.
Le campus Tergeminorum étoit placé , félon quel-
-ques-uns, dans là onzième région, & fuivant d’autres
dans la treizième ; il étoit ainli appellé de la porte
Tergemina, au-devant de laquelle il étoit, à l’endroit
où les Horaces Ôc les Curiaces avoient combattu.
Mais on ne fait précifément en quel endroit étoit la
porte Tergemina', on conjecture que c’étoit entre le
Tibre & le mont Aventin, à l’extrémité de la v ille ,
ou eft actuellement la porte d’Oftie.
Lecampus Vaticanus étoit dans la quatorzième région,
entre le mont Vatican Ôc le Tibre , où eft aujourd’hui
la citt-a Ltonina.
hecampus Vinimalis étoit dans la quinzième région,
près des remparts de Tarquin ; c’eft ce qu’on
appelle aujourd’hui villa Pcretta.
Tant de places ne doivent pas peu contribuer à
nous donner une haute idée de l’étendue 8c de la magnificence
de l’ancienne Rome, fur-tout fi nops en fai-
fpns la comparaifon avec les villes les plus grandes
qui foient en Europe-, l'oyp^ ant' exP‘ & èex.
C hamp de M ars ou de Ma y . C ’étoit ainfi; que
dans les premiers tems de la monarchie françoile on
appelloit les aflëmblées générales de la nation .que
les rois conyoquoient tous les ans pour y faire de
nouvelles lois, pour écouter les plaintes de leurs fu-
je ts , décider les démêlés des grands, & faire une re-
vûe générale des troupes.
Quelques auteurs ont tiré ce nom d’un prétendu
champ de Mars femblable à celui de Rome, mais fans
fondement; d’autres, avec beaucoup plus de vraif-
femblance, le font venir du mois de Mars où ces af-
femblées fe tenoient ; ôc fous le roi Pépin, vers l’an
y < 5 , ce prince les remit au mois de Mai, comme à
une faifon plus douce pour faire la revue des troupes.
Elles confervent néanmoins l’ancien nom de
chapip de Mars y ôc on les nomme auffi quelquefois
champ de May.
Les rois recevoient alors de leurs fujets ce qu’on
appelle les dons annuels ou dons royaux, qui étoient
offerts quelquefois volontairement, Ôc quelquefois
en conféquence des taxes impofées ; ôc ces taxes
étoient deftinées aux befoins du roi 8c de l’état. Nous
avons beaucoup de preuves que les eccléfiaftiques
n’étoientpas exempts de ce tribut à caufe de leurs
domaines & de leurs fiefs. Quelques monafteres les
dévoient auffi, 8c donnoient outre cela un contingent
de troupes dans le befoin : d’autres, qui étoient
pauvres, n’étoient obligés qu’à des prières pour la
fanté du prince 8c pour laprofpérité du royaume, 8c
c’eft de-là que l’on tire l’origine des fubventions que
le clergé paye au roi. Sous la fécondé race on tint,
ces affemblees deux fois l’an, favoir au commencement
dé chaque année,& au mois d’Août ou de Septembre.
Sous la troifiemerace elles prirent le nom de
parlement & S états généraux. Voyeç PARLEMENT ,
E t a t s g én éraux. ( G ) ( <*■ )
C e même ufage étoit établi chez les anciens Ân-
glois , qui l’avoient emprunté des François, comme
il paroît par les lois d’Edoiiard le confeffeur, qui portent
que le peuple s’affembieroit tous les ans pour
renouveller les fermens d’obéiffance à fon prince.
Quelques auteurs anglois parlent encore de cette
coûtume vers l’an 1094, Ôc difentque l’affemblée de
la nation fe fit in campoMartio ; ce qui montre que
ces affemblées fe tenoient encore fous les premiers
rois normands après la conquête ; 8c qu’encore qu’elles
fe tinffent au mois de Mai, elles ne laiffoient pas
de conferver le nom de champ de Mars. Ducange ,
4^. diffirt.fur Thijl, de S. Louis. ( G )
C hamjp clos , {füfl. mod. ) étoit anciennement
un lieu clos ou fermé de barrières, deftiné aux joutes
& aux tournois y divertiffemens que prenoient les
fouverains 6c qu’ils donnoient à leur cour. Mais on
l’a auffi attribué à des combats finguliers qui étoient
quelquefois ou permis ou ordonnés par les fouverains,
pour la vengeance des injures, 8c pour maintenir
l’honneur des. chevaliers, ou même celui des
dames de la cour. Alors on fe battoit en champ clos,
6c ces combats avoient leurs lois 6c leurs juges ,
comme ©n le verra ci-deffous au mot C hampio n.
Voye^ auffi les articles JOUTES, BARRIERE , TOURNOIS.
( a')
C h am p , entermede guerret eft le lieu oùs’eftdon-
né une bataille. Le général ejl rejlé maître du champ de
bataille, A la bataille de Malplaquet les ennemis achetèrent
le ftérile honneur de demeurer maîtres du champ
de bataille, par le plus horrible carnage qui fut fait
de leurs troupes. ( Q )
C h am p , en terme de Blafonf eft la face plane ordinairement
de l’écu ou écuffon. On lui a donné ce
nom, parce qu’elle eft chargée des armes que l’on
prenoit autrefois fur l’ennemi dans un champ de bataille.
C ’eft le lieu qui porté!es couleurs, les pièces, les
métaux, les fourrures, &c. On commence parbla-
fonner le champ : il porte de fable, 6cc.
Les auteurs modernes qui ont écrit fur le blafon ,
fe« fervent plus fouvent du terme d*écu 6c d’écuffon ,
que de celui de champ. Voye^ Écu & Écu sson.
C h am p , terme d.'Architecture y efpacc qui refte
autour d’un cadre ou chambranle de pierre, 6c qui
dans la Menuiferie s’appelle balte. (P\
C hamp et une lunette, ('Lunettier.) eft l’efpacequë
cette lunette embraffe , c’eft-à-dire ce que l’on voit-
en regardant dans la lunette. C ’eft une perfection
dans une lunette d’embraffer beaucoup de champ ;
mais cette perfection nuit fouvent à une autre, c’eft
la netteté des objets : car les rayons qui tombent fur
les bords du verre objectif, 6c d’où dépend le champ
delà lunette, font rompus plusinégalemrnt que les
autres, ce qui produit des couleurs 6c delà conhifion.
On remédie à cet inconvénient par un diaphragme
placé au-dedans de la lunette, qui en interceptant
ces rayons diminue le champ, mais rend la vifion plus
diftincte. ( O )
C hamp , en terme d.'Orfèvre en grofferie ; c’eft proprement
le fond d’une piece où font difpofés en fym-
métrie les ornemens dont on l’enrichit, mais qui lui-
même n’en reçoit point d’autre que le poli. Voye^
Po li.
C h am p , en Menuiferie, fe dit de la largeur 6c
longueur de la face d’un,battant ou traverfè, efpa-
ce qui refte fans moulure. Vo^e^ Champ en-Architecture.
* C hamp , ( Peinture, Haute-liffe, Marqueterie ,
6ec. ) fe dit de l’efpace entier qui renferme les
objets exécutés, foita vec les couleurs, foit avec
les foies, foitavec les pièces de rapport; 6c en ce
fens il eft fynonyme à étendue. Quelques perfonnès
ont donné à ce terme une acception bien différente ;
ils ont dit qu’un corps étoit de champ à un autre,
quand celui-ci étoit placé derrière ; ainfi, félon eux,
i a draperie d’un bras dans une figure eft de champ à
ce bras. II ne paroît pas qu’en parlant ainfi ils ayent
eu égard à la direction de la draperie, mais qu’ils ont
employé l’expreffion de champ , foit que le corps
qu’ils difoient de champ à un autre, fut ou perpendiculaire
, ou incliné, ou parallèle à celüi-ci. Quoi
qu’il en foit, M. de Piles a improuvé cette expref-
lion ,6c il prétend qu’il-eft mieux de dire cette drape-
rie fa it fond à ce bras ; cette terraffe fa it fond à cette f igure.
Le terme de champ fe reftraint quelquefois à
une feule partie d’un tableau, d’une tapifferie, &c.
& alors il lignifie feulement Y efpacc occupé par cette
partie.
Champ a encore quelqu’autre lignification en menuiferie
ôc en charpenterie. Un corps y eft dit être de
champ , quand fa fituation eft exactement parallèle à
l ’horifon ; parallélifme dont on s’affûre à l’équerre :
alors de champ eft oppofé à incliné ,6 c le contraire
de debout. Un corps qui eft de champ eft perpendiculaire
à un corps qui eft vertical.
Autre lignification d’être de champ, relative à la
fituation du corps ôc à fes dimenfiens. Un corps qui a
moins d’épaiffeur que de hauteur, comme une tuile,
eft dit être p lacé de champ, quand il eft dreffé fur fon
côté J e plus étroit ; en ce cas il eft oppofé à couché,
& fynonyme à droit. Une tuile droite 6C une tuile
de champ, c’eft la même chofe. Le terme de champ
eft encore d’ufage en horlogerie. Une roue eft placé
e de champ , quand fon plan eft perpendiculaire à
la partie qu'on regarde comme la bafe de la machine.
Car remarquez bien que dans une montre , par
exemple, la roue qu’on appelle de champ ne peut
être ainfi appellée que relativement aux plaques qui
fervent de bafe à toute la machine. C ’eft alors un
terme relatif ; 6c fi on le définit, eu égard à des
chofes extérieures à la machine même, la définition
deviendra fauffe. Ainfi , dans une machine telle que
celle que nous venons de cite r, celui qui diroit que
la roue de champ eft celle qui fe meut perpendiculairement
à l’horifon , ne s’appercevroit pas que
cette définition n’eft vraie que dans la fuppofition
que quand cette roue eft confidérée, on a placé la
montre horifontalement.
C hamp besiale , (.Jurifpr.) dans la coûtume
d’Acqs , eft une terre ou lande fans maifons ni bâti-
mens , commune entre plufieurs co-propriétaires
qui y ont chacun des parts certaines contiguës les
unes aux autres. Voye^ la coutume d’Acqsytit.xj. art.
2. & le gloffaire de Lauriere, hoeverbo. (A )
*CH AMPACAM,fub. m. (Bot. exot.) arbre qui
croît aux Indes orientales, qui donne deux fois l’année
des ileurs très-odoriférantes, mais qui fait attendre
fon fruit long-tems. Rai qui en fait mention,
n’ajoûte rien de plus fur fa defcnption : quant à l’énumération
de fes vertus, elle ne finit point. Nous
la fupprimons, parce qu’il eft indifférent d’être inf-
truit des propriétés d’une plante ignorée 5 _ qu’il eft
étonnant que ces propriétés foient fi bien connues ,
6c que la plante le foit fi peu ; 6c qu’il eft allez vraif-
femblable qu’on n’a rien de bien affûré fur un médicament,
fur-tout s’il eft exotique, quand bn en raconte
tant de merveilles. Ce qui nous encourage à prononcer
fi féverement fur les éloges qu’on fait des
fubftances des, pays lointains , c eft la vérité avec
laquelle les habitans de ces pays porteroient le même
jugement des vertus admirables que- rioùs attribuons
aux nôtres. On pourroit bien dirë de la plû-
partdes médicamensexotiques, ce qu’on acoûtume
de dire de la plûpart des hiftoires profanes.des tems
anciens : voulez-vous favoir quel degré de Certitude
il faut leur accorder, voyez quel degré de foi vous
devez à Celles de votre tems.
* CHAMPADA, ( Bot. exot. ) arbre qui croît au
Malaque : il eft grand 8c touffu ; fes branches font
cendrées, hoiieufes, 6c jettent une liqueur gluante
6c acre comme celle du titimale, quand on y tait une
incifion. Le fruit naît du tronc 6c des groffes branches
; il fort d’un bouton qui s’ouvre en plufieurs
feuilles entre lefquelles le ff uit naît : il prend jufqu’à
quatorze pouces de long , fur autant de circonférence
: il a la figure de nos melons ; fon éebree eft
verte ; elle eftdivifée en petits pantagones au centre
defquels il y a un point noir : le pédicule en eft
gros ôc ligneux ; il pénétré dans la fubftance du fruit,
6c s’y difperfe en plufieurs gros filamens qui vont fe
réunir à la pointe , mais defquels il part comme des
châtaignes qu’une pulpe blanchâtre enveloppe : fi
l ’on ouvre l’écorce 6c qu’on écarte la pulpe fpon-
gieufe, les châtaignes fe dégagent de leurs compar»
timens , 6c demeurent attachées à la queue comme
les grains du raifin à la grappe. Cette pulpe eft fu-
crée ; on la fuce ; le goût en eft affez bon ; mais l’odeur
en eft forte. Les habitans du pays aiment ce
fruit parce qu’il échauffe 6c entête. On en fait cuire
les châtaignes dans de l’eau ; mais elles- ne valent
pas les nôtres. Voye^ mèm, de l ’Acad, page g 31. tome
IX.*
CHAMPAGNE, f. f. ( Gèog. &Comm. ) province
de France qui a environ foixante-cinq lieues de longueur,
fur quarante-cinq de largeur. Elle eft bornée
au feptentrion par le Hainaut 6c le Luxembourg ; à
l’orient par la Lorraine 6c la Franche-Comté ; à l’oc*
^ cident par Vlüe de France 6c le Soiflbnnois; au midi
par la Bourgogne. Ses rivières principales font la
Seine , 1a Marne, laMeufe, l’Aube, 6c l’Aîne : on la
divife en haute 6c baffe ; T ro y e s , Châlons, 6c Reims,
fe difputent l’honneur d’en être la capitale. Elle comprend
la Champagne propre, le Rémois, le Rétélois-,
le Pertois, le Vallage , le Baffigny, le Senonois , 6c
la Brie champenoifè. La partie qui eft entre Séfanne
ôc V itri, s’appelle la Champagne pouilleufe : en effet
elle eft pauvre, ôc ne produit guerre que de l’ avoine ,
du feigle,6c dufarrafin; mais les terres du refte delà
province font excellentes ; elles donnent des blés ;
fes coteaux font couverts de vignes, dont il eft inutile
de loiier les vins. Il y a de bons- pâturages*, des
mhies de fer en grand nombre , des forges, des fonderies
, quelques papeteries, ôc des tanneries à l’infini.
On fabrique à Reims des étoffes de foie 6c laine
des chapeaux , des couvertures, des toiles 6c des
cuirs. Il y a des métiers 6c des manufa&ures dé toutes
ces fortes à Rételyà Mézieres, à Charleville , à
Sedan, &c. c’eft de cette derniere ville que font originaires
les fameux draps de Pagnon. Les villes de
Châlons, de Vitri, de Saint-Dizier,de Chaumont,&c.
ne font pas fans commerce : il fe fabrique dans cette
derniere de gros draps, 6c on y paffe en mégie beaucoup
de peaux de boucs 8c de chevreaux. Laneres
a été plus fameufe par fa coutellerie, qu’elle ne I’eft
aujourd’hui ; le nombre des ouvriers en fer y eft cependant
encore très-grand. Troyes eft confidérable
par fes manufaftures en étoffes de laine -, en toiles ÔC
bafins ; 6c il n’y a peut-être pas une ville en Champagne
dont le commerce foit plus étendu. Les Champenois
font laborieux , ÔC paffent pour de bonnes
gens. Si le proverbe eft v r a i, la Champagne eft en
France ce que la Béotie étoit dans la Grece : l’une
a donné naiffance à Pindare, 8c l’autre à la Fontaine.
C hampagne , ou D ro it dé C ham pagne ,
terme de Finances ufité anciennement à la chambre
des comptes ; cétoit ùn droit ou rétribution que les
auditeurs des comptes prenoient fur les baux à ferme
des domaines de Champagne , pour être payé aux
préfidens., maîtres 6c auditeurs. Ce droit etoit d©