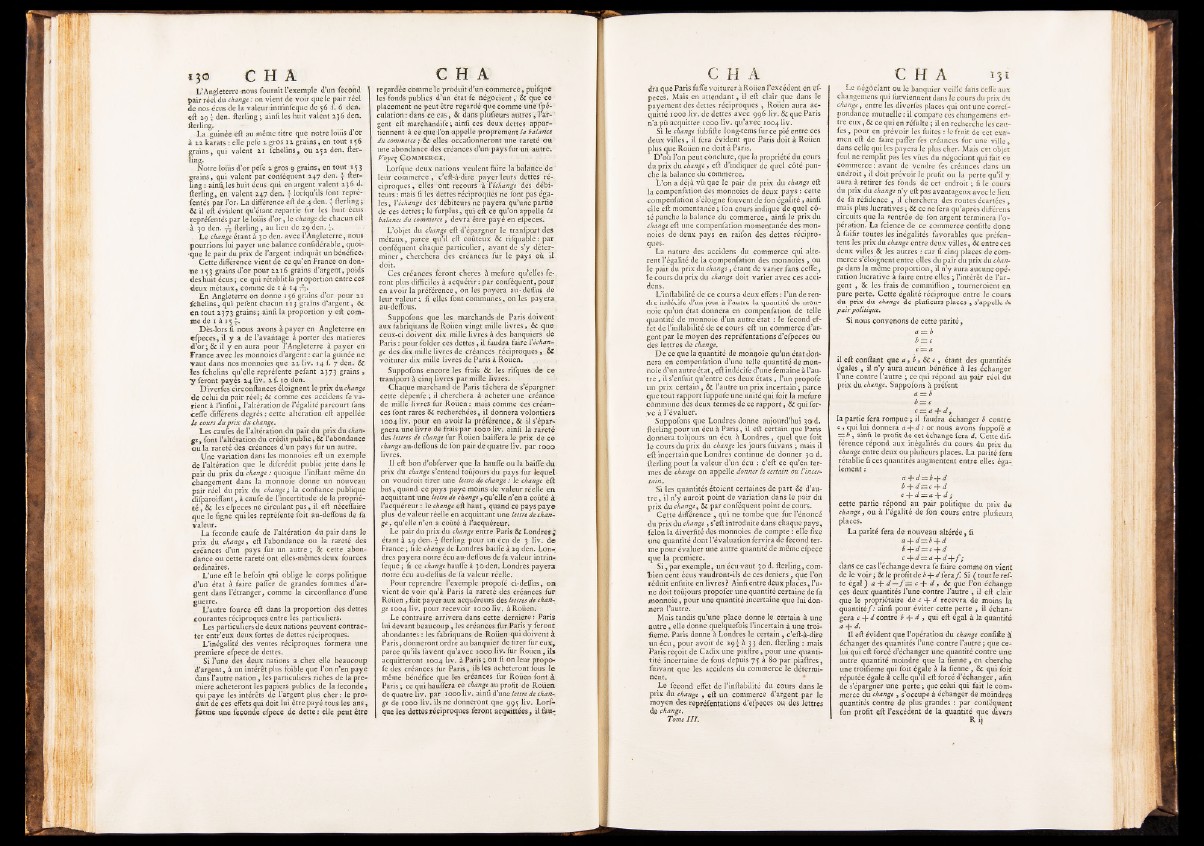
13© C H A
L’Angleterre-nous fournit l’exemple d’un'fécond
pair réel du change : on vient de voir que le pair réel
de nos-écus de la valeur intrinfeque de 56 f. 6 den,
eft 29 £ den. fterling ; ainli les huit valent 2.36 den.
fterling.
La.guinëe eft au même titre que notre loiiis d’or
à 22 karats : elle pefe 2 .gros 12 grains, en tout 156
grains, qui valent 21 Ichelins, ou 252 den. fterling.
. Notre loiiis d’or péfe 2 gros 9 grains, en tout 153
grains, qui valent par conséquent 247 den. ^ fter-
hng : ainfi» les huit écus qui en argent valent 236 d.
fterling, en valent 247 den. f lorfqu’ils font repré-
fentés par l’or. La différence eft de 4 den. j fterling3
& il eft évident qu’étant repartie fur les huit écus
repréfentés.par le loiiis d’o r , le 'change de chacun eft
à 30 den. fterling , au lieu de .29 den,
. Le change étant à 30 den. avec l’Angleterre, nous
pourrions lui payer une balance confidérable, quoi»,
que le pair du prix de l’argent indiquât un bénéfice.
Cette différence vient de ce qu’en France on donne
153 grains d’or pour 2216 grains d’argent, poids
des huit écus ; ce qui rétablit la proportion entre ces
deux métaux, comme de 1 à 14
En Angleterre on donne 156 grains d’or pour 21
ichelins, qui pefent chacun 113 grains d’argent, &
en tout 2373 grains; ainfi la proportion y eft comme
de 1 à 15 -f.
Dès-lors fi nous avons à payer en Angleterre en
efpeces, il y a de l’avantage à porter des matières
d’or; & il y en aura pour l’Angleterre à payer en
France avec les monnoies d’argent : car la guinée ne
vaut dans nos monnoies que 22 liv. 14 f. 7 den. &
les fehelins qu’elle repréfente pefant 2373 grains ,
y feront payes 24,liv. 2 f. 10 den.
Diverfes circonftances éloignent le prix du change
de celui du pair réel ; & comme ces accidens fe varient
à l’infini, l ’altération de l’égalité parcourt fans
ceffe différens degrés : cette altération eft appellée
le cours du prix du change.
Les caufes de l’altération du pair du prix du change
^ font l’altération du crédit public, & l’abondance
ou la rareté des créances d’un pays fur un autre.
Une variation dans les monnoies eft un exemple
de l’altération que le diferédit public jette dans le
pair du prix du change : quoique l’inftant même du
changement dans la monnoie donne un nouveau
pair réel du prix du change ,• la confiance publique
difparoiffant, à caufe de l’incertitude de la propriété
, & les efpeces ne circulant pas, il eft néceffaire
que le figne qui les repréfente foit au-deffous de fa
valeur.
La fécondé caufe de l’altération du pair dans le
prix du change, eft l’abondance ou la rareté des
créances d’un pays fur un autre ; & cette abondance
ou cette rareté ont elles-mêmes deux fources
ordinaires.
L ’une eft le befoin qui oblige le corps politique
d’un état à faire paffer de grandes fommes d’argent
dans l’étranger, comme la circonftance d’une
guerre.
L’autre fource eft dans la proportion des dettes
courantes réciproques entre les particuliers.
Les particuliers de deux nations peuvent contracter
entr’eux deux fortes de dettes réciproques.
L ’inégalité des ventes réciproques formera une
première efpece de dettes.
Si l’une des deux nations a chez elle beaucoup
d’argent, à un intérêt plus foible que l’on n’en paye
dans l’autre nation, les particuliers riches de la première
achèteront les papiers publics de la fécondé,
qui paye les intérêts de l’argent plus cher : le produit
de ces effets qui doit lui être payé tous les ans,
forme une fécondé efpece de dette : elle peut être
€ H A
regardée comme lé produit d’un commerce , puifque
les fonds publics d’un état fe négocient, & que ce
placement ne peut être regardé que comme unè'fpé-
culation: dans ce cas, & dans plusieurs a u t r e s l’àr- ‘
gent eft marchandife; ainfi ces deux dettes appartiennent
à ce que l’on -appelle proprement la balance
du commerce ; &c elles oecafionneront une rareté ou
une abondance des créances d’un pays fur un -autre.
Foye{ Go M MEUGE,
Lorfque deux nations veulent faire la balance d e -
leur commerce., c’ eft-à-dire payer leurs dë'ttfes réciproques,
elles ont recours à {'échange des débiteurs
: mais fi les dettes réciproques ne font pas égales,
Y échange des-débiteurs ne payera qu’une partie
de ces detres ; le furplus, qui eft ce qu’On appelle la-
balance du commerce, devra être' payé en eipeceS.
L’objet du -change eft d’épargner le tranfport des
métaux., parce qu’il eft coûteux & rifquable : par
; conféquent chaque particulier, ayant de s’y déter-,
miner, cherchera des créances fur le pays où il
doit.
Ces créances feront cheres àmefure qu’elles fe-.
ront plus difficiles à acquérir : par conféquent, pour
en avoir la préférence, on les payera au-deffus de
leur valeur; fi elles font communes, on les payera,
au-deffous.
Suppofons que les marchands de Paris doivent
aux fabriquans de Roiien vingt mille livres > &C que
ceux-ci doivent dix mille livres à des banquiers de
Paris : pour folder ces dettes, il faudra faire Yéchan-
ge des dix mille livres de créances .réciproques,,
voiturer dix mille livres de Paris à Rouen.
Suppofons encore les frais & les rifques de ce
tranfport à cinq livres par mille livres.
Chaque marchand de Paris tâchera de s’épargner
cette dépenfe ; il cherchera à acheter une créance
de mille livres fur Roiien : mais comme ces créances
font rares & recherchées, il donnera volontiers
1004 liv. pour en avoir la préférence, & il s’épargnera
une livre de frais'par 1000 liv. ainfi la rareté
des lettres de change fur Roiien baiffera le prix de Ce
change au-deffous de fon pair de quatre liv. par 1000
livres.
Il eft bon d’obferver que la hauffe ou la baiffe du
prix du change s’entend toujours du pays fur lequel
on voudroit tirer une lettre de change : le change eft
bas, quand ce pays paye moins de valeur réelle en
acquittant une lettre de change, qu’elle n’en a coûté à
l’acquéreur : le change eft haut, quand ce pays paye
plus de valeur réelle en acquittant une lettre de change
, qu’elle n’en a coûté à l’acquéreur.
Le pair du prix du change entre Paris & Londres J
étant à 29 den. 7 fterling pour un écu de 3 liv. de
France ; fi le change de Londres baiffe à 29 den. Lon-;
dres payera notre écu au-deffous de fa valeur intrin-
feque ; fi ce change hauffe à 30 den. Londres payera
notre écu au-defius de fa valeur réelle.
Pour reprendre l’exemple propofé ci-deflus, on
vient de voir qu’à Paris la rareté des créances fur
Roiien, fait payer aux acquéreurs des lettres de change
1004 liv. pour recevoir 1000 liv. à Roiien.
Le contraire arrivera dans cette derniere : Paris
lui devant beaucoup, les créances fur Paris y feront
abondantes : les fabriquans de Roiien qui doivent à
Paris, donneront ordre au banquier de tirer fur eux,
parce qu’ils favènt qu’avec 1000 liv. fur Roiien, ils
acquitteront 1004 liv. à Paris ; ou fi on leur propo-
fe des créances fur Paris, ils les achèteront fous le
même bénéfice que les créances fur Roiien font à
Paris ; ce qui hauffera ce change au profit de Roüenr
de quatre liv. par 1000 liv. ainfi d’une lettre de change
de 1000 liv. ils ne donneront que 995 liv. Lorfque
les dettes réciproques feront acquittées, ilfau-
G H A
dra que Paris füffe voiturer à Roiien l’excédent en efpeces.
Mais.en attendant, il eft clair que dans le
payement des dettes réciproques > Roiien aura acquitté
1000 liv. de dettes avec 996 liv. & que Paris
n’à pû acquitter 1000 liv. qu’avec 1004
Si le change fubfifte long-tems fur ce pié entre ces
deux v illes, il fera évident que Paris doit à Roiien
plus que Roiien ne doit à Paris.
D ’où l’on peut conclure, que la propriété du cours
du prix du change, eft d’indiquer de quel côté pan-
che la balance du commerce.
L ’on a déjà vu que le pair du prix du change eft
la compenfation des monnoies de deux pays : cette
compenfation s’éloigne fouvent de fon égalité , ainfi
elle eft momentanée ; fon cours indique de quel côté
panche la balance dû commerce, ainfi le prix du
change eft une compenfation momentanée des monnoies
de deux pays en raifon des dettes réciproques.
La nature des accidens du commerce qui altèrent
l’égalité de la compenfation des monnoies, ou
le pair au prix du change, étant de varier fans ceffe,
le cours du prix du change doit varier avec ces acei-
dens.
L’inftabilité de ce cours a deux effets : l’un de rendre
indécife d’un jour à l’autre la quantité de monnoie
qu’un état donnera en compenfation de telle
quantité de monnoie d’un autre état : le fécond effet
de finftabiiité de ce cours eft un commerce d’argent
par le moyen des repréfentàtions d’efpeces ou
des lettres de change.
De ce que la quantité de monijoie qu’un état dort-
nera en compenfation d’une telle quantité de mon-
üôie d’un autre état, eft indécife d’une femaine à l’autre
, il s’enfuit qu’entre ces deux états , l’un propofe
un prix certain, & l’autre un prix incertain ; parce
que tout rapport fuppofe une unité qui foit la mefure
cômmûne des deux termes de ce rapport, & qui fer-
,ve à l ’évaluer.
Suppofons que Londres donne aujourd'hui 3a d .
fterling pour un écu à Paris, il eft certain que Paris
donnera toûjours un ecu a Londres , quel que foit
‘le cours du prix du change les jours fuivans ; mais il
eft incertain que Londres continue de donner 30 d.
fterling pour la valeur d’un écu : c’eft ce qu’en termes
de change on appelle donner le certain ou l'incertain.
Si les quantités étoient certaines de part & d’autre
, il n’y auroit point de variation dans le pair du
prix du change, & par conféquent point de cours.
Cette différence , qui ne tombe que fur l’énoncé
du prix du change , s’eft introduite dans chaque pays,
félon la diverfité des monnoies de compte : elle fixé
une quantité dont l’évaluation fervira de fécond terme
pour évaluer une autre quantité de même efpece
que la première.
S i, par exemple, un écu vaut 30 d. fterling, com-
*bien cent écus vaudront-ils de Ces deniers , que l’on
réduit enfuite en livres ? Ainfi entre deux places, l’une
doit toûjours propofer une quantité certaine de fa
monnoie, pour une quantité incertaine que lui donnera
l’autre.
Mais tandis qu’une place donne le certain à une
autre, elle donne quelquefois l’incertain à une troi-
fieme. Paris donne à Londres le certain, c’eft-à-dire
un écu, pour avoir de 29£ à 33 den. fterling : mais
Paris reçoit de Cadix une piaftre, pour une quanti-
tité incertaine de fous depuis 75 à 80 par piaftfes,
fuivant que les accidens du commerce le déterminent.
*
Le fécond effet de l’inftabilité du cours dans le
prix du change , eft un commerce d’argent par le
moyen des repréfentàtions d’efpeces on des lettres
de change. ■
Tome III.
C H A 13*
Le négôciaht ou le banquier veillé farts Ceffe aux
changemens qui furviennent dans le cours du prix du
change, entre les diverfes places qui ont une corref-
pondance mutuelle : il compare cès changemens entre
eux, & ce qui en réfulte ; il en recherche les caufes
, pour en prévoir les fuites : le fruit de cet examen
eft de faire paffer fes créances fur une ville ,
dans celle qui les payera le plus cher. Mais cet objet
feul ne remplit pas les vues du négociant qui fait ce
commerce : avant de vendre fes créances dans un
endroit, il doit prévoir le profit ou la perte qu’il y
aura à retirer fes fonds de cet endroit ; fi le cours
du prix du change n’y eft pas avantageux avec le lieu
de fa réfidence , il cherchera des routes écartées ,
mais plus lucratives ; & ce ne fera qu’après différens
circuits que la rentrée de fon argent terminera l’o1-
peration. La fcience de ce commerce confifte donc
à faifir toutes les inégalités favorables que préfen-
tent les prix du change entre deux v illes, &c entre ces
deux villes & les autres : car fi cinq places de commerce
s’éloignent entre elles du pair du prix du change
dans la meme proportion, il n’y aura aucune opération
lucrative à faire entre elles ; l’intérêt de l’ argent
, & les frais de commiffion , tourneroient eft.
pure perte. Cette égalité réciproque entre le cours
du prix du change de plufieurs places , s’appelle h.
pair politique.
Si nous convenons de cette parité,
b — c
C — a
il eft confiant que a 3 b, & c , étant des quantités
égales , il n’y aura aucun bénéfice à les échanger
l’une contre l’autre ; ce qui répond au pair réel du
prix du change. Suppofons à préfent
ax zb
b — c
■. c = a - l - d t
la partie fera rompue ; il faudra échanger b contre
c , qui lui donnera a + d : or nous avons fuppofé a
= b , ainfi. le profit de eet échange fera d. Cette différence
répond aux inégalités du cours du prix du
change entre deux ou plufieurs places. La panté fera
rétablie fi ces quantités augmentent entre elles éga^
lement ;
a -f- d = b -f- d
b-\-dzzc -f-d
c + dxza-\- d $
cette partie répond au pair politique du prix dw.
change, ou à l’égalité de fon cours entre plufieurs
places.
La parité fera de nouveau altérée, fi
a + dzxb
b -\-dxzc d
c-\-dzza + d-\-f ;
dans ce cas l’échange devra fe faire comme ôn vient
de le voir ; & le profit de b d fera f . Si ( tout le ref-
te égal ) a + d — ƒ== c -f- d , & que l’on échange
ces deux quantités l’une contre l’autre -, il eft clair
que le propriétaire de c 4- d recevra de moins la
quantité ƒ : ainfi pour éviter cette perte , il échangera
c q- d contre b q- d , qui eft égal à la quantité.
a d.
Il eft évident que l’opération du change confifte à
échanger des quantités l’une contre l’autre ; que celui
qui eft forcé d’échanger une quantité contre une
autre quantité moindre que la tienne, en cherche
une troifieme qui foit égale à la fienne, & qui foit
réputée égale à celle qu’il eft forcé d’échanger, afin
de s’épargner une perte ; que celui qui fait le commerce
du change , s’occupe à échanger de moindres
quantités contre de plus grandes : par conféquent
fon profit çft l’excédent de la quantité que divers