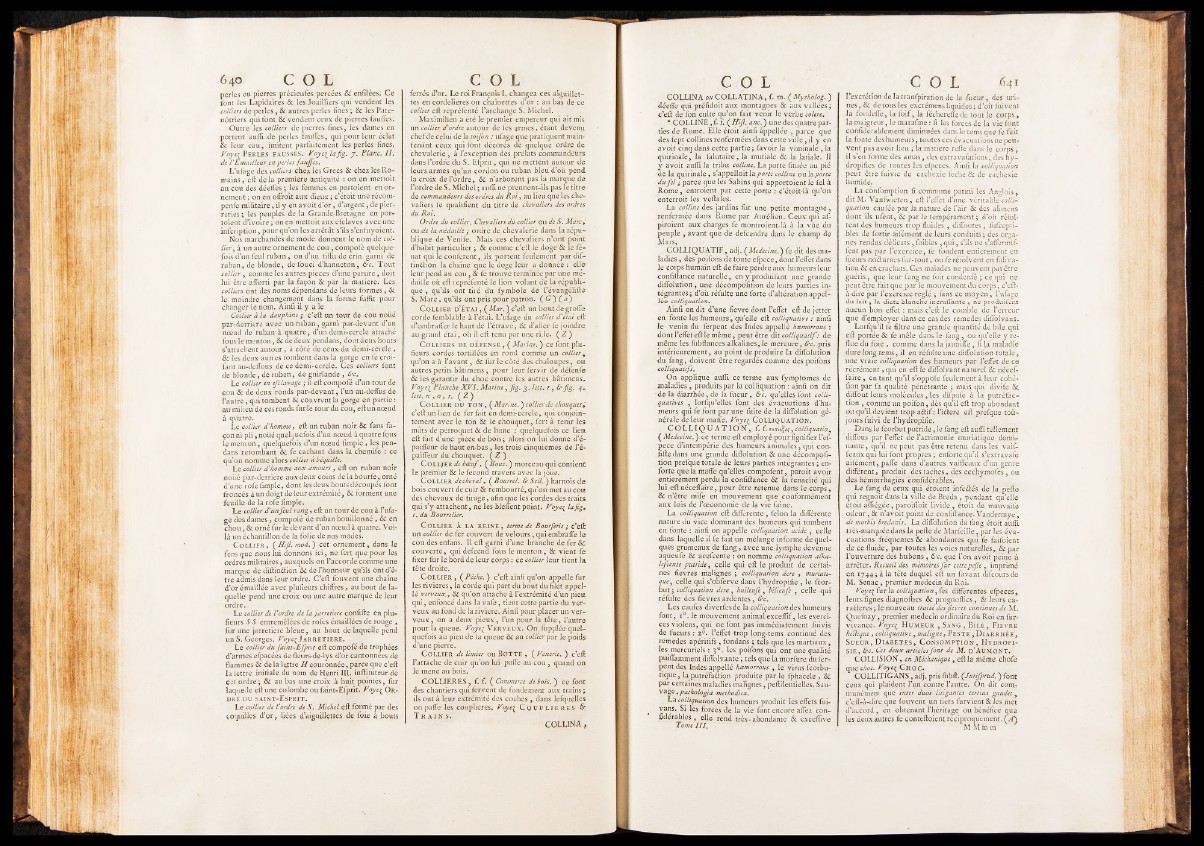
perles ou pierres précieufes percées 8c enfilées. Ce
font les Lapidaires & les Joailliers qui vendent les
colliers de perles, & autres perles fines ; 8c les Pate-
nôtriers qui font 8c vendent ceux de pierres fauffes.
Outre les colliers de pierres fines, les dames en
portent aufli de perles fauffes, qui pour leur éclat
8c leur e au , imitent parfaitement les perles'fines.
Voye^ Perles fausses. Voye^lafig. 7 . Plane. II.
de V Emailleur en perles faujfes.
L ’ufage des colliers chez les Grecs & chez les Romains,
eft d e là première antiquité : on en mettoit
au cou des déeffes ; les femmes en portoient en ornement
; on en offroit aux dieux ; c’étoit une récom-
penfe militaire, il y en avoit d’o r , d’argent, de pierreries
; les peuples de la Grande-Bretagne en portoient
d’ivoire ; on en mettoit aux efclavés avec une
infeription, pour qu’on les arrêtât s ’ils s’enfuyoient.
Nos marchandes de mode donnent le nom de collier,
à un autre ornement de cou , compofé quelquefois
d’un feul ruban, ou d’un tiffu de crin garni de
ruban, de blonde, de fouci d’hanneton, &c. Tout
collier, comme les autres pièces d’une parure, doit
lui être afforti par la façon & par la matière. Les
colliers ont des noms dépendans de leurs formes, &
le moindre changement dans la forme fuffit pour
changer le nom. Ainfi il y a le
Collier à la dauphine ; c ’eft un tour de cou noüé
par-derriere avec un ruban, garni par-devant d’un
noeud de ruban à quatre, d’un demi-cercle attaché
fous le menton, & de deux pendans, dont deux bouts *
s’ attachent autour , à côté de ceux du demi-cercle,
8c les deux autres tombent dans la gorge en fe croi-
fant au-deflpus de ce demi-cercle. Ces colliers font
de blonde, de ruban, de guirlande, &c.
Le collier tn ejclavage ; il eft compofé d’un tour de
cou & de deux ronds par-devant, l’un au-deffus de
l’autre, qui tombent 8c couvrent la gorge en partie :
au milieu de ces ronds furie tour du cou, eft un noeud
à quatre.
Le collier d'homme, eft un ruban noir & fans façon
ni p li, noüé quelquefois d’un noeud à quatre fous
le menton, quelquefois d’un noeud fimple , les pendans
retombant 8c fe cachant dans la chemife : ce
qu’on nomme alors collier à béquille.
Le collier d'homme aux amours, eft un ruban noir
noüé par-derriere aux deux coins d e labou rfe ,o rn é
d’une rofe fimple, dont les deux bouts découpés font
froncés à un doigt de leur extrémité, 8c forment une
feuille de la rofe fimple.
L e collier d'un feul rang, eft un tour de cou à l’ufage
des d ames, compofé de ruban bouillonné * 8c en
ch ou , & orné fur le devant d’un noeud à quatre. Voilà
un échantillon de la folie de nos modes.
C ollier, (Hifl. mod.') cet ornement, dans le
fens que nous lui donnons ic i, ne fert que pour les
ordres militaires , auxquels on l’accorde comme une
marque de diftinftion 8c de l’honneur qu’ils ont d’être
admis dans leur ordre. C ’eft fouvent une chaîne
d’or émaillée avec plufieurs chiffres, au bout de laquelle
pend une croix ou une autre marque de leur
ordre. ,
L e collier de l'ordre de la jarretière confifte en plufieurs
S S entremêlées de rofes émaillées de rouge ,
fur une jarretière bleue, au bout de laquelle pend
un S . Georges. Voye%_ Jarretière.
L e collier du faint-Efprit eft compofé de trophées
d’armes efpacées de fleurs-de-lyis d’or cantonnées de
flammes & delà lettre ET couronnée, parce que c’eft
la lettre initiale du nom de Henri III. inftituteur de
e st ordre; 8c au bas une croix à huit pointes, fur
laquelle eft une colombe ou faint-Efprit. Voye^ Ordre
DU SAINT-ËSPRIT.
Le collier de l'ordre de S. Michel eft formé par des
coquilles d’o r , liées d’aiguillettes de foie à bouts
ferrés d’or. Le roi François L changea ces aiguillettes
en cordelieres ou chaînettes d’or : au bas de ce
collier eft repréfenté l’archange S. Michel.
Maximilien a été le premier empereur qui ait mis
un collier d'ordre autour de fes armes, étant devenu
chef de celui de la toifon : u fage que pratiquent maintenant
ceux qui font décorés de quelque ordre de
chevalerie , à l’exception des prélats commandeurs
dans l’ordre du S. Eiprit, qui ne mettent autour de
leurs armes qu’un cordon ou ruban bleu d’où pend
la croix de l’ordre, 8c n’arborent pas la marque de
l’ordre de S. Michel ; aufli ne prennent-ils pas le titre
de commandeurs désordres du Roi, au lieu que les chevaliers
fe qualifient du titre de chevaliers des ordres
du Roi.
Ordre du collier. Chevaliers du collier ou de S. Marcÿ
ou de la médaille ; ordre de chevalerie dans la république
de Venife. Mais ces chevaliers n’ont point
d’habit particulier ; & comme c ’eft le doge 8c le fé-
nat qui le confèrent, ils portent feulement par dif-
tinâion la chaîne que le doge leur a donnée : elle
leur pend au cou , & fe trouve terminée par une médaille
où eft repréfenté le lion volant de la république
, qu’ils ont tiré du fymbole de l’évangélifte
S. Marc, qu’ils ont pris pour patron. ( G ) ( <z)
C ollier d’ét ai , ( Mar. ) c’eft un bout de grofîe
corde femblable à l’étai. L’ufage du collier d'étai eft
d’embraffer le haut de l’é trave, 8c d’aller fe joindre
au grand é ta i, où il eft tenu par une ride. ( Z )
C olliers de défense , ( Marine. ) ce font plufieurs
cordes tortillées en rond comme un collier,
qu’on a à l’av an t, 8c fur le côté des chaloupes, ou
autres petits bâtimens, pour leur fer vir de défenfe
8c les garantir du choc contre les autres bâtimens.
Voye^ Planche XVI. Marine, fig. 3 . lett. r, & fig. 4 .
lett. n , o, r. ( Z )
C ollier du TON, ( Marine. ) collier de chouquetJ
c’eft un lien de fer fait en demi-cercle, qui conjointement
avec le ton 8e lé chouquet, fert à tenir les
mâts de perroquet & de hune : quelquefois ce lien
eft fait d’une piece de bois ; alors on lui donne d’é-
paiffeur de haut en-bas, les trois cinquièmes de, l’é-
paiffeur du chouquet. ( Z )
C olljer de boeuf, ( Bouc. ) morceaü'qui contient
le premier 8c le fécond travers avec la joiie.
C ollier decheval, ( Bourrel. & Sell. ) harnois de
bois couvert de cuir & rembourré, qu’on met au cou
des chevaux de tirage, afin que les cordes des traits
qui s’y attachent, ne les bleffent point. Voye^ la fig.
t. du Bourrelier.
C ollier à la reine, terme de Bourferie; c’eft
un collier de fer couvert de velours, qui embraffe le
cou des enfans. Il eft garni d’une branche de fer 8c
couverte, qui defeend fous le menton, 8c vient fe
fixer fur le bord de leur corps : ce collier leur tient la
tête droite.
Collier , ( Pêche. ) c’eft ainfi qu’on appelle fur
les rivières, la corde qui part du bout du filet appel-
lé verveux., 8c qu’on attache à l’extrémité d’un pieu
qui, enfoncé dans la v a fe , tient cette partie du yer-
veux au fond de la riviere. Ainfi pour placer un ver-
v e u x , on a deux pieux, l’un pour la tê te , l’autre
pour la queue. Voye£ Ver veux. On fupplée quelquefois
au pieu de la queue 8c au collier par le poids
d’une pierre.
C ollier de limier ou Bo t t e , ( Venerie. ) c’eft
l’attache de cuir qu’on lui paffe au cou , quand on
le mene au bois.
CO L L IER E S , f. f. ( Commerce de bois. ) ce font
des chantiers qui fervent de fondement aux trains;
ils ont à leur extrémité des cochés , dans lefquelles
on paffe les couplieres. Voye^ C o u p l ie r e s &.
T r a i n s .
COLLINA *
COLLINA ou COLLATINA, f. m. ( Mytholog. )
déeffe qui préfidoit aux montagnes 8c aux vallées ;
c’eft de fon culte qu’on fait venir le verbe colere.
* COL L IN E , f. f. ( Hifl. anc. ) une des quatre parties
de Rome. Elle étoit ainfi appellée , parce que
des fept collines renfermées dans cette v ille , il y en
avoit cinq dans cette partie ; favoir la viminale , la
quirinale, la falutaire, la mutiale 8c la latiale. Il
y avoit aufli la tribu colline. L a porte fituée au pié
de la quirinale, s’appelloit la. porte colline ou la porte
du fel ; parce que les Sabins qui apportaient le fel à
R om e , entroient par cette porte : c’étoit-là qu’on
enterroit les veftales.
La colline des jardins fut une petite montagne,
renfermée dans Rome par Aurélien. Ceux qui af-
piroient aux charges fe montroient-là à la vue du
peuple , avant que de defeendre dans le champ de
Mars,
CO L L IQ U A T IF , adj. ( Medecine. ) fe dit des maladies
, des poifons de toute.efpece, dont l’effet dans
le corps humain eft de faire perdre aux humeurs leur
confiftance naturelle, en y produifant une grande
diffolution, une décompofition de. leurs parties intégrantes
; d’où réfuite une forte d’altération appellée
colliquation.
Ainfi on dit d’une fievre dont l’effet eft de jetter
en fonte les humeurs, qu’elle eft colliquative : ainfi.
le venin du ferpent des Indes appellé hoemorrous :
dont l’effet eft le meme, peut être dit colliquatif : de
même les fubftances alkalines, le mercure, &c. pris
intérieurement, au point de produire la diffolution
du fang, doivent être regardés comme des poifons
colliquatifs.
On applique aufli ce terme aux fymptomes de
maladies , produits par la colliquation : ainfi on dit
• de la diarrhée, de la fu eu r, &c. qu’elles font colli-
quatives , lorfqu’elles font des évacuations d’humeurs
qui fe font par une fuite de la diffolution générale
de leur maffe. Voye{ Colliquation.
C O L L IQ U A T IO N , f. f ; tw&ç, colliquatio,
( Medecine. ) ce terme eft employé pour lignifier l’ef-
pece d’intempérie des humeurs animales, qui confifte
dans une grande diffolution & une décompofition
prefque totale de leurs parties intégrantes ; en-
forte que la maffe qu’elles compofent, paroît avoir
entièrement perdu la confiftance 8c la ténacité qui
lui eft néceffaire, pour être retenue dans le corps ,
8c n’être mife en mouvement que conformément
aux lois de l’oeconomie de la v ie faine.
L a colliquation eft différente , félon la différente
nature du vice dominant des humeurs qui tombent
en fonte : ainfi on appelle colliquation acide , celle
dans laquelle il fe fait un mélange informe de quelques
grumeaux de fan g, avec une lymphe devenue
aqueufe 8c acefcente : on nomme colliquation alka-
lefeente putride, celle qui eft le produit de certaines
fievres malignes ; colliquation âcre , muriatique,
celle qui s’obferve dans l’hydropifie , le feor-
but ; colliquation âcre , huileufe , bilieufe , celle qui
réfulte des fievres ardentes, &c.
Les caufes diverfesde la colliquation des humeurs
font, i ° . le mouvement animalexceflif, les exercices
v iolens, qui ne font pas immédiatement fui vis
de fueurs : 20. l’effet trop long-tems continué des
remedes apéritifs, fondans ; tels que lés martiaux,
les mercuriels : 3 0. les poifons qui ont une qualité
puiffamment diffolvante ; tels que la morfure du ferpent
des Indes appellé hoemorrous , le virus feorbu-
txque, la putréfaction produite par le fphacele , 8c
par certaines maladies malignes, peftilentielles. Sauvage
, pathologia methodica.
L a colliquation des humeurs produit les effets fui-
vians. Si les forces de la vie font encore affez con-
fidérables , elle rend très-abondante 8c exceflîve
Tome III,
l’excrétion de la tranfpiration de la fu eu r, des urin
es, 8c de tous les excrémens liquides ; d ’où fuivent
la foibleffe, la fo if , la fécherelfede tout le corps.,
la m aigreur, le marafme : fi les forces de la vie lont
confidérablement diminuées dans le tems que fe fait
la fonte des humeurs, toutes ces évacuations ne peuvent
pas avoir lieu ; la matière refte dans le corps ,
il s’en forme des ama s, des extravafations, des hy-
dropifies de toutes les efpeces. Ainfi la colliquation
peut être fuivie de cachexie feche 8c de cachexie
humide.
La confomption fi commune parmi les Ancdois,
dit M. Vanfwieten, eft l’effet d’une véritable colli-
quation caufée par la nature de l’air 8c des alimens
dont ils ufent, 8c p a r le tempérament; d’où réful-
tent des humeurs trop fluides , diffoutes , fufcepti-
bles de fortir aifément de leurs conduits ; des organes
rendus délicats, foibles , q u i, s’ils ne s’affermif-
fent pas par l’exercice, fe fondent entièrement en
fueürs noCturnesfur-tout, ou feréfolvent en faliva-
tion 8c en crachats. C es malades ne peuvent pas être
guéris, que leur fang ne foit condenfé ; ce qui ne
peut être fait que par le mouvement du corps, c’eft-
à-dire par l’exercice réglé ; fans ce moyen, l’ufage
du la it , la dicte blanche incraflante , ne produifent
aucun bon effet : mais ç’eft le comble de l’erreur
que d’employer dans ce cas des remedes diflblvan$.
Lorfqu’il le filtre une grande quantité de bile qui
eft portée 8c fe mêle dans le fan g , bu qu’elle y reflue
du foie , comme dans la jauniffe, fi la maladie
dure long-tems, il en réfulte une diffolution totale,
une vraie colliquation des humeurs par l’effet de ce
récrement, qui en eft le diffolvant naturel 8c néceffaire
, en tant qu’il s’oppofe feulement à leur cohé-
fion par fa qualité pénétrante ; mais qui divife 8c
diffout leurs molécules , les difpofe à la putréfaction
, comme un poifon, dès qu’il eft trop abondant
ou qu’il devient trop aftif : l’iûere eft prefque toujours
fuivi de l’hydropifie.
Dans le feorbut putride, le fang eft aufli tellement
diffous par l’effet de l’acrimonie muriatique dominante,
qu’il ne peut pas être retenu dans les vaif-
feaux qui lui font propres ; enforte qu’il s’extravafe
aifément, pa,ffe dans d’autres vaiffeaux d’un genre
différent, produit des taches, des ecchymofes, ou
des hémorrhagies confidérables.
Le fang de ceux qui étoient infeélés de la pefte
qui regnoit dans la ville de Breda , pendant qu’elle
étoit alfiégée, paroiffoit livide , étoit de mauvaife
odeu r, 8c n’avoit point de confiftance. Vandermye,
de morbis bredanis. La diffolution du fang étoit aufli
très-marquée dans la pefte de Marfeille, par les évacuations
fréquentes 8c abondantes qui fe faifoient
de ce fluide, par toutes lés voies naturelles, 8c par
l’ouverture des bubons , 6-c. que l’on avoit peine à
arrêter. Recueil des mémoires fur cette pefie , imprimé
en 1744 ; à la tête duquel eft un favant difeours de
M. Senac , premier médecin du Roi.
V3yeç fur la colliquation, fes différentes efpeces ,
leurs lignes diagnoftics 8c prognoftics y 8c leurs caractères
; le nouveau traité des fievres continues de-M..
Quefnay , premier médecin ordinaire du R oi en fur-
vivance. Voye^ Humeur , Sang , Bile, Fièvre
hectique , colliquative , maligne, PESTE, DIARRHÉE,
Sueur,D iabètes, C onsomption, Hydropi-
SIE, &c. Ces deux articles font de M. d’Aumont.
COLL ISION, en Méchanique, eft la même chofe
que choc. Voye{ C h o c .
COLL ITIGANS, adj. pris fubft. (Jurifprud. ) font
ce.ux qui plaident l’un contre l’autre. On dit coiut
munément que inter duos litigantes tertius gaudet,
c’eft-à-dire que fouvent un tiers furvient 8c les met
d’accord , en obtenant l’héritape ou bénéfice que
les deux autres fe conteftoient réciproquement. {A\
M M m m