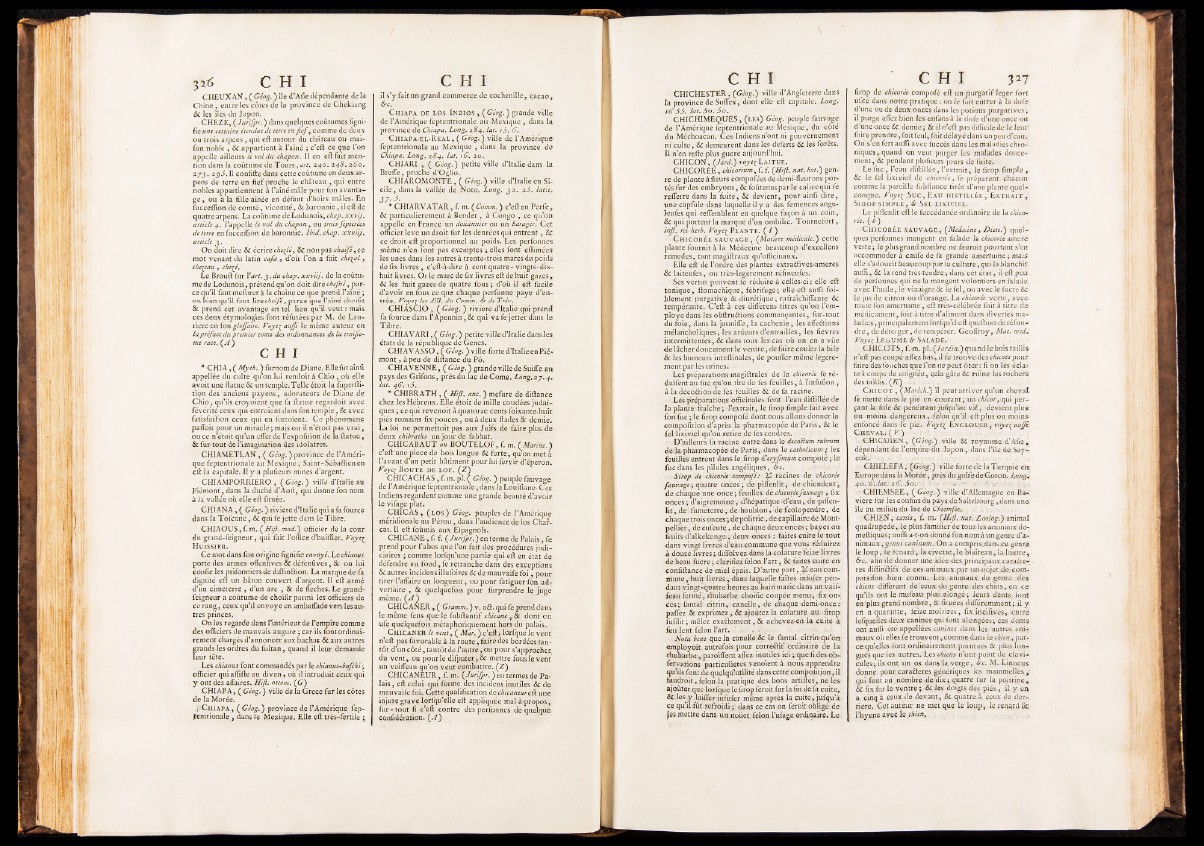
CHEUXAN, ( Géog. ) île d’Afxe dépendante delà
Chine, entre les côtes de la province de Chekiang
& les îles du Japon.
CHEZÉ, ( Jurifpr. ) dans quelques Coutumes lignifie
une certaine étendue de terre en fie f y comme de deux
ou trois arpens, qui eft autour du château ou mai-
ion noble , 8c appartient à l’aîné ; c’eft ce que l’on
appelle ailleurs le vol du chapon. Il en eft fait mention
dans la coutume de Tours,art. 240. 248. 260.
273. 2 t)i. Il confifte dans cette coutume en deux arpens
de terre en fief proche le château , qui entre
nobles appartiennent à l’aîné mâle pour fon avantag
e , ou à la fille aînée en défaut d’hoirs mâles. En
lucceflion de comté, vicomté, & baronnie, il eft de
quatre arpens. La coutume de Lodunois, chap. xxvij.
article 4. l’appelle le vol du chapon, ou trois fepterées
de terre enfucceflion de baronnie. Ibid. chap. xxviij.
article 3.
On doit dire 8c écrire che^lé, 8c non pas chaifèy ce
mot venant du latin cafa , d’où l’on a fait chenal,
che\eau , cheçé.
Le Brouft fur Y are. 3. du chap. xxviij. de la coutume
de Lodunois, prétend qu’on doit dire chefné, parce
qu’il faut mefurer à la chaîne ce que prend l’aîné ;
ou bien qu’il faut lire choifé, parce que l’aîné choifit
& prend cet avantage en tel lieu qu’il veut : mais
ces deux étymologies font réfutées par M. de Lau-
riere en fon glojfaire. Voyeç auffi le même auteur en
la préface du premier tome des ordonnances de la troijîe-
me race. (A )
C H I
* CHIA, ( Myth. ) furnom de Diane. Elit fut ainli
appellée du culte qu’on lui rendoit à Chio , où elle
a voit une ftatue 8c un temple. Telle étoit la fuperfti-
tion des anciens payens, adorateurs de Diane de
C h io , qu’ils croyoient que fa ftatue regardoit avec
févérite ceux qui entroient dans fon temple, 8c avec
fatisfaâion ceux qui en fortoient. Ce phénomène
pafloit pour un miracle; mais ou il n’étoit pas v ra i,
ou ce n’étoit qu’un effet de l’expofition de la ftatue,
& fur-tout de l’imagination des idolâtres.
CHIAMETLAN , ( Géog. ) province de l’Amérique
feptentrionale au Mexique ; Saint-Sébaftien en
eft la capitale. Il y a plufieurs mines d’argent.
CHIAMPORRIERO , ( Géog. ) ville d’Italie au
Piémont. dans la duché d’Àoft, qui donne fon nom
à la vallee où elle eft fituée.
CHIANA, ( Géog. ) riviere d’Italie qui a fafource
dans la T ofcane, 8c qui fe jette dans le Tibre.
CHIAOUS, f. m. ( Hifl. mod. ) officier de la cour
du grand-feigneur, qui fait l’office d’huiffier. Voye^
Huissier.
Ce mot dans fon origine lignifie envoyé. Le chiaous
porte des armes offenfives 8c défenfives, & on lui
confie les prifonniers de diftinôion. La marque de fa
dignité eft un bâton couvert d’argent. Il eft armé
d’un cimeterre , d’un arc , & de fléchés. Le grand-
feigneur a coutume de choifir parmi les officiers de
ce rang, ceux qu’il envoyé en ambaffade vers les autres
princes.
On les regarde dans l’intérieur de l’empire comme
des officiers de mauvais augure ; car ils font ordinairement
chargés d’annoncer aux bachas 8c aux autres
grands les ordres du fultan, quand il leur demande
leur tête.
Les chiaous font commandés par le chiaous-bafchi ;
officier qui affifte au divan, où il introduit ceux qui
y ont des affaires. Hfl. ottom. (G)
CHIAPA, ( Géog. ) ville de la Grece fur les côtes
de la Morée.
j;C h ia p a , ( Géog.') province de l’Amérique fep-
Eentrionale , dans le Mexique. Elle eft très-fertile ;
il s’y fait un grand commerce de cochenille, cacao,'
&c.
C hiapa de los Indios , ( Géog. ) grande ville
de l’Amérique feptentrionale au Mexique , dans la
province de Chiapa. Long. 284. lat. rS, 6V
C hiapa-el-Re a l , ( Géog.) ville de l’Amérique
feptentrionale au Mexique , dans la province de
Chiapa. Long. 284. lat. 1Ç. 20.
CHIARI , ( Géog. ) petite ville d’Italie dans la
Breffe, proché d’Oglio.
CHI AROMONTE, ( Géog.) ville d’Italie en Sicile
, dans la vallée de .Noto, Long. 32. z 5. latit.
3 7 - i -
* CHIARVATAR, f. m. ( Comm. ) c’eft en Perfe,
8c particulièrement à Bender , à Congo , ce qu’on
appelle en France un doüannier ou un barager. Cet
officier leve un droit fur les denrées qui entrent , 8c
ce droit eft proportionnel au poids. Les perfonnes
même n’en font pas exemptes ; elles font eftimées
les unes dans les autres à trente-trois marcs du poids
de fix livres , c’eft-à-dire à cent quatre - vingts-dix-
huit livres. Or le marc de fix livres eft de huit gazes,
8c les huit gazes de quatre fous ; d’où il eft facile
d’avoir en fous ce que chaque perfonne paye d’entrée.
Voye^ les dicl. du Comm. & de Trév.
CHIASCIO , ( Géog. ) riviere d’Italie qui prend
fa fource dans l’Apennin, 8c qui va fe jetter dans le
Tibre.
CHIAVARI, ( Géog. ) petite v ille d’Italie dans les
états de la république de Genes.
CHIAVASSO, ( Géog. ) ville forte d’Italie en Piémont
, à peu de diftance du Pô.
CHIAVENNE, ( Géog. ) grande ville de Suiffe au
pays des Grifons, près du lac de Corne. Long.zy. 4.
lat. 4<r. 1$.
* CHIBRATH, ( Hiß. anc. ) mefure de diftance
chez les Hébreux. Elle etoit de mille coudées judaïques
; ce qui revenoit à quatorze cents foixante-huit
piés romains fix pouces, ou à deux ftades 8c demie.
La loi ne permettoit pas aux Juifs de faire plus de
deux chibraths un jour de fabbat.
CHICABAUT ou BOUTELOF, f. m. ( Marine. )
c’ eft une piece de bois longue 8c forte, qu’on met à
l ’avant d’un petit bâtiment pour lui fervir d’éperon.
Voyei Boute de lo f . (Z )
CHICACHAS, f. m. pl. ( Géog. ) peuple fauvage
de l’Amérique feptentrionale, dans la Louifiane- Ces
Indiens regardent comme une grande beauté d’avoir
le vifage plat.
CH ICA S, ( lo s ) Géog. peuples de l ’Amérique
méridionale au Pérou, dans l’audience de los Char-
cas. Il eft fournis aux Efpagnols.
CHICANE, f. f. ( Jurifpr. ) en terme de Palais, fe
prend pour l’abus que l’on fait des procédures judiciaires
; comme lorfqu’une partie qui eft en état de
défendre au fond, fe retranche dans des exceptions
8c autres incidensillufoires 8c de mauvaife f o i , pour
tirer l’affaire en longueur, ou pour fatiguer fon ad-
verfaire , 8c quelquefois pour furprendre le juge
même. ( A )
CHICANER, ( Gramm. ) v. aft. qui fe prend dans
le même fens que le fubftantif chicane , 8c dont on
ufe quelquefois métaphoriquement hors du palais.
C hicaner le vent, ( Mar. ) c’eft, lorfque le vent
n’eft pas favorable à la route, faire des bordées tantôt
d’un côté, tantôt de l’autre, ou pour s’approcher;
du vent, ou pour le difpute,r, 8c mettre fous le vent
un vaiffeau qu’on veut cpmbattre. (Z )
CHICANEUR, f. m. (Jurifpr. ) en termes de Palais
, eft celui qui forme des incidens inutiles 8c de
mauvaife foi. Cette qualification de chicaneur eft une
injure grave lorfqu’elle eft appliquée mal à-propos,
fur - tout fi c’eft contre des perfonnes de quelque
confidération. (A )
CHICHESTER, (Géog.) ville d’Angleterre dans
la province de Suffex, dont elle eft capitale. Long.
i-C55. l-at.5 o .5o.
■ CHICHIMEQUES, ( les) Géog. peuple fauvage
de l’Amérique feptentrionale au Mexique, du côté
du Méchoacan. Ces Indiens n’ont ni gouvernement
ni culte, 8c demeurent dans les deferts 8c les forêts.
Il n’en refte plus guere aujourd’hui.
CHICON, (Jdrd.) voye{ L aitue.
CHICORÉE y chicorium y f. f. (Hifl. nat. bot.) genre
de plante à fleurs composées de demi-fleurons portés
fur des embryons, 8c foûtenus par le calice qui fe
refferre dans la fuite, 8c devient, pour ainfi dire,
une capfule dans laquelle il y a des femences angu-
leufes qui reffemblent en quelque façon à un coin,
8c qui portent la marque d’un ombilic. Tournefort,
infi. rei herb. Voye^ Plan t e . ( 1 )
C hicoré e s a u v a g e , (Matière médicale.) cette
plante fournit à la Médecine beaucoup d’exeellens
remedes, tant magiftraux qu’officinaux.
Elle eft de l’ordre des plantes extra£fives*ameres
8c laiteufes, ou très-legerement réfineufes.
Ses verti^tpeuvent fe réduire à celles-ci : elle eft
tonique, ftomachique, fébrifuge; elle eft auffi faiblement
purgative & diurétique, rafraîchiffante 8c
tempérante. C’eft à ces différens titres qu’on remployé
dans les obftruéHons commençantes, fur-tout
du foie, dans la jauniffe, la cachexie, les affe&ions
mélancholiques,'les ardeurs d’entrailles, les fievres-
intermittentes, 8c dans tous les cas où on en a vue
de lâcher doucement le ventre, de faire couler la bile
8c les humeurs inteftinales, de pouffer même Iegere-
ment par les urines.-
Les préparations magiftrales de la chicorée fe ré-
duifentau-fitc qu’on jire dé fes feuilles , à l’infufion ÿ
à la déco&ion de fes feuilles 8c de fa racine.
Lés préparations officinales:font l’eair, diftillée'de
la plante: fraîche ; l’extrait , le firop fimple fait avec
fan fuc ; le firop compofé dont nous allons donner la
eompofition d’après la pharmacopée de Paris, 8c le
fel lixiviel qu’on retire defes cendres. HjE
D’ailleurs fa racine entre dans le decoBum rubrum
dedq.pharmacopée de Paris,: dans le catholicum; les
feuilles entrent dans le firop à’eryfimum compofé ; le
fuc dans les pilules angéliques, &c.
- Sirop, de c/ùcorée compofé: ^ racines-' de' chicorée
fauvage ? quatre onces ; de piffenlir, de chiendent',
de chaque une once ; feuilles dè chicorée fauvage, fix
onces; d’aigremoine, d’hépatique<'d’eau, de -piffen-
Kt;, de: fumeterre ;-de houblon, -de fcolopendre, de
chaque trois ônces';'de'politric, de capillaire.de Montpellier,
deeufeute, de chiqué deux onces ; bayes ou
fruits d’alkekenge;- deux nonces: faites cuire» le* tout
dans vingt livres d’eauxommune que: vous_ réduirez
à douze livres ; diflolvez- dlans la•colature-fejzelivres
de beau fucre ; clarifiez félon l’art, 8c »faites cuire en
confiftance de miel épais. D ’autre part, ^ 'éau commune,
diuit; livres,: dans-laquelle faites- infufér pendant
vingt-quatre hepres’au bain'marie dans uoevaifr
feau fermé, rhubarbe ■ choifie coupée menu, fix on-;
ces;: tentai eitrin, cauelle, de chaque demi-once:1
paffez 8c exprimez , 8c ajoutez la colature au, firop.
fufdit ; mêlez exactement, 8c achev,ez-en la cuite à;
feu lent féloh l’art. ’ . ; « -
- : HoMhme .que.li canefle,8c le fantal eitrin.qu’on
employoit, autrefois;pour corrèûif ordinaire /de la,
ïhubarbe-, paroiffent affez- inutiles-ici que fi dèsob.-i
fefrvations particulières venoient à nous apprendre'
qu’ils .font de quélqü-uïilité dans cette eompofition, i l
faudrôit, félon la pratique des bons artifteS, ne les.
ajoüter que lorfque le firop féroit fur la fin de fa- cuite,
& les y -biffer-infufer même après la cuite, jufqu’à'
ce qu’il fiit refroidi ;' dans ce cas .on feroit obligé de
Jes mettre.dans, unnoüet. félon l’ufage ordinaire. L e .
firop de chicorée compofé eft un purgatif leger fort
ufité dans notre pratique : on le fait entrer à la dofe
d’une ou de deux onces dans les potions purgatives ;
il purge affez bien les enfans à la dofe d’une once ou
d ’une once 8c demie ; 8c il n’eft pas difficile de le leur
faire prendre, foitfeul, foit délayé dans un peu d’eau.
On s’en fert auffi avec fuccès dans les maladies chroniques,
quand on veut purger les malades doucement,
8c pendant plufieurs jours de fuite.
Le fuc, l’eau diftillée, l’extrait, le firop fimple ,
8c le fel lixiviel de ckiccrèe, fc préparent chacun
comme la pareille fubftance tirée d’une plante quelconque.
Hoyes^ S u c , Eau d is t il l é e , Ex t r a i t ,
Sirop s im p l e , & Sel lixiv iel.
Le piffenlit eft le fuccédanée ordinaire de la chicot
C h icoré e sa u v a g e , (Médecine, Diete.) quelques
perfonnes mangent en falade la chicorée amere
verte; le plus grand'nombre ne fauroit pourtant s’en
accommoder à caufe de fa grande amertume ; mais
elle s’adoucit beaucoup par la culture, qui la blanchie
auffi, 8c la rend très-tendre ; dans cet état, il eft peu
de pèrfonnes qui ne la mangent volontiers en falade
avec l ’huile ; le vinaigre 8c le fel; on avec le fucre 8c
le jus de citron où d’orange. La chicorée verte, avec
toute fon amertume, eft très-célébrée foit à'titre de
médicament, foit à titre d’aliment dans diverfes ma--
ladies, principalement lorfqu’il eft queftion deréfou-
dré, de déterger, de tempérer. Geoffroy, Mat. med.
Foye{ L egume & Salad e.
CHICOTS, f. m. pl. (Jardin.) quand le bois taillis
n’eft pas coupé affez bas1, îl fe trou ve des chicots pour
faire des'fouches que l’on ne peut ôter: fi on les écla-.
te à coups de coignee , cela gâte 8c ruine les rochers
des taillis^ (K ) ..ji.
C h ic o t , (Maréch.) il peut arriver qu’un cheval
fè mette dans, le .pié.'jenréouitant ÿ'.iin xfdcot ,;qui perçant
la. foie 8c pénétrant jtifqu’air v if , devient plus
ou moins. dahgëfeux , ,félon qu’il -eft'plus ou moins
enfoncé dans ;lfe pié. Foye\ En CLOUER, voye^ auffi.
C hev al; ( F ) v
L:GHIGU1EN , (Géog'i). ville 8c royaume :d’Afie ,
dépèndant de l’empirerdu -Japon -, dans; l ’île de Say->
cokJ
CHIEJ-.EFA, (Géog!) ‘ville forte de là Turquie en
Europe dans la Morée ; près du golfe de Goron. Lo/ig*
40 .‘6'idat. 26. 5o '.'■ ■ ! t-,
•• CHIEMSÉE, ( Géog..); ville d’Allemagne, en Ba-
viere fur les confinsdq paiys.de Salt-zbôurg , dans une
île au milieu du lac de Chièmfée.* b]
■ ‘CHIEN, caniSy f. m. (Hifl. nat, Zoolog.) ranimal
quadrupedë,:le plus familier de tous les annnaux'do-
meftiques,; auffi a-t-pii-donné fon nom à un genre d’animaux
pgtnus caninum..On.a-compris.dans ce,genre
le l o u p le renardy laeivette, le blaireau, ia^ioutre,
&c. afin ;dé donner une idée des, principaux, caractères
diftinftifs de ces'animaux.par un objetjie; c.om-
paraifon bien connu.. Les. animaux ,du -genre des
chiens different de 'ceux du genre-, des chats, ,-en ce
qu’ils ont le mufeau plus.alongé; leurs, dènts. font
en plus grand nombre,. & fitjiées différemment ; il y
en a quarante, féize molaires, fixiheifives,- entre
lefquelles deux canines qui font alongées; ces d.ents
ont .auffi été'appellées. canines dans les 'autres, ani-*
maux où elles le trouvent, comme dans le. chien,y par-
ee;qur’elles.font ordinairement pointues 8c plusjon-
gués que les autres. Les chiens n’ont point de: clavi-
cùlesjilsont un os dans'la verge, &c. M. Linneus
donne, pour, caraâeres génériques les mammelles
qui font au .nombre, de dix;: quatre fur la poitrine,
8c fix fur lë ventre ; 8c les doigts, des piés., il y en
a cinq à ceux de devant , ,8c quatre à ceux de derrière.
Cet auteur ne met que le loup, le renard oc
l’by.epe ay ecie .chien*