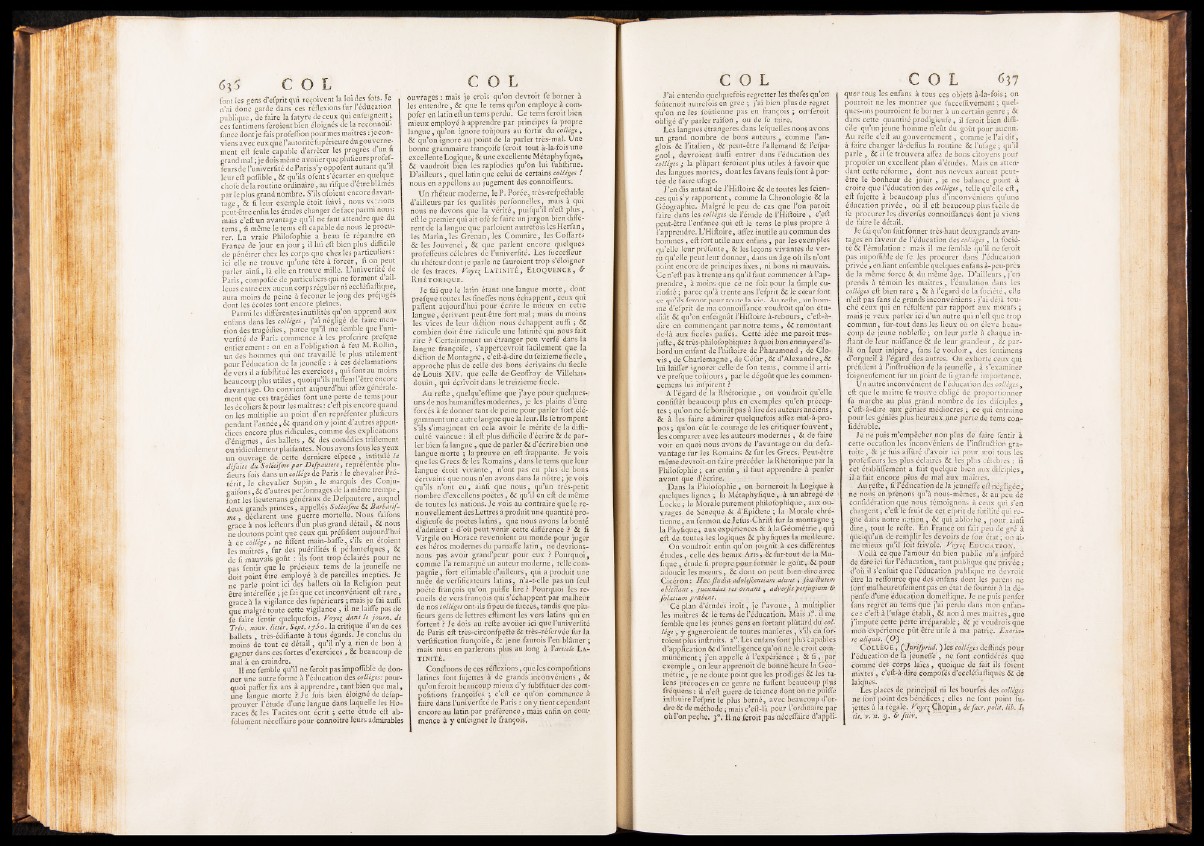
TJ
6 3 S C O _i
font les gens d’efprit qui reçoivent la loi clés fots. Je
n’ai donc garde dans ces réflexions fur l’éducation
publique, de faire la fatyre de ceux qui enleignent ;
ces fentimens feroient bien éloignes de la recônnoif-
fance dont je fais profeffion pourmes maîtres : je conviens
avec eux que.l’autorité fuperieure du gouvernement
eft feule capable d’arrêter les progrès d un li ,
grand mal ; je dois même avoiier que plufieurs profef-
l'eursde l’iiniverfité de Paris s’y oppofent autant qu’il
leur eft poffible, 8c qu’ ils ofent s’écarter en quelque
chofe de la routine ordinaire, au rifque d’être blâmés
par le plus grand nombre. S’ils ofoient encore davantage
, & fi leur exemple étoit fu iv i, nous verrions
peut-être enfin les études changer de face parmi nous:
mais c’eftun avantage qu’il ne faut attendre que du
tem s, fi même le tems eft capable de nous le procurer.
La vraie Philofophie a beau fe répandre en
France de jour en jour ; il lui eft bien plus difficile
de pénétrer chez les corps que chez les particuliers :
ici elle ne trouve qu’une tête à forcer, fi on peut
parler ainfi, là elle en trouve mille. L ’univerfité de
P aris, compofée de particuliers qui ne forment d’ailleurs
entre eux aucun corps régulier ni eccléfiaftique,
aura moins de peine à fecouer le joug des préjugés
dont les écoles font encore pleines.
Parmi les différentes inutilités qu’on apprend aux
enfans dans les collèges, j’ai négligé de faire mention
des tragédies, parce qu’il me femble que l’uni-
verfité de Paris commence à les proferire prefque
entièrement : on en a l’obligation à feu M.Rollin,
un des hommes qui ont travaillé le plus utilementv
pour l’éducation de la jeuneffe : à ces déclamations
de vers il a fubftitué les exercices, qui font au moins
beaucoup plus u tile s, quoiqu’ils puffent l’être encore
davantage. On convient aujourd’hui affez généralement
que ces tragédies font une perte de tems pour
les écoliers & pour les maîtres : c’eft pis encore quand
on les multiplie au point d’en repréfenter plufieurs
pendant l’année, 8c quand on y joint d’autres appendices
encore plus ridicules, comme des explications
d’énigmes, des b allets, 8c des comédies triftement
ou ridiculement plaifantes. Nous avons fous les yeux
un ouvrage de cette derniere efpece , intitulé la
défaite du Solècifme par Defpautere, repréfentée plufieurs
fois dans un collège de Paris : le chevalier Prété
rit, le chevalier Su p in , le marquis des Conju-
gaifons, & d’autres perfonnages de la même trempe,
font les lieutenans généraux de D efpautere, auquel
deux grands princes, appellés Solècifme 8c Barbarif-
me, déclarent une guerre mortelle. Nous faifons
grâce à nos lefteurs d’un plus grand détail, 8c nous
ne doutons point que ceux qui préfident aujourd’hui
à ce collège, ne nffent main-baffe, s’ils en étoient
les maîtres, fur des puérilités fi pédantefques, 8c
de fi mauvais goût : ils font trop éclairés pour ne
pas fentir que le précieux tems de la jeuneffe ne
doit point etre employé à de pareilles inepties. Je
ne parle point ici des ballets où la^ Religion peut
être intéreffée ; je fai que cet inconvénient eft r a r e ,
grâce à la vigilance des fupérieurs ; mais je fai auffi
que malgré toute cette vigilance , il ne laiffe pas de
fe faire fentir quelquefois. Foye^ dans le journ. de
Trév. nouv. litter. Sept. rySo. la critique d’un de ces
ballets , très-édifiante à tous égards. Je conclus du
moins de tout ce d é tail, qu’il n’y a rien de bon à
gagner dans ces fortes d’exercices , 8c beaucoup de
mal à en craindre,
11 me femble qu’il ne feroit pas.impoffible de donner
une autre forme à l’éducation des collèges: pourquoi
paffer fix ans à apprendre, tant bien que m al,
une langue morte ? Je fuis bien éloigné de defap-
prouver l’ étude d’une langue dans laquelle les Ho-
races 8c les Tacites ont écrit ; cette étude eft ab-
folument néceffaire pour connoître leurs admirables
C O L
ouvrages : mais je crois qu’on devroit fe borner à
les entendre, 8c que le tems qu’on employé à coim
pofer eri latin eft un tems perdu. Ce tems feroit bien
mieux employé à apprendre par principes fa propre
langue, qu’on ignore toujours au fortir du collège,
8c qu’on ignore au point de la parler très-mal. Une
bonne grammaire françoife feroit tout à-la-fois une
excellente Logique, & une excellente Métaphyfique,
8c vaudroit bien les rapfodies qu’on lui fubftitué.
D ’ailleurs, quel latin que celui de certains collèges l
nous en appelions au jugement des connoiffeurs.
Un rhéteur moderne, le P. Porée, très-refpe&able
d’ailleurs par fes qualités perfonnelles, mais à qui
nous ne devons que la v é rité , puifqu’il n’eft p lu s,
eft le premier qui ait ofé fe faire un jargon bien different
de la langue que parloient autrefois les Herfan,
les Marin, les Grenan, les Commire, les C offarts
8c les Joüv enc i, 8c que parlent encore quelques
profeffeurs célébrés dé l’univerfité. Les fucceffeur
du rhéteur dont je parle ne fauroient trop s’éloigner
de fes traces. Foye%_ La t in it é , Elo q u en c e , &
Rhé to r iq u e .
Je fai que le latin étant une langue morte, dont
prefque toutes les fineffes nous échappent, ceux qui
paffent aujourd’hui pour écrire le mieux en cette
langue, écrivent peut-être fort mal ; mais du moins
les vices de leur diûion nous échappent auffi ; 6c
combien doit être ridicule une latinité qui pous fait
rire ? Certainement un étranger peu verfé dans la
langue françoife, s’appercevroit facilement que la
diétion de Montagne, c’eft-à-dire du feizieme fie c le ,
approche plus de celle des bons écrivains du fiecle
de Louis X IV . que celle de Geoffroy de Villehar-
douin, qui écrivoit dans le treizième fiecle.
Au refte, quelqu’eftime que j’aye pour quelques-/
uns de nos humaniftes modernes, je les plains d’être
forcés à fe donner tant de peine pour parler fort élégamment
une autre langue que la leur. Ils fe trompent
s’ils s’imaginent en cela avoir le mérite de la difficulté
vaincue : il eft plus difficile d’écrire 8r de parler
bien fa langue , que de parler 8c d’écrire bien une
langue morte ; la preuve en eft frappante. Je v o is
que les G recs & les Romains, dans.le tems que leur
langue étoit vivante , n’ont pas eu plus de bons
écrivains que nous n’en avons dans la nôtre ; je v o is
qu’ils n’ont e u , ainfi que n ous, qu’un très-petit
nombre d’excellens po è te s, 8c qu’il en eft de même
de toutes les nations. J e vois au contraire que le renouvellement
des Lettres a produit une quantité pro-
digieufe de poètes latins, que nous avons la bonté
d’admirer : d-’où peut venir cette différence ? & fi
Virgile ou Horace revenoient au monde pour juger
ces héros modernes du parnaffe latin , ne devrions-
nous pas avoir grand’peur pour eux ? Pourquoi,
comme l’a remarqué un auteur moderne, telle compagnie
, fort efhmabled’ailleurs, qui a produit une
nuée de verfificateurs latins, n’a-t-elle pas un feul
poète françois qu’on puiffe lire ? Pourquoi les recueils
de vers françois qui s’échappent par malheur
de nos collèges ont-ils fi peu de fuccès, tandis que plufieurs
gens de lettres eftiment les vers latins qui en
fortent ? Je dois àù refte avoiier ici que l’univerfité
de Paris eft très-circonfpefte 6c très-réfervée fur la
verfification françoife , 6c je ne faurois l’en blâmer ;
mais nous en parlerons plus au long à Xarticle L at
in it é .
Concluons de ces réflexions, que les compofitions
latines font fujettes à de grands'incônvéniens , 6c
qu’on feroit beaucoup mieux d’y fubffituer des com-
pofitions françoifes ; c’eft ce qü’Ôn commence à
faire dans l’univerfité de Paris : on y tient cependant
I encore au latin par préférence, mais enfin on commence
à y enfeigner le françois.
C O L
J ’ai entendu quelquefois regretter les thefes qu*on
foûtenoit autrefois en grec ; j’ai bien plus de regret
qu’on ne les foûtienne pas en françois ; ort'feroit
obligé d’y parler raifon , ou de fe taire.
Les langues étrangères dans lefquelles nous avons
un grand nombre de bons auteurs , comme l’an-
glois 6c l’italien, 6c peut-être l’allemand 8c l’efpa-
<*nol, devroient âuffi entrer dans l’éducation des
collèges ; la plupart feroient plus utiles à favoir que
des langues m ortes, dont les favans feuls font à portée
de faire ufage.
J ’en dis autant de l’Hiftoire 6c de toutes les feien-
ces qui s’y rapportent, comme la Chronologie 6c la
Géographie. Malgré le peu de cas que l’on paroît
faire dans les collèges de l’étude de l’Hiftoire , c’eft
peut-être l’enfance qui eft le tems le plus propre à
l’apprendre. L ’Hiftoire, affez inutile au commun des
hommes, eft fort utile aux enfans, par les exemples
qu’elle leur préfente, 8c les leçons vivantes de vertu
qu’elle peut leur donner, dans un âge où ils n’ont
point encore de principes fixes, ni bons ni mauvais.
C e n’eft pas à trente ans qu’il faut commencer à l’apprendre
, à moins que ce ne foit pour la fimple cu-
riofité ; parce qu’à trente ans l’efprit 6c le coeur font
ce qu’ils feront pour toute la vie. Au refte, un homme
d’efprit de ma connoiffance voudroit qu’on étudiât
6c qu’on enfeignât l’Hiftoire à-rebours, c’eft-à-
dire en commençant par notre tem s, 6c remontant
de-là aux fiecles paffés.. Cetté idée me paroît très-
jufte, 6c très-philofophique : à quoi bon ennuyer d’abord
un enfant d e l’hiftoire de Pharamond , de C lo v
is , de Charlemagne ,.de C é fa r, 6c d’Alexandre, 8c
lui laiffer ignorer celle'de fon tems, comme il arriv
e prefque fÔûjours, par le dégoût que les commen-
cemens lui infpirent ?
A l’égard de la Rhétorique , on voudroit qu’elle
confiftât beaucoup plus en exemples' qu’eh précep- .
tes ; qu’on ne fe bornât pas à lire des autéurs'anciens,
Ôc à les faire admirer quelquefois; affez^ mal-à-propos
; qu’on eût le courage de les critiquer foûvent',
les comparer avec les auteurs modernes , 8t de faire
voir en quoi nous avons de l’avantage ou du defa-
vantage fur les Romains 8c fur les Grecs. Peut-être
même devroit-on faire précéder la Rhétorique par la.
Philofophie ; car enfin, il faut apprendre à penfer
avant que d’écrire. :
Dans la Philofophie , on borneroit la Logique à
quelques lignes ; la Métaphyfique , à un abrégé de <
Locke ; la Morale purement philofophique, aux ouvrages
de Séneque 6c d’Epiûete ; la Morale chrér
tienne,, au fermonde Jefus-Chrift fur la montagne ;
la Phyfique, aux expériences 8c à la Géométrie, qui.
eft de toutes les;logique,? & phyfiques la meilleure.
On voudroit enfin qu’on joignît.à ces.différentes
étu d e s, celle des beaux Arts, 6c fur-tout de la Mu-
fique, étude fi propre pOur.former le g'oûtr;6c pour
adoucir les m oeurs, 6c dont on peut bien-dire avec
Cicéron: Hoec Jludia adolefcentiam alunt y. fencclutcrn
obleciant, jucundas res ornant, adverfts pe/fugium &
(olatium proebent.
' Ce plan d’études iro it, je l’av o u e , à multiplier
les maîtres 6c le tems de l’éducation. Mais iP. il me
femble que les jeunes gens en fortartt plûtard du col-
lège, y gagneraient de toutes m aniérés, s’ils en for-;
toient plus inftruits. z °. Lès enfans font plus capables
d ’application ôc d’intelligence qu’on ne le çrqit com-
nnirrërrient ; j’en appelle à l’eXpériéncé ; 6c fi par-
exemple , ôn leur apprenoit de bonne heure la G éométrie
, je ne doute point que les prodigès'ÔC les talons
précoces en ce genre ne fuffent beauèoup plus
fréquéns : il n’eft guere de fciencë dont on ne piiiffe
inftruire l’efprit le plus borné, avec beaucoup d’ordre
6c de méthode ; mais c’eft-là pour l’ordinaire par
OùFonpeçhe. 30. Il ne feroit pas néceffaire d’ajipli-
C O L 6 3 7
quer tous les enfans à tous ces objets à-la-fois ; on
pourroit ne les montrer que fucceffivement ; quelques
uns pourroient fe borner à un certain genre ; 8c
dans cette quantité prodigieufe, il feroit bien difficile
qu’un jeune homme n’eût du goût pour aucun.
Au refte c’eft au gouvernement, comme je l’ai dit,
à faire changer là-defl’us la routine 6c l’ufage ; qu’il
parle , 6c il fe trouvera affez de bons citoyens pour
propofer un excellent plan d’études. Mais en attendant
cette réforme, dont nos neveux auront peut-
être le bonheur de joiiir , je ne balance point à
croire que l’éducation des collèges, telle qu’elle eft ,
eft fujette à beaucoup plus d’inconvéniens qu’une
éducation privée, où il eft beaucoup plus facile de
fe procurer les çliverfes connoiffances dont je viens
de faire le détail.
Je fai qu’on faitfonner très-haut deux grands avantages
en faveur de l’éducation des collèges, la focié-
té 6c l’émulation : mais il me femble qu’il ne feroit
pas impoffible de fe les procurer dans l’éducation
privée, en liant enfemble quelques enfans à-peu-près
de la même force & du même âge. D’ailleurs , j’en
prends à témoin les maîtres, l’émulation dans les
collèges eft bien rare ; 8r à l’égard de la fociété, elle
ii’eft pas fans de grands incônvéniens : j’ai déjà touché
ceux qui en réfultent par rapport aux moeurs ;
mais je veux parler ici d’un autre qui n’eft que trop
commun, fur-tout dans le? lieux où on éleve beaucoup
de jeune nobleffe ; on leur parle à chaque biffant
de leur naiffance 6c de leur grandeur , 6c par-
là on leur infpire , fans le vouloir, des fentimens
d’orgueil à l’égard des autres. On exhorte ceux qui
préfident àTinftruétion de la jeuneffe, à s’examiner
foigneufement fur un point de fi grande importance.
Un autre inconvénient de l’éducation des collèges,
eft que le maître fe trouve obligé de proportionner
fa marche au plus .grand nombre de fes diiciples ,
c’eft-à-dire aux génies médiocres;; ce qui entraîne
pour les génies plus henreiix.une perte de tems con-
fidéïablè.
Je ne puis m’empêcher, non plus de faire fentir à
cette Ôccafion les incônvéniens de l’inftru&ion gratuite
8c je fuis affûré d’ayoir ici pour moi tous les
profeffeurs les plus éclairés 6c les plus célébrés : fi
cet étàbliffement a fait quelque bien aux difciples,
il a fait encore plus de mal aux maîtres.
. Au refte, fi l’cducatiqn de, la jeuneffe eft négligée,
né nous en prenons qu’à nous-mêmes , 8c au peu de
çonfidération que nous .témoignons à ceux qui s’en
chargent ; c’eft le fruit de cet efprit de futilité qui re-
ghe dans nôtre nation, 6c qui abforbe , pour, ainfi
; dire., -tout le rèfte. En France on fait peu.- de gré à
quelqu'un de fernpli.rles devoirs de fon' état; on ai*
nie Mieux qu’il foit frivole. VoyeK. Education.
.Voilà ce qùè l’amour du bien public m’a infpiré
de.dire ici fur l’éducation, tant publique que privée :
d’où il s’enfuit que l’éducation publique ne devroit
êtré là reffourçe que des enfans dont les parèns né
font malheuréufement pas en état de fournir à la dé-
penfe d’unè éducation domeftique. Je ne puis penfer
fans regret au fems que j’ai perdu dans mon enfan-r
ce-: c’eft à l’ufage établi, 6c non à mes maîtres, que
j’impute cette perte irréparable ; 6c je voudroisque
rnôn 'expérience pût être litile à ma patriç. Ëxoria-
re aliqiùs. (D )
C ollège , Cjürifprud. ) les collèges deftinés pour
l’éducation de la jëunefl’e', ne font confidérés que
comme des corps laïcs, quoique de fait ils foient
mixtes , c’eft-à-dire compofés a’eccléfiaftiques 6c de
laïques.
Les places de principal ni les bourfes des collèges
nedont point dés bénéfices.; elles ne font point fu-
jettés à la régale, y?ye? <*}iopin, de facr.polit, lib, ƒ,
tit. v. 'n. & fu ir. '