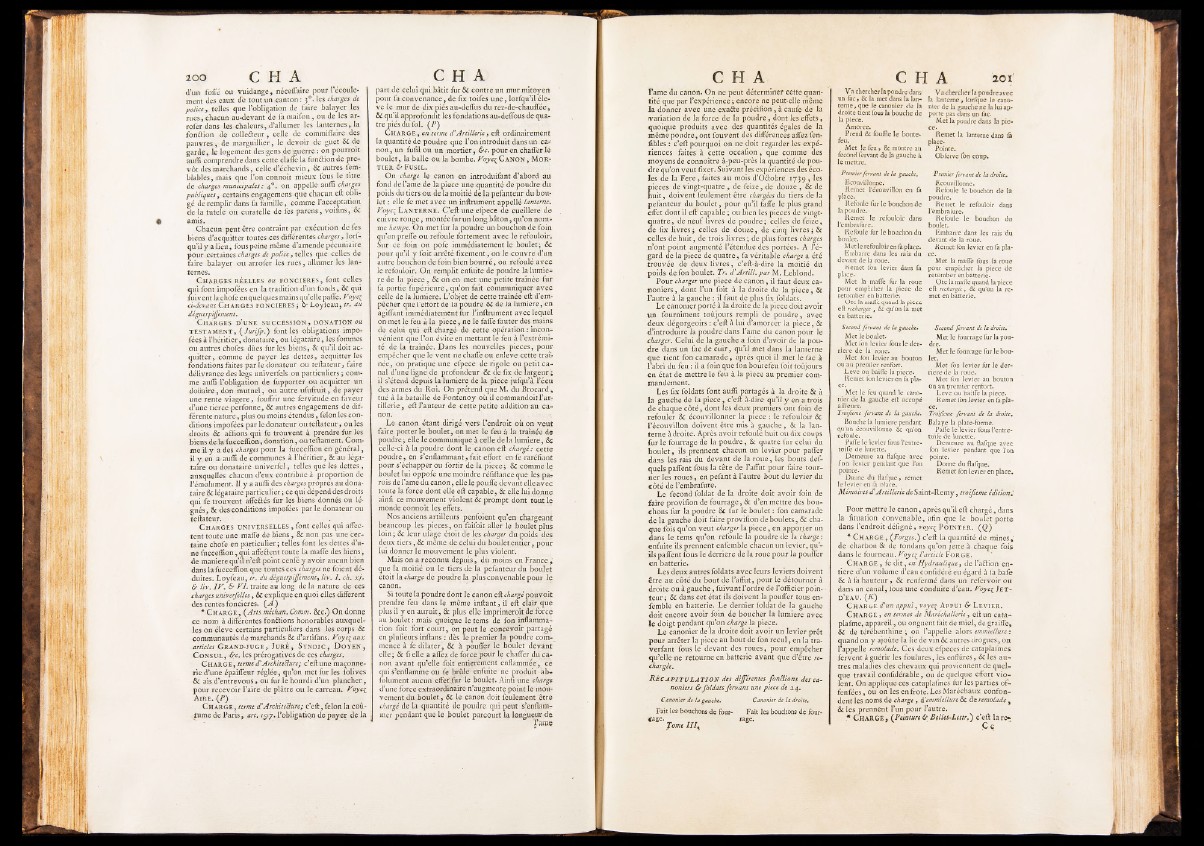
d’un foffé ou vuidange, néceffaire pouf l’écoule- |
ment des eaux de tout un canton : 3 °. les charges de
police, telles que l’obligation de faire balayer les
rues,.chacun au-devant de fa maifon, ou de les ar-
rofer dans les chaleurs, d’allumer les lanternes, la
fonction de colleâeur, celle de commiffaire des
pauvres, de marguillier, le devoir de guet 8c de
garde, le logement des gens de guerre : on pourroit
auffi comprendre dans cette claffe la fonélion de prévôt
des marchands, celle d’échevin, & autres fem-
blables, mais que l’on connoît mieux fous le titre
de charges municipales: 40. on appelle auffi charges
publiques, certains engagemens que chacun eft obligé
de remplir dans fa famille, comme l’acceptation
de la tutele ou curatelle de les parens, voiùns, 8c
0 amis.
Chacun peut être contraint par exécution de fes
biens d’acquitter toutes ces différentes charges , lorf-
qu’i l y a li eu, fous peine même d’amende pécuniaire
pour .cer.taines charges de police, telles que celles de
faire balayer ou arrofer les rues, allumer les lanternes.
C harges réelles ou fon ciè r e s , font celles
qui font impofées en la tradition d’un fonds, 8c qui
liiivent la çhofe en quelques mains qu’elle palfe. Voye{
ci-devant Ch a rg es FONCIERES; & Loyfeàu, tr. du
dlgiurpijjhnent.
C harges d’une su c c e s s io n , d on at io n ou
t e s t am e n t , ( Jurifp.) font les obligations impofées
à l’héritier, donataire, ou légataire, les fommes
ou autres chofes dues fur les biens, & qu’il doit acquitter,
comme de payer les dettes, acquitter les
fondations faites par le donateur ou teftateur, faire
délivrance des legs univerfels ou particuliers ; comme
auffi .l’obligation de fupporter ou acquitter un
douaire, don mutuel, ou autre ufufruit, de payer
line rente viagère, fouffrir une fervitude en faveur
d’une tierce perfonne, 8c autres engagemens de différente
nature, plus ou moins étendus, félon les conditions
impofées par le donateur outeftateur, ou les
droits 8c aûions qui fe trouvent à prendre fur les
biens de la fucceffion, donation, outeftament. Comme
il y a des charges pour la fucceffion en général ,
il y. en a-auffi de communes à l’héritier , & au légataire
ou donataire univerfel, telles que les dettes ,
auxquelles chacun d’eux contribue à proportion de
l’émolument. Il y a auffi des charges propres au donataire
& légataire particulier; ce qui dépend des droits
qui fe trouvent affe&és fur les biens donnés ou légués,
& des conditions impofées parle donateur ou
teftateur.
C harges universelles , font celles qui affectent
toute une maffe de biens, 8c non pas une certaine
chofe en particulier ; telles font les dettes d’une
fucceffion, qui affe&ent toute la maffe des biens,
de maniéré qu’il n’eft point cenfé y avoir aucun bien
dans la fucceffion que toutes ces charges ne foient déduites.
Loyfeau, tr. du déguerpiffement, liv. I . ch. xj.
& liv. I F . & F L traite au long de la nature de ces
charges univerfelles, 8c explique en quoi elles different
des rentes foncières. (A )
* C h a r g e , (Arts méchan. Comm. 8cc.) On donne
ce nom à différentes fondions honorables auxquelles
on éleve certains particuliers dans les corps 8c
communautés de marchands 8c d’artifans. Foye^aux
flr/ic/« Grand-ju g e , Ju r é , Sy n d ic , D o y e n ,
C o n su l , O c. les prérogatives de ces charges.
C h a r g e , termed'Architecture; c’eflune maçonnerie
d’une épaiffeur réglée, qu’on met fur les folives
& ais d’entre vous, ou fur le hourdi d’un plancher,
pour recevoir l’aire de plâtre ou le carreau. Foye^
Aire. ( P )
C h a r g e , terme d*Architecture; c’eft, félon la coutume
de Paris, art. l ÿ j . l’obligation de payer de la
part de celui qui bâtit fur 8c contre un mur mitoyen
pour fa convenance, de fix toifes une, lorfqu’il éleve
le mur de dix piés au-deffus du rez-de-chauffée,
8c qu’il approfondit les fondations aurdeffous de quatre
piés.du fol. (P )
C harge , en terme d'Artillerie, eft ordinairement
la quantité de poudre que l’on introduit dans un canon
, un fufil ou un mortier, &c. pour en chaffer lé
boulet, la balle ou la bombe. Foye^ C anon , Mort
ier & Fusil.
On charge le canon en introduifant d’ abord au
fond de Famé de la piece une quantité de poudre du
poids du tiers ou de la moitié de la pefanteur du boulet
: elle fe met avec un infiniment appelle lanterne.
Foyei L anterne. C ’eft une efpece de cueillere de
cuivre rouge, montée fur un long bâton, qu’on nomme
hampe. On met fiir la poudre un bouchon de foin
qu’on preffe ou refoule fortement avec le refouloir.
Sur ce foin on pofe immédiatement le boulet; 8c
pour qu’il y foit arrêté fixement, on le couvre d’un
autre bouchon de foin bien bourré, ou refoulé avec
le refouloir. On remplit enfuite de poudre la lumière
de la piece, 8c on en met une petite traînée fur
fa partie fupérieure, qu’on fait communiquer avec
celle de la lumière. L’objet de cette traînée eft d’empêcher
que l’effort de la poudre 8c de la lumière,;en
agiffant immédiatement fur l’inftrument avec lequel
on met le feu à la piece, ne le faffe fauter des mains
de celui qui eft chargé de cette opération : inconvénient
que l’on évite en mettant le feu à l’extrémité
de la traînée. Dans les nouvelles pièces, pour
empêcher que le vent ne chaffe ou enleve cette traînée
, on pratique une efpece de rigole ou petit canal
d’une ligne de profondeur 8c de fix de largeur ;
il s’étend depuis la lumière de la piece jufqu’à l’écu
des armes du Roi. On prétend que M. du Brocard,
tué à la bataille de Fontenoy oîi il commandoit l’ar?
tillerie, eft l’auteur de cette petite addition au canon.
Le canon étant dirigé?vers l’endroit oii on veut
faire porter le boulet, on met le feu à la traînée de
poudre; elle le communique à celle de la lumière, 8c
celle-ci à la poudré dont le canon eft chargé: cette
poudre, en s’enflammant,fait effort en fe raréfiant
pour s’échapper ou fortir de la piece ; 8c comme le
boulet lui oppofe une moindre réfiftance que les pa?
rois de Famé du canon, elle le pouffe devant elle avec
toute la force dont elle eft capable, & elle lui donne
ainfi ce mouvement violent 8c prompt dont tout le
monde connoît les effets.
Nos anciens artilleurs penfoient qu’en chargeant
beaucoup les pièces, on faifoit aller le boulet plus
loin ; 8c leur ufage étoit de les charger du poids des
deux tiers, & même de celui du boiiletentier, pour
lui donner le mouvement le plus violent.
Mais on a reconnu depuis, du moins en France
que la moitié ou le tiers de la pefanteur du boulet
etoit la charge de poudre la plus convenable pour le
canon.
Si toute la poudre dont le canon eft chargé pouvoit
prendre feu dans le même inftant, il eft clair que
plus il y en auroit, & plus elle imprimeroit de forcé
au boulet: mais quoique le tems de fon inflammation
foit fort court, on peut le concevoir partagé
en plufieurs inftans : dès le premier la poudre com-_
mence à le dilater, 8c à pouffer le boulet devant
elle; & fi elle a affez de force pour le chaffer du canon
avant qu’elle foit entièrement enflammée , ce
qui s’enflamme ou fe brûle enfuite ne produit ab-
lolument aucun effet\fur le boulet. Ainfi une charge
d’une force extraordinaire n’augmente point le mouvement
du boulet, 8c le canon doit feulement être
chargé de la quantité de poudre qui peut s’enflammer
pendant que le boulet parcourt la longueur de
l’ame du canon. On ne peut déterminer cette quantité
que par l’expérience ; encore ne peut-elle même
la donner avec une exafte précifion, à caufe de la
(variation de la force de la poudre, dont les effets,
quoique produits avec des quantités égales de la
même poudre, ont fouvent des différences affez fen-
fibles : c’eft pourquoi on ne doit regarder les expériences
faites à cette occafion , que comme des
moyens de connoître à-peu-près la quantité de poudre
qu’on veut fixer. Suivant les expériences des écoles
de la Fere, faites au mois d’Ottobre 1739 , les
pièces de vingt-quatre , de feize, de douze , 8c de
huit, doivent feulement être chargées du tiers de la
pefanteur du boulet, pour qu’il faffe le plus grand
effet dont il eft capable ; ou bien les pièces de vingt-
quatre, de neuf livres de poudre; celles de feize,
de fix livres ; celles de douze, de cinq livres ; &
celles de huit, de trois livres ; de plus fortes charges
n’ont point augmenté l’étendue des portées. A l’égard
de la piece de quatre, fa véritable charge a été
trouvée de deux livres, c’eft-à-dire la moitié du
poids de fon boulet. Tr. d'Artill. par M..Leblond.
Pour charger une piece de canon, il faut deux ca-
noniers, dont l’un foit à la droite de la piece, &
l ’autre à la gauche : il faut de plus fix foldats.
Le canonier porté à la droite de la piece doit avoir
un fourniment toujours rempli de poudre, avec
deux dégorgeoirs : c’eft à lui d’amorcer la piece, &
d’introduire la poudre' dans l’ame du canon pour le
charger. Celui de la gauche a foin d’avoir de la poudre
dans un fac de cuir, qu’il met dans la lanterne
que tient fon camarade, après quoi il met le fac à
l’abri du feu : il a foin que fon boutefeu foit toujours
en état de mettre le feu à la piece au premier commandement.
Les fix foldats font auffi partagés à la droite & à
la gauche de la piece, c’eft- à-dire qu’il y en a trois
de chaque côté, dont les deux premiers ont foin de
refouler 8c écouvillonner la piece : le refouloir 8c
l’écouvillon doivent être mis à gauche, & la lanterne
à droite. Après avoir refoulé huit ou dix coups
fur le fourrage de la poudre, & quatre fur celui du
boulet, ils prennent chacun un levier pour paffer
dans les rais du devant de la roue, les bouts.def-
quels paffent fous la tête de l’affût pour faire tourner
les roues, en pefant à l’autre bout du levier du
côté de l’embrafure.
Le fécond foldat de la droite doit avoir foin de
faire provifion de fourrage, & d’en mettre des bouchons
fur la poudre 8c fur le boulet : fon camarade
de la gauche doit faire provifion de boulets, 8c chaque
fois qu’on veut charger la p iece, en apporter un
dans le tems qu’on refoule la poudre de la charge :
enfuite ils prennent enfemble chacun un levier, qu’ils
paffent fous le derrière de la roue pour la pouffer
en batterie.
Les deux autres foldats avec leurs leviers doivent
être au côté du bout de l’affût, pour le détourner à
droite ou à gauche, fuivant l’ordre de l’officier pointeur
; & dans cet état ils doivent la pouffer tous en-
fepible en batterie. Le dernier foldat de la gauche
doit encore avoir foin de boucher la lumière avec
le doigt pendant qu’on charge la piece.
Le canonier de la droite doit avoir un levier prêt
pour arrêter la piece au bout de fon recul, en la tra-
verfant fous le devant des roues, pour empêcher
qu’elle ne retourne en batterie avant que d’être re-
chargée.
RÉ CAP ITULA TION des différentes fonctions des canonier
s & foldats fervant une piece de 24.
Canonier de la gauche. Canonier de la droite.
Fait les bouchons de four- Fait les bouchons de four-
cage. rage.
Jome III,
Va chercher la poudre dans
un fac, & la met dans la lanterne
, que le canonier de la
droite tient fous la bouche de
la piece.
Amorce.
Prend & fouffle le boutefeu.
Met le feu, & montre au
fécond fervant de la gauche à
le mettre.
Premier fervant de la gauche.
Ecouvillonne.
Remet l’éeouvillon en fa
place.
Refoule fur le bouchon de
la poudre.
Remet le refouloir dans
l’embrafure..
• Refoule for le bouchon du
boulet.
Met le refouloir en fà place.
Embarré dans les rais du
devant de la roue.
Kemet fon levier dans fa
placé.
Met la maffe for la roue
pour empêcher la piece de
retomber en batterie.
Ote la maffe quand la piece
eft rechargée , & qu’on la met
en batterie.
Va chercher la poudreavec
la lanterne, lorfque le canonier
de la gauche ne la lui apporte
pas dans un fac.
Met la poudre dans la pièce
Remet la lanterne dans là
place.
Pointe.
Obferve fon coup.
Premier fervant de la droite.
Ecouvillonne.
Refoule le bouchon de la
poudre.
Remet le refouloir dans
l’embrafure.
Refoule le bouchon du
boulet.
Embarré dans les rais du
devant de la roue.
Remet fon levier en fa place.
Met la maffe fous la roue
pour empêcher la piece de
retomber en batterie.
Ote la maffe quand la piece
eft rechargée, & qu’on la remet
en batterie.
Second fervant de la gauche. Second fervant de la droite.
Met le boulet. Met le fourrage fur la pou-
Met fon levier fous leder- dre.
riere de la roue. Met le fourrage for le bou-
Met fon levier au bouton let.
ou au premier renfort. Met fon levier for le der-
Leve ou baiffe la piece. riere de la roue.
Remet fon levier en fa place.
Met fon levier au bouton
ou au premier renfort.
Met le feu quand le canonier
Leve ou baiife la piece.
de la gauche eft occupé
Remet fon levier en fà place.
ailleurs.
Troifeme fervant de la gauche.
Troifeme fervant de la droite.
Bouche la lumière pendant Balaye la plate-forme,
qu’on écouvillonne & qu'op Paffe le levier fous l’entre-
refbule. toife de lunette.
Paffe le levier fous l’entre- Demeure au flafque avec
toife de lunette. fon levier pendant que l'on
Demeure au flafque avec pointe,
fon levièr pendant que l’on Donne du flafque.
pointe. Remet fon levier en place.
Donne du flafque, remet
le levier en fà place.
Mémoires £ Artillerie de Saint-Remy, troijîeme édition
Pour mettre le canon , après qu’il eft chargé, dans
la fituation convenable, afin que le boulet porte
dans l’endroit défigné, voyeç Po in t er . (Q )
* C h a r g e , (Forges.") c’eft la quantité.de mines,’
de charbon & de tondans qu’on jette à chaque fois
dans le fourneau. Foyeç l'article Fo rg e.
C harge , fe dit, en Hydraulique, de l’aélion entière
d’un volume d’eau confidéré eu égard à fà bafe
& à fa hauteur, 8c renfermé dans un refervoir ou
dans un canal, fous une conduite d’eau. Foyeç Jet -
d’eau. (K )
C harge d'un appui, voye^ Appui & L ev ier.
CHARGE, en termes de Maréchallerie, eft un cata-
plafme, appareil, ou onguent fait de miel, de graiffe,
8c de térébenthine ; on l’appelle alors emmiellure :
quand on y ajoute la lie de vin 8c autres drogues, on
l’appelle remolade. Ces deux efpeces de cataplafmes
fervent à guérir les foulures, les enflûres, & les autres
maladies des chevaux qui proviennent de quelque
travail confidérable, ou de quelque effort violent.
On applique ces cataplafmes fur les parties of-
fenfées, ou on les en frote. Les Maréchaux confondent
les noms de charge, d'emmiellure 8c de remolade ,
& les prennent l’un pour l’autre.
.* C h a r g e , (Peinture& Belles-Lettr.) c’eft lare»
Ç Ç