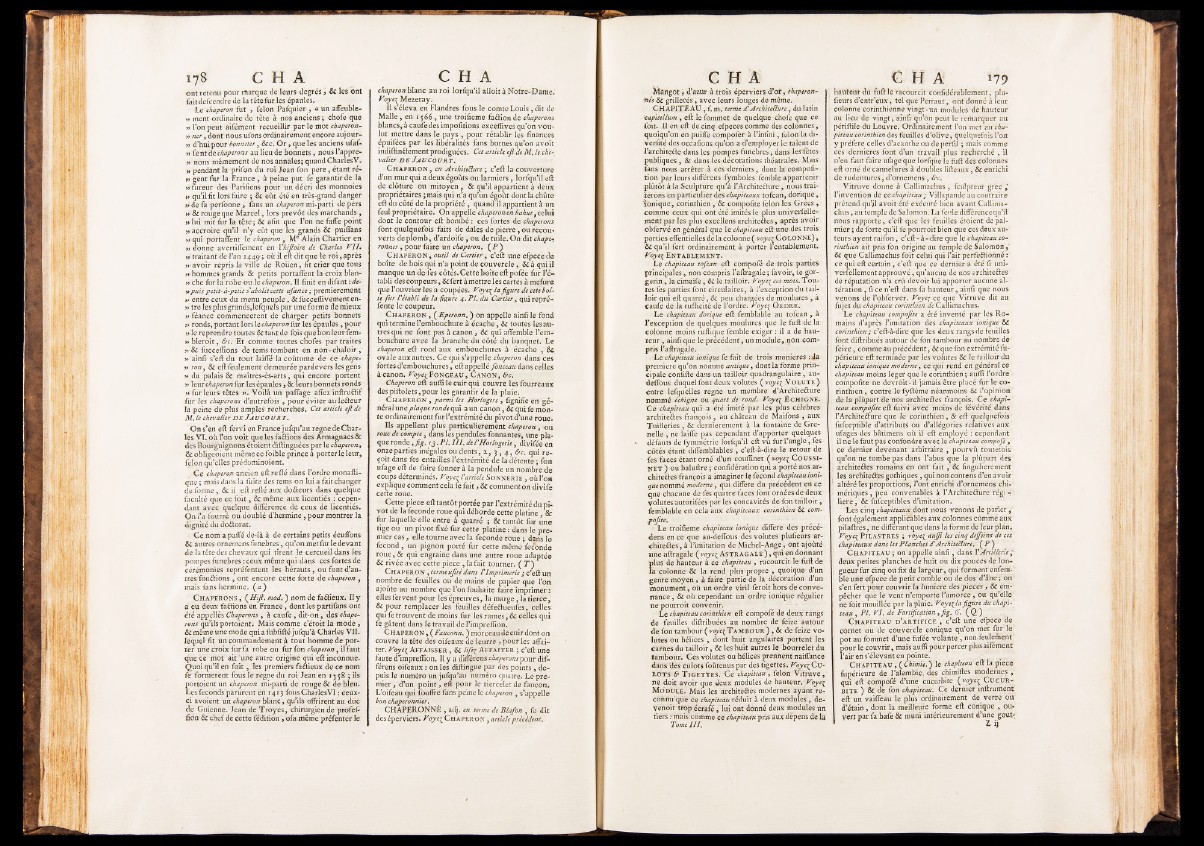
178 C H A
ont retenu pour marque de leurs degrés y & les ont
feitdefcendre de la tête fur les épaules.
Le chaperon fut , félon Pafquier , « un affeuble-
» ment ordinaire de tête à nos anciens ; chofe que
» l’on peut aifément recueillir par le mot chaperon-
» ner, dont nous ufons ordinairement encore aujour-
» d’hui pour bonneter, & c . Or , que les anciens ufaf-
» fent de chaperons au lieu de bonnets, nous l’appre-
» nom mêmement de nos annales; quand CharlesV.
» pendant la prifon du roi Jean fon pere, étant ré-
» gent fur là France, à peine put fe garantir de la
» f ureur des Parifiéns pour un décri des monnoies
» qu’il fit lors faire ; & eût été en très-grand danger
» de fa perfonne » fans un chaperon mi-parti de pers
» & rouge que Marcel, lors prévôt des marchands ,
» lui mit fur la tête ; & afin que l’on ne faffe point
» accroire qti’il n’y eût que les grands & puiffans
» qui portaffent le chaperon , Me Alain Chartier en
» donne avertiffement en Vhifioire de Charles V I L
» traitant de l’an 144^; où il eu dit que le r o i, après
»•avoir repris la ville de Roiien, fît crier que tous
» hommes grands & petits portaffent la croix blan-
» che fur la robe ou le chaperon. Il finit en difant : de-
»puis petit-à-petit s'abolit cette ufance ; premièrement
» entre ceux du menu peuple, &fucceflivementen-
» tre les plus grands,lefquels par une formé dé mieux
» féance commencèrent de charger petits bonnets
» ronds, portant lors le chaperon fur les épaules, pour
» le reprendre toutes & tant de fois que bon leur fem-
» bleroit, &c. Et comme toutes chofes par traites
» & fucceffions de tems tombent en non- chaloir,
» ainfi s’eft du tout laiffé la coûtume de ce ckape-
» ron, & eft feulement demeurée pardevers les gens
» du palais & maîtres-ès-arts, qui encore portent
» leur chaperon fur les épaules , & leurs bonnets ronds
» fur leurs têtes ». Voilà un paffage affezinftruôif
fur les ckapêrons d’autrefois , pour éviter au le&eur
la peine de plus amples recherches. Cet article efi.de
M. le chevalier d e J a u CO U RT .
On s’en eft fervi en France jufqu’au régné de Charles
VI. où l’on voit que les faâions des Armagnacs &
des Bourguignons étoient diftinguées par le chaperon,
ôcobligeoient m êmecefoible prince à porter le leur,
félon qu’elles prédominoient.
Ce chaperon ancien eftrefté dans l’ordre monafti-
que ; mais dans la fuite des tems on lui a fait changer
de forme, & il eft refté aux doÛeurs dans quelque
faculté que ce fo i t , & même aux licentiés : cependant
avec quelque différence de ceux de licentiés.
Ôn l’a fourré ou doublé d’hermine, pour montrer la
dignité du dottorat.
C e nom a paffé de-là à de certains petits écuffons
& autres ornemens funèbres, qu’on met fur le devant
•de la tête des chevaux qui tirent le cercueil dans les
pompes funèbres :ceux même qui dans ces fortes de
cérémonies repréfentent les hérauts , ou font d’autres
fondions , ont encore cette forte de chaperon ,
mais fans hermine. ( a )
C haperons , ( Hifi. mod,') nom de faôieux. Il y
a eu deux fàftions en France, dont les partifans ont
été appellés Chaperons , à caufe , dit-on, des chaperons
qu’ils portoient. Mais comme c’étoit la mode ,
&même une mode quiafubfifté jufqu’à Charles VII.
lequel fit un commandement à tout homme de porter
une croix fur fa robe ou fur fon chaperon, il faut
que Ce mot ait une autre origine qui eft inconnue.
Quoi qu’il en f o i t , les premiers faôieux de ce nom
fe formèrent fous le régné du roi Jean en 1358 ; ils
portoient un chaperon mi-parti de rouge & de bleu.
Les féconds parurent en 1413 fous CharlesVI : ceux-
c i avoient un chaperon blanc, qu’ils offrirent au duc
de Guienne. Jean de Troÿes , chirurgien de profef-
fion ôc chef de cette fédition , ofa même préfenter le
C H A
chaperon blanc au roi lorfqu’il alloit à Notre-Dame.
Voye[ Mezeray.
Il s’éleva en Flandres fous le comte Louis , dit de
Malle, en 1566 , une troifieme faôion de chaperons
blancs, à caufe des impofitions excellives qu’on voulut
mettre dans le pays , pour rétablir les finances
épuifées par les libéralités fans bornes qu’on avoit
indiftinôement prodiguées. Cet article efi de M. le chevalier
d e J a u c o u r t .
C haperon , en Architecture ; c’eft la couverture
d’un mur qui a deux égoûts ou larmiers, lorfqu’il eft
de clôture ou mitoyen, & qu’il appartient à deux
propriétaires ;mais qui n’a qu’un égoût dont la chûte
eft du côté de la propriété , quand il appartient à un
feul propriétaire. On appelle chaperon en bahut, celui
dont le contour eft bombé : ces fortes de chaperons
font quelquefois faits de dales de pierre, ou recouverts
de plomb, d’ardoife , ou de tuile. On dit chaperonner
, pour faire un chaperon. ( P )
C h a p ero n , outil de Cartier, c’eft une efpece dê
boîte de bois qui n’a point de couvercle, & à qui il
manque un de fes côtés. Cette boîte eft pofée fur l’établi
des coupeurs, & fert à mettre les cartes à mefure
que l’ouvrier les a coupées. Voye{ la figure de cete boîte
fur l'établi de la figure 4. PI. du Cartier, qui repréfente
le coupeur.
C haperon , ( Eperonn. ) on appelle ainfi lé fond
qui termine l’embouchure à écache, & toutes les autres
qui ne font pas à canon, & qui affemble l’embouchure
avec la branche du côté du banquet. Le
chaperon eft rond aux embouchures à écache , &
ovale aux autres. Ce qui s’appelle chaperon dans ces
fortes d’embouchures, eftappellé fonceau dans celles
à canon. Voye^ Fo n c e a u , C a n o n , & c.
Chaperon eft aufli le cuir qui couvre les fourreaux
despiftolets,pour les garantir de la pluie.
•Chaperon , parmi les Horlogers, fignifie en général
une plaque ronde qui a un canon, & qui fe monte
ordinairement fur l’extrémité du p ivot d’une roue.
Ils appellent plus particulièrement chaperon, ou
roue de compte, dans les pendules tonnantes, une plaque
ronde ,fig. 13. PI. I II. de VHorlogerie , divifée en
onze parties inégales OU dents, z , 3 , 4 , &c. qui reçoit
dans fes entailles l’extrémité de la détente ; fon
ufage eft de faire fonner à la pendule un nombre de
coups déterminés. Voyeurarticle Sonnerie , où l’on
explique comment cela fe fait * & comment on divife
cette roue.
Cette pieee eft tantôt portée par l’extrémité du pivot
de la fécondé roue qui déborde cette platine, &
fur laquelle elle entre à quarré ; & tantôt fur une
tige ou un pivot fixé fur cette platine : dans le premier
cas, elle tourne avec la fécondé roue ; dans le
fécond, un pignon porté fur cette même fecbnde
roue, & qui engraine dans une autre roue adaptée
& rivée avec cette piece , la fait tourner. ( T )
C haperon , termeujîté dans CImprimerie ; c’eft un
nombre de feuilles ou de mains de papier que l’on
ajoûte au nombre que l’on fouhaite faire imprimer :
elles fervent pour les épreuves, la m arge, la tierce,
& pour remplacer les feuilles défe&ueufes, celles
qui fe trouvent de moins fur les rames, & celles qui
le gâtent dans le travail de l’imprefîion.
C haperon , ( Fauconn. ) morceau de cuir dont on
couvre la tête des oifeaux de leurre , pour les affai-
ter. Voye^ Affaisser , & ///^ A ffaiter ; c’eft une
faute d’impreflion. Il y a différens chaperons pour dif-
férens oifeaux : on les diftingue par des points , depuis
le numéro un jufqu’au numéro quatre. Le premier
, d’un point, eft pour le tiercelet de faucon.
L’oifeau qui fouffre fans peine le chaperon , s’appelle
bon chaperonrtier.
CHAPERONNÉ, adj. en terme de Blafdn , fe dit
des éperviérs. Voye^ C haperon , article précédent.
C H A
MàrigOt \ d’azûr à trois éperviers d’o î , ehaperon-
toés & grilletés, avec leurs louges dé même.
CHAPITEAU, f. m. terme d'Architecture, du latin
'capitellum , eft lefomnlet de quelque chofe que ce
■ foit. Il en eft de cinq efpeces comme des colonnes,
quoiqu’on en puiffe compofer à l’infini, félon la di»
verfité des occafions. qu’on a d’employer le talent de
l ’architeâe dans les pompes funèbres, dans les*fêtes
publiques, & dans les décorations théâtrales. Mais
•fans nous arrêter à ces derniers, dont la'compofi- :
tiori par leurs différens fymboles femble appartenir
plutôt à la Sculpture qu’à l’Architecture, nous traiterons
èn particulier des chapiteaux tofcan, dorique,
Monique,.corinthien, & compofite félon les Grecs ,
comme ceux qui ont été imités le plus univerfelle-
ment par les plus excellons architectes, après avoir
obfervé en général que le chapiteau eft une des trois
parties effentielles de là colonne (,voyeç C olonne) ,
& qu’il fert ordinairement à porter l’entablement.
Voyc{ Enta b lem en t .
Le chapiteau tofcan eft compofé de trois parties
principales, non compris l’aftragale ; favoir, le gor-
gerin, la cimaife, & le tailloir. Voye%_ ces mots. T outes
fes parties font circulaires, à l’exception du taih
loir qui eft quarré, & peu chargées de moulures , à
Caufe de la rufticité de l’ordre. Voyt{ Ordre.
Le chapiteau dorique eft femblable au tofcan, à
l ’exception de quelques moulures que le fuft de la
colonne moins ruftique femble exiger : il a de hauteur
, ainfi que le précédent, un module , non compris
l’aftragale.
Le chapiteau ionique te fait de trois .maniérés : Ja
première qu’on nomme antique, dont la forme principale
confifte dans un tailloir quadrangulaire, au-
deffous duquel font deux volutes ( voyc^ .Volute )
entre lefquellés régné un membre d’Architecture
nommé échigne ou quart de rond. Voye{ É ch igne.
Ce chapiteau qui a été imité par les plus célèbres
architectes françois, au château de Maifons , aux
Tuillèries , & dernièrement à la fontaine de Grenelle
, ne laiffe pas tependant d’apporter quelques
défauts de fymmétrie lorfqu’il eft vû fur l’angle, fes
côtés étant diffemblables , c’eft-à-dire le retour de
fes faces étant orné d’un couflinet ( voye^ C oussin
e t ) ou baluftre ; considération qui a porté;nos architectes
françois a imaginer lç fécond chapiteau ionique
nommé moderne, qui différé du précédent eû ce
que chacune de fés quatre faces font o rnéesdedeux
volutes auto'riféeS par les concavités de fon tailloir,
femblable en cela aux chapiteaux corinthien & com-■
.pofite. ‘ '
Le troifieme chapiteau ionique différé dés précé-
dens en ce que au-deffous des volutes plufieurs architectes,
à l ’imitation de Michel-Ange, ont ajouté
une aftragâlé ( voye^ As t r a g a l e ) , qui en donnant
plus' de hauteur à ce chapiteau , racourcifc le fuft de
la colonne & la rend plus propre , quoique d’un
genre moyen, à faire partie de la décoration d’un
monument, où un ordre yiril feroit hors de convenance
, & où cependant un ordre ionique- régulier
ne pourroit convenir.
Le chapiteau corinthien eft compofé de deux rangs
de feuilles diftribuées au nombre de feize autour
de fon tambour (voye{T am bo ur ) , & de feize volutes
ou hélices , dont huit angulaires portent les
cariies du tailloir, &- les huit autres lé bourrèlet du
tambour. Ces volutes ou hélices prennent naiffance
dans 'dès Culots foûtenus par des tigettes'. Voye^ C ulo
t s 6* T ig e t t e s . C e chapiteau, félon Vitru ve,
ne doit avoir que.deux modules de hauteur.-
Module. Mais les archite&es modernes ayant re-
cdnüu’quë ce ckapitedu réduit à deux modules , de-
venoit trop.écrafé, lui ont donné deux modules un
tiers rmàis comme ce chapiteau pris aux dépens de la
Tome I II,
G H A 179
hauteur dû fuft lé racourcit confidérablement, plufieurs
d’entr’éux , tel qué Perraut, ont donné à leur
colonne Corinthienne vingt-un modules de hauteur
au lieu de vingt , ainfi qu’on peut le remarquer au
périftile du Louvre. Ordinairement l’on met au chapiteau
corinthien des féuilies d’olive, quelquefois l’on
y préféré celles d’acanthe où de perfil ; mais comme
ces dernieres font d’un travail plus recherché , il
n’en faut faire ufage que lorfqûe le fuft des colonnes
eft orné de cannelures à doubles lifteaux, & enrichi
de rudentures, d’ornemens, &c.
Vitruve donne à Callimachus , fculpfeur grec
l’invention de ce chapiteau ; Villapande au contraire
prétend qu’il avoit été exécuté bien avant Callimachus
, au temple de Salomon. La feule différence qu’il
nous rapporte, c’eft que les feuilles étoient de palmier
; de forte qu’il fe pourroit bien que ces deux auteurs
ayent raifon, c’eft-à-dire que le chapiteau corinthien
ait pris fon origine au temple de Salomon
& que Callimachus foit celui qui l’ait perfectionné :
ce qui eft certain, c’eft que ce dernier a été fi uni-
verlellement approuvé, qu’aucun de nos architeôes
de réputation n’a crû devoir lui apporter aucune altération
, fi ce n’eft dans fa hauteur, ainfi que nous
venons de l’obferver. Voye^ ce que Vitruve dit au
fujet du chapiteau corinthien de Callimachus.
Le chapiteau compofite a été inventé par les Romains
d’après l’imitation des chapiteaux ionique Sc
corinthien; c’eft-à-dire que les deux rangs de feuilles
font diftribués autour de fon tambour au nombre de
feize, comme au précédent, & que fon extrémité fu-
périeure eft terminée par les volutes & le tailloir du
chapiteau ionique moderne, ce qui rend en general ce
chapiteau moins léger que le corinthien ; aufli l’ordre
compofite ne devrôit- il jamais être placé fur le corinthien,
contre le fyftème néanmoins & l’opinioni
de la plupart 'de nos architeftes françois. Ce chapiteau
compofite eft fuivi avec moins de févérité dans
l’Architefture que le corinthien, & eft quelquefois
fufceptible d’attributs ou d’allégories relatives aux
ufages’ des bâtimens où’il eft employé : cependant
il ne le faut pas confondre avec le chapiteau, compofé ,
ce dernier devenant arbitraire , pourvû toutefois
qu’on ne tombe pas dans l’abus que la plûpart des
architeéfes romains en ont fait,' & fingulierement
les architeâ'es gothiques , qui non contens d’en avoir
1 altéré les pfoporfionsj l’ont enrichi d’ornemens chi-
■ mériques , peu convenables à l’Architecture régt-
liere, & füfceptibles d’imitation.
Lès cinq chapiteaux dont nous venons de parler ,•
font également applicables aux colonnés comme aux
pilaftres, ne différant que dans la forme de leixr plan.
VoyeïPILASTRES ; voye^ àujji tes cinq dèjféins de ces
chapiteaux dans les Planches d!Architecture. f P )
C hapite au ; on appelle ainfi , daris-1 'Artillerie f
deux petites planches de huit ou dix pouces1 de longueur
fur cinq oufix de largeur, qui forment enfern-
ble une efpece de petit comble ou de dos d’â’ne ; ori
s’en fert pour couvrir la lumière des pièces, & empêcher
que le vent n’èmporte l’amorce, ou qu’elle
ne foit mouillée par la pluie. Voye\la figure du chapiteau
, PI. VI. de Fortification, fig. S. (Q )
C hapite au d ’a r t if ic e , c’ eft une efpece 'de
çornet ou de couvercle conique qu’on met für le
pot au fommet d’une fufée volante , non-feulenient
pour le couvrir, mais aufli pour percer plus aifement
l’air en s’élevant en pointe. .
C hapite au , ( Chimie. ) le chapiteau' eft la- piece
fupérieure de l ’alembic, des chimiftes modernes ,
qui eft compofé d’une cüçurbite ( voyéç C u cuR -
b it e ) & de fon chapiteau. Ce dernier inftrument.
eft un vaiffeau le plus ordinairement de verre ou
d’étain, dont la meilleure forme eft conique , ou-
vert par fa bafe & muni intérieurement d’une goût*