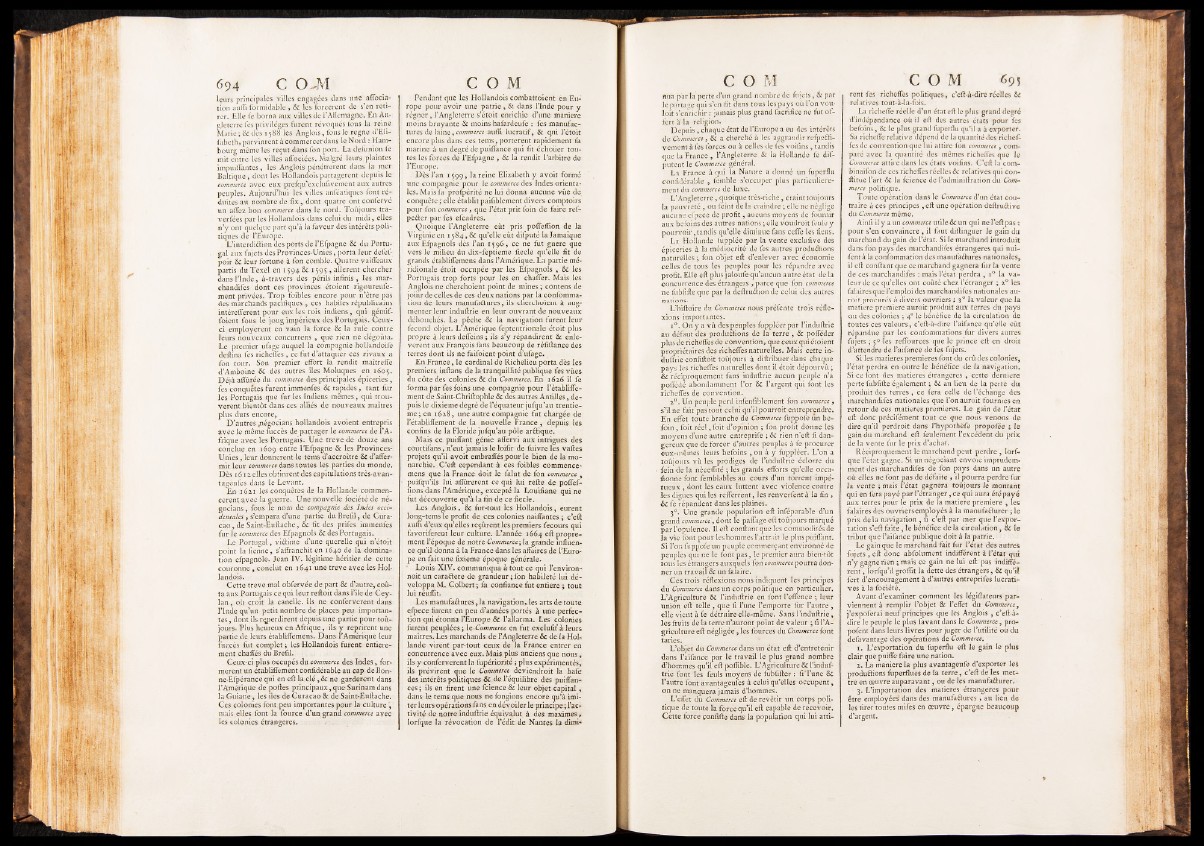
694 C OJVI
leurs principales villes engagées dans une affocia-
lion aufli formidable , & les forcèrent de s’en retirer.
Elle l'e borna aux villes de l’Allemagne. En Angleterre
les privilèges furent révoqués fous la reine
Marie ; & dès 1588 les Anglois, fous le régné d’Eli-
fabeth, parvinrent à commercer dans le Nord : Hambourg
même les reçut dans fon port. La defunion fe
mit entre les villes affociées. Malgré leurs plaintes
impuiffantes, les Anglois pénétrèrent dans la mer
Baltique, dont les Hollandois partagèrent depuis le
commerce avec eux prefqu’exclufivement aux autres
peuples. Aujourd’hui les villes anféatiques font réduites
au nombre de f ix , dont quatre ont confervé
un allez bon commerce dans le nord. Toujours tra-
verfées par les Hollandois dans celui du midi, elles
n’y ont quelque part qu’à la faveur des intérêts politiques
de l’Europe.
L’interdiCrion des ports de l’Efpagne & du Portugal
aux fujets des Provinces-Unies, porta leur defef-
poir & leur fortune à fon comble. Quatre vaiffeaux
partis du T exel en 1594 & z 595 , allèrent chercher
dans l’Inde, à-travers des périls infinis , les marchandées
dont ces provinces étoient rigouretife-
ment privées. Trop foibles encore pour n’être pas
des marchands pacifiques , ces habiles républicains
intérefferent pour eux les rois indiens, qui gémif-
foient fous le joug impérieux des Portugais. Ceux-
ci employèrent en vain la force & la rufe contre
leurs nouveaux concurrens , que rien ne dégoûta.
Le premier ufage auquel la compagnie hollandoife
deftina fes richeflés , ce fut d’attaquer ces rivaux a
fon tour. Son premier effort la rendit maîtreffe
d’Amboine & des autres îles Moluques en 1605.
Déjà affûrée du commerce des principales épiceries,
fes conquêtes furent immenfes & rapides, tant fur
les Portugais que fur les Indiens mêmes, qui trouvèrent
bientôt dans ces alliés de nouveaux maîtres
plus durs encore,
D ’autres /îégocians hollandois avoient entrepris
avec le même fuccès de partager le commerce de l’A frique
avec les Portugais. Une treve de douze ans
conclue en 1609 entre l’Efpagne & les Provinces-
Unies , leur donnèrent le tems d’accroître & d’affermir
leur commerce dans toutes les parties du monde.
Dès 1.612 elles obtinrent des capitulations très-avan-
tagèufes dans le Levant.
En 1621 les conquêtes de la Hollande commencèrent
avec la guerre. Une nouvelle fociété de né-
gocians, fous le nom de compagnie des Indes occidentales
, s’empara d’une partie du Brefil, de Curaçao
, de Saint-Euftache, & fit des prifes immenfes
fur le commerce des Efpagnols & des Portugais.
Le Portugal, viCtime d’une querelle qui n’étoit
point la fienne, s’affranchit en 1640 de la domination
efpagnole. Jean IV. légitime héritier de cette
couronne, conclut en 1641 une treve avec les Hollandois.
Cette treve mal obfervée de part & d’autre, coûta
aux Portugais ce qui leur reftoit dans; i’île de Cey-
lan , où croît la canelle. Ils ne conferverent dans
l’Inde qu’un petit nombre de places peu importantes
, dont ils reperdirent depuis.une partie.pour toit-,
jours. Plus heureux en Afrique, ils y reprirent une
partie de leurs établiffemens. Dans l’Amérique leur
fuccès fut complet ; les Hollandois furent entièrement
chaffés du Brefil.
Ceux-ci plus occupés du commerce des Indes, formèrent
un établiffement confidérable au cap de Bon-
ne-Efpérance qui en eft la c lé , & ne gardèrent dans
l’Amérique de portes principaux, que Surinam dans
la Guiane, les îles de Curaçao & de Saint-Euftache.
Ces colonies font peu importantes pour la culture
mais elles font la fource d’un grand commerce avec
les colonies étrangères.
C O M
Pendant que les Hollandois combattoient èn Europe
pour avoir une patrie , & dans l’Inde pour y
régner, l’Angleterre s’étoit enrichie d’une maniéré
moins bruyante & moins hafardeufe : fes manufactures
de laine, commerce aufli- lucratif, & qui l’étoit
encore plus dans ces tems, portèrent rapidement fa
marine à un degré de puiffance qui fit échoiier toutes
les forces de l’Efpagne , & la rendit l ’arbitre de
l ’Europe.
Dès l’an 1599, la reine Elizabeth y avoit formé
une compagnie pour le commerce des Indes orientales.
Mais l'a profpérité ne lui donna aucune vûe de
conquête ; elle établit paifiblement divers comptoirs
pour fon commerce, que l’état prit foin de faire rel-
peCter par fes efeadres.
Quoique l’Angleterre eût pris poffeflïon de la
Virginie en 1584, & qu’elle eût difputé la Jamaïque
aux Efpagnols dès. l’an 1 5 9 6 , ce ne fut guere que
vers le milieu du dix-feptieme liecle qu’elle fit de
grands établiffemens dans l’Amérique. L a partie méridionale
étoit occupée par les Efpagnols , & les
Portugais trop forts pour les en charter. Mais les
Anglois ne cherchoient point de mines ; eôntens de
joiiir de celles de ces deux nations par la confomma-
tion de leurs manufactures, ils cherchoient à augmenter
leur induftrie en leur ouvrant de nouveaux
débouchés. L a pêche & la navigation furent leur
fécond objet. L ’Amérique feptentrionale étoit plus
propre à leurs deffeins ; ils s’y répandirent & enlevèrent
aux François fans beaucoup de réfiftance des
terres dont ils ne faifoîent point d’ufage.
En France, le cardinal de Richelieu porta dès les
premiers inftans de la tranquillité publique fes vûes
du côte des colonies & du Commerce. En 1626 il fe
forma par fes foins une compagnie pour l’établiffe-
ment de Saint-Chriftophle & des autres Antilles, depuis
le dixième degré de l’équateur jufqu’au trentièm
e ; en 1628, une autre compagnie fut chargée de
l’établiffement de la nouvelle F ran ce , depuis les
confins de la Floride jufqu’au pôle arCtique.
Mais ce puiffant génie affervi aux intrigues des
courtifans, n’eut jamais le lôifir de fuivre les vaftes
projets qu’il avoit embrafféspour le bien de la m onarchie.
C ’eft cependant à ces foibles eommenee-
mens que la France doit le falut de fon commerce ,
puifqu’ifs lui affûrerent ce qui' lui refte de poffef-
îions dans l’Amérique, excepté la Louifiane qui ne
fut découverte qu’à la fin de ce liecle.
L e s Anglois, & fur-tout les Hollandois, eurent
long-tems le profit de ces: colonies nailfantes ; c’efl
aufli d’eux qu’elles reçûrent les premiers fecours qui
favoriferent leur culture. L’année 1664 eft proprement
l’époque de notre Commerce ; la grande influence
qu’il donna à la France dans les affaires de l’Europe
en fait une fixieme époque générale.
■ Louis XIV . communiqua à tout ce qui l’environ-
noit un caraCtere de grandeur ; fon habileté lui développa
M. Colbert ; là confiance fut entière ; tout
lui réuflit.
Les manufactures, la navigation, les arts de toute
efpece furent en peu d’années portés à une perfection
qui étonna l’Europe & l’allarma. Les colonies
furent peuplées; 1 ^Commerce. en fut exclufif à leurs
maîtres. Les marchands de l’Angleterre & de la Hollande
virent par-tout ceux de la France entrer en
concurrence avec eux. Mais plus anciens que n ou s,
ils y conferverent la fupériorité ; plus expérimentés,,
ils prévirent que le Commerce deviendroit la bafe
des intérêts politiques & de l’équilibre des puiffanr-
ces ; ils en firent une fcience & leur objet c a p ita l,
dans le tems que nous ne fongions encore qu’à imiter
leurs opérations fans en dévoiler le principe ; l’activité
de notre induftrie équivalut à des maximes ,
lorfque la révocation de l’édit de Nantes la dimi-
C O M
ftua par la perte d’un grand nombre de fujets, & par
le partage qui s’en fit dans tous les pays où l’on vou-
loit s’enrichir : jamais plus grand facrifice ne fut offert
à'la religion.
Depuis , chaque état de l’Europe a eu des intérêts
de Commerce, & a cherché à les aggrandir refpeCti-
vement à fes forces ou à celles de fes voifins, tandis
que la France , l’Angleterre & la Hollande fe disputent
le Commerce général.
La France à qui la Nature a donné un fuperflu
confidérable , femble s’occuper plus particulièrement
du commerce de luxe.
L’Angleterre, quoique très-riche, craint tou jours
la pauvreté , ou feint de la craindre ; elle ne néglige
aucune efpece de profit, aucuns moyens de fournir
aux befoins des autres nations ; elle voudroit feule y
pourvoir, tandis qu’elle diminue fans celfe les liens.
La Hollande fupplée par la vente exclufive des
épiceries à la médiocrité de fes autres productions
naturelles ; fon objet eft d’enlever avec économie
celles de tous les peuples pour les répandre avec
profit. Elle eft plus jaloufe qu’aucun autre état de la
concurrence des étrangers »parce que fon commerce
ne fublifte que par la deftruétion de celui des autres
nations.
L’hiftoire du Commerce nous préfente trois réflexions
importantes.
i° . On y a vû des peuples fuppléerpar l’induftrie
au défaut des produirions de la terre , & pofféder
plus de richeflés de convention, que ceux qui étoient
propriétaires des richeflés naturelles. Mais cette induftrie
confiftoit toûjours à diftribuer dans chaque
pays les richeflés naturelles dont il étoit dépourvû ;
& réciproquement fans induftrie aucun peuple n’a
poffédé abondamment l’or & l’ argent qui font les
richeflés de convention.
20. Un peuple perd infenfiblement fon commerce ,
s’il ne fait pas tout celui qu’il pourroit entreprendre.
En effet toute branche de Commerce fuppofe un be-
foin, foit réel, foit d’opinion ; fon profit donne les
moyens d’une autre entreprife ; & rien n’eft fi dangereux
que de forcer d’autres peuples à fe procurer
eux-mêmes leurs befoins , ou à y fuppléer. L’on a
toûjours vû les prodiges de l’induftrie éclorre du
fein de la néceflité ; les grands efforts qu’elle occa-
fionne font femblables au cours d’un torrent impétueux
, dont les eaux luttent avec violence contre
les digues qui les refferrent, les renverfent à la fin ,
& fe répandent dans les plaines.
3*. Une grande population eft inféparable d’un
grand commerce, dont le partage eft toûjours marqué
par l’opulence. II eft confiant que les commodités de
la vie font pour les hommes l’attrait le plus puiffant.
Si l’on fuppofe un peuple commerçant environné de
peuples qui ne le font pas, le premier aura bien-tôt
tous les étrangers auxquels fon commerce pourra donner
un travail & un falaire.
Ces trois réflexions nous indiquent les principes
du Commerce dans un corps politique en particulier.
L’Agriculture &c l’induftrie en font l’effence ; leur
union eft telle , que fi l’une l’emporte fur l’autre ,
elle vient à fe détruire elle-même. Sans l ’induftrie,
les fruits de la terre n’auront point de valeur ; fi l’Agriculture
eft négligée, les fources du Commerce font
taries.
L’objet du Commerce dans un état eft d’entretenir
dans l’aifance par le travail le plus grand nombre
d’hommes qu’il eft poflible. L’Agriculture & l’induftrie
font les feuls moyens de fubfîfter : fi‘ l’une &
l’autre font avantageuses à celui qu’elles occupent,
on ne manquera jamais d’hommes.
L’effet du Commerce eft de revêtir un corps politique
de toute la force qu’il eft capable de recevoir.
Cette force çonfifte dans la population qui lui atti-
C O M 6 9 5
refit fes richeflés politiques, c’eft-à-dire réelles
relatives tout-à-la-fois.
La richeffe réelle d’un état eft le plus grand degré
d’indépendance où il eft des autres états pour fes
befoins, & le plus grand fuperflu qu’il a à exporter.
Sa richeffe relative dépend de la quantité des richef-
fes de convention que lui attire fon commerce, comparé
avec la quantité des mêmes richeffes que le
Commerce attire dans les états voifins. C ’eft la com-
binaifon de c es richeffes réelles & relatives qui con-
ftitue l’art & la fcience de l’adminiftration du Commerce
politique.
Toute opération dans le Commerce d’un état cou-
traire à ces principes ,eft une opération deftruCrive
du Commerce même.
Ainfi il y a un commerce utile & un qui ne l’eft pas :
pour s’en convaincre , il faut diftinguer le gain du
marchand du gain de l’état. Si le marchand introduit
dans fon pays des marchandifes étrangères qui nui-
fentà la confommation des manufactures nationales,
il eft confiant que ce marchand gagnera fur la vente
de ces marchandifes : mais l’état perdra , i° la valeur
de ce qu’elles ont coûté chez l’étranger ; 20 les
falaires que l’emploi des marchandifes nationales au*
roit procurés à divers ouvriers ; 30 la valeur que la
matière première auroit produit aux terres du pays
ou des colonies ; 40 le bénéfice de la circulation de
toutes ces valeurs, c’eft-à-dire l’aifance qu’elle eût
répandue par les confommations fur divers autres
fujets ; 50 les reffources que le prince eft en droit
d’attendre de l’aifance de les fujets.
Si les matières premières font du crû des colonies,
l’état perdra en outre le bénéfice de la navigation.
Si ce font des matières étrangères , cette derniere
perte fubfifte également ; &C au lieu de la perte du
produit des terres, ce fera celle de l’échange des
marchandifes nationales que l’on auroit fournies en
retour de ces matières premières. Le gain de l’état
eft donc précifément tout ce que nous venons de
dire qu’il perd roit dans l’hy pothèfe propofée ; le
gain du marchand eft feulement l’excédent du prix
de la vente fur le prix d’achat.
Réciproquement le marchand peut perdre , lorfque
l’état gagne. Si un négociant envoie imprudemment
des marchandifes de fon pays dans un autre
où elles ne font pas de défaite , il pourra perdre fur
la vente ; mais l’état gagnera toûjours le montant
qui en fera payé par l’étranger, ce qui aura été payé
aux terres pour le prix de la matière première , les
falaires des ouvriers employés à la manufacturer ; le
prix delà navigation , fi c’eft par mer que l’exportation
s’eft faite, le bénéfice de la circulation, & le
tribut que l’aifance publique doit à la patrie.
Le gain que le marchand fait fur l’état des autres
fujets , eft donc abfolument indifférent à l’état qui
n’y gagne rien ; mais ce gain ne lui eft pas indifférent
, lorfqu’il groflit la dette des étrangers, & qu’il
fert d’encouragement à d’autres entreprifes lucratives
à la fociété.
Avant d’examiner comment les légiflateurs parviennent
à remplir l’objet & l’effet du Commerce,
j’expôfefai neuf principes que les Anglois , c’eft-à-
dire le peuple le. plus favant dans le Commerce, pro-
pofent dans leurs livres pour juger de l’utilité ott du
defavantage des opérations de Commerce.
1. L’exportation du fuperflu eft le gain le plus
clair que puiffe faire une nation.
2. La maniéré la plus avantageufe d’exporter les
productions fuperflues de la terre, c’eft de les mettre
en oeuvre auparavant, ou de les manufacturer.
3. L’importation des matières étrangères pour
être employées dans des manufactures , au lieu de
les tirer toutes mifes en oeuvre, épargne beaucoup
d’argent.