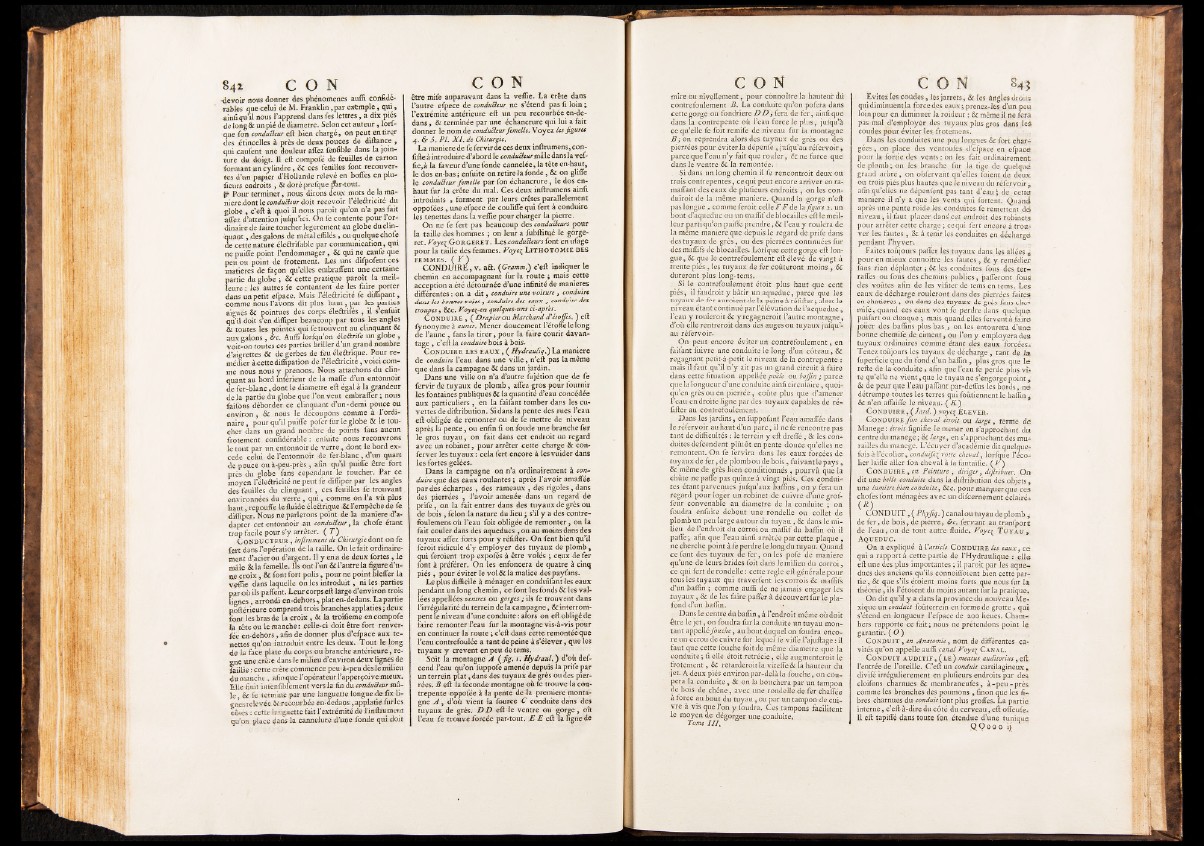
§4 2 C O N
Revoir nous donner des phénomènes auffi confide-
rables que celui de M. Franklin, par exemple, qui,
ainfi qu’il nous l’apprend dansfes lettres, a dix piés
de long & un pié de diamètre. Selon cet auteur| lorfque
fon conducteur eft bien chargé , on peut en tirer
des jétincelles à près de deux pouces de diûance ,
qui caufent une douleur allez fenfible dans la jointure
du doigt. Il eft composé de feuilles de carton
formant un cylindre, & ces feuilles font recouvertes
d’un papier d’Hollande relevé en boffes en plusieurs
endroits , & doré prefque jfar-tout.
Pour terminer, nous dirons deux mots de la maniéré
dont le conducteur doit recevoir l’éleftricité du
globe , c’eft à quoi il nous paroît qu’on n’a pas fait
affez d’attention jufqu’ici. On fe contente pour l’ordinaire
de faire toucher legerement au globe du clinquant
, des galons de métal effilés, ou quelque chofe
de cette nature éle&rifable par communication, qui
ne pvûffe point l’endommager, & qui ne caufe que
peu ou point de frotement. Les uns difpofent ces
matières de façon qu’elles emhraffent une certaine
partie du globe ; & cette pratique paroît la meilleure
les autres fe contentent de les faire porter
dans un petit efpace. Mais l’éleâricité fe diffipant,
-comme nous l’avons dit plus haut, par les parties
aiguës & pointues des corps éle&rifés , il s’enfuit
qu’il doit s’en diffiper beaucoup par tous les angles
& toutes les pointes qui fe trouvent au clinquant &
aux galons , &c. Auffi iorfqu’on éleftrife un globe ,
voit-on toutes ces parties briller d’un grand nombre
d’aigrettes & de gerbes de &.u éle&ricpie. Pour remédier
àcettediffipation de l’éleûricite, voici comme
nous nous y prenons. Nous attachons du clinquant
au bord inférieur de la maffe d’un entonnoir
de fer-blanc, dont le diamètre eft égal à la .grandeur
delà partie du globe que l’on veut embraffer ; nous
faiibns déborder ce clinquant d’un-demi pouce ou
environ, & nous le découpons comme à l’ordinaire
, pour qu’il puilfe pofer fur le globe & le toucher
dans un grand nombre de points fans aucun
frotement confidérable : enfuite nous recouvrons
le tout par un entonnoir de verre , dont le bord excède
celui de l’entonnoir de fer-blanc »d’un quart
de -pouce ou à-peu-près , afin qu’il puifle etr.e fort
près du globe fans cependant le toucher. Par ce
moyen l’éleôricité ne peut fe diffiper par les angles
des feuilles du clinquant , ces feuilles fe trouvant 7
environnées du verre, qui, comme on l’a vu plus
haut, repouffe le fluide éle&rique l’empêche de fe
diffiper. Nous ne parlerons point de la maniéré d’adapter
cet entonnoir au conduBeur, la chofe étant
trop facile pour s’y M-rêter. ( T)
C onduc teu r , instrument de Chirurgie d on t on fe
fert dans l’opération de la taille. On le fait ordinairement
d’a.cier ou d’argent. Il y ena de deux fortes , le
mâle &la femelle. Ils ont l’un & l'autre la figure d’u-
ne croix, & font fort polis, pour ne point blefler la
veffie dans laquelle on les introduit, ni les parties
par où ils paffent. Leur corps eft large d’environ trois
lignes, arrondi en-dehors^ plat en-dedans. La partie
poftérieure comprend trois branches applaties ; deux
font les bras de la croix , & la troifieme en compofe
ia tête ou le manche : celle-ci doit être fort renver-
fée en-dehors, afin de donner plus d’efpace aux teneurs
qu’on introduit entre les deux. Tout Le long
de la face plate du corps ou branche antérieure, régné
une crête dans le milieu d’environ deux lignes de
faillie : cette crête commence peu-à-peu dès le milieu
du manche, afinque l’opérateur l’apperçoive mieux.
Elle finit infenfiblement vers la fin du conduBeur mâle,
& fe termine par une languette longue-de fix lignes
relevée & recourbée en-dedaos ,a.ppiatié.furles
côtés i cette languette fait l’extrémité de l inftriimcfît
qu’on, place tjlaas la cannelure d’une fonde qui doit
C O N
être mife auparavant dans la veffie. La crête dans
l’autre efpe.ee de conduBeur ne s’étend pas fi loin j
l’extrémité antérieure eft un peu recourbée en-de-
dans, & terminée par une échancrure qui lui a fait
donner le nom de conducteur femelle. Voyez les figure*
4 . & S . P L X I . de Chirurgie.
La maniéré de fefervirdeces deux inftrumens, con-
fifte à introduire d’abord le conducteur mâle dans la vef-
fie,à la faveur d’une fonde cannelée, la tête en-haut,
le dos en-bas; enfuite on retire la fonde, & on gliffe
le conduBeur femelle par fon échancrure, le dos en-
haut fur la crête du mal. Ces deux inftrumens ainfi
introduits , forment par leurs crêtes parallèlement
oppofées, une .efpece de couüffe qui fort à conduire
les tenettes dans la veffie pour charger la pierre.
On ne fe fort pas beaucoup des conducteurs pour
la taille .des hommes ; on leur a fubftittfe le gorge-
ret. Voye^ G o rg er e t . Les conduBeur s font en ufage
pour la taille des femmes. Voyt^ Lith o t om ie des
femm es. ( F )
CONDUIRE, v. aâ. (Gromm.') c’eft indiquer le
chemin en accompagnant fur la route ; mais cette
acception a été détournée d’une infinité de maniérés
différentes : on a dit, conduire une voiture , conduire
dan s les bonnes voies , conduire des e au x , conduire des
troupes, ôcc. Voye^-en quelques-uns ci-apres.
CONDUIRE , {D r a p ie r ou Marchand d ’étoffes, ) eft
fy nonyme à auner. Mener doucement l’étoffe le long
de l’aune , fans la tirer, pour la faire courir davantage
, c’eft la conduire b o is à bois.
C onduire les eaux , ( Hydrauliq.') La maniéré
de conduire l’eau dans une ville, n’eft pas la même
que dans la campagne & dans un jardin.
Dans une ville on n’a d’autre fujétion que de fe
fervir de tuyaux de plomb, affez gros pour fournir
les fontaines publiques & la quantité d’eau concédée
aux particuliers , en la faifant tomber dans les cuvettes
de diftribution. Si dans la pente des rues l’eau
eft obligée de remonter ou de fe mettre de niveau
après la pente, ou enfin fi on fonde une branche fur
le gros tuyau, on fait dans cet endroit un regard
avec un robinet, pour arrêter cette charge .& con-
ferver les tuyaux : cela fert encore à les vuider dans
les fortes gelées.
Dans la campagne on n’a ordinairement à conduire
q u e des eaux roulantes ; après l’avoir amaffée
par des écharpes , des rameaux , des rigoles, dans
des pierrées , l’avoir amenée dans un regard de
prife, on la fait entrer dans des tuyaux de grès ou
de bois , félon la nature du lieu ; s’il y a des contre-
foulemensoù l’eau foit obligée de remonter, on la
fait couler dans des aqueducs , ou au moins dans des
tuyaux affez forts pour y réfifter. On fent bien qu’il
feroit ridicule d’y employer des tuyaux de plomb ,
qui feroient trop expofés à être volés ; ceux de fer
font à préférer. On les enfoncera de quatre à cinq
piés , pour éviter le vol & la malice despayfans.
Le plus difficile à ménager en conduifantles eaux
pendant un long chemin, ce font les fonds & les vallées
appellées ventres .ou gorges ; ils fe trouvent dans
l’irrégularité du terrein de la campagne, &interrom-
pent le niveau d’une conduite: alors on eft obligé de
faire remonter l’eau fur la montagne vis-à-vis pour
en continuer la route ; c’eû dans cette remontée que
l’eau contrefoulée a tant de peine à s’élever, que les
tuyaux y crevent en peu de teins.
Soit la montagne A ( fig . 1. H y d rau l.') d’où def-
cend l’eau qu’on fuppofe amenée depuis la prife par
un terrein plat, dans des tuyaux de grès ou des pierrées.
B eft la fécondé montagne où fe trouve la con-
trepente oppofée à la pente de la première montagne
A , d’où vient la fource C conduite dans des
tuyaux de grès. D D eft le ventre ou gorge, où
l’eau fe trouve forcée par-tout. £ fi1 eft la ligne de
C O N
mire.ou nivellement, pour cônnoître la hâiiteiif dù
contre feulement B . La conduite qu’on pofera dans
cettegorge ou fondrière D D , fera de fer, ainfi que
dans la contrepente où l’eau force le plus, jufqu’à
ce qu’elle fe foit remife de niveau fur la montagne
B ; on reprendra alors des tuyaux de grès ou des
pierrées pour éviter la dépenfe , jufqu’au réfervoir,
parce que l’eau n’y fait que rouler, & ne force que
dans le ventre & la remontée* ■
. Si dans un long chemin il fe rencontrait deux ou
trois contrepentes, ce qui peut encore arriver en ra-.
maffant des eaux de piufieurs endroits , on les conduisit
de la même maniéré. Quand la gorge n’eft
pas longue, comme feroit celle F F de la figure x . un
bout d’aqueduc ou un maffif de blocailles eft le meilleur
parti qu’on puilfe prendre, & l’eau y roulera de
la même maniéré que depuis le regard de prife dans
des tuyaux de grès, ou dès pierrees continuées fur
des maffifs de biocailles. Lorfque cettegorge eft longue
, & que le contrefoulement eft élevé de vingt à
trente piés, les tuyaux de fer coûteront moins , &
dureront plus long-teins*
. Si le contrefoulement étoit plus haut que cent
piés ,. il faudroit y bâtir un aqueduc, parce que les
tuyaux de fer auroient de la peine à réfifter ; alors le
niveau étant continué par l’élévation de l’acquedue,
l’eau y rouleroit & y regagneroit l’autre montagne,
d’où elle rentrerait dans des auges ou tuyaux jufqu’-.
au réfervoir. : •
On peut encore éviter un contrefoulement, en
faifant fuivre une conduite.le long d’un coteau, &
regagnant petit-à-petit le niveau de la contrepente :
mais il faut qu’il n’y ait pas un grand circuit à faire
dans cette fituation appellée .poêle ou baßin ; parce
que la longueur d’une conduite ainfi circulaire, quoi-*:
qu’en grès ou en pierrée ,■ coûte plus que d’amener
l’eau en droite ligne par des tuyaux capables de réfifter
au Contrefoulement. •
Dans les jardins, en fuppofant l’eau amaffée dans
le réfervoir au haut d’un parc, il ne fe rencontre pas
tant de difficultés : le terrein y eft dreffé j & les conduites
defeendent plûtôt en pente douce qu’elieS ne
remontent. Ori fe fer vira dans les eaux forcées de
tuyaux de fer, de plomb ou de bois, fuivant le pays,
& même de grès bien conditionnés , pourvû que la
chûte ne paffe pas quinze à vingt piés. Ces conduites
étant parvenues jufqu’aux baffins, on y fera un
regard pour loger un robinet de cuivre d’une grof-
feur convenable au diamètre de la conduite ; on
fondra enfuite debout une rondelle ou. collet de
plomb un peu large autour du tuyau , & dans le milieu
de l’endroit du corroi ou maffif du baffin où il
paffe ; afin que l’eau ainfi arrêtée par cette plaque ,
ne cherche point à fe perdre le long du tuyau. Quand
ce font des tuyaux de fer, on les pofe de maniéré
qu’une de leurs brides foit daris le milieu du corroi,
ce qüi fert de rondelle : cette regle eft générale.pour
tous les tuyaux qui traverfent les corrois & maffifs
d’un baffin ; comme auffi de ne jamais engager lés
tuy aux, & de les faire paffer à découvert fur le plafond
d’un baffin.
Dans le centre du baffin, à l’endroit même où doit
être le jet, on foudra fur la conduite un tuyaü montant
appelléyo«c/ze, aubout.duquelon foudra encore
un écrou de cuivre fur lequel fe viffe,l’ajuftage : il
faut que cetteTouche foit de même diamètre que la
conduite; fi elle étoit rétrécie, elle augmenterait le
frotement, & retarderait la vîteffe & la hauteur du
jet. A deux piés environ par-delà la fouche, on coupera
la conduite, & on la bouchera par un tampon
de bois de chêne, avec une rondelle de fer chaffée
a force au bout du tuyau ,;ôu par un tampon de cuivre
a vis que l’on y foudra. Ces tampons facilitent
le moyen de dégorger une conduite.
Tome I I I ,
C O N 845
Evitez les côüdes, lès jarrets, & les angles droits
qui diminuent la force des eaux ; prenez-les d’un peu
loin pour en diminuer la raideur : & même il ne fera
pas mal d’employèr des tuyaux plus gras dans leà-
coudes pour éviter les. frotemens.
Dans les conduites une peu longues & fort chargées
j on place des ventoufes d’efpace en efpacé
pour la fortie des vents : on les fait ordinairement
de plomb; on les branche fur la tige de quelque
grand arbre, on obfervaiit qu’elles loient de deux
où trois piés plus hautes que le niveau du réfervoir,
afin qu’elles ne dépenfent pas tant d’eau ‘ de cette
maniéré il n’y a que les vents qui fortent. Quand
après une pente roide les conduites fe remettent de
niveau, il faut placer dans" cet endroit dès robinets
pour arrêter cette charge ; ce qui fert encore à trouver
lés fautes , & à tenir les conduites en déchargé
pendant l’hyven
Faites toûjours paffer les tuyaux dans.les. allées
pour en mieux connoître les fautes , & y remédier
fans rien déplanter ; 6c les conduites fous des ter-
raffes ou fous des chemins' publies, pafferont fous
des voûtes afin de les vifiter de tems en tems. Les
eauX de décharge rouleront dans des pierrées faites
eti chatierés j ou dans des tuyaux de grès fans che-
mifé, quand ces eaux vont fe perdre dans quelque
puifart ou cloaque j mais quand elles fervent à faire
joiiér des baffins plus bas., on les entourera d’une
bonne chemife de ciment, ou l’on y employera des
tuyaux ordinaires comme étant des eaux forcées*
Tenez toûjours les tuyaux de décharge , tarit de la
fuperficie que du fond d’un baffin , plus gros que lé
refte. de la conduite, afin que l’eau fe perde plus vî*
te qu’elle ne vient, que le tuyau ne s’engorge point,
& de peur que l’eau pafTânt par-deffus les bords, né
détrempe toutes les terres qui foûtiennentle baffin,
& n’en affadie le niveau. ( if) - ,
C onduire, ( 7drd.fvoye^ É lever.
C onduire fon cheval étroit ou large, terme dé
Manege : étroit fignifie le mener en s’approchant du
centre divmanege ; & large, en s’approchant des murailles
du manege. L’écuyer d’académie dit quelque*
fois à l’écolier, corïduife^ votre cheval, lorfque i’éco*
lier laiffe aller fon cheval à fa fantaifie* ( V')
CONDUIRE ven Peinture ) diriger j diftribuer. On
dit une belle conduite dans la diftribution des objets,
une lumière, bien conduite, &c. pour marquer que ces
chofes font ménagées avec un difeernement éclairé*
Hf
CONDUIT, ( Phyjîq. ) canal ou tuyau de plomb.,
de fer, de bois, de pierre, &c. fervant au tranfporc
de l’eau, ou de tout autre fluide* Voycç T u y au >
A queduc*
On a expliqué à l’article C onduire les e aux ^ cé
qui a rapport à cette partie de l’Hydraulique : elle
eft une des plus importantes ; il paraît par les aqueducs
des anciens qu’ils connoifîoient bien cetté par*
tie, & que s’ils étoierit moins forts que nous fur la
théorie, ils l’étoient du moins autant fur la pratique*
On dit qu’il y a dans la province du nouveau Mexique
un conduit foûterrein en forme de grotte, qui
s’étend en longueur l’efpace de 100 lieues. Chain-
bers rapporte ce fait; nous ne prétendons point le
garantir. ( O )
C onduit , en Anatomie, nom de différentes cavités
qu’on appelle auffi cana l Voyeç C anal.
C onduit a u d it if , ( l e ) meatus au ditorius, eft
l’entrée de l’oreille. C.’eft un conduit cartilagineux ,
divifé irrégulièrement en piufieurs endroits par des
cloifons charnues & membraneufes, à-peu-près
comme les bronches des poumons , finon que les fibres
charnues du conduit (on t plus grofles. La partie
interne, c’eft à-dire du côté du cerveau, eft offeufe.
11 eft tapiffé dans toute fon étendue d’une tunique
.QO000 i)