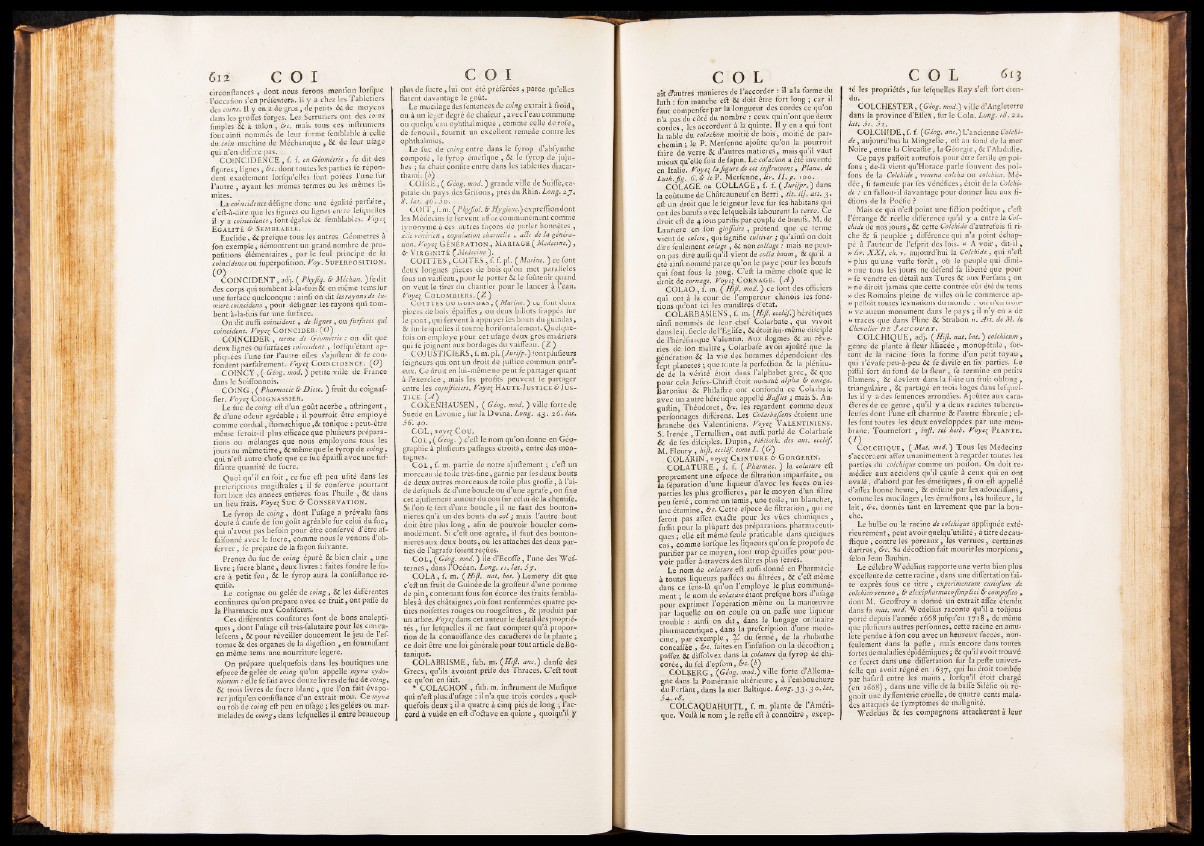
circonftances , dont nous ferons mention lorfcfue
l’occafion s’en préfentera. U y a chez les Tabletiers
des coins. Il y en a de g ros, de petits ô£. de moyens
dans les greffes forges. Les Serruriers ont des coins
fimples &c à talon , &c. mais tous ces inftrumens
font ainfi nommés de leur forme femblable à celle
du coin machine de Méchanique , & de leur ufage
qui n’en différé pas.
CO ÏNC IDENC E, f. f. en Géométrie , fendit des
figures, lignes, &c. dont toutes les parties fe repondent
exactement lorfqu’elles font pofées lune fur
l ’autre , ayant les mêmes termes ou les memes limites.
-
La coïncidence Aèïigne donc une égalité parfaite,
c’ eft-à-dire que les figures ou lignes entre lefquelles
il y a coïncidence, font égales ÔC lemblables. Foye^
Eg a l it é & Sem b la blè.
Euclide, & prefque tous les autres Géomètres à
fon exemple, démontrent un grand nombre de pro-
pofitions élémentaires, par le feui principe de là
coïncidence ou fuperpofition. Voy. Su p e r po s it io n ,
(O)C
O ÏNCIDENT, adj. ( Phyfiq. & Mèchan. ) ledit
des corps qui tombent à-la-fois & enrhéme tems fur
une furface quelconque : ainfi on dit lés rayons de lumière,
coincidens , pour défigner les rayons qui tombent
à-la-fois fur une furface.
On dit auffi coïncident , de lignes , ou furfaces qui
coïncident. Voye{ C O ÏN C ID E R . (O ) i
COÏNCIDER , terme de Géométrie : on dit que
deux lignes ou lurfaces coïncident, lorfqu’étant appliquées
l’une fur l’autre elles s’ajnftenr & fe confondent
parfaitement.. Foye{ C o ïn c id en c e . ( O )
C O I N C Y y ( Géog. mod.) petite ville de. France
dans le Soiffonnois. 1
CO IN G , ( Pharmacie & Dicte. ) fruit du coignaf-
fier. Voye%_ C ôign a s s ier.
Le fuc de coing eft d’un goût acerbe , aftringent,
& d’une odeur agréable ; il pourroit être employé
comme cordial, ftomachique ,& tonique : peut-être
même feroit-il plus efficace que plufieurs préparations
ou mélanges que nous employons tous les
jours au même titre, & même que le fyrop de coing,
qui n’eft autre chofe que ce fuc épaifli avec une fuf-
fifante quantité de fucre.
Quoi qu’ il en fo it , ce fuc eft peu ufité dans les
preferiptions. magiftrales ; il fe conferve pourtant
fort bien des années entières fous l’huile , & dans
un lieu frais. F oye^Svc & C onserv at ion.
Le fyrop de cojng, dont l’ufage a prévalu fans
doute à caufe de fon goût agréable fur celui du fuc,
qui n’a voit pas befoin pour être confervé d’être af-
faifonné avec le fucre, comme nous le venons d’ob-
ferver, fe prépare de la façon fuivante.
Prenez du fuc de coing épuré & bien clair , une
livre ; fucre blanc, deux livres : faites fondre le fucre
à petit feu , & le fyrop aura la confiftance re-
quife. . HH
Le cotignac ou gelée de coing, & les differentes
confitures qu’on prépare avec ce fruit, ont paffé de
la Pharmacie aux Confifeurs.
Ces différentes confitures font de bons analeptiques
, dont l’ufage eft très-falutaire pour les conva-
lefcens , & pour réveiller doucement le jeu de l’ef-
tomac & des organes de la digeftion , en fourniffant
en même tems une nourriture legere.
On prépare quelquefois dans les boutiques une
efpece de gelée de coing qu’on appelle myva cydo-
niorum : elle fe fait avec douze livres de (ucdt coing,
& trois livres de fucre blanc , que l’on fait évaporer
jufqu’en confiftance d’un extrait mou. Ce myva
ou rob de coing eft peu en ufage ; les gelées ou marmelades
de coing y dans lefquelles il entre beaucoup
plus de fucre, lui ont été préférées , parce qu’elles
flatent davantage le goût.
Le mucilage des femencés de coing extrait à froid,
ou à un leger degré de chaleur , avec l’eau commune
ou quelqu’eau ophthalmique , comme celle derofe,
dè fenouil, fournit un excellent remede contre les
op ht h a l mies.
Le fuc de coing entre dans le fyrop d’abfynthe
compofé , le fyrop émétique , & le fyrop de jujubes
; fa chair confite entre dans les tablettes diacar-
thami. (b ) ....
COIRE, ( Géog. mod. ) grande ville de Suiffe, capitale
du pays des G rifons, près du Rhin. Long, z j .
8. lat. 46. 60..
C O ÏT , f. m. ( Phyjiol. & Hygiene.) exprefliondont
les Médecins le fervent affez communément comme
fynonyme à ces autres façons de parler honnêtes ,
acte vénérien , copulation charnelle , acte de la génération.
Foye^ G én ération , Ma r ia g e ( Medecine.') ,
& V ir g in it é ( Medecine ).
CO ITTE S , C O ITE S , f. f. pl. ( Marine. ) ce font
deux longues pièces de bois qu’on met parallèles
fous un vaiffeau, pour le porter & le foûtenir quand
on veut le tirer du chantier pour le làncer à l’eau.
Foye^ C o lom biers . ( Z )
C o it t e s DU GUINDAS, ( Marine. ) ce font deux
pièces de bois épaiffés, ou deux billots frappés fur
le pont, qui fervent à appuyer les bouts du guindas,
& fur leiquelles il tourne horifontalement. Quelquefois
on employé pour cet ufage deux gros madriers
qui fe joignent aux bordages du vaiffeau. ( Z )
COJUSTICIERS, f. m. pl. (Jurifp.) lontplufieurs
feigneurs qui ont un droit de juftice commun entr’-
eux. Ce droit en lui-même ne peut fe partager quant
à l’exercice , mais les profits peuvent fe partager
entre les cojufticiers. Voye^ Haute-Ju st ice & Just
ic e . (A )
COKENHAUSEN, ( Géog. mod. ) ville forte de
Suede en Livonie, fur la Dwina. Long. 43. z6 . lat.
66. 40.
C O L , voye^ C o u .
C ol , ( Géog. ) c’eft le nom qu’on donne en Géographie
à plufieurs paffages étroits, entre des montagnes.
C o l , f. m. partie de notre ajuftement ; c’eft un
morceau de toile très-fine, garnie par fes deux bouts
de deux autres morceaux de toile plus groffe, à l’aide
defquels &.d’une boucle ou d’une agrafe, on fixe
cet ajuftement autour du epu fur celui de la chemife.
Si l’on fe fert d’une boucle, il ne faut des boutonnières
qu’à un des bouts du col ; mais l’autre bout
doit être plus long , afin de pouvoir boucler commodément.
Si c’eft une agrafe, il faut des boutonnières
aux deux bouts, où les attaches des deux parties
de l’agrafe foient reçûes.
C o l , ( Géog. mod. ) île d’Ecoffe, l’une des "Wef-
ternes, dans l’Océan. Long. //. lat. 6y.
C O L A , f. m. ( Hifl. nat. bot. ) Lemery dit que
c’eft un fruit de Guinée de la groffeur d’une pomme
de pin, contenant fous fon écorce des fruits fembla-
ble$à des châtaignes > où font renfermées quatre petites
noifettes rouges ou rougeâtres, & produit par
un arbre. Voyeq_dans cet auteur le détail des propriétés
, fur lefquelles il ne faut compter qu’à proportion
de la connoiffance des caraâeres de la plante ;
ce doit être une loi générale pour tout article de Botanique.
COLABRISME, fub. m. (Hift. anc.) danfe des
Grecs -, qu’ils avoient prife des Thraces. C ’eft tout
ce qu’on en fait.
* COLACHON , fub. m. inftrument dè Mufique
qui n’eft plus d’ufage : il n’a que trois cordes , quelquefois
deux ; il a quatre à cinq piés de long ; l’ac-
cord à vuide en eft d’ottave en quinte, quoiqu’il ÿ
C O L
ait d’autres maniérés de l ’accorder : il a la forme du
luth : fon manche eft & doit être fort long ; car il
faut compenfer par la longueur des cordes ce qu’on
n’a pas du côté du nombre : ceux quin’ont que deux
cordes les accordent à la quinte. Il y en a qui font |
la table* du roldchon moitié de bois, moitié de parchemin
; le P. Merfçnne ajoute qu’on la pourroit
faire de verre & d’autres matières, mais qu’il vaut
mieux qu’elle foit de fapin. Le colachon a été inventé
en Italie. F ’oye[ la figure de cet inflrument, Plane, de
Luth. fis. 6 f & H P- Merfenne, liv. I I . p. | ^ H H
COLAGE ou CO LLAG E, f. f. ( Jurijpr. ) dans
la coûtume de Çhâteauneuf en Berri, tit. iij. art. 3 .
eft un droit que le feigneur leve fur fes habitans qui
ont des boeufs avec leîquelsils labourent la terre. Ce
droit eft de 4 fous parifis par couple de boeufs. M. de
Lauriere en fon glofiaire , prétend que ce terme
vient de colère, qui fignifie cultiver ; cju’ainfi on doit
dire feulement çolage , & non collage •' mais ne peut-
on pas dire auffi qu’il vient de colla boum, & qu'il a
été ainfi nommé parce qu’on le paye pour les boeufs
qui font fous le joug. C ’eft la même choie que le
droit de.cornage, f'oyfeçC O R N A G E . ( ^ )
COLAQ , f. m. ( Hift. mod. ) ce font des officiers
qui ont à la cour de l’empereur chinois les fonctions
qu’ont ici les miniftres d’état.
COLARBASIENS, f. m. (Hift. eccléf.) hérétiques
ainfi nommés de leur chef Colarbafe, qui vivoit
dansleij.fiecle del’Ëglife, &étoit lui-même difciple
de l’héréfiarque Valentin. Aux dogmes ôc au rêveries
de Ion maître, Colarbafe avoit ajouté que la
génération & ja vie des hommes dépendoient des
lept planètes ; que toute la perfe&ion & la plénitude
de la vérité étoit dans l’alphabet grec, & que
pour cela Jefus-Chrift étqit nommé alpha & oméga.
Baronius & Philaftre ont confondu ce Colarbafe
avec un autre hérétique appellé Baftits ; mais S. Au-
guftin, Théodoret, &c. les regardent comme deux
perfonnages différens. Les Colarbajiens etoient une
branche des Valentiniens. Voyc^ V alentiniens. ;
S. Irenée , Tertullien, ont auffi parlé de Colarbafe
& de fes difciples. Dupin, biblioth. des aut. eccléf.
M. Fleury , hift. eccléf. tome I . (G)
. COLARIN, voye^ C einture & G o rgerin.
COLATURE , f. f. ( Pharmac. ) la colature eft
proprement une efpece de filtration imparfaite, ou
f a féparation d’une liqueur d’avec les feces ou ïes
parties les plus groffieres, par le moyen d’un filtre
peu ferré, comme un tamis, une toile, un blanchet,
une étamine, &c. Cette efpece de filtration., qui ne
feroit pas affez exatte pour les vîtes chimiques ,
fuffit pour la plûpart des préparations pharmaceutiques
; elle eft meme feule praticable dans quelques
cas, comme lorfque les liqueurs.qu’onfepropofe de
purifier par ce moyen, font trop épaiffés pour pouvoir
paffer à-travers des filtres plus ferrés.
Le nom de colature eft auffi donné en Pharmacie
à toutes liqueurs paffées ou filtrées, & c’eft meme
dans ce fens-là qu’on l’employé le plus communément
; le nom de colature étant prefque hors d’ulage
pour exprimer l’opération même ou la manoeuvre
par laquellé ou on coule ou on paffe une liqueur
trouble : ainfi; on d it , dans le langage ordinaire
pharmaceutique, dans la preferiprion d’une medecine,
par exemple, I f du.fenné, de la rhubarbe
concaffée ,, &c. faites-en l’infufion ou la déco&ion;
paffez & diffolvez dans la colature du fyrop de chicorée
, du fel d’epfom, &c. (£)
COLBERG, (Géog. mod.) ville forte d’Allemagne
dans la Poméranie ultérieure , à l’embouchure
du Perfant, dans la mer Baltique. Long. 3 3 .3 0. lat.
64.18. \
COLCAQUAHUITL, f. m. plante de l’Amérique.
Voilà le nom ; le refte eft à connoître, excep-
C O L 6 1 3
té les propriétés, fur lefquelles Ray s’eft fort étendu.
COLCHESTER, (Géog. mod.) v ille d’Angleterre
dans la province d’Effex, fur le Coin. Long. 18. z z .
lat. 61. 6z.
COLCHIDE, f. f. (Géog. anc.) L’ancienne ColchU
de, aujourd’hui la Mingrelie, eft au fond de la mer
Noire, entre la Circafîîe, la Géorgie, & l’Aladulie.
Ce pays paffoit autrefois pour être fertile en poi-
fons ; de-là vient qu’Horace parle fouvent des poi-
fons de la Colchide , venena colcha ou colchica. Mé-
dée, fi fameufe par fes vénéfices, étoit de la Colchide
: en falloit-il davantage pour donner lieu aux fi-
âions de la Poéfie ?
Mais ce qui n’eft point une fiftion poétique, c’eft
l’étrange & réelle différence qu’il y a entre la Colchide
de nos jours, & cette Colchide d’autrefois fi riche
& fi peuplée ; différence qui n’a point échappé
à l’auteur de l’efprit des lois. « A v o ir , dit-il,
» liv . X X I . ch. v. aujourd’hui la Colchide , qui n’eft
»' plus qu’une vafte forêt, où le peuple qui dimi-
» nue tous les jours ne défend fa libetté que pour
» fe vendre en détail aux Turcs & aux Perfans ; on
» ne dirôit jamais que cette contrée eût été du tems
>> des Romains pleine de villes où le commerce ap-
» pelloit toutes les nations du monde : on n’en trou-
» v e aucun monument dans le pays ; il n’y en a de
» traces que dans Pline & Strabon » . Art. de M. le
Chevalier d e J a u C O U R T .
COLCHIQUE, adj. ( Hift. nat. bot. ) colchicum ,
genre de plante à fleur liliacée , monopétale, for-
tant de la racine fous la forme d’un petit tuyau,
qui s’évafe peu-à-peu & fe divife en fix parties. Le
piftil fort du fond de la fleur , fe termine en petits
filamens, & devient dans la fuite un fruit oblong ,
triangulaire , & partagé en trois loges dans lefquelles
il y a des femences arrondies. Ajoûtez aux carâ-
éteres de ce genre, qu’il y a deux racines tubercu-
leufes dont l’une eft charnue & l’autre fibreufe 3 elles
font toutes les deux enveloppées par une membrane.
Tournefort , Inft. réi Kerb. Voye^ Plante.
( ƒ)C
o lch iq u e , (Mat. med.) Tous les Médecins
s’accordent affez unanimement à regarder toutes les
parties dit colchique comme un poifon. On doit remédier
aux accidens qu’il caufe à ceux qui en ont
av a lé, d’abord par les émétiques, fi on eft appellé
d’affez bonne heure, & enfuite parles adouciffans,
comme les mucilages, les émulfions, les huileux, le
lait, &c. donnés tant en lavement que par la bouche.
Le bulbe ou la racine de colchique appliquée extérieurement
, peut avoir quelqu’utilité, à titre decau-
ftiqüe , contre les poreaux, les verrues, certaines
dartres, &c. Sa décoétion fait mourir les morpions,
félon Jean Bauhin.
Le célébré"Wedelius rapporte une vertu bien plus
excellente de cette racine, dans une differtation faite
exprès fous ce titre , experimentum curiofum de
colchicoyeneno , & alexipharmacofimplici & compofito ,
dont M. Geoffroy a donné un extrait affez étendu
dans fa mat. med. 'Wédélius raconte qu’il a toûjous
porté depuis l’année 1668 jufqu’en 1718 , de même
que plufieurs autres perfonnes, cette racine en amu-
lete pendue à fon cou avec un heureux fuccès, non-
feulement dans la pefte , mais encore dans toutes
fortes de maladies épidémiques ; & qu’il avoit trouvé
ce fecret dans une differtation fur ia pefte univer-
felle qui avoit régné en 1637, h“ tomhée
par hafard entre les mains, lorfqu’il étoit chargé
feii ; dans une ville de là baffe Siléfie ôù ré- - i ' i ^ H l
gnoit une dyffenterié cruelle, de quatre cents malades
attaqués de fymptomes de malignité.
"Wedelius & fes compagnons attachèrent à leur
lif