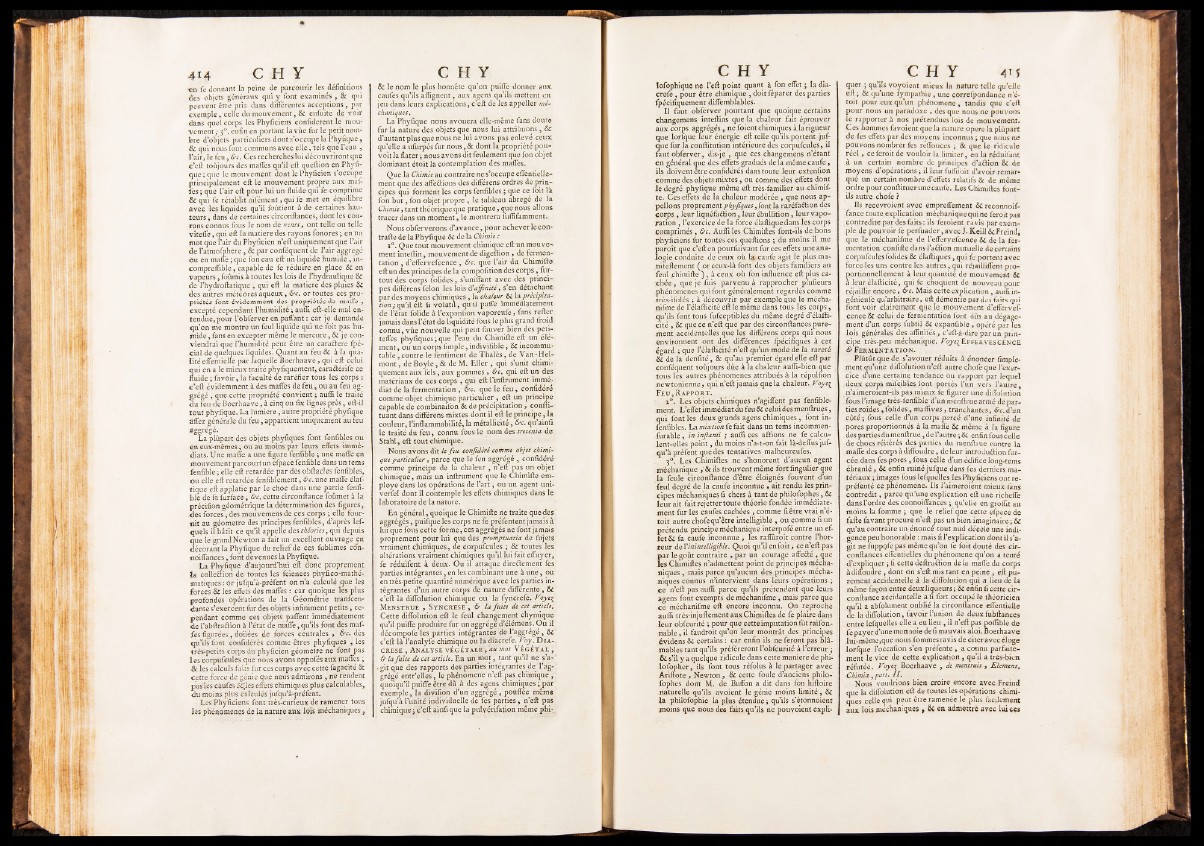
•en fe donnant la peine de parcourir les définitions
des objets généraux qui y font examinés , & qui
peuvent être pris dans différentes acceptions , par
exemple, celle du mouvement, & enfuite de voir
clans quel corps les Phyficieits confiderent le mouvement;
30. enfin en portant la vue fur le petit nombre
d’objets particuliers dont s’occupe la Phyfique,
& qui nous font communs avec elle, tels que Peau ,
l ’air, le feu, &c. Ces recherches'lui découvriront que
c ’eft toujours des maffes qu’il eft queftion en Phyfique
; que le mouvement dont le Phyficien s’occupe
principalement eft le mouvement propre aux maffes
; que l’air eft pour lui un fluide qui fe comprime
& qui fe rétablit aifément, qui fe met en équilibre
avec 'les liquides qu’il foûtient à de certaines ‘hauteurs
; dans de certaines'circonftances, dont les cou-
rans connus fous le nom de vents., ont telle ou telle
vîteffe, qui eft la matière des rayons fonores ; en un
mot que Pair du Phyficien n’eft uniquement que Pair
de Patmofphere, & par conféquent de Pair aggregé
ou en maffe ; que fon eau eft un liquide humide, in-
compreffible, capable de fe réduire en glace & en
vapeurs, foûmis à toutes les lois de l’hydraulique &
de l’hydroftatique , qui eft la matière des pluies 8c
des autres météores aqueux, &c. or toutes ces propriétés
font évidemment des propriétés de maffe ,
excepté cependant l’humidité ; aufli eft-elle mal entendue,
pour l’obferver en paffant : car je demande
qu’on me montre un feul liquide qui ne foit pas humide
, fans en excepter même le mercure, 8c je conviendrai
que l’humidité peut être un caraftere fpé-
cial de quelques liquides. Quant au feu 8c à la qualité
effentielle par laquelle Boerhaave, qui eft celui
qui en a le mieux traité phyfiquement, caraâérife ce
fluide ; fa voir, la faculté de raréfier tous les corps :
c ’eft évidemment à des malfes de feu , ou au feu ag-
grégé , que cette propriété convient ; aufli le traité
du feu de Boerhaave, à cinq ou fix lignes près, eft-il
tout phyfique. La lumière, autre propriété phyfique
affez générale du feu , appartient uniquement au feu
aggrégé. . _ • ..
La plupart des objets phyfiques font fenfiblês ou
en eux-mêmes , ou au moins par leurs effets immé:
diats. Une mafie a une figure fenfible ; une maffe en
mouvement parcourt un efpace fenfible dans un tems
fenfible ; elle eft retardée par des obftacles fenfibles,
ou elle eft retardée fenfiblement, &c. une maffe élaf-
tique eft applatie par le choc dans une partie fenfible
de fa furface, &c. cette circonftance foûmet à la
précifion géométrique la détermination des figures,
.des forces, des mouvemens de ces corps ; elle fournit
au géomètre des principes fenfibles, d’après lesquels
il bâtit cë qu’il appelle des théories, qui depuis
que le grand Newton a fait un excellent ouvrage en
décorant la Phyfique du relief de ces fublimes con-
noiffances, font devenues la Phyfique.
La Phyfique d’aujourd’hui eft donc proprement
la colleftion de toutes les fciences phyfico-mathé-
matiques : or jufqu’ à-préfent on n’a calculé que les
forces & les effets des maffes : car quoique les plus
profondes opérations de la Géométrie tranfeen-
dante s’exercent fur des objets infiniment petits, cependant
comme ces objets paffent immédiatement
de l’abftra&ion à l’état de maffe, qu’ils font des maffes
figurées, douées de forces centrales , &c. dès
qu’ils font confidérés comme êtres phyfiques , les
très-petits corps du phyficien géomètre ne font pas
lescorpùfeules que nous avons oppofés aux maffes ;
& les calculs faits fur ces corps avec cette fagacité &
cette force de génie que nous admirons , ne réndent
pas les catifeS &jles effets chimiques plus calculables,
du moins plus calculés jufqu’à-préfent.
Les’Phÿïiéiens font très-curieux de ramener tous
les phénomènes de la nature aux lois méchaniques,
8c le nom le plus honnête qu’on puiffe donner aux
caufes qu’ils aflignent, aux agens qu’ils mettent en
jeu dans leurs explications, c ’eft de les appeller mé-
chaniqu.es.
La Phyfique nous avouera elle-même fans doute
fur la nature des objets que nous lui attribuons, 8c
d’autant plus que nous ne lui avons pas enlevé ceux
qu’elle a ufurpés fur nous, & dont la propriété pou-
voit la flater ; nous avons dit feulement que fon objet
dominant étoit la contemplation des maffes.
Que la Chimie au contraire nes’occupe effentielle-
ment que des affe&ions des différens ordres de principes
qui forment les corps fenfibles ; que ce^ foit là
fon b u t , fon objet propre , le tableau abrégé de la
Chimie, tant théorique que pratique, que nous allons
tracer dans un moment, le montrera fuffifamment.
Nous obferverons d’avance, pour achever le contraire
de la Phyfique 8c de la Chimie :
i° . Que tout mouvement chimique eft un mouvez
ment inteftin, mouvement de digeftion, de fermentation
, d’effervefcence , &c. que l’air du Chimifte.
eft un des principes de la compofition des corps, fur-
tout des corps folides, s’uniffant avec des principes
différens félon les lois affinité, s’en détachant
par des moyens chimiques, la chaleur 8c la précipitaw
tion;qu’il eft fi vola til, qu’il paffe immédiatement
de l’état folide à l’expanfion vaporeufe, fans refter
jamais dans l’état de liquidité fous le plus grand froid
connu, vûe nouvelle qui peut fauver bien des peti—
teffes phyfiques ; que l’eau du Chimifte eft un ele- ■
ment, ou un corps fimple, indivifible, 8c incommu-
table , contre le lentiment de Thalès, de Van-Hel-
mont, de Boy le, & de M. EUer , qui s’unit chimiquement
aux fels, aux gommes, &c. qui eft un des
matériaux de ces corps , qui eft l’inftrument immédiat
de la fermentation , 6-c. que le feu , confidéré
comme objet chimique particulier , eft un principe
capable de combinaifon & de précipitation, confti-
tuant dans différens mixtes dont il eft le principe, la
couleur, l’inflammabilité, la métallicité, &c. qu’ainfi
le traité du feu, connu fous le nom des trecenta de
Stahl, eft tout chimique. ,
Nous avons dit le feu conjidiré comme objet chimique
particulier, parce que le feu aggrégé , confidéré
comme principe de la chaleur , n’eft pas un objet
chimique, mais un infiniment que le Chimifte employé
dans les opérations de l’art, ou un agent uni-
verfel dont il contemple les effets chimiques dans le
laboratoire de la nature.
En général, quoique le Chimifte ne traite quedes.
aggrégés, puifque les corps ne fe préfentent jamais à
lui que fous cette forme, ces aggrégés ne font jamais
proprement pour lui que dés promptuaria de fujets
vraiment chimiques, de corpufcüles ; & toutes les
altérations vraiment chimiques qu’il lui fait effuyer,
fe réduifent à deux. Ou il attaque directement fes
parties intégrantes, en les combinant une à une, ou-
en très-petite quantité numérique avec les parties intégrantes
d’un autre corps de nature différente , 8c
c’eft la diffolution chimique ou la fyncrefe. Voye^
MENSTRUE , SYNCRESE , & la fuite de cet article:
Cette diffolution eft le feul changement chymique
qu’il puiffe produire fur un aggrége d’élémens. Ou il
décompofe les parties intégrantes de l ’aggrégé, 8c ‘
c’eft là l’analyfe chimique ou la diaçrefe. Ÿoy. D ia-,
crese , Analy se v é g é ta le^ ’^umot V é g é t a l ,
& la fuite de cet article. En un mot, tant qu’il ne s’a- ‘
. git que des rapports des parties intégrantes de l’ag-'
grégé entr’elles, le phénomène n’eft pas chimique ,
quoiqu’il puiffe être dû à des agens chimiques ; par
exemple, la divifion d’un aggrégé, ponffee même
jufqu’à l’unité individuelle de fes parties, n’eft pas
chimique 3 c’eft ainfi que la pulvérifation même philofophique
ne l’eft point quant à fon effet ; la dia-
c re fe , pour être chimique , doit féparer des parties
ipécifiquement diffemblables.
Il faut obferver pourtant que quoique certains
changemens inteftins que la chaleur fait éprouver
aux corps aggrégés, ne foient chimiques à la rigueur
que lorfque leur énergie eft telle qu’ils portent juf-
que fur la conftitution intérieure des corpufcules, il
faut obferver, dis-je , que ces changemens n’étant
en général que des effets gradués de la même caufe,
ils doivent être confidérés dans toute leur extenfion
comme des objets mixtes, ou comme des effets dont
le degré phyfique même eft très-familier au-chimif-
te. Ces effets de la chaleur modérée , que nous appelions
proprement phyfiques, font la raréfaction des
corps , leur liquéfaCtipn, leur ébullition, leurvapo-
ration , l’exercice de la force élaftiquedans les corps
Comprimés, &c. Aufli les Chimiftes font-ils de bons
phyficiens fur toutes ces queftions ;d u moins il me
paroît que c’eft en pourfuivant fur ces effets une analogie
conduite de ceux où la caufe agit le plus ma-
nifeftement ( or ceux-là font,des objets familiers au
feul .chimifte ) , à ceux ovx fon influence eft plus cach
é e , que je fuis parvenu, à rapprocher plufieurs
phénomènes qui font généralement regardés comme
très-ifolés ; à découvrir par exemple que le mécha-
nifme de l’élafticité eft le même dans tous les corps,
qu’ils font tous fufceptibles du même degré d’élafti-
cité , 8c que ce n’eft que par des circonftances purement
accidentelles que les différens corps qui nous
environnent ont des différences fpécifiques à cet
égard ; que l’élaftiçité n’eft qu’un mode de la rareté
8c de la derifité, & qu’au premier égard elle eft par
conféquent toujours due à la chaleur aufli-bien que
tous les autres phénomènes attribués à la répulfion
newtonienne, qui n’eft jamais que la chaleur. Voyt{
Feü ,R a p pô r t .
i °. Les objets chimiques n’agiffent pas fenfiblement.
L ’effet immédiat du feu 8c celui des menftrues,
qui font les deux grands agens chimiques, font in-
fenfibles. La mixtion fe fait dans un tems incommen-
furable, in inftanti ; aufli ces a étions ne fe calculent
elles point, du moins n’ a-t-on fait là-deffus jufqu’à
préfent que des tentatives malheureufes.
30. Les Chimiftes ne s’honorent d’aucun agent
méchanique , ‘&ils trouvent même fortfingulier que
la feule circonftance d’être éloignés fouvent. d’un
feul degré de la caufe inconnue, ait rendu les principes
méchaniques fi chers à tant de philofophes, 8c
leur ait fait rejetter toute théorie fondée immédiatement
fur les caufes cachées , comme fi être vrai n’é-
toit autre chofequ’être intelligible , ou comme fi un
prétendu principe méchanique interpofé entre un effet
8c fa caufe inconnue , les rafluroit contre l’horreur
del 'inintelligible. Quoi qu’il en foit; ce n’eft pas
par le goût cpntraire , par un courage affefté , que
les Chimiftes n’admettent point de principes média-,
niques, mais parce qu’aucun des principes mecha-
niques connus n’intervient dans leurs opérations ;
ce n’eft pas aufli parce qu’ils prétendent que leurs
agens font exempts de méchanifme , mais parce que
ce méchanifme eft encore inconnu. On reproché
aufli très-injuftement aux Chimiftes de fe plaire dans
leur obfcurité ; pour que pette imputation fût raifon-
nable, il faudroit qu’on leur montrât des principes
évidens 8c certains : car enfin ils ne feront pas blâmables
tant qu’ils préféreront l’obfcurité à l’erreur ;
8c s’il y a quelque ridicule dans cette maniéré de phi-
lofopher , ils font tous réfolus à le partager avec
Ariftote , Newton, 8c cette foule d’anciens philofophes
dont M. de Buffon a dit dans fon hiftoire
naturelle qu’ils avoient le .génie moins limité, &
la philofophie la plus étendue ; qu’ils s’étonnoient
moins que nous des faits qu’ils ne pouvoient expliquer
; qu’ils voyoient mieux la nature telle qu’elle
eft ; & qu’une lympathie, une correfpondance n’é-
toit pour eux qu’un phénomène, tandis que c’eft
pour nous un paradoxe , dès que nous ne pouvons
le rapporter à nos prétendues lois de mouvement.
Çes hommes fa voient que la nature opéré la plupart
de fes effets par des moyens inconnus ; que nous ne
pouvons nombrer fes reffouces ; & que le ridicule
r é e l, ce feroit de vouloir la limiter, en la réduifant
à un certain nombre de principes d’a&ion & de
moyens d’operations ; il leur fuffifoit d’avoir remarque
un certain nombre d’effets relatifs & de même
ordre pour conftituer une caufe. Les Chimiftes font-
ils autre chofe ?
Ils recevroient avec empreffement & reconnoif-
fance toute explication méchanique qui ne feroit pas
contredite par des faits: ils feroient ravis par exemple
de pouvoir fe perfuader, avec J. Keill & Freind,
que le méchanifme de l’effervefcence & de là fermentation
confifte dans l’aâion mutuelle de certains
corpufcules folides & élaftiques, qui fe portent avec
force les uns contre les autres, qui réjailliffenr proportionnellement
à leur quantité de mouvement &
à leur élafticité, qui fe choquent de nouveau po.ur
réjaillir encore, &c. Mais cette explication, aufli in-
génieufe qu’arbitraire., eft démentie par des faits qui
font voir clairement que-le mouvement d’effervef-
çençe & celui de fermentation font dûs au dégagement
d’un corps fubtif & expanfible, opéré par les
lois générales des affinités., c’eft-à-dire par un principe
très-peu méchanique. Voyt{ Effervescence
& Fe rm en t a t io n .
- Plutôt que de s’avouer réduits à énoncer Amplement
qu’une diffolution,n’eft autre chofe que l’exer-
. cice d’une certaine tendance ou rapport par lequel
..deux.eprps mifcibles.font, portés L’un, vers l’autre,
n’aimeroient-ils pas mieuxffe figurer une cliffolution
^fous l’image très-fenfifile d’un menftrue armé de parties
roides , folides, maflîves, tranchantes, &c.d’un
côté; fous celle d’un corps percé d’une infinité de
pores proportionnés à la maffe & même à la figure
des parties du menftrue, de l’autre ; 8c enfin fous celle
de çhqçs réitérés des parties du menftrue contre la
maffe des corps àdiffoudre, de leur introduction forcée
dans fes pores , fous celle d’un édifice long-tems
ébranlé, & enfin riiinéjufque dans fes derniers matériaux
; images fous lefquelles les Phyficiens ont re-
préfenté ce phénomène. Ils l ’aimeroient mieux fans
contredit, parce qu’une explication eft une richeffe
dans l’ordre des connoiffances ; qu’elle en groffit au
moins la fomme ; que le relief que cette efpece de
fafte favant procure n’eft pas un bien imaginaire; &
qu’au contraire un énoncé tout nud décele une indigence
peu honorable : mais fi l’explication dont il s’agit
ne fupppfe pas même qu’on fe foit douté des circonftances
effentielles du phénomène qu’on a tenté
d’expliquer ; fi cette deftru&ion de la maffe du corps
àdiffoudre , dont on s’eft mis tant en peine, eft purement
accidentelle à la diffolution qui a lieu de la
même façon entre deux liqueurs ; & enfin fi cette circonftance
accidentelle a fi fort occupé le théoricien
qu’il a abfolument oublié la circonftance effentielle
de la diffolution, favoir l’union de deux fubftances
entre lefquelles elle a eu lieu , il n’eft pas poffible de
fe payer d’une monnoie défi mauvais aloi. Boerhaave
lui-même,que nous fommes ravis de citer avec éloge
lorfque l’occafions’en préfente, a connu parfaitement
le vice de cette explication, qu’il a très-bien
réfutée. V°yt:i Boerhaave , de mentruis , Elément,
Chimice, part. I I .
Nous voudrions bien croire encore avec Freind
que la diffolution eft de toutes les opérations chimiques
celle oui peut être ramenée le plus facilement
aux lois méchaniques , 8c en admettre avec lui cçs