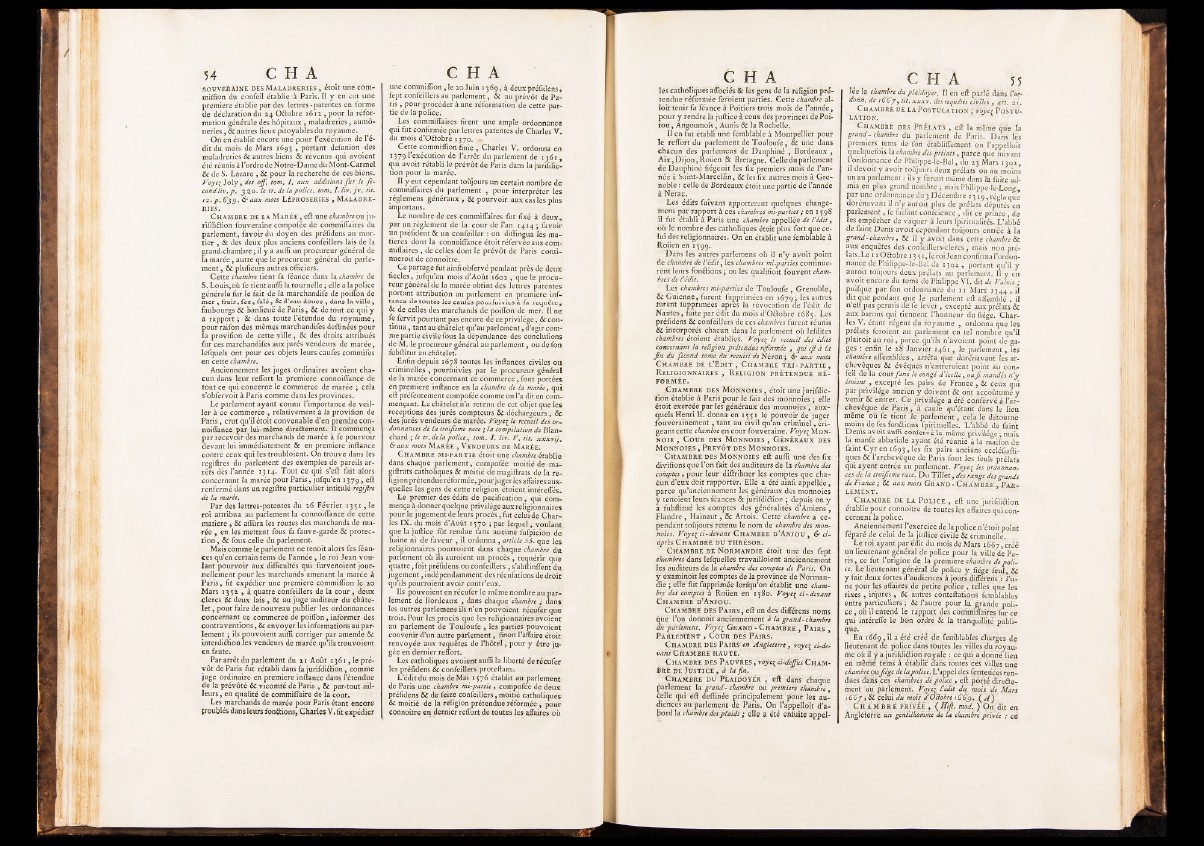
souveraine des M aladreries , étoit une commiffion
du confeil établie à Paris. Il y en eut une
première établie par des lettres-patentes en forme
de déclaration du 14 Odobre 1612 , pour la réformation
générale des hôpitaux, maladreries, aumô-
neries, & autres lieux pitoyables du royaume.
On en établit encore une pour l’exécution de l’édit
du niois de Mars 1693 , portant defunion des
maladreries & autres biens & revenus qui avoient
été réunis à l’ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel
8c de S. Lazare , 8c pour la recherche de ces biens.
Voyt{ J oly, des off, tom. I. aux additions fur le fécond
liv. p. 2,2.0. Le tr.de la police, tom. I. liv. jv . tit.
12. p. 639. & aux mots L éproseries , Maladrerie
s .
C hambre de la Ma r é e , eft une chambre ou ju-
rifdidion fouveraine compofée de commiffaires du
parlement, favoir du doyen des prélidens au mortier
, & des deux plus anciens confeillers lais de la
grand-chambre ; il y a auffi un procureur général de
la marée, autre que le procureur général du parlement
, 8c plufieurs autres officiers.
Cette chambre tient fa féance dans la chambre de
S. Louis,où fe tient auffi la tournelle ; elle a la police
générale fur le fait de la marchandife de poiffon de
m e r , frais, fec, falé, 8c d’eau douce , dans la v ille ,
faubourgs 8c banlieuë de Paris, 8c de tout ce qui y
a rapport ; & dans toute l’étendue du royaume,
pour raifon des mêmes marchandifes deftinees pour
la provifion de cette v ille , 8c des droits attribués
fur ces marchandifes aux jurés vendeurs de marée,
lefquels ont pour ces objets leurs caufes commifes
en cette chambre.
Anciennement les juges ordinaires avoient chacun
dans leur reffort la première connoiffiance de
tout ce qui concerne le commerce de marée ; cela
s’obfervoit à Paris comme dans les provinces.
Le parlement ayant connu l’importance de veiller
à ce commerce , relativement à la provifion de
Paris, crut qu’il étoit convenable d’en prendre con-
noiffance par lui-même directement. Il commença
par recevoir des marchands de marée à fe pourvoir
devant lui immédiatement & en première inftance
contre ceux qui les troubloient. On trouve dans les
regiftres du parlement des exemples de pareils arrêts
dès l’année 1314. Tout ce qui s’eft fait alors
concernant la marée pour Paris, jufqu’en 1379 >
renfermé dans un regiftre particulier intitulé regiftre
de la maree.
Par des lettres-patentes du 16 Février 13 5 1 , le
roi attribua au parlement la connoiffiance de cette
matière j & affûra les routes des marchands de marée
, en les mettant fous fa fauve-garde 8c protection
, & fous celle du parlement.
Mais comme le parlement ne tenoit alors fes féan-
ces qu’en certain tems de l’année, le roi Jean voulant
pourvoir aux difficultés qui furvenoient journellement
pour les marchands amenant la marée à
Paris, fît expédier une première commiffion le, 2.0
Mars 1351 , à quatre confeillers de la cour , deux
■ clercs 8c deux la is, 8c au juge auditeur du châtele
t , pour faire de nouveau publier les ordonnances
concernant ce commerce de poiffon, informer des
contraventions, 8c envoyer les informations au parlement
; ils pouvoient auffi corriger par amende 8c
interdiction les vendeurs de marée qu’ils trouvoient
en faute.
Par arrêt du parlement du 11 Août 136 1, le prévô
t de Paris fut rétabli dans fa jurifdiétion, comme
juge ordinaire en première inftance dans l’étendue
de la prévôté 8c vicomté de Paris , 8c par-tout ailleurs
, en qualité de commiffiaire de la cour.
Les marchands de marée pour Paris étant encore
{roubles dans leurs fondions, Charles V , fit expédier
une commiffion, le 20 Juin 1369, à deux prélidens»
fept confeillers au parlement, 8c au prévôt de Paris
, pour procéder à une réformation de cette partie
de la police.
Les commiffaires firent une ample ordonnance
qui fut confirmée par lettres patentes de Charles V .
du mois d’OCtobre 1370.
Cette commiffion finie , Charles V. ordonna en
13 79 l’exécution de l’arrêt du parlement de 136 1 ,
qui avoit rétabli le prévôt de Paris dans la jurifdic-
tion pour la marée.
Il y eut cependant toujours un certain nombre de
commiffaires du parlement , pour interpréter les
réglemens généraux , 8c pourvoir aux cas les plus
importans.
Le nombre de ces commiffaires fut fixé à deux,
par un réglement de la cour de l’an 14 14 ; favoir
un préfident & un confeiller : on diftingua les matières
dont la connoiffiance étoit réfervée aux commiffaires
, de celles dont le prévôt de Paris conti-
nueroit de connoître.
Ce partage fut ainfiobfervé pendant près de deux
fiecles, jufqu’au mois d’Août 1602, que le procureur
général de la marée obtint des lettres patentes
portant attribution au parlement en première inftance
de toutes les caufes pourfuivies à fa requête,
& de celles des marchands de poiffon de mer. Il ne
fe fervit pourtant pas encore de ce privilège, & continua
, tant au châtelet qu’au parlement, d*agir comme
partie civile fous la dépendance des conclufions
de M. le procureur général au parlement, ou de font
fubftitut au châtelet.
Enfin depuis 1678 toutes les inftances civiles ou
criminelles , pourfuivies par 4e procureur général
de la marée concernant ce commerce, font portées-
en première inffance en la chambre de la marée, qui
eft préfentement compofée comme on l’a dit en commençant.
Le châtelet n’a retenu de cet objet que les
réceptions des jurés compteurs 8c déchargeurs , 8c
des jurés vendeurs de marée. Voye[ le recueil des ordonnances
de la troifieme race ; la compilation de Blanchard
; le tr.dela police, tom. I . liv. V . tit. x x x v ij .
& a u x mots MARÉE , VENDEURS DE MARÉE.
C hambre m i-p a r t ie étoit une chambre établis
dans chaque parlement, compofée moitié de ma-
giftrats catholiques & moitié de magiftrats de la religion
prétendue réformée, pour juger les affaires auxquelles
les gens de cette religion étoient intéreffés.
Le premier des édits de pacification , qui commença
à donner quelque privilège auxreligionnaires
pour le jugement de leurs procès, fut celui de Charles
IX. du mois d’Août 15 70 ; par lequel, voulant
que la juftice fût rendue fans aucune fufpicion de
haine ni de faveur , il ordonna , article 55. que les
religionnaires pourroient dans chaque chambre du
parlement où ils auroient un procès , requérir que
quatre, foit préfidens ou confeillers , s’abftinffent du
jugement, indépendamment desrécufations de droit
qu’ils pourroient avoir çontr’eux.
Ils pouvoient en récufer le même nombre au parlement
de Bordeaux , dans chaque chambre ; dans
les autres parlemens ils n’en pouvoient récufer que
trois. Pour les procès que les religionnaires avoient
au parlement de Touloufe , les parties pouvoient
convenir d’un autre parlement, finon l’affaire étoit
renvoyée aux requêtes de l’hôtel, pour y être jugée
en dernier reffort.
Les catholiques avoient auffi la liberté de récufer
les préfidens 8c confeillers proteftans.
L’édit du mois de Mai 1576 établit au parlement
de Paris une chambre mi-partie , compofée de deux
préfidens 8c de feize confeillers, moitié catholiques
8c moitié de la religion prétendue réformée, pour
connoître en dernier reffort de toutes les affaires où
les catholiques affociés 8t lés gens de la religion prétendue
réformée fèrbient parties. Cette chambre al-
loi’t tènir là féancè à Poitiers trois mois de Farinée,
pour y rendre la juftice à ceux dès provinces de Poitou
, Angbumois, Àunis 8c la Rochelle.
Il en fut établi une fémblable à Montpellier pour
le reffort du parlement de Toüloufé, 8c une dans
chacun des parlemens de Dauphiné , Bordeaux ,
A ix , Dijon, Rouen & Bretagne. Celle du parlement
de Dauphiné fiégeoit les fix premiers mois de l’année
à Saint-Marcellin, 8c les fix autres mois à Grenoble
: celle de Bordeaux étoit une partie de l’année
à Nera'c.
Les édits fuivans apportèrent quelques changerions
par rapport à ces chambres mi-parties ; en 1598
il fut établi à Paris une chambre appellée de l'édit,
ôù le nombre des catholiques étoit plus fort que celui
des religionnairés. On en établit une femblable à
Rouen en 1599.
Dans lès autres parlemens où il n’y avoit point
de chàhibre de l'édit, les chambres mi-parties continuèrent
iéurs fondions ; on les qualifioit fouvent chambres
de l'édit.
Les chambres mi-parties de Touloufe , Grenoble,
& Guienne , furent fupprimées en 1679 » ^es autres
furèrit fùppfimées après la révocation de l’édit de
Nantes y faite par édit du mois d’Odobre 1685. Les
préfidens 8c confeillers de ces chambres furent réunis
& incorporés chacun dans le parlement où lefdites
chambres étoiént établie^. Voye^_ le recueil des édits
1concernant la religion, prétendue reformée , qui ejl à La
fin du fécond tôm'è du recuéd de Néron ; & aux mots
C hambre de l’Édit , C hambré t r i - pa r t ie ,
Re l ig io n n a ir e s , Rel ig ion prétendue r éfo
rm é e .
.Chambre des Mônnoies , étoit une jurifdic-
tion établie à Paris pour lé fait des rtionnoies ; elle
étoit exércée par les généraux des monnoiés , auxquels
Henri II. donna en 15 51 le pouvoir de juger
foüvëràiriëment, tarit au civil qu’au criminel, érigeant
cette chambre en cour fouveraine. Voye^ Mqn-
n o ie , C our des Monnoiés , G énéraux des
Monnoiés , Prévôt des Monnoiés.
C h ambre des Monnoiés eft auffi une des fix
divifions que l ’on fait des auditeurs de la chambre des
comptes, pour leur diftribuer les comptes que chacun
d’eüx doit rapporter. Elle a été ainfi appellée,
parce qu’anciennement les généraux des monnoiés
y terioient leurs féances 8t jurifdidion ; depuis on y
a fubftitué les comptes des généralités d’Amiens,
Flandre , Hainaut, 8c Artois. Cette chambre a cependant
tôûjours retenu le nom de chambre des mon-
noies. Voye^ ci-devant CHAMBRE d ’A n jo u , & ci-
après C hambre du th réso r.
C hambré de Normandie étoit une des fept
chambrés dans lefquelles travailloient anciennement
les auditeurs de la chambre des comptes de Paris. On
y examinoit les comptes de la province de Norriian-
dië ; elle frit fuppriméë lorfqu’on établit une chambre
des comptes à Roüeri en 1580. Voyt{ ci-devant
C hambre d’Anjou.
C haiùére des Pa ir s , eft un dés différens noms
que fon dbnnoit anciennement à la grand-chambre
du pdHtment. Voyt{ Grand - C hambre , Pairs ,
Pà é leMéNt , C our des Pa irs.
C hambre des PAIRS en Angleterre y voye^ ci-de-
vàrit C h ambré haut é.
. C hambre pes Pauvées , voye^ci-deffiis C ham -
Ère bt; Ju st ic e , à là fin.
C hatUbre du Pé a iHOyéR , eft dahs chaque
fjâflëmeht la' grand- charàbrè où première chambre ,
celle qui eft deftinéë pfihtipaletnént pour lés audiences
au parlement dè Paris. On l’appèlloit d’abord
la' chambre des plaids ; elle a été érifuite appel-
! lee la chambre du plaidoyer. II en éft parlé dans IV-
dond. de tit. xxxv. des requêtes civiles , art. %u
de la Po stulat io n ; voye? Postü -
lA’t î6 n. • ; • •■ '■ ‘p*'--
C hambée dés Prélat s , ëft la même que la
grand' - chambre du parlement de Paris. Dans les
premiers tems de fort étâbliffeirient on l’àppelloit
quelquefois la chambré des prélats, pàrcë que fuivant
l’ordonnance de Philippë-lë-Bel, du 23 Mars 1302,
il devoir y avoir toûjoiirs deux prélats bu au moins
un au parlement : ils y fürent même dans la fuite admis
en plus grand nombre ; mais Phïlippe-Ie-Long ,
par une ordonnancé du'3 Décembre 1319, régla que
doreriavant il n’y auroit plus de prélats députés en
parlement, fe faifànt corifciénce , dit ce prince, de
les empêcher de vaquer à leurs fpiritualités. L ’abbé •
de faint Denis avoit cependant toûjours entréé à la
grand-chambre, & il y avoit dans cettë chambre &
aux enquêtes des confeillers-clercs , mais npn prélats.
Le 11 Oélobre 13 51, le roi Jean confirrria l’ordonnance
de Philippe-lë-Bél dë 1302 , portant qu’il y
auroit toujours deux prélats au parlement. Il y en
avoit encore dû terris dé Philippe VI. dit de Valois;
puifque par fort ordonnance du 11 Mars 134 4 , il
dit què pendant que Iq parlement eft aflèmblé , il
n’eft pas permis dé fe lè y e r , excepté aux prélats 8c
aux barons qui tiennent l’honneur du fiége. Charles
V . étant régent du foyàûme , ordonna que les
prélats feroient au parlement en tel nombre qu’il
plairoit au r o i , parcè qu’ils ri’àvoient point de gages
: enfin le 28 Janvier 146 1 , le parlement, les
chambre affembléés , arrêta quë dorénavant les archevêques
8c évêqùè's n’éntfefoient point au confeil
de là cour fans le c'ongé d'icelle , ôuji mandés né y
etoient y excepté les pairs, de France , & ceux qui
par privilège ancien y doivent 8c ont accoûtùmé y
venir 8c entrer. Cè privilège a été confervé à l ’archevêque
dè Paris, ,a capte qu’étant dans le lieu
même où fe tient le parlement, cela lé détourne
moins dé fes fondions fpirituelles. L’abbé dé faint
Denis avoit auffi confervé le, même privilège ; mais
la manfë abbatiale ayânt'été réuniè à la maifon de
faint C y r én 1693, les fîx pairs anciëri’s ecclefiafti-
ques 8c l’archevêque de Çaris font les.feuls prélats
qui ayerit entrée au parlémeht. Voye^ les ordonnances
de la troifieme race. D u T îlle t, des rangs des grands
de FraAce ; 8c aux mots Grand - C hambré , Pa r lem
en t .
C hamére de la Po l ic e , eft une jurifdidion
établie pour connoître. de toutes les affaires qui concernent
la police.
^ Anciennement Fexercice.de la police n’étoit point
féparé dè celui de la juftice civile 8c criminelle.
Le roi ayant par édit du mois de Mars 1667, créé
un lieutenant général de police pour la ville de Paris,
ce fut l’origine de la premiere chambre de police.
Le liëütènant général de police y . fiége feul, 8c
y fait deux fortes d’audiences à jours, différèris i l’une
pour les affaires de petite policé , telles que les
rixes , injùrés , 8c autres conteftatioriS femblables
entre particuliers ; 8c l’autre pour la grande policé
, où il ériterid lé rapport des commiffaires fur ce
qui intéreffe le bon ordre 8c la tranquillité pùbli-
qüe.
En 1669, il à été créé de feniblàbfe.s charges dé
lieutenant de police dans toutes les villes du royau-
riiè où il v a jurifflidion royale : ce qui a donné lieu
éri rifênie tems à établir dans toutès cès villes une
chambre ou fiége de lapolice^ L’appel des fente n’çes rendues
dans ces chambrés de police[, eft porté direfte-
rneht ''ali .pàrlëmérif. pçyéfl'édil du, niois. de Mars
i 66J » S t celui dit mois a Qctobxe 10^9 ?. { A )
C h a m b r é priyé é , (H ift . mod. ) On dit en
Angleterre un gentilhomme de là chambré'privée : cè