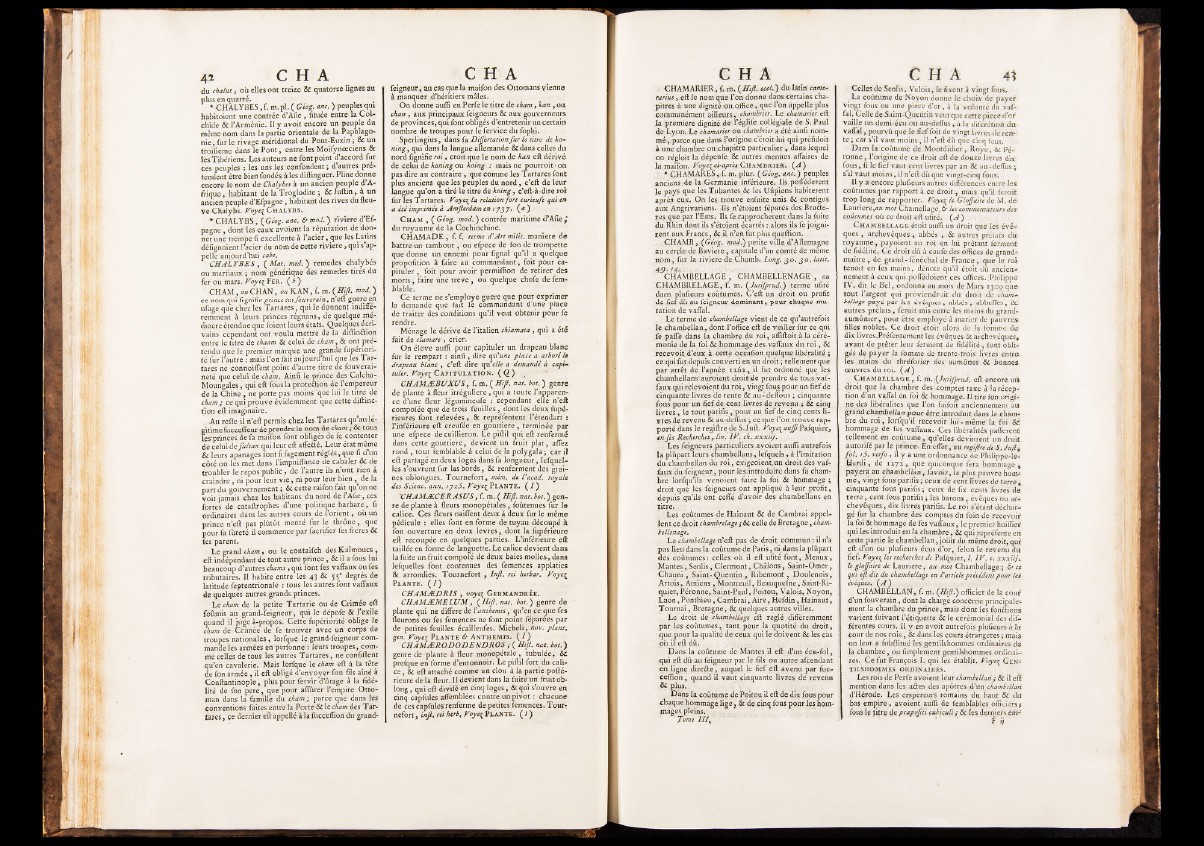
du chalut, où elles ont treize & quatorze lignes au
plus en quarré.
* CHALYBES , f. m.pl. ( Géog. anc. ) peuples qui
habitoient une contrée d’Afie, fituée entre la Col-
chide & l’Arménie. Il y avoit encore un peuple du
même nom dans la partie orientale de la Paphlagonie
, fur le rivage méridional du Pont-Euxin ; & un
troifieme dans le Pont, entre les Moifynoeciens &
les Tibériens. Les auteurs ne font point d’accord fur
Ces peuples : les uns les confondent ; d’autres prétendent
être bien fondés à les diftinguer. Pline donne
encore le nom de Chalybes à un ancien peuple d A-
frique, habitant de la Troglodite ; &c Juftin, à un
ancien peuple d’Efpagne, habitant des rives du fleuv
e Chalybs. Foye^ C h a l yb s .
* CHALYBS, ( Géog. anc. & mod. ) riviere d’Efpagne
, dont les eaux avoient la réputation de don-t
ner une trempe fi excellente à l’acier, que les Latins
défignoient l’acier du nom de cette riviere, qui s’appelle
aujourd’hui cube. ........... f
CH A L Y B E S , ( Mat. mtd. ) remedes chalybes
ou martiaux ; nom générique des remedes tires du
fer ou mars. Voye% Fer. ( b )
CHAM , ou CHAN, ou K A N , f. m. ( Hiß. mod. )
ce nom qui fignifîe prince ou fouverain, n’eft guere eh
ufage que chez les Tartares, qui le donnent indifféremment
à leurs princes régnans, de quelque médiocre
étendue que foient leurs états. Quelques écrivains
cependant ont voulu mettre de la diftinûion
entre le titre de chaam & celui de cham, & ont prétendu
que le premier marque une grande fupériori-
te fur l’autre : mais l’on fait aujourd hui que les T ar-
tares ne connoiffent point d’autre titre de fouverai-
neté que celui de cham. Ainfi le prince des Calcha-
Moungales, qui eft fous la prote&fon de l’empereur
de la Chine, ne porte pas moins que lui le titre de
cham ; ce qui prouve évidemment que cette diftirtc-
tion eft imaginaire.
A u refte il n’eft permis chez les Tartares qu’au 1er
gitime fucceffeur de prendre le nom de cham ; 8c tous
les'princes de fa maifon font obligés de fe contenter
de celui de fultan qui leur eft affeâé.^ Leur état même
& leurs apanages font fi fagement réglés, que fi d’un
côté on les met dans l’impuiffance de cabaler & de
troubler le repos public, de l’autre ils n’ont rien a
craindre, ni pour leur v ie , ni pour leur bien , de la
part du gouvernement ; & cette raifon fait qu on ne
voit jamais chez les habitans du nord de l Afie, ces
fortes de cataftrophes d’une politique barbare, fi
ordinaires dans les autres cours de l’orient, où un
prince n’eft pas plutôt monté fur le thrône, que
pour fa fureté, il commence par facrifîer fes freres &
les parens.
Le grand cham, ou le contaifch des Kalmoucs ,
eft indépendant de tout autre prince, & il a fous lui
beaucoup d’autres chams, qui font fes vaffaux ou fes
tributaires. Il habite entre les 43 & 55e degrés de
latitude feptentrionale : tous les autres font vaffaux
de quelques autres grands princes.
Le cham de la petite Tartarie ou de Crimée eft
fournis au grand-feigneur, qui le dépofe & l’exile
quand il juge à-propos. Cette fupériorité oblige le
cham de Crimée de fe trouver avec un corps de
troupes nationales, lorfque le grand-feigneur commande
les armées en perfonne : leurs troupes, comme
celles de tous les autres Tartares, ne confiftent
qu’en cavalerie. Mais lorfque le cham eft à la tête
de fon armée, il eft obligé d’envoyer fon fils aîné à
Conftantinople, plus pour fervir d’ôtage à la fidélité
de fon pere, que pour affûrer l’empire Ottoman
dans la famille du cham ; parce que dans les'
conventions faites entre la Porte & le cham des Tartares,
ce dernier eft appelle à la fuççéfEon du grandfeigneur,
au cas que la maifon des Ottomans vienne
à manquer d’héritiers mâles.
On donne auffi en Perfe le titre de cham, kan, ou
chan , aux principaux feigneurs & aux gouverneurs
de provinces, qui font obligés d’entretenir un certain
nombre de troupes pour le fervice du fophi.
Sperlingius, dans fa Dijfertation fur le titre de ko-
ning, qui dans la langue allemande & dans celles du
nord fignifîe roi , croit que le nom de kan eft dérivé
de celui de koning ou koing : mais ne pourroit - on
pas dire au contraire , que comme les Tartares font
plus anciens que les peuples du nord, c’eft de leur
langue qu’on a tiré le titre de koing, c’eft-à-dire roi:
fur les Tartares. Foye^ la relation fort curieufe qui en
a été imprimée à Amfierdam en iJ$J. (<* )
C ham , (Gcog. mod.') contrée maritime d’Afie*
du royaume de la Cochinchine.
CHAMADE, f. f. terme d’Art milit. maniéré de
battre un tambour , ou efpece de fon de trompette
que donne un ennemi pour fignal qu’il a quelque
propofition à faire au commandant, foit pour capituler
, foit pour avoir permiffion de retirer des
morts, faire Une tre ve , ou quelque chofe de fem-
blable.
Ce terme rie s’employe guere que pour exprimer
la demande que fait le commandant d’une place
de traiter des conditions qu’il veut obtenir pour fe
rendre.
Ménage le dérive de l’italien chiamata , qui a été
fait de clamare , crier.
On éleve auffi pour capituler un drapeau blanc
fur le rempart : ainfi, dire qu'une place a arboré It
drapeau blanc , c’eft dire qu’e//e a demandé à capi~.
tuler. Yoyei CAPITULATION. ( Q ) 4
CHAMÆBUXUS, f. m. ( Hifi. nat. bot. ) genre
de plante à fleur irrégulière, qui a toute l’apparence
d’une fleur légumineufe : cependant elle n’eft
compofée que de trois feuilles, dont les deux fupé-
rieures font relevées, & repréfentent l’étendart :
l’inférieure eft creufée en gouttière, terminée par
une efpece de cuillieron. Le piftil qui eft renfermé
dans cette gouttière, devient un fruit plat, affez
rond , tout femblable à celui de la polygala ; car il
eft partagé en deux loges dans fa longueur, lefquel-
les s’ouvrent fur las bords, & renferment des graines
oblongues. Tournefort, mém. de l'acad. royale
des Scienc. ann. tyxS. Foyc^ Pla n t e . ( I )
’CHAMÆCERASUSy f. m. ( Hifi. nat. bot. ) genre
de plante à fleurs monopétales, foûtenues fur la
calice. Ces fleurs naiffent deux à deux fur le même
pédicule : elles font en forme de tuyau découpé à
fon ouverture en deux levres, dont la fupérieure
eft recoupée en quelques parties. L’inférieure eft
taillée en forme de languette. Le calice devient dans
la fuite un fruit compofé de deux baies molles, dans
lefquelles font contenues des femences applaties
& arrondies. Tournefort , Infi. rei herbar. Foyc^
Plante. ( / )
CH AM Æ D R IS , voye{ Germàndrée.
CHAMÆMELUM, (Hifi. nat. bot.) genre de
plante qui ne différé de l’anthémis, qu’en ce que fes
fleurons ou fes femences ne font point féparees par
de petites feuilles écailleufes. Micheli, nov. plant.
gen. Foye[ Plan t e & Anthemts. ( I )
CHAMÆR O D O D E ND RO S ; ( Hijl. nat. bot.)
genre de plante à fleur monopétale ,• tubulée, &
prefque en forme d’entonnoir. Le piftil fort du calic
e , & eft attaché comme un clou à la partie pofté-
rieure de la fleur. Il devient dans la fuite un fruit ob-
long, qui eft divifé en cinq loges, & qui s’ouvre en
cinq capfules affemblées contre un pivot : chacune
de ces capfules renferme de petites femences. Tournefort
, infi, rei hcrb, Foye{ PLANTE. ( I )
| CHAMARIER, f. m.. (. Hifi. ecclf) dù lâtin came*
tarius y.eft le nom que l’on donne dansicértains chapitres
à une dignité ou; o ff ic eq u e l’on Appelle plus
communément ailleurs , • chambrier^ Le chamarier eft
la première dignité;de' l’églife collégiale de S. Paul
de Lyon. Le chamarier oxi chambrier a été ainfi nommé;,
parce que dans l’origine cetoitiui qui préfidoit
à une chambre ouicbapitré particulier, dans lequel
on régloit la. dépenfe. & autres menues affaires de
la maifom Foye^ ci-après, C hAMBRIER. (A )
* ÇHAMARES, f. m. plür. ( Géog. anc.) peuples
anciens;de la Germanie inférieure. Ils pofféderent
le pays que les Tubantesôf les Ufipi.éns habitèrent
après-eux. On les trouve-enfuite unis. & ; contigu s
aux AngrivarienS, lls n’étoient féparés des Brutte-
^es que par l’Ems. Ils, fe :ra;ppro.cherertt dans la fuite
du Rhin dont ils s’étoient écartés : alprs ils fe joignirent
aux Francs , & :ilin’en.fut plus queftion,
. ,.CHAMB y (Géog. mod.) petite ville; d’Allemagne
au cercle-de Bavière, capitale d’un .comté de même
nom, fur. la riviere de.Chamb. Long, j o . j o . latit. ■' m H . ■ I - ■ CHAMBELLAGE, CHAMBELLENAGE , ou
CHAMBRELAGE, f. m. ( Jurifprud,,) terme ufité
dans plufieurs coût.upie5* C ’eft un droit ou profit
de fief dû au feigneur dominant, pour chaque mutation
de vaffal.
Le terme de chambellage vient de ce qu’autrefois
le chambellan, dont.l’office eft;de veiller fur ce qui
fe paffe dans la chambre du roi, affiftoit à la cérémonie
de la foi & hommage des vaffaux,du r o i , &
recevoir d’eux à cette ocçafion quelque libéralité ;
ce qui fu.t,depuis converti en un droit ; tellement que
par arrêt de l’apnée. 11,62,.il fut ordonné que les
chambellans , auroient droitfde prendre de tous /vaf-
fapx qui relevoient du ro i, yingt fous pour un fief dp
cinquante livres de rente & au-deffous ; cinquante
fous pour un fief de.cent: livres de revenu ; & cinq
liv re s , le tout parifis Kpour un fief de cinq cents livres
de revenu 8c au;deffus ; ce que l’on trouve rapporté
dans le régiftre de S. Juft. Foye^aujjiPafquier,
en fies Recherches,, liy, IF , ch. xxxiij.
■ Les feigneurs particuliers avoient aiiffi autrefois
la plupart leurs chambellans, lefquels, à i’imitation
du chambellan du ro i, èxigeoient, un droit, des. vaffaux
du feigneur,, pour lesfintrpduire dans fa chambre
lorfqu’ils venoient faire la foi & hommage ;
droit que les feigneurs ont appliqué à leur profit,
depuis qu’ils ont ceffé d’avoir des chambellans en
titre.
Les coutumes de Hainaut & de Cambrai appel-
lent ce droit chambrelage ; Ôc celle de Bretagne, cham-
bellenage.
Le chambellage n’eft pas de droit commun : il n’a
pas lieu dans la coutume de Paris, ni dans la plupart
des coutumes : celles où ii eft ufité font, Meaux,
Mantes, Senlis, -Clermont, Châlons, Saint-Omer,
Chauni, Saint- Quentin , Ribemont, Doulenois,
Artois, Amiens , Montreuil, Beauquefne, Saint-Ri-
quier, Péronne, Saint-Paul, Poitou, Valois, Noyon,
Laon, Ponthieu, Cambrai, A ire, Hefdin j Hainaut,
Tournai, Bretagne , & quelques autres villes;
Le droit de chambellage eft réglé différemment
par les coutumes, tant pour la quotité du droit,
que, pour la qualité de ceux qui le doivent & les cas
où il eft du.
Dans la coutume de Mantes il eft d’un écu-fol,
qui eft dû au feigneur par le fils ou autre afeendant
en ligne direéle, auquel le fief éft avenu par fuc-
cefïion, quand il vaut cinquante livres dé revenu
& plus.
Dans la coûtume .de Poitou il eft de dix fous pour
chaque hommage lige, & de cinq fous pour les hommages,
pleins..*;; ^
Rome I l l f
Celles de Senlis, Valois, le fixent à vingt fous.
■- La coûtume de Nbyon donne lè: choix de payer
vingt fous ou une piece d’o r , à la volonté du .vaf-
fah Celle .de Saint-Quentin veut que cette piece d’o f
Vaille un:demi-écu;ou,au-deffus, à la diferétiori du
vaffal, po.uryû quê.le fief foit de vingt livres dè rente
; car s’il vaut moins, il n’eft dû que cinq fous. ,
Dans la’coûtumê dè Montdidier, Roÿe, & Pé-
rprtne, l’origine de ce droit eft de douze livres dix
fous, fi le fief vaut cent livrés, par an &c au-deffus ;
s’il vaut moins, il n’éft dû que vingt-cinq fous.
- | | y a;ehcbre plufieiirs autres différences entre les
coutumes par rapport à ce .droit-, mais. qu’il feroit
trop.long,de rapporter. Foye% le G l o f aire de M. de
Lauriere,<zæ mot Chamellage,0* les commentateurs des
coutumes où ce droit eft ufité;, (A )
C hambe llage étoit auffi un droit que les évêques
, archevêques , abbés , & autres prélats dû-
royaume , ;payoient au roi en lui prêtant ferment
de fidélité. Ce droit dû à.caufedes offices de grande
maître , de grand - fé né chai de France, que le roi
tenoit en fes mains, dénote qu’il étoit dû anciennement
à. ceux qui poffédoiertt ces office^..Philippe
IV.,dit le Bel, ordonna au,mois de Mars 1309 que
tom l’argent qui prôvieridroit du droit âe cham-
bellage payé parles évêques, abbés., abbéffés, &C
autres prélats, feroit.mis entre les mains du grand-
aumônier , pour être employé à marj,ejr de pauvres?,
filles nobles.: Ce droit étoit; alors de la .fomrné de
dix livres.Préfentement les évêques & archevêques^
avant de prêter leur ferment de fidélité font obligés
de payer la fomme d.e trente-trois livres entre
le s . mains du thréfprier des aumônes & bonnes
oeuvres du roi. (A )
C ham be llag e , f. m. j (jurifprud. eft encore, uii
droit que la chambre des .comptes taxe à la réception
d’un vaffal en foi & hommage. Il tire fon origine
des libéralités que l’on faifqit anciennement ait
grand chambellan pour être introduit dans la chambre
du ro i, lorfqu’il recévoit lui - même: la. foi ÔS
hommage de fes vaffaux. Ces libéralités pafferenü
tellement en coutume, qu’elles devinrent un .droit
autorifé par le prince. En.effet, au regifire de S.Jufi^
fol. iS. verfo y il y a une ordonnance de Phiïippe-Ie-*
Hardi, de i z y z , que quiconque fera hommage *
payera au chambellan, lavoir, le plus pauvre homme
, vingt fous parifis ; ceux de cent livres de terre ^
cinquante fous parifis ceux de fix cents livres de
terre j.cent fous parifis ; les barons, évêques bu archevêques
, dix livres parifis. Le roi s’étant déchargé
fur la chambre des comptes du foin de recevoir
la foi & hommage de fes vaffaux; le premier huiffier
qui les introduit en la chambre, & qui repréfente eii
cette partie le chambellan, joiiit du même droit, qui
eft d’un ou plufieurs écus d’or, felori le revenu dû
fief. Voye^ les recherches de Pafquier, /. I F , ç? Xxxiijï
le glojfaire de Lauriere, au mot Chambellage; 6* ce
qui tfl dit du chambellage en l'article précéde.nt pour les
évêques. ( A )
CHAMBELLAN; fi ni. (Hifi.) officiel de îâ cour
d’un fouverain, dont la charge concerne principalement
la chambre du prirtee, niais dont les foriâions
Varient fuivant l’étiquette & le cérémonial des différentes
cours. Ü y en avoit autrefois plufieurs à là
cour de nos rois, & dans les cours étrangères ; mais
on leur a fubftitué les gentilshomnies ordinaires dè
la chambre, ou fimplement gentilshommes ordinaires.
Ce fut François I. qui les établit. Voyeç Gentilshommes
ordinaires.
Les rois de Perfe avoient leur chambellan j & il eft
inention dans les aôes des apôtres d’un chambellan
d’Hérode. Les empereurs romains du haut & dû
bas empire, avoient auffi de fertiblables officiersi
fous le litre de ptapofiti çïibicUlij dites derniers êriH