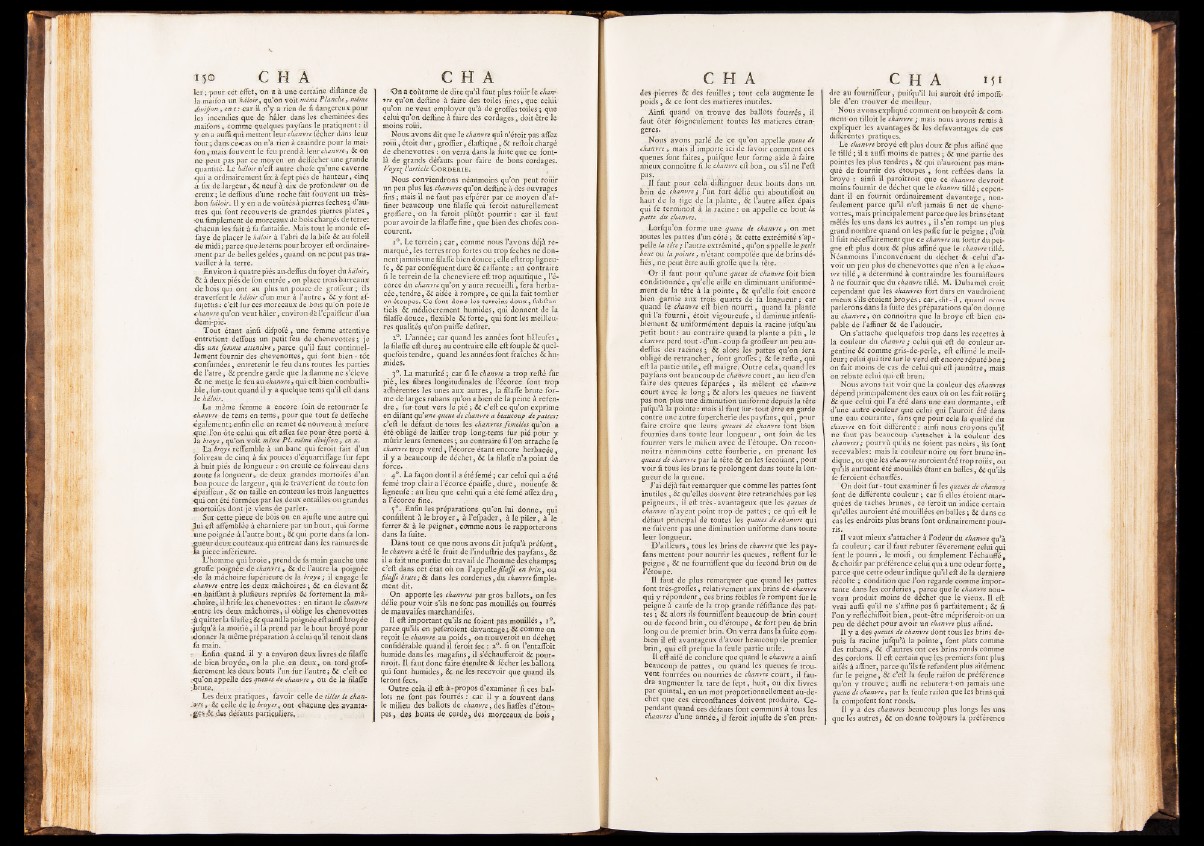
1er; pour cet effet, on a à une certaine diftance de
la maifon un hâloir, qu’on voit même Planche, même
divifion, en t : car il n’y a rien de fi dangereux, pour
les incendies que de nâler dans les cheminées -des
maifons, comme quelques payfans le pratiquent : il
y en a aufli qui mettent leur chanvre fécher dàns leur
four,; clans cc»cas on n’a rien à craindre pour la maifon
, mais fouvent le feu prendà leur chanvre , & on
ne peut pas par ce moyen en deflecher une grande
quantité. Le hâloir n’eft autre chofe qu’une caverne
qui a ordinairement lix à fept piés de hauteur, cinq
à fix de largeur, & neuf à dix de profondeur ou de
creux ; le deffous d’une roche fait fouvent un très-
bon -hâloir. Il y en a de voûtés à pierres feches; d’autres
qui font recouverts de grandes pierres .plates,
o u Amplement de morceaux de bois chargés de terre:
chacun les faitù fa fantaifie. .Mais tout le monde ef-
faye de placer le hâloir à l’abri de la bife & au foleil
de midi; parce queletenis pour broyer eft ordinairement
par de belles gelées, quand on ne.peut pas travailler
à la terre.
Environ à quatre piés au-deffus du foyer du hâloir,
& à deux piés de fon entrée, on place trois barreaux
de bois qui ont au plus un pouce de grofleur ; ils
îraverfent le hâloir d’un mur à l’autre, & y font af-
fujettis^ c’eft fur ces morceaux de bois qu’on pofe le
chanvre qu’on veut hâler, environ dè l’épaiffeur d’un
demi-pie.
Tout étant ainfi difpofé , une femme attentive
entretient deffous un petit feu de chenevottes ; je
dis une femme attentive , parce qu’il faut continuellement
fournir des chevenottes, qui font bien-tôt
confumées, entretenir le feu dans toutes les parties
de l’atre, & prendre garde que la flamme ne s’élève
& ne metçe le feu au chanvre , qui eft bien combufti-
b le , fur-tout quand il y a quelque tems qu’il eft dans
le hâloir.
.La même, femme a encore foin de retourner le
■chanvre de tems en tems, pour que tout fe deffeche
égâlement.;.enfin elle en remet de nouveau à mefure
.que. L’on ôte celui qui eft allez fec pour etre porte à
la broyé , qu’on voit même PL même divijion , en u.
Là broyé reffemble à un banc qui feroit fait d’un
foliveau de cinq à fix pouces d’équarriflage fur fept
à huit .piés de longueur :-on creufè ce foliveau dans
foute fa longueur, de deux grandes mortoifes d’un
bon pouce de largeur, qui le traverfent de toute fon
-épàiffeur, & on taille en couteau les trois languettes
qui-ont été formées par les deux entailles ou grandes
mortoifes dont je viens de parler.
Sur cette pièce de bois on en ajufte une autre qui
^lui eft afiëmblée à charnière par un bout, qui forme
.une poignée à i ’autre bout, & qui porte dans fa longueur
deux couteaux qui entrent dans les rainures de
la pie.ee inférieure.
L ’homme qui b roie, prend de fa main gauche une
groffe poignée; de chanvre , & de l’autre la poignée
:de la mâehoiré fupérieure de la broyé; il engage le
chanvre entre les deux mâchoires ; & en élevant &
ren .baiflantà plitfieurs reprifes & fortement la mâchoire,
il brifedes.chenevottes : en tirant le chanvre
centre.les deux mâchoires, il oblige les chenevottes
:à quitter la filafle; & qttandla poignée eft ainfi broyée
.julqu’à la moitié, il la prend par le bout broyé pour
donner là même préparation à celui qu’il tenpit dans
fa main.
r - • ■ Enfin quand il y a environ; deux livres de filafle
-de bien broyée., on la plie en deux, on tord grol-
fierement les deux bouts l’un fur l ’autre; & c’eft ce
^qu’oti appelle des queues de chanvre , ou de la filafle
.brute.
Les deux pratiques, favoir celle de tiller le çhan-
» & celle de le broyer, ont chacune des avanta-
-gÇS;&.d«s .défauts particuliers,.
•On a coûtume de dire qu’il faut plus roiiir le chanvre
qu’on deftine à faire des toiles fines, que celui
qu’on, ne veut employer qu’à de grofles toiles ; que
celui qu’on deftine-à faire des cordages, doit être le
moins roui.
Nous avons dit que le chanvre qui n’étoit pas aflez
roiii, étoit dur, groflïer, élaftique, & reftoit chargé
de chenevottes : on verra dans la fuite que ce font-
là de grands défauts pour faire de bons cordages.
Voyt{ l'article CoRDERIE.
Nous conviendrons néanmoins qu’on peut roiiir
un peu plus Xts-chanvresqu’on deftine à des ouvrages
fins ; mais il ne faut pas efpérer par ce moyen d’affiner
beaucoup une filafle qui feroit naturellement
grofliere, on la feroit plutôt pourrir: car il faut
pour avoir de la filafle fine, que bien des chofes concourent.
i° . Le terrein ; car, comme nous l’avpns déjà remarqué
, les terres trop fortes ou trop feches ne donnent
jamais une filafle bien douce ; elle eft trop ligneu-
fe , & par conféquent dure & caftante : au contraire
fi le terrein de la cheneviere eft trop aquatique, l’écorce
du chanvre qu’on y aura recueilli, fera herbacée,
tendre, & aifée à rompre, ce qui la fait tomber
en étoupes. Ce font donc les terreins doux, fubftan-
tiels & médiocrement humides, qui donnent de la
filafle douce, flexible & forte, qui font les meilleures
qualités qu’on puiffe defirer.
2°. L’année ; car quand les années font hâleufes,
la filafle eft dure ; au contraire elle eft fouple & quelquefois
tendre, quand les années font fraîches & humides.
3°. La maturité ; car fi le chanvre a trop relié fur
pié, les fibres longitudinales de l’écorce font trop
adhérentes les unes aux autres, la filafte brute forme
de larges rubans qu’on a bien de la peine à refendre
, fur-tout vers le pié ; & c’eft ce qu’on exprime
en difant qu'une queue de chanvre a beaucoup de pattes:
c ’eft le défaut de tous les chanvres femelles qu’on a
été obligé de laiffer trop long-tems fur pié pour y
mûrir leurs femences ; au contraire fi l ’on arrache le
chanvre trop verd, l’écorce étant encore herbacée,
il y a beaucoup de déchet, & la filafle n’a point de
force. •
4°. La façon dont il a été femé ; car celui qui a été
femé trop clair a l’écorce épaifte, dure, noüeufe &
ligneufe : au lieu que celui qui a été femé aflez dru ,
a l’écorce fine.
5°. Enfin les préparations qu’on lui donne, qui
confident à le broyer, à l ’efpader, à le piler, à le
ferrer & à le peigner, comme nous le rapporterons
dans la fuite.
Dans tout ce que nous avons dit jufqu’à préfent,
le chanvre a été le fruit de l’induftrie des payfans, &
il a fait une partie du travail de l’homme des champs;
c’eft dans cet état oii on l’appelle filaffe en brin, ou
filajfe brute; & dans les çorderies, du chanvre Amplement
dit.
On apporte les chanvres par gros ballots, on les
délie pour voir s’ils ne font pas mouillés ou fourrés
de mauvaifes marchandifes.
Il eft important qu’ils ne foient pas mouillés , i? ,
parce qu’ils en peferoient davantage ; & comme on
reçoit le chanvre au poids, ontrouveroit un déchet
confidérable quand il feroit fec : 2°. fi on Pentaffoit
humide dans les magafins, il s’échaufferoit & pour-
riroit. Il faut donc faire étendre & fécher les ballots
qui font humides, &c ne les recevoir que quand ils
feront fecs.
Outre cela il ell à-propos d’examiner fi ces ballots
ne font pas fourrés : car il y a fouvent dans
le milieu des ballots de chanvre, des liaftes d’étou-
pes, des bouts de eprde, des morceaux de bois z
des pierres & des feuilles ; tout cela augmente le
poids , & ce font des matières inutiles.
Ainfi quand on trouve des ballots fourrés, il
faut ôtér foigneufément toutes les matières étrangères.
Nous avons parlé de ce qu’on appelle queue de
chanvre , mais il importe ici de favoir comment ces.
queues; font faites, puifque leur forme aide à faire
mieux connoître fi le chanvre eft bon, ou s’il ne l’eft
pas.
.11 faut pour çela dim^g^er deux, bouts dans un
brin de chanvre l’un fort délié qui aboutiffoit au
haut de la tige de ja plante, & l’autre affez épais
qui fe term'inoit à la racine : on appelle ce bout là
patte du chanvre.
, Lorfqu’on forme une queue de chanvre , on met
toutes les pattes d’un côté ; & cette extrémité s’appelle.
la tête ; l’autre, extrémité, qu’on appelle lepetit
bout ou la pointe, n’étant compôfée que: de brins déliés,
ne peut être aufli gfoffe que la tête.
Or il faut pour qu’une queue de chanvre foit bien
conditionnée, qu’elle aille en diminuant uniformément
dé la tête à la pointe, & qu’elle foit encore
bien garnie aux trois quarts de fa longueur; car
quand le chanvre eft bien nourri, quand la plante
qui l’a fourni, étoit vigoureufe, il diminue infenfi-
blement & uniformément depuis la racine jufqu’au
petit bout : au contraire quand la plante a p â ti, le
chanvre perd tout - d’un - coup fa grofleur un peu au-
deftus des racines ; & alors les partes qu’on fera
obligé de retrancher , font groffes ; & le rëfte, qui
eft la partie utile, eft maigre; Outre cela, quand les
payfans ont beaucoup de chanvre court, au lieu d’en
faire des queues' féparées , ils mêlent ce chanvre
court avec le long ; & alors les queues ne fuivent
pas non plus une diminution uniforme depuis la tête
jufqu’à la pointe: mais il faut fur-tout être en garde
contre une autre fupercherie des payfans, q ui, pour
faire croire que leurs queues de chanvre font bien
fournies dans toute leur longueur, ont foin de les
fourrer vers le milieu avec de l’étoupe. On recon-
noîtra néanmoins cette fourberie, en prenant les
queues de chanvre par la tête & en les fecoiiant, pour
voir fi tous les brins fe prolongent dans toute la longueur
de la queue.
J’ai déjà fait remarquer que comme les pattes font
inutiles, & qu’elles doivent être retranchées par les
peigneurs, il eft très-avantageux que les queues de
chanvre n’ayent point trop de pattes ; ce qui eft le
défaut principal de toutes les queues de chanvre qui
ne fuivent pas une diminution uniforme dans toute
leur longueur.
D ’ailleurs, tous les brins de chanvre que les payfans
mettent pour nourrir les queues, reftent fur'le
peigne, & ne fourniflent que du fécond brin ou de
l ’étoupe.
Il faut de plus remarquer que quand les pattes
font très-grofles, relativement aux brins de chanvre
qui y répondent, ces brins foibles fe rompent fur le
peigne à caufe de la trop grande réfiftance des pattes
; & alors ils fourniflent beaucoup de brin court
ou de fécond brin. ou d’étoupe, & fort peu de brin
long ou de premier brin. On verra dans la fuite combien
il eft avantageux d’avoir beaucoup de premier
brin, qui eft prefque la feule partie utile.
Il eft aifé de conclure que quand le chanvre a ainfi
beaucoup de pattes, ou quand les queues fe trouvent
fourrées ou nourries de chanvre court, il faudra
augmenter la tare de fept, huit, ou dix livres
par quintal, en un mot proportionnellement au-de-
chet que ces circonftances doivent produire. Cependant
quand ces défauts font communs à tous les
chanvres d’une année, il feroit injufte de s’en prendre
au fournifleur, puifqu’il lui auroit été impofli-
ble d’en trouver de meilleur.
Nous avons expliqué comment onbrôyoit & Comment
on tilloit le chanvre ; mais nous avons remis à
expliquer les avantages & les defavantages de ces
différentes pratiques.
Le chanvre broyé eft plus doux & plus affiné que
le tillé ; il a aufli moins de pattes ; & une partie des
pointes les plus tendres, & qui n’auroient pas manqué
de fournir des étoupes , font reliées dans la
broyé : ainfi il paroîtroit que ce chanvre devroit
moins fournir de déchet que le chanvre tillé ; cepen?
dant il en fournit ordinairement davantage i non-
feulement parce qu’il n’eft jamais fi net de chenevottes,
mais principalement parce que les brins étant
mêlés les uns dans les autres, il s’en rompt un plus
grand nombre quand on les paffe fur le peigne ; d’oit
il fuit néceffairement que ce chanvre au fortir du peigne
eft plus doux & plus affiné que le chanvre tillé.
Néanmoins l’inconvénient du déchet & celui d’avoir
un peu plus de chenevottes que n’en a le chanvre
tillé , a déterminé à contraindre les fourniffeurs
à ne fournir que du chanvre tillé. M. Duhamel croit
cependant que les chanvres fort durs en vaudroient
mieux s’ils etoient broyés ; car, d i t - il, quand nous
parlerons dans la fuite des préparations qu’on donne
au chanvre, on connoîtra que la broyé eft bien capable
de l’affiner & de l’adoucir. .
On s’attache quelquefois trop dans les recettes à
la couleur du chanvre ; celui qui eft de couleur argentine
& comme gris-de-perle, eft efiimé le meilleur
; celui qui tire lur le verd eft encore réputé bon ;
ôn fait moins de cas de celui qui eft jaunâtre, mais
on rebute celui qui-eft brun:
Nous avons tait voir que la couleur des chanvres
dépend principalement des eaux où on les fait roiiir ;
& que celui qui l’a été dans une eau dormante, eft
d’une autre couleur que celui qui l’auroit été dans
une eau courante, fans qiie pour cela la qualité du
chanvre en foit différente : ainfi nous croyons qu’il
ne faut pas beaucoup s’attacher à la couleur des
chanvres; pourvu qu’ils ne foient pas noirs, ils font
recevables: mais la couleur noire ou fort brune indique
, ou que les chanvres auroient été trop roiiis, ou
qu’ils auroient été mouillés étant en balles, & qu’ils
fe feroient échauffés.
On doit fur - tout examiner fi les queues de chanvre
font de différente couleur ; car fi elles étoient marquées
de taches brunes, ce feroit un indice certain
qu’elles auroient été mouillées en balles ; & dans ce
cas les endroits plus bruns font ordinairement pourris.
Il vaut mieux s’attacher à l’odeur du chanvre qu’à
fa couleur ; car il faut rebuter féverement celui qui
fent le pourri, le moifi, ou Amplement l échauffé ,
& choifir par préférence celui qui a une odeur forte ,
parce que cette odeur indique qu’il eft de la derniere
récolte ; condition que l’on regarde comme importante
dans les çorderies, parce que le chanvre nouveau
produit moins de déchet que le vieux. Il eft
vrai aufli qu’il ne s’affine pas fi parfaitement ; & fi
l’on y refléchiffoit bien, peut-être mépriferoit-on un
peu de déchet pour avoir un chanvre plus affiné.
Il y a des queues de chanvre dont tous les brins depuis
la racine jufqu’à la pointe, font plats comme
des rubans, & d’autres ont ces brins ronds comme
des cordons. Il eft certain que les premiers font plus
aifés à affiner, parce qu’ils fe refendent plus aifément
fur le peigne, & c’en: la feule raifon de préférence
qu’on y trouve; aufli ne rebutera-t-on jamais une
queue de chanvre, par la feule raifon que les brins qui
la compofent font ronds,
Il y a des chanvres beaucoup plus longs les uns
que les autres, & on donne toûjours la préférence