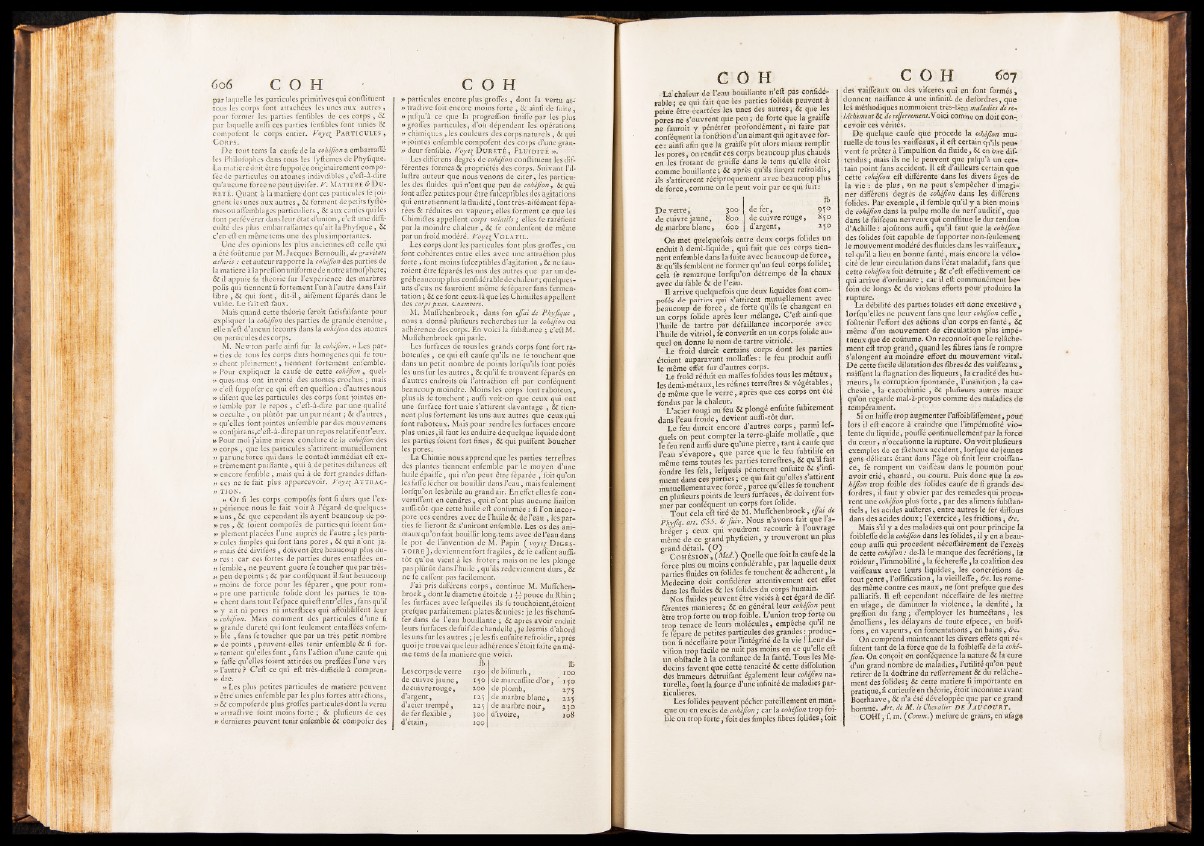
6o6 C O H
par laquelle les particules primitives qui conftituent
tous les corps font attachées les unes aux autres ,
pour former les parties fenfibles de ces corps , ôc
par laquelle aufli ces parties fenfibles font unies 6c
compofent le corps entier. Voyt^ Pa rt icul es ,
C orps.
De tout tems la caufe de la cohéjîon a embarraffé
les Philofophes dans tous les fyftcmes dePhyfique.
La matière doit être fuppofée originairement compo-
fée de particules ou atomes indivifibles, c’eft-à-dire
qu’aucune force ne peutdivifer. V. Matière «S* D ur
e t é . Quant à la maniéré dont ces particules fe joignent
les unes aux autres, 6c forment de petits fy fientes
ouaffemblages particuliers , 6c aux caulesquiles
font perfévérer dans leur état d’union, c’eft une difficulté
des plus embarraffiantes qu’ait la Phylique, 6c
c’en eft en même tems une des plus importantes.
Une des opinions les plus anciennes eft celle qui
a été foûtenue par M. Jacques Bernoulli, degravitate
atheris : cet auteur rapporte la cohéjîon des parties de
la matière à la preffion uniforme de notre atmofphere;
6c il appuie fa théorie fur l’expérience des marbres
polis qui tiennent fi fortement l’un à l’autre dans l’air
libre , 6c qui font, dit-il, aifément féparés dans le
vuide. Le fait eft faux.
Mais qüand cette théorie feroit fatisfaifante pour
expliquer la cohéjîon des parties de grande etendue,
elle n’eft d’aucun fecours dans la cohéjîon des atomes
ou particules des corps.
M. Newton parle ainfi fur la cohéjîon. « Les par-
» ties de tous les corps durs homogènes qui fe tou-
» chent pleinement, tiennent fortement enfemble.
» Pour expliquer la caufe de cette cohéjîon, quel-
» ques-uns ont inventé des atomes crochus ; mais
» c’eft fuppofer ce qui eft en queftion : d’autres nous
» difent que les particules des corps font jointes en-
» femble par le repos , c’eft-à-dire par une qualité
» occulte , ou plutôt par un pur néant ; 8c d’autres,
» qu’elles font jointes enfemble par des mouvemens
» confpirans,c’eft-à-direparun repos relatif entr’eux.
» Pour moi j’aime mieux conclure de la cohéjîon tes
» corps , que les particules s’attirent mutuellement
» par une force qui dans le contaâ immédiat eft ex-
» trèmement puiffànte, qui à de petites diftances eft
» encore fenfible , mais qui à de fort grandes diftan-
» ces ne fe fait plus appercevoir. Foye^ A t t r a c -
» TION.
» Or fi les corps compofés font fi durs que l’ex-
» périence nous le fait voir à l’égard de quelques-
» uns , 8c que cependant ils ayent beaucoup de po-
» res , 8c foient compofés de parties qui foient fim-
» plement placées l’une auprès de l’autre ; les parti-
» cilles fimples qui font fans pores , ôc qui n’ont ja-
» mais été divifées , doivent être beaucoup plus du-
w res : car ces fortes de parties dures entaflees en-
» femble, ne peuvent guere fe toucher quepartrès-
» peu de points ; Ôc par conféquent il faut beaucoup
» moins de force pour les féparer, que pour rom-
» pre une particule folide dont les parties fe tou-
» chent dans tout l’efpace qui eft entr’elles, fans qu’il
» y ait ni pores ni interftices qui affoibliffent leur
» cohéjîon. Mais comment des particules d’une fi
» grande dureté qui font feulement entaflees enfem-
» ble , fans fe toucher que par un très petit nombre
»> de points , peuvent-elles tenir enfemble 8c fi for-
» tement qu’elles font, fans l’aâion d’une caufe qui
» fafle qu’efles foient attirées ou preffées l’une vers
» l’autre? C’eft ce qui eft très-difficile à compren-
» dre.
» Les plus petites particules de matière peuvent
» être unies enfemble par les plus fortes attrapions,
» 8c compofer de plus grofles particules dont la vertu
»> attraPive foint moins forte ; & plufieurs de ces
» dernieres peuvent tenir enfemble 6c compofer des
C O H
» particules encore plus grofles , dont la vertu at-
» traPive foit encore moins forte , 8c ainfi de fuite,
» jufqu’à ce que la progreffion finiffe par les plus
» grofles particules, d’où dépendent les opérations
» chimiques , les couleurs des corps naturels , 8c qui
» jointes enfemble compofent des corps d’une gran-
» deur fenfible. Voyt{ D u r e t é , Flu id it é ».
Les différens degrés de cohéjîon conftituent les différentes
formes 8c propriétés des corps. Suivant l’il-
luftre auteur que nous venons de citer, les particules
des fluides qui n’ont que peu de cohéjîon, 8c qui
font allez petites pour être fuf ceptibles des agitations
qui entretiennent la fluidité, font très-âifément fépa-
rées 8c réduites en vapeur ; elles forment ce que les
Chimiftes appellent corps volatils ; elles fe raréfient
par la moindre chaleur , & fe condenfent de même
par un froid modéré. Voye^ V o l a t il .
Les corps dont les particules font plus grofles, ou
font cohérentes entre elles avec une attraPion plus
forte , font moins fufceptibles d’agitation, 8c ne làu-
Toient être fpparés les tins des autres que par un degré
beaucoup plus confidérable de chaleur ; quelques-
uns d’eux ne fauroient même fe féparer fans fermentation
; Ôc ce font ceux-là que les Chimiftes appellent
des corps fixes. Chambers.
M. Muflchenbroek, dans fon ejjai de Phyjîque ,
nous a donné plufieurs recherches fur la cohéjîon ou
adhérence des corps. En voici la fubftance ; c’eft M.
Muflchenbroek qui parle.
Les furfaces de tous les grands corps font fort ra-
boteufes , ce qui eft caufe qu’ils ne fe touchent que
dans un petit nombre de points lorfqu’ils font pofés
les uns fur les autres, & qu’il fe trouvent féparés en
d’autres endroits où l’attraPion eft par conféquent
beaucoup moindre. Moins les corps font raboteux,
plus ils fe touchent ; auffi voit-on que ceux qui ont
une furface fort unie s’attirent davantage , & tiennent
plus fortement les uns aux autres que ceux qui
font raboteux. Mais pour rendre les furfaces encore
plus unies,il faut les enduire, de quelque liquidedont
les parties foient fort fines, 8c qui puiffent boucher
les pores.
La Chimie nous apprend que les parties terreftres
des plantes tiennent enfemble par le moyen d’une
huile épaiffe, qui n’en peut être féparée , foit qu’on
les fafle fécher ou bouillir dans l’eau, mais feulement
lorfqu’on les brûle au grand air. En effet elles fe con-
vertiffent en cendres, qui n’ont plus aucune liaifon
aufli-tôt que cette huile eft confumée : fi l’on incorpore
ces cendres avec de l’huile 8c de l’eau , les parties
fe lieront 8c s’uniront enfemble. Les os des animaux
qu’on fait bouillir long-tems avec de l’eau dans
le pot -de l’invention de M. Papin ( voyeç D iges-
t Oire ) , deviennent fort fragiles, 6c fe caffent aufli-
tôt qu’on vient à les froter ; mais on ne les plonge
pas plutôt dans l’huile , qu’ils redeviennent durs, ÔC
ne fe caffent pas facilement.
J’ai pris différens corps , continue M. Muflchenbroek
, dont le diamètre étoit de i -jr-j pouce du Rhin ;
les furfaces avec lefquelles ils fe touchoient,étoient
prefque parfaitement plates 8c unies : je les fis chauffer
dans de l’eau bouillante ; 8c après avoir enduit
leurs furfaces defuif de chandelle, je les mis d’abord
les uns fur les autres ; je les fis enfuite refroidir, après
quoi je trouvai que leur adhérence s’étoit faite en même
tems de la maniéré que voici.
ib
Les corps de verre
de cuivre jaune,
de cuivre rouge,
d’argent,
d’acier trempé,
de fer flexible,
d’étain,
de bifmuth,
de marcaffite d’o r ,
de plomb,
de marbre blanc,
de marbre noir,
d’ivoire,
ib
ioo
150
275
225
230
10$
C O H
. La chaleur de l’eau bouillante ti’eft pas confidérable;
ce qui fait que l'ès parties folidèS peuvent à
peine être écartées les unes des atitres;; 6c que les
pores né s’ouvrent que peu ; de forte que la graiffe
ne fauroit y pénétrer profondément, ni faire- par
conféquent lafonâiortd’un aimant qùiagitavec force
: ainfi afin que la graiffë pût alors mieux remplir
les pores, on rendit ces corps beaucoup plus chauds
en les frotant de graiffé dans lé tems qu’elle étoit
comme bouillante ; 8c après qu’ils furent refroidis,
le peut voir par ce qui fuit :
ib
399', .. de fer, 95°
800.. ' de cuivre rouge 8S°
èoo d’argent, M ?
D e v e r rè ,
de cuivre jaünô,
de marbre blanc,
On met quelquefois entre deux corps folides un
enduit à demi-liquidé:,: qtii fait que ces corps tiennent
enfemble dans la fuite avec beaucoup de force,
& qu’ils femblent ne former qu’un feül corps folide ;
cela fé remarque îorfqu’on détrempe de la chaux
avec du fable ôc de l ’eau»
Il arrive quelquefois que deux liquides font compofés
de parties qui s’attirent mutuellement avec
beaucoup de force, de forte qu’ils fe changent en
un corps folide après leur mélange. C ’eft ainfi que
l ’huile de tartre par défaillance incorporée avec
l’huile de v itriol, fe convertit en un corps folide auquel
on donne le nom de tartre vitriolé»
Le froid durcit certains corps dont lés parties
étoient auparavant mollaflès : le feu produit aufli
le même effet fur d’autres corps»
Le froid réduit en maffes folides tous les métaux,
les demi-métaux, les réfines terreftres & végétables,
de même que le verre, après que ces corps ont été
fondus par la chaleur. H H M
L’acier rougi au feu & plonge enfuite lubitement
dans l’eau froide, dévient auffi-tot dur»
Le feu durcit encore d’autres corps, parmi Iet-
quels on peut compter la terre-glâifé mollafle, que
le feu rend aufli dure qu’une p ierre, tant à caufe que
l’eau s’évapore, que parce que le feu fiibtilrfe en
même tèms toutes les parties terreftres , & qu il tait
fondre les fels, lefquels pénètrent enfuite 8c s infirment
dans ces parties ; ce qui fait qu’elles s attirent
mutuellement avec force, parce qu’elles fe touchent
en plufieurs points de leurs furfaces, & doivent former
par conféquènt un corps fort folide.
Tout cela eft tiré de M. Muflchenbroek, ejjaide
Phyfiq. an. GS6. &fuiv. Nous n’avons fait que 1 a-
btéger ; ceux qui voudront recourir à l’ouvrage
même de ce grand phyficien, y trouveront un plus
grand détail. (O ) ^ r i t
C o h é s i o n , (M ed . ) Quelle que foit la caufe de la
force plus ou moins confidérable, par laquelle deux
parties fluides ou folides fe touchent & adhèrent, la
Medecine doit confidérer attentivement cet effet
dans les fluides & les folides du corps humain»
Nos fluides peuvent être viciés à cet égard de difi
férentes maniérés; 6c en général leur cohéjîon peut
être trop forte ou trop foible. L’union trop forte ou
trop tenace de leurs molécules, empêche qu’il ne
fe fëpare de petites particules des grandes production
li néceffaire pour l’intégrité de la vie ! Leur di-
Vifion trop facile ne nuit pas moins en ce qu’elle eft
un obftacle à la confiance de la fanté. Tous les Médecins
favent que cette ténacité 6c cette diffolution
des humeurs détruifant également leur cphéjîon naturelle
, font la fource d’une infinité de maladies particulières.
Les folides peuvent pécher pareillement en manque
ou en excès de cohéjîon; car la cohéjîon trop foi-
C O H 60 7
dés vaifleaux ou des vifceres qui en font formés ,
donnent naiflance à une infinité de defordres , que
les méthodiques nommoient très-Uen maladies de re-
: lâchltHèni 6c de rtjjerrement. Voici comaie on doit concevoir
ces vérités»
De quelque caufe qtié procédé la cüiéjîon mutuelle
de tous les vaifleaux, il eft certain qi’ils peu*
vent fe prêter à l’impulfion du fluide, 6c en b-.re dif-,
tendus ; mais iis ne le peuvent que jufqu’à un cer-
. tain point fans accident* Il eft d’ailleurs certain que
cétté cohéjîon eft 'différente dans les divers âges de
la vie : de plus, On ne peut s’empêcher d’imagi-;
nèr différens degrés de cohéjîon dans les différens
folides. Par exemple, il femble qu’il y a bien moins
de cohéjîon dans la pulpe molle du nerf auditif, que
dans lè faifeeau nerveux qui conftitue le dur tendon
d’Achille : ajoûtons aufli, qu’il faut que la cohéjîon
des folides foit capable de fupporter non-feulement
le mouvement modéré des fluides dans les vaifleaux,'
tel qu’il a lieu en bonne fanté, mais encore la vélocité
de leur circulation dans l’état maladif, fans que
cette cohéjîon. foit détruite ; 6c c’eft effectivement ce
qui arrive d’ordinaire ; car il eft communément be-
foin de longs 6c de violens efforts pour produire 1%
rupture»
La débilité des parties folides eft donc éxeeffivô a
îorfqu’elles ne peuvent fans que leur cohéjîon ceffe ,
foûtertir l’effort des aCtions d’un corps en fanté, 6c
même d’un mouvement de circulation plus impétueux
que de coutume. On reconnoît que le relâchement
eft trop grand, quand lés fibres làns fe rompre
s’alongènt au moindre effort du mouvement vital.
D é cette facile dilatation des fibres 6c des vaifleaux ,
nàiffent la ftagnation des liqueurs, la crudité dés humeurs
, la corruption fpontanée, l’ inanition, la cachexie
,- la cacochirftie , ôc plufieurs autres maux
qit’oii regarde mal-à-prôpos comme des maladies de
tempérament.
Si on laiffe trop àiigttientèr l’affbîblîflement, pour,
lors il eft encore à craindre queTimpétuofité violente
du liquide, pouffé continuellement par la forcé
du coeur, n’occafionne la rupture. On voit plufieurs
exemples de ce fâcheux accident, lorfque de jeunes
gens délicats étant dans l’âgé où finit leur croiflan-
cé , fe rompent un vaifféau dans le poumon pour,
avoir crié, chanté, ou couru. Puis donc que la cô-
hèjion trop foible des folides caufe de fi grands de-;
fordres, il faut y obvier pat des remedes qui procurent
une cohéjîon plus forte, par des alimens fubftan-
tiels, les acides aufteres, entre autres le fer diffous
dans des acides doux; l’exercice ; les fri&ions, &c.
Mais s’il y a des maladies qui ont pour principe la
foibleffe de la cohéjîon dans lès folides, il y en à beaucoup
aufli qui procèdent néceflairement de l’excès
dë cette cohéjîon: de-là le manque des fecrétions, là
roideut, l’immobilité, la féchereffe, la coalition des
vaifleaux avec leurs liquides, les concrétions de
tout genre, l’oflifieation, la vieilleffe, &c. les remedes
même contre ces maux, ne font prefque que des
palliatifs. Il eft cependant néceffaire de les mettre
en ufage, de diminuer la violence, la denfité, la
preffion dix fang ; d’employer les humeftans, les
émolliens, les délayans de toute efpece, eh boifc
fons, en vapeurs, en fomentations, en bains, &c.
On comprend maintenant les divers effets qui ré-
fultent tant de la force que de la foibleffe de la cohéjîon.
On conçoit en conféquence la naturé 6c la cure
d’un grand nombre de maladies, l’utilité qu’on peut
retirer de la doûrine du refferrement & du relâchement
des folides; 6c cette matière fi importante en
pratique, fi curieufe en théorie, étoit inconnue avant
Boerhaave, ôc n’a été développée que par ce grand
homme. A n . de M . U Chevalier d e J au c o u r t .
COHI, f, m. ( Comm.) mefure de grains, eh ufage