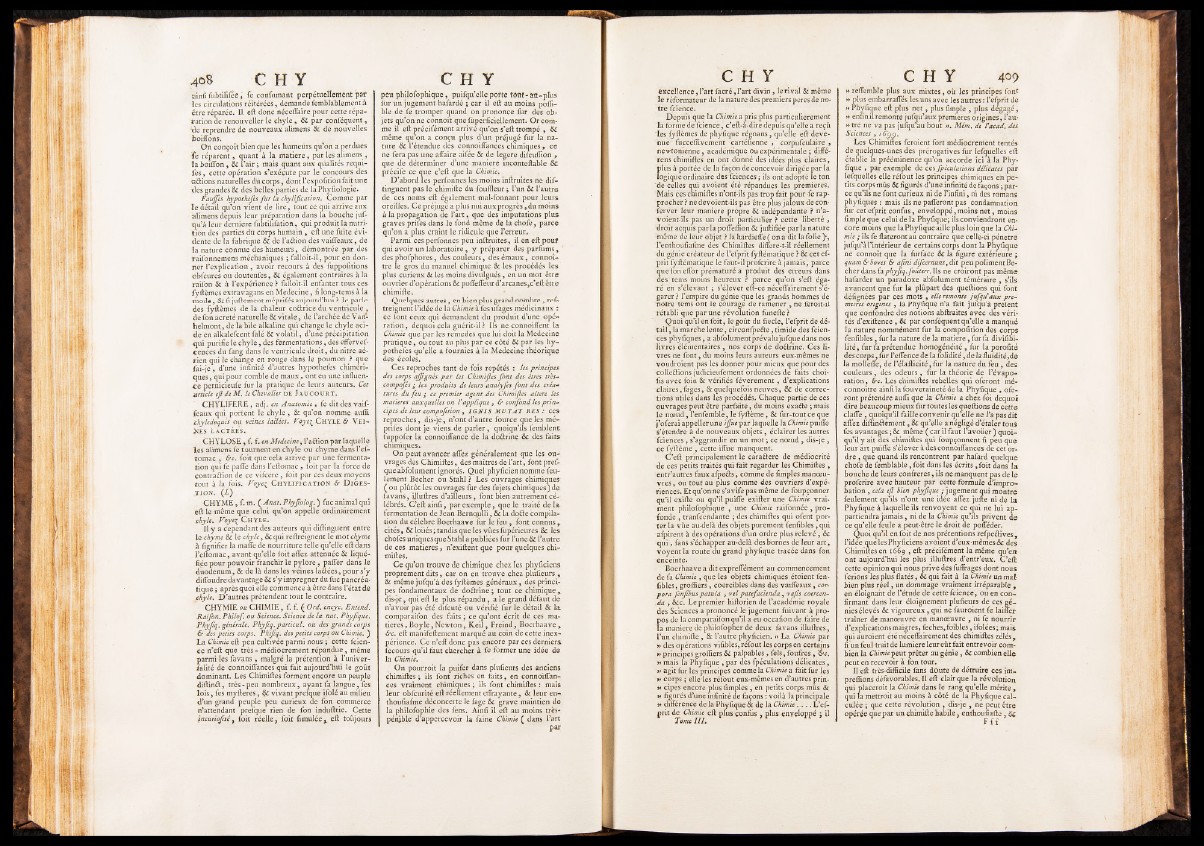
binfi fubtilifée, fe confumant perpétuellemènt par
!es circulations réitéréès, demande femblablement à
être réparée. Il eft donc néceffaire pour cette réparation
dè renouvèller le ch y le, 8c par conféquent,
•'de reprendre de nouveaux alimens & de nouvelles
boiffons.
Oft conçoit bien que les humeurs qu*ôn a perdues
ÿe réparent, quant à la matière, par les alimens ,
la boiffon, 8c l’air ; mais quant aux qualités requi-
fe s , cette opération s’exécute par le concours des
aétions naturelles dit corps, dont l’expofitiôn fait une
des grandes & des belles parties de laPhyfiologie.
Fàujfts hypothefes fur la chylifcation. Comme par
le détail qu’on vient de lire, tout ce qui arrive aux
alimens depuis leur préparation dans la bouche jufqu’à
leur derrtiere fubtilifation, qui produit la nutrition
des parties dit corps humain, eft une fuite évi*
dente de la fabrique 8c de l’a&ion des vaiffeaux, de
la nature connue des humeuïs, démontrée par des
taifonnemens méchaniques ; falloit-il, pour en donner
l’explication , avoir rëcoufs à des fuppofitions
obfcures ou douteufes, 8c également contraires à la
raifon & à l’expérience ? falloit-il enfanter tous ces
fyftèmes extfavagans en Medecine, li long-tems à la
mode, 8c fi juftement méprifés aujourd’hui ? Je parle
des fyftèmes de la chaleur coftrice du ventricule ,
de fon acreté naturelle & vita le, de l’archée de Van-
helmont, de labile alkaline qui change le chyle acide
en àlkalefcent fàlé 8c vola til, d’une précipitation
qui purifie le ch yle, des fermentations, des éffervef-
ceocés du fang dans le ventricule droit, du nitre aérien
qui le change en rouge dans le poumon ? que
fai-je, d’une infinité d’autres hypothefes chimériques,
qui pour comble de maux, ont eu une influenc
e pernicieufe fur la pratique de leurs auteurs. Cet
article eft de M. le Chevalier DÈ Ja ü COURT.
CHYLIFERE , adj. en Anatomie, fe dit des vaiffeaux
qui portent le ch y le , & qu’on nomme aufli
chyledoqüîs ou veines lactées. Voye^ CHYLE & V e i-
Jn'ES LACTÉ ES.
CHYLOSE, f. f. en Medtcine, l’aôion par laquelle
tes alimens fe tournent en chyle ou chyme dans l’ef-
tomac , &c. foit que cela arrive par une fermentation
qui fe paffe dans l’eftomac, ioit par la force de
contraction de ce vifcere, foit par ces deux moyens
tout à la fois. Voye^ C hyl if i CATION & D igest
io n . (Z)
CHYME, f. m. (.Anat. Phyjiolog. ) fuc animal qui
eft le même que celui qu’on appelle ordinairement
chyle. Voye^ C h ÿ LE.
Il y a cependant des auteurs qui diftingüent entre
le chyme 8c le chyle, 8c qui reftreignent le mot chyme
à lignifier la maffe de nourriture telle qu’elle eft dans
l’eftomac, avant qu’elle loit allez atténuée & liquéfiée
pour pouvoir franchir le pylore, palier dans le
duodénum, & de là dans les veines laâées, pour s’y
difloudre davantage 8c s’y imprégner du fuc pancréatique
; après quoi elle commence à être dans l’état de
chyle. D ’autres prétendent tout le contraire.
CHYMIE ou CHIMIE, f. f. ( Ord. encyc. Entend.
Raifon. Philof ou Science. Science de la nat. Phyjîque.
Phyfiq. générale. Phyfiq. particul. ou des grands corps
& des petits corps. Phijîq. des petits corps ou Chimie. )
La Chimie eft peu cultivée parmi nous ; cette fcien-
ce n’eft que très - médiocrement répandue, même
parmi les favans , malgré la prétention à l’univer-
lalité de connoiflances qui fait aujourd’hui le goût
dominant. Les Chimiftes forment encore un peuple
diftinû, très - peu nombreux, ayant fa langue, fes
lo is , fes myfteres, $c vivant prelque ifolé au milieu
d’un grand peuple peu curieux de Ibn commerce
n’attendant prefque rien de fon induftrie. Cette
incuriôfité, foit réelle, foit fimulée, eft toujours
peu phiiofophique, puifqu’elle porte tout-au-plus
fur un jugement hafardé ; car il eft au moins pofli-
ble de fe tromper quand on prononce fur des objets
qu’on ne connoît que fùperficiellement. Or comme
il eft précifément arrivé qu’on s’eft trompé , &
même qü’on a conçu plus d’un préjugé fur la nature
8c l’étendue des connoiflances chimiques , ce
ne fera pas une affaire aifée & de legere difculfion >
que de déterminer d’une maniéré inconteftable 8c
précife ce que c’eft que la Chimie.
D ’abord les perfonnes les moins inftruites ne distinguent
pas le chimifte du fouffleur ; l’un 8c l’autre
de ces noms eft également mal-fonnant pour leurs
oreilles. Ce préjugé a plus nui aux progrès, du moins
à la propagation de l’a r t , que des imputations plus
graves prifes dans le fond même de la chofe, parce
qu’on a plus craint le ridicule que l’erreur.-
Parmi ces perfonnes peu inftruites, il en eft pouf
qui avoir un laboratoire, y préparer des parfums ,
des phofphofes, des couleurs, des émaux, connoî-
tre îe gros du manuel chimique & les procédés les
plus curieux & les moins divulgués, en un mot être
ouvrier d’opérations 8c poffeffeur d’arcanes,c’eft être
chimifte.
Quelques autres, en bien plus grand nombre, refi
treignent l’idée de la Chimie à fes ufages médicinaux :
ce font ceux qui demandent du produit d’une operation
, dequoi cela guérit-il} Ils ne connoiffent la
Chimie que par les remedes que lui doit la Medecine
pratique, ou tout au plus par ce côté 8c par les hypothefes
qu’elle a fournies à la Medecine théorique
des écoles.
Ces reproches tant de fois répétés : tes principes
des corps affignés par les Chimiflts font des êtres très-
compofés • les produits de leurs analyfes font des créa*
• tures du feu ; ce premier agent des Chimiftes altéré les
matières auxquelles on l'applique , & confond les principes
de leur compofiùon, IG N IS MU T A T r e s : ces
reproches, dis-je, n’ont d’autre fource que les mé-
prifes dont je viens de parler, quoiqu’ils femblent
fuppofer la connoiffance de la doctrine 8c des faits
chimiques.
On peut avancer aflez généralement qüe les ouvrages
des Chimiftes, des maîtres de l’art, font pref*
que abfolument ignorés. Quel phyficien nomme feulement
Becher ou Stahl ? Les ouvrages chimiques
( ou plutôt les ouvrages fur des fujets chimiques) de
favans, ijluftres d’ailleurs, font bien autrement célébrés.
C ’eft a inli, par exemple, que le traité de la
fermentation de Jean Bernojulli, 8c la dotte compilation
du célébré Boerhaave fur le fe u , font connus ,
cités, 8c loiiés ; tandis que les vues fupérieures 8c les
chofes uniques que Stahl a publiées fur l’une 8c l’autre
de ces matières , n’exiftent que pour quelques chimiftes.
Ce qu’on trouve de chimique chez les phyficienS
proprement dits, car on en trouve chez plufieurs ,
& même jufqu’à des fyftèmes généraux, des principes
fondamentaux de doctrine ; tout ce chimique ,
dis-je, qui eft le plus répandu, a le grand défaut de
n’avoir pas été difeuté ou vérifié fur le détail & la
comparaifon des faits ; ce qu’ont écrit de ces matières,
B oy le, Newton, K e il, Freind, Boerhaave,
&c. eft manifeftement marqué au coin de cette inexpérience.
Ce n’eff donc pas encore par ces derniers
fécours qu’il faut chercher à fe former une idée de
la Chimie.
On pourroit la puifer dans plufieurs des anciens
chimiftes ; ils font riches en faits, en connoiflances
vraiment chimiques ; ils font chimiftes : mais
leur obfcurité eft réellement effrayante, & leur en-
thoufiafme déconcerte le fage 8c grave maintien de
la philofophie des fens. Ainfi il eft au moins très-
pénible d’appercevoir la faine Chimie ( dans l’art
par
excellence, l’art facré, l’art d ivin, le rival & même
le réformateur de la nature des premiers peres de notre
fcience.
Depuis que la Chimie a pris plus particulièrement
la forme de fcience, c’eft-à-dire depuis qu’elle a reçû
les fyftèmes de phyfique régnans, qu’elle eft devenue
fucceflivement 'cartéfienne , corpufculaire ,
newtonienne, académique ou expérimentale ; diffe-
rens chimiftes en ont donné des idées plus claires,
plus à portée de la façon de concevoir dirigée par la
logique ordinaire des fciences ; ils ont adopté le ton
‘de celles qui avoient été répandues les premières.
Mais cés chimiftes n’ont-ils pas trop fait pour-fe rapprocher
? ne devoient-ils pas être plus jaloux de con-
ferver leur maniéré propre 8c indépendante ? n’a-
voient-ils pas un droit particulier ? cette liberté ,
droit acquis parla pofleffion 8c juftifiée parla nature
même de leur objet ? là hardieffe( on a dit la folie J,
l’enthotifiafme des Chimiftes differe-t-il réellement
du génie créateur de l’efprit fyftématique ? & cet ef-
prit fyftématique le faut-il proferire à jamais , parce
que fon effor prématuré a produit des erreurs dans
des tems moins heureux ? parce qu’on s’eft égaré
en s’élevant ; s’élever eft-ce néceflairement s’égarer
? l’empire du génie que les grands hommes de
notre tems ont le courage de ramener , ne feroit-il
rétabli que par une révolution funefte ?
Quoi qu’il en foit, le goût du fiecle, l’efprit de détail
, la marche lente, circonfpefte, timide des feien-
cès phyfiques, a abfolument prévalu jufque dans nos
livres élémentaires , nos corps de doûrine. Ces livres
ne font, du moins leurs auteurs eux-mêmes ne
voudroient pas les donner pour mieux que pour des
collerions judicieufement ordonnées de faits choi-
fis avec foin & vérifiés féverement , d’explications
claires, fages, & quelquefois neuves, & de corrections
utiles dans les procédés. Chaque partie de ces
ouvrages peut être parfaite, du moins exacte ; mais
le noeud, l’enfemble, le fyftème, & fur-tout ce que
j’oferai appeller une ijfue par laquelle la Chimie puiffe
s’étendre à de nouveaux objets , éclairer les autres
fciences, s’aggrandir en un mot ; ce noeud , dis-je ,
ce fyftème , cette iflue manquent.
C ’eft principalement le caraûere de médiocrité
de ces petits traités qui fait regarder les Chimiftes ,
entr’autres faux afpeéls, comme de Amples manoeuvres
, ou tout au plus comme des ouvriers d’expériences.
Et qu’on ne s’âvife pas même de foupçonner
qu’il exifte ou qu’il puiffe exifter une Chimie vraiment
phiiofophique , une Chimie raifonnée , profonde
, tranfeendante ; des chimiftes qui ofent porter
la vûe au-delà des objets purement fenfibles, qui
afpirent à des opérations d’un ordre plus relevé, &
q u i, fans s’échapper au-delà des bornes de leur art,
voyent la route du grand phyfique tracée dans fon
enceinte.
Boerhaave a dit expreffément au commencement
de fa Chimie , que les objets chimiques étoient fenfibles,
greffiers, coercibles dans des vaiffeaux, cor-
pora fenfibus patula , vel patefacienda, vajis coercen-
da , &çc. Le premier hiftorien de l’académie royale
des Sciences a prononcé le jugement fuivant à propos
de la comparaifon qu’il a eu occafion de faire de
la maniéré de philofopher de deux favans illuftres,
l’un chimifte , & l’autre phyficien. « La Chimie par
» des opérations vifibles, réfout les corps en certains
►> principes grofliers & palpables, fels,foufres, 'è-c.
» mais la Phyfique , par des fpéculations délicates,
» agit fur les principes comme la Chimie a fait fur les
» corps ; elle les réfout eüx-mêmesen d’autres prin-
» cipes encore plus fimples, en petits corps mûs &
» figurés d’une infinité de façons : voilà la principale
» différence de la Phyfique & de la Chimie . . . . L ’efprit
de Chimie eft plus confus , plus enveloppé j il
Tome I I I .
» reffemble plus aux mixtes, où les principes font
» plus embarraffés les uns avec les autres : l’efprit de
» Phyfique eft plus n e t , plus fimple , plus dégagé,
» enfin il remonte jufqu’aux premières origines, i’au-
» tre ne va pas jufqu’au bout ». Mém. de Cacad. des
Sciences , /(Tço.
Les Chimiftes feroient fort médiocrement tentés
de quelques-unes des prérogatives fur lefquelles eft
établie la prééminence qü’on accorde ici à la Phyfique
, par exemple de ces fpéculations délicates par
lefquelles elle réfout les principes chimiques en petits
corps mûs & figurés d’une infinité de façons ; parce
qu’ils ne font curieux ni de l’infini, ni des romans
phyfiques : mais ils ne pafferont pas condamnation
fur cet efprit confus, enveloppé, moins n et, moins
fimple que celui de la Phyfique; ils conviendront encore
moins que la Phyfique aille plus loin que la Chimie
; ils fe dateront au contraire que celle-ci pénétré
jufqu’à l’intérieur de certains corps dont la Phyfique
ne connoît que la furface & la figure extérieure ;
quam&boves & afini difeernunt^ dit peu poliment Becher
dans fa phyfiq. foûterr. Ils ne croiront pas même
hafarder un paradoxe abfolument téméraire , s’ils
avancent que fur la plûpart des queftions qui font
défignées par ces mots , elle remonte jufqiüaux premières
origines , la Phyfique n’a fait jufqu’à préfent
que confondre des notions abftraites avec des vérités
d’exiftence , & par conféquent qu’elle a manqué
la nature nommément fur la compofition des corps
fenfibles, fur la nature de la matière, fur fa divifibi-
lité , fur fa prétendue homogénéité , fur la porofité
des corps, fur l’effence de la lolidité, de là fluidité,de
la molleffe, de l ’élafticité, fur la nature du feu , des
couleurs, des odeurs , fur la théorie de l’évaporation
, &c. Les chimiftes rebelles qui oferont mé-
connoître ainfi la fouyeraineté de la Phyfique , oferont
prétendre aufli que la Chimie a chez foi dequoi
dire beaucoqp mieux fur toutes les queftions de cette
claffe , quoiqu’il faille convenir qu’elle ne l’a pas dit
aflez diftinttement, & qu’elle a négligé d’étaler tous
fes avantages ; 8c même ( car il faut l’avoüer ) quoiqu’il
y ait des chimiftes qui foupçonnent fi peu que
leur art puiffe s’élever à des connoiflances de cet ordre
, que quand ils rencontrent par hafard quelque
chofe de fembtable, foit dans lès écrits , foit dans la
bouche de leurs confrères, ils ne manquent pas de le
proferire avec hauteur par cette formule d’improbation
, cela eft bien phyjîque ; jugement qui montre
feulement qu’ils n’ont une idée affez juffe ni de la
Phyfique à laquelle ils renvoyent ce qui ne lui appartiendra
jamais, ni de la Chimie qu’ils privent de
ce qu’elle feule a peut-être le droit de pofféder.
Quoi qu’il en foit de nos prétentions refpe&ives,
l’idée que les Phyficiens avoient d’eux-mêmes & des
Chimiftes en 1669 , eft précifément la même qu’en
ont aujourd’hui les plus illuftres d’entr’eux. C ’eft
cette opinion qui nous prive des fuflrages dont nous
ferions les plus flatés, 8c qui fait à la Chimie un mal
bien plus rée l, un dommage vraiment irréparable ,
en éloignant de l’étude de cette fcience, ou en confirmant
dans leur éloignement plufieurs de ces génies
élevés 8c vigoureux, qui ne fauroient fe laiffer
traîner de manoeuvre en manoeuvre , ni fe nourrir
d’explications maigres, feches,foibles, ifolées; mais
qui auroient été néceflairement des chimiftes zélés,
fi un feul trait de lumière leur eût fait entrevoir combien
la Chimie peut prêter au génie, 8c combien elle
peut en recevoir à ion tour.
Il eft très-difficile fans doute de détruire ces im-
preflions défavorables. II eft clair que la révolution
qui placeroit la Chimie dans le rang qu’elle mérite ,
qui la mettroit au moins à côté de la Phyfique calculée
; que cette révolution , dis-je , ne peut être
opérée quej>ar un chimifte habile, enthoufiafte, 8c