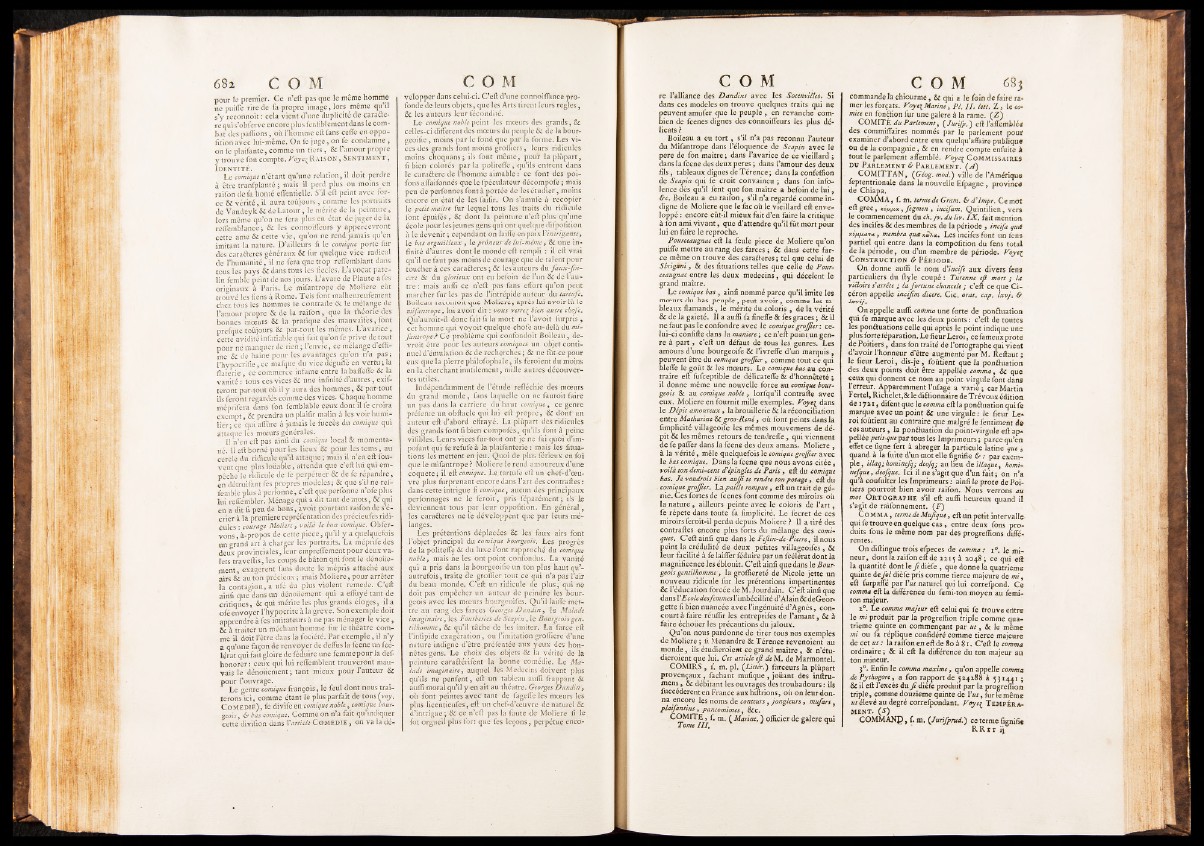
pour le premier. Ce n’eft pas que le même homme
ne puifîe rire de fa propre image, lors même qu’il
s’y reconnoît : cela vient d’une duplicité de caraâe-
re qui s’obferve encore plus fenfiblement dans le combat
des pallions, oii l’homme eft fans celfe en oppo-
iition avec lui-même. On fe juge, on fe condamne ,
on fe plaifante, comme un tiers, & l’amour propre
y trouve fon compte. Voye^ Raison , Sentiment ,
Identité.
Le comique n’étant qu’une relation, il doit perdre
à être tranfplanté; mais il perd plus ou moins en
raifon de fa bonté eflentielle. S’il ell peint avec force
& vérité, il aura toujours, comme les portraits
de Vandeyk & de Latour, le mérite de la peinture,
lors même qu’on ne fera plus en état de juger de la
relfemblance ; & les eonnoilfeurs y appercevront
cette ame & cette v ie , qu’on ne rend jamais qu’en
imitant la nature. D ’ailleurs fi le comique porte fur
des eara&eres généraux & fur quelque vice radical’
de l’humanité, il ne fera que trop relfemblant dans
tous les pays & dans tous les fiecles. L’avocat patelin
femble peint de nos jours. L’avare de Plaute a fes
originaux à Paris. Le mifantrope de Moliere eût
trouvé les fiens à Rome. Tels font malheureufement
chez tous les hommes le contrafte & le mélange de
l’amour propre & de la raifon , que la théorie des
bonnes moeurs & la pratique des mauvaifes, font
prefque toujours & par-tout les mêmes. L’avarice,
cette avidité infatiable qui fait qu’on fe jmve debout
pour né manquer dé rien; l’envie, ce mélange d’efti-
me & de haine pour les avantages qu’on n’a pas ;
l’hypocrifie, ce mafque du vice déguifé en vertu ; la
flaterie ce commerce infâme entre la baffefle & la
vanité : tous ces vices & une infinité d’autres, exif-
teront par-tout où il y aura des hommes, & par-tout
ils feront regardés comme des vices. Chaque homme
méprifera dans fon femblable ceux dont il fe croira
exempt, & prendra un plaifir malin à les voir humilier;
ce qui affûre à jamais le fuccès du comique qui
attaque les moeurs générales.
Il n’en eft pas ainfi du comique local & momentané.
U eft borné pour les lieux & pour les tèms, au
cercle du ridicule qu’il attaque ; mais il n’en eft fou-
vent que plus louable, attendu que c’eft lui qui empêche
le ridicule de le perpétuer tte. de fe répandre,
en détruifant fes propres modèles ; & que s’il ne ref-
femble plus à perfonne, c’eft queperfonne n’ofe plus
lui reffembler. Ménage qui a dit tant de mots, & qui
en â dit fi peu de bons, avoit pourtant raifon de s’écrier
à la première repréfentation des précieufes ridicules
: courage Moliere, voilà le bon comique. Obfer-
vons, à-propos de cette piece, qu’il y a quelquefois
un grand art à charger les portraits. La méprife des
deux provinciales , leur empreffement pour deux valets
traveftis, les coups de bâton qui font le dénouement
, exagèrent fans doute le mépris attaché aux
airs & au ton précieux; mais Moliere, pour arrêter
la contagion, a ule du plus violent remede. C eft
ainfi que dans un dénouement qui a efluyé tant de
critiques, & qui mérite les plus grands éloges, il a
ofé envoyer l’hypocrite à la greve. Son exemple doit
apprendre à fes imitateurs à ne pas ménager le v ic e ,
& à traiter un méchant homme fur le théâtre comme
il doit l’être dans la fociété. Par exemple, il n’y
a qu’une façon de renvoyer de deflùs la feene un fcé-
lérat qui fait gloire de féduire une femme pour la def-
honorer: ceux qui lui reffemblent trouveront mauvais
le dénouement ; tant mieux pour l’auteur &
pour l’ouvrage.
Le oenre' comique françois, le feul dont nous trai-
terons°ici, comme étant le plus parfait de tous (voy.
COMEDIE), fe divifè en comique noble, comique bourgeois
, & bas càmique. Comme on n’a fait qtt indiquer
cette divifion dans l’article C omedie, on va la developper
dans celui-ci. C ’eft d’une connoiffance profonde
de leurs objets, que les Arts tirent leurs réglés,
& les auteurs leur fécondité.
Le comique noble peint les moeurs des grands, &
celles-ci different des moeurs du peuple ôc de la bour-
geoifie, moins par le fond que par la forme. Les v ices
des grands font moins grofliers, leurs ridicules
moins choquans ; ils font même, pour la plûpàrt,
fi bien colorés par la politeffe , qu’ils entrent dans
le caraûere de l’homme aimable : ce font des poi-
fons affaifonnés que le fpéculateut décompofe ; mais
peu de perfonnes font à portée de les étudier, moins
encore en état de les faifir. On s’amufe à recopier
le petit maître fur lequel tous les traits du ridicule
font épuifés, & dont la peinture n’ eft plus qu’une
école pour les jeunes gens qui ont quelque difpofition
à le devenir ; cependant on laiffe enpaix\’intrigante,
le bas orgueilleux, le prôneur de lui-même, &C une infinité
d’autres dont le monde eft rempli : il eft vrai
qu’il ne faut pas moins de courage que de talent pour
toucher a ces cara&eres; & les auteurs du faux-jin-
cere & du glorieux ont eu beloin de l’un & de l’autre
: mais aufli ce n’eft pas fans effort qu’on peut
marcher fur les pas de l’intrépide auteur du tartufe.
Boileau racontoit que Moliere, après lui avoir lu le
mifantrope, lui avoit dit : vous verre^ bien autre chofe.
Qu’auroit-il donc fait fi la mort ne l’avoit furpris ,
cet homme qui voyoit quelque chofe au-delà du mifantrope?
Ce problème qui confondoit Boileau, de-
vroit être pour les auteurs comiques un objet continuel
d’émulation & de recherches ; & ne fût-ce pour
eux que la pierre philofophale, ils feroient du'moins
en la cherchant inutilement, mille autres découvertes
utiles.
Indépendamment de l’étude refléchie des moeurs
du grand monde, fans laquelle on ne fauroit faire
un pas dans la carrière du haut comique, ce genre
prélente un obftacle qui lui eft propre, & donr un
auteur eft d’abord effrayé. La plupart des ridicules
des grands font fi bien compofés, qu’ils font à peine
vifibles. Leurs vices fur-tout ont je ne fai quoi d’im-
pofant qui fe refufe à la plaifanterie : mais les fitua-
tions les mettent en jeu. Quoi de plus férieux en foi
que le mifantrope ? Moliere le rend amoureux d’une
coquete ; il eft comique. Le tartufe eft un chef-d’oeuvre
plus furprenant encore dans l’art des contraires :
dans cette intrigue fi comique, aucun des principaux
perfonnages ne le feroit, pris féparément ; ilsr le
deviennent tous par leur oppofition. En générai,
les caraCteres ne fe développent que par leurs mélanges.
Les prétentions déplacées & les faux airs font
l’objet principal du comique bourgeois. Les progrès
de la politeffe & du luxe l’ont rapproché du comique
noble, mais ne les ont point confondus. La vanité
qui a pris dans la bourgeoifie un ton plus haut qii’-
autrefois, traite âe groffier tout ce qui n’a pas l’air
du beau monde, C ’eft un ridicule de plus,''qui ne
doit pas empêcher un auteur de peindre les bourgeois
avec les moeurs bourgeoifes. Qu’il laiffe mettre
au rang des farces Georges Dandin, le Malade
imaginaire, les Fourberies de Scapin, le Bourgeois gentilhomme
, & qu’il tâche de les imiter. La' farce eft
: -i’infipide exagération, ou l’imitation groflîere d’une
nature indigne d’être .pré(entée aux yeux des hon-
; nêtes gens. Le choix des objets & la vérité de la
peinture cafaâérifent la bonne comédie. Le Malade
imaginaire y auquel les Médecins doivent plus
qu’ils ne penfent, eft un tableau aufli frappant &
aufli moral qu’il y en ait au théâtre. Georges Dandin ,
où font peintes avec tant de fageffe les moeurs les
plus licentieufes, eft un chef-d’oeuvre de naturel &
d’intrigue ; & ce n’eft pas la faute de Moliere fi le
fot orgueil plus fort que fes leçons, perpétue encore
l’alliance des Dandins avec les Sotenvillts. Si
dans ces modèles on trouve quelques traits qui ne
peuvent amufer que le peuple , en revanche combien
de feenes dignes des eonnoilfeurs les plus délicats
?
Boileau a eu to r t , s’il n’a pas reconnu l’auteur
du Mifantrope dans l’éloquence de Scapin avec le
pere de fon maître ; dans l’avarice de ce vieillard ;
dans la feene des deux peres ; dans l’amour des deux
fils, tableaux dignes de Térence; dans la confeflion
de Scapin qui fe croit convaincu ; dans fon info-
lence dès qu’il fent que fon maître a befoin de lu i ,
&c. Boileau a eu raifon, s’il n’a regardé comme indigne
de Moliere que le fac où le vieillard eft enveloppé
: encore eût-il mieux fait d’en faire la critique
à fon ami vivant, que d’attendre qu’il fût mort pour
lui en faire le reproche.
Pourceaugnac eft la feule piece de Moliere qu’on
puiffe mettre au rang des farces ; & dans cette farce
même on trouve des caractères ; tel que celui de
Sbrigâni, & des fituations telles que celle de Pourceaugnac
entre les deux médecins, qui décelent le
grand maître.
Le comique bas, ainfi nommé parce qu’il imite les
moeurs du bas peuple, peut avo ir, comme les tableaux
flamands, le mérite du coloris , de la vérité
& de la gaieté. 11 a aufli fa fineffe & fes grâces ; & il
ne faut pas le confondre avec le comique groffier'. celui
ci confifte dans la maniéré ; ce n’eft point un genre
à pa rt, c’eft un défaut de tous les genres. Les
amours d’une bourgeoife & l’ivrefle d’un marquis ,
peuvent être du comique groffier, comme tout ce qui
bleffe le goût & les moeurs. Le comique bas au contraire
eft fufceptible de délicateffe & d’honnêteté ;
il donne même une nouvelle force au comique bourgeois
& au comique noble , lorfqu’il contrafte avec
eux. Moliere en fournit mille exemples. Voye{ dans
le Dépit amoureux y la brouillerie& la réconciliation
entre Mathurine & gros-René, où font peints dans la
fimplicité villageoife les mêmes mouvemens de dépit
& les mêmes retours de tendreffe, qui viennent
de fe paffer dans la feene des deux amans. Moliere ,
à la vérité, mêle quelquefois le comique groffier avec
le bas comique. Dans la feene que nous avons citée ,
voila ton demi-cent d?épingles de Paris , eft du comique
bas. Je voudrois bien aujji te rendre ton potage , eft du
. comique groffier. La paille rompue , eft un trait de génie.
Ces fortes de feenes font comme des miroirs où
la nature, ailleurs peinte avec le coloris de l’a r t ,
fe répété dans toute fa fimplicité. Le fecret de ces
miroirs feroit-il perdu depuis Moliere ? Il a tiré des
contraftes encore plus forts du mélange des comiques.
C ’eft ainfi que dans le Fefin-de - Pierre, il nous
peint la crédulité de deux petites villageoifes , &
leur facilité à fe laiffer féduire par un fcélérat dont la
magnificence les éblouit. C ’eft ainfi que dans le Bourgeois
gentilhomme’y la groffiereté de Nicole jette un
nouveau ridicule fur les prétentions impertinentes
& l ’éducation forcée de M. Jourdain. C ’eft ainfi que
dans V Ecole desfemmes l’imbécillité d’Alain & deGeor-
gette fi bien nuancée avec l’ingénuité d’Agnès, concourt
à faire réuflir les entreprifes de l’amant, & à
faire échoiier les précautions du jaloux.
Qu’on nous pardonne de tirer tous nos exemples
de Moliere ; fi Menandre & Térence revenoient au
monde, ils étudieroient ce grand maître, & n’étu-
dieroient que lui. Cet article efl de M. de Marmontel.
COMIRS, f. m. pl. (Littér.) farceurs la plûpart
provençaux, fachant mufique, jouant des inftru-
mens, & débitant les ouvrages des troubadours : ils
fuccéderent en France auxhiftrions, où on leur donna
encore les noms de conteurs, jongleurs , mufars ,
plaifanùns , pantomimes y &C.
COMITE, f. m. ( Marine. ) officier de galere qui
Tome I II.
commandé la chiourme, & qui a lé foin de faire ramer
les forçats. Voye{Marine * Pl. IL lett. Z , le co»
mite en fon&ion fur une galere à la rame. (Z )
COMITÉ du Parlement, ( Jurifp. ) eft l’aflemblée
des commiflaires nommés par le parlement pour
examiner d’abord entre eux quelqu’affaire publique
ou de la compagnie, & en rendre compte enfuite à
tout le parlement aflemblé. Voye[ C ommissaires
du Parlement & Parlement. (^ )
COMITTAN, (Géog. modf ville de l’Amérique
feptentrionale dans la nouvelle Efpagne, province
de Chiapa.
COMM A , f. m. tetntt de Gram. & d'Impr. Ce mot
eft g rec, Koppa, fegmen, incifum. Quintilien, vers
le commencement du ch. jv. du liv. IX . fait mention
des incifes &c des membres, de la période f inc fa qud
Koppartty membra quet kuXol. Les incifes font un l’ens
partiel qui entre dans la compolition du fens total
de la période, ou d’un membre de période. Voye£
C o n stru ct ion & Période*
On donne aufli le nom tfincift aux divers fens
particuliers du ftyle coupé ; Turenne efl mort ; la
victoire s'arrête ; la fortune chancelé ; c’eft ce que C icéron
appelle incifim diçere, Cic. orat. cap. Ixvji &.
Ixvij.
^On appelle aufli comma une forte de pônêluation
qui fe marque avec les deux points : c’eft de toutes
les ponctuations celle qui après le point indique une
plus forte f éparation. Le fleur Leroi, ce fameux prote
de Poitiers, dans fon traité de l’ortographe qui vient
d’avoir l ’honneur d’être augmenté par M. Reftaut ;
le fleur Leroi, dis-je, foûtient que la ponctuation
des deux points doit être appellee comma, & que
ceux qui donnent ce nom au point-virgule font dans
l’erreur. Apparemment l’ufage a varie ; car Martin
Fertel, Richelet,& le dictionnaire de Trévoux édition
de 17 1 1 , difent que le comma eft la ponctuation qui fe
“ arque avec un point & une virgule : le fleur Leroi
foûtient au contraire que malgré le fentiment de
ces auteurs , la ponctuation du point-virgule eft ap-
pellée petit-que paf tous les Imprimeurs ; parce qu’en
effet ce figne fert à abréger la particule latine que 4
quand à la fuite d’un mot elle fignifie & : par exemple,
illaq; hominefq; deofq; au lieu de iliaque i homi-
nefquey deofque. Ici il ne s’agit que d’un fait; on n’a
qu’à confulter les Imprimeurs : ainfi le prote de Poitiers
pourroit bien avoir raifon. Nous verrons au
mot O r to g r a ph e s’il eft aufli heureux quand il
s’agit de raifonnement. (F)
C o m m a , terme de Mufique, eft un petit intervalle
qui fe trouve en quelque cas , entre deux fons produits
fous le même nom par des progreflions différentes.
On diftingue trois efpeces de comma : i°. le mineur,
dont la raifon eft de 1115 à 1048; ce qui eft
la quantité dont le ƒ dièfe , que donne la quatrième
quinte de fo l dièfe pris comme tierce majeure de mi,
eft furpaffé par l’ut naturel qui lui correfpond. Ce
comma eft la différence du femi-ton moyen au femi-
ton majeur.
i ° . Le comma majtur eft celui qui fe trouve entre
le mi produit par la progreflion triple comme quatrième
quinte en commençant par u t , & le même
mi ou fa réplique confidéré comme tierce majeure
de cet ut : la raifon en eft de 80 à 81. C ’eft le comma
ordinaire ; & il eft la différence du ton majeur aü
ton mineur.
30. Enfin le comma maxime, qu’on appelle comma
de Pythogore, a fon rapport de 514288 à 531441 ;
& il eft l’excès du f i dièfe produit par la progreflion
triple, comme douzième quinte de Y ut, fur le même
ut élevé au degré correfpondant. Voye{ T empéram
en t . (£)
COMMANp, f. m. ( Jurifprud.) ce terme lignifie
R R r r ij
â