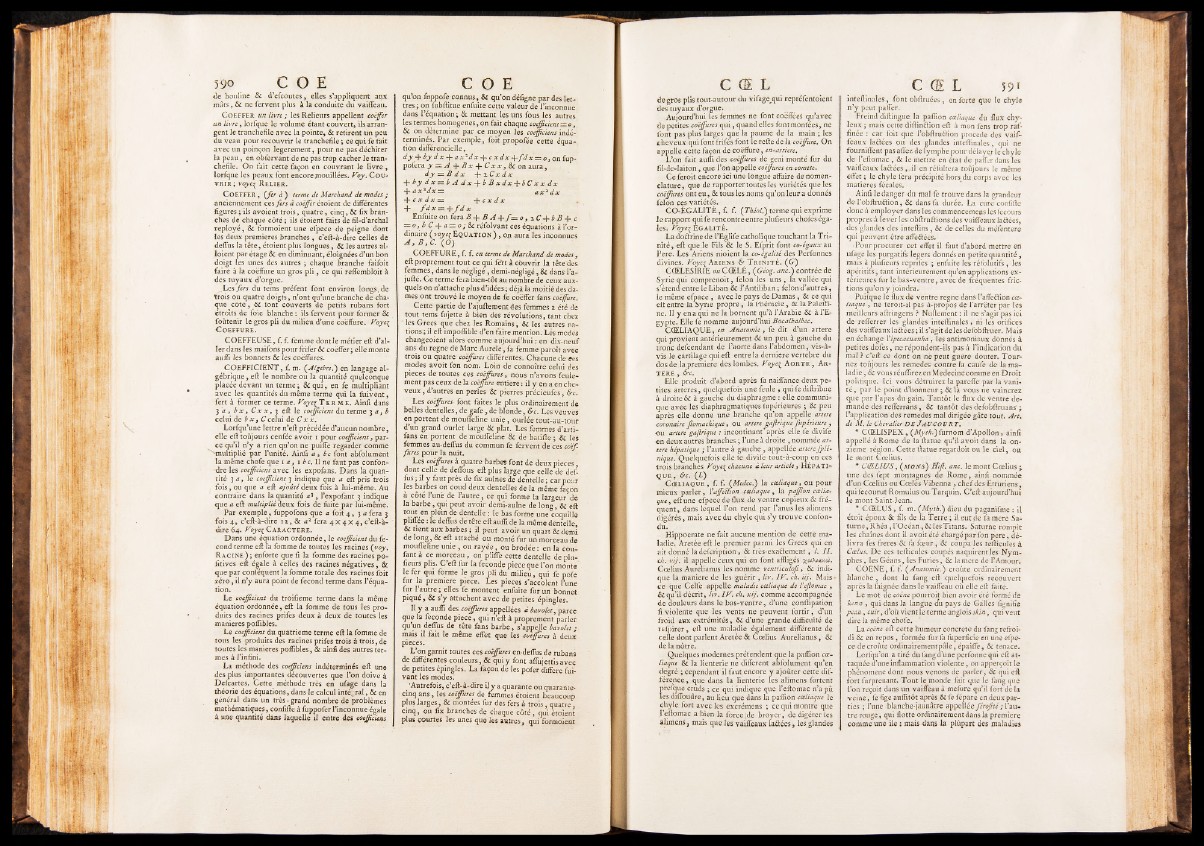
590 C O E
de bouline 6c d’efcoutes, elles s’appliquent aux
mâts, 6c ne fervent plus à la conduite du vaiffeau.
C oeffer un livre ; les Relieurs appellent coiffer
un livre, lorfque le volume étant couvert, ils arrangent
le tranchefile avec la pointe, & retirent un peu
du veau pour recouvrir le tranchefile ; ce qui fe fait
avec un poinçon legerement, pour ne pas déchirer
la peau, en obfervant de ne pas trop cacher le tranchefile.
On fait cette façon en couvrant le livre ,
lorfque les peaux font encore mouillées. Voy. Cou*
vrir ; voye^ R elier.
C oeffer , (fer a ) terme de Marchand de modes ;
anciennement ces fers à coeffer étoient de différentes
figures ; ils avoient trois, quatre, cinq, 6c lix branches
de chaque côté ; ils étoient faits de fil-d’archal
reployé, 6c formoient une efpece de peigne dont
les deux premières branches , c’eft-à-dire celles de
deffus la tête, étoient plus longues, & les autres al-
loient par étage 6c en diminuant, éloignées d’un bon
doigt les unes des autres ; chaque branche faifoit
faire à la coëffure un gros p l i , ce qui reffembloit à
des tuyaux d’orgue.
.Les fers du tems préfent font environ longs.de
frois ou quatre doigts, n’ont qu’une branche de chaque
cô té , 6c font couverts de petits rubans fort
étroits de foie blanche : ils fervent pour former 6c
foutenir le gros pli du milieu d’une coëffure. Voye^
C oeffure.
COEFFEUSE, f. f. femme dont le métier eft d’aller
dans les maifons pour frifer 6c coeffer; elle monte
auffi les bonnets & les coëffures.
COEFFICIENT, f. m. (’Algèbre.) en langage algébrique
, eft le nombre ou la quantité quelconque
placée devant un terme ; & qui, en fe multipliant
avec les quantités du même terme qui la fuivent,
fert à former ce terme. Voye^T e r m e . Ainfi dans
3 a > b x , C x x , 3 eft le coefficient du terme 3 a , b
celui de b x , C celui de C x x .
Lorfqu’une lettre n’eft précédée d’aucun nombre,
elle eft toûjours cenfée avoir 1 pour coefficient, parce
qu’il n’y a rien qu’on ne puiffe regarder comme
'■ 'multiplié par l’unité. Ainfi a , bc font abfolument
la même chofe que 1 a , 1 b c. Il ne faut pas confond
r e les coefficient avec les expofans. Dans la quantité
3 a , le coefficient 3 indique que a eff pris trois
fois, ou que a eft ajoûté deux fois à lui-même. Au
contraire dans la quantité <z? , l’expofant 3 indique
que a eft multiplié deux fois de fuite par lùi-même.
Par exemple, fuppofons que a foit 4 , 3 a fera 3
fois 4 , c’eft-à-dire 1 x , & a* fera 4 x 4 x 4 , c’eft-à-
dire 64. Voye^ C a r ac tè r e .
Dans une équation ordonnée, le coefficient du fécond
terme eft la fomme de toutes les racines (voy.
Ra c in e ) ; enforte que fi la fomme des racines po-
fitives eft égale à celles des racines négatives, &
que par conlequent la fomme totale des racines foit
zé ro , il n’y aura point de fécond terme dans l’équation.
Le coefficient du troifieme terme dans la même
équation ordonnée, eft la fomme de tous les produits
des racines prifes deux à deux de toutes les
maniérés poffibles.
Le coefficient du quatrième terme eft la fomme de
tous les produits des racines prifes trois à trois, de
toutes les maniérés poffibles, & ainfi des autres termes
à l’infini.
La méthode des coefficiens indéterminés eft une
des plus importantes découvertes que l’on doive à
Defcartes. Cette méthode très en ufage dans la
théorie des équations, dans le calcul inté.ral, & en
général dans un très - grand nombre de problèmes
mathématiques, confifte à fuppofer l’inconnue égale
à une quantité dans laquelle il entre des coefficiens
C O E
qu’on fuppofe connus, 6c qu’on défigne par des lettres
; on fubftitue enfuite cette valeur de l’inconnue!
dans l’équation ; & mettant les uns fous les autres
les termes homogènes, on fait chaque coefficient = o ,
6c on détermine par ce moyen les coefficiens indéterminés.
Par exemple, foit propofée cette équation
différencielle,
d y + bydx-\r ax'ld x + cxd x-\-fdxz=:o>on{\xp-
pofera y = A + B x + C x x , 6c on aura,
d y — B d x -\ - x C x d x
-f- b y d x z z b A d x - \ - b B x d x - \ - b C x x d x
+ a x * d x = a x * d x
- \ - c x d x Ji®L. , - \ - c x d x
+ f d x=z-\- f d x
Enfuite on fera B - \ -B A - \ - f= z o , iC + b B - \ - c
— o 9bC -\ -a— o i6 c réfolvant ces équations à l’ordinaire
( voyei Equation ) , on aura les inconnues
A , B t C. (O)
COEFFURE, f. f. en terme de Marchand de modes,
eft proprement tout ce qui fètt à côuvrir la tête des
femmes, dans le négligé, demi-négligé, 6c dans Ta-
jufté. C e terme fera bien-tôt au nombre de ceux auxquels
on n’attache plus d’idées; déjà la moitié des dames
ont trouvé le moyen de fe coëffer fans coëffure.
Cette partie de l’ajuftement des femmes a été de
tout tems fujette à bien des révolutions, tant chez
' les Grecs que chez les Romains, & les autres nations
; il eft impoffible d’en faire mention. Lés modes
changeoient alors comme aujourd’hui : en dix-neuf
ans du régné de Marc Aurele, fa femme paroît avec
trois ou quatre coëffures différentes. Chacune de ces
modes avoit fon nom. Loin de connoître celui des
pièces de toutes ces coëffures, nous n’avons feulement
pas ceux de la coëfftre entière : il y en a en cheveux
, d’autres en perles 6c pierres précieufes, &c.
Les coëffures- font faites le plus ordinairement de
belles dentelles, de gafe, de blonde, &c. Les veuves
en portent de mouffeline unie, ourlée tout-au-tour
d’un grand ourlet large & plat. Les femmes d’arti-
fans en portent de mouffeline 6c de batifte ; 6c les
femmes au-deffus du commun fe fervent de ces coëffures
pour la nuit.
Les coëffures à quatre barbes font de deux pièces ,
dont celle de deffous eft plus large que celle de deffus
; il y faut près de fix aulnes âe dentelle ; car pour
1« barbes on coud deux dentelles de la même façon
à côté l’unè de l’autre, ce qui forme la largeur'de
la barbe, qui peut avoir demi-aulne de long, & eft
tout en plein de dentelle : le bas forme une coquille
pliffée : le deffus de tête eft auffi de la même dentelle,
6c tient aux barbes ; il peut avoir un quart & demi
de long , & eft attaché ou monté fur un morceau de
mouffeline unie , ou rayée , ou brodée: en la cou-
fant à ce morceau, on pîiffe cette dentelle de plu-
fieurs plis. C eft fur la fécondé piece que l’on monte
le fer qui forme le gros pli du milieu, qui fe pôle
fur la première piece. Les pièces s’accolent l’une
fur l’autre ; elles fe montent enfuite fur un bonnet
piqué, 6c s’y attachent avec de petites épingles.
Il y a auffi des coëffures appellées à bavolet, parce
que la fécondé piece, qui n’eft à proprement parler
qu’un deffus de tête fans barbe, s’appelle bavolet ;
mais il fait le même effet que les coëffures à deux
pièces.
L’on garnit toutes ces coëffures en deffus de rubans
de différentes couleurs, & qui y font affujettis avec
de petites épingles. La façon de les poler différé fui-
vant les modes.
'Autrefois, c’eft-à-dire f ly a quarante ou quarante-
cinq ans, les coëffures de femmes.étoient beaucoup
plus larges, & montées fur des fers à trois, quatre,
cinq, ou fix branches de chaque côté, qui étoient
plus courtes les unes que les autres, qui formoient
C (S L
de gros plis tout-autour du vifage^qui repréfentoient
des tuyaux d’orgue»
Aujourd’hui les femmes ne font coeffées qu’avec
de petites coëffures qui, quand elles font montées, ne
font pas plus larges que la paume de la main ; les
cheveux qui font frifés font le refte de la coëffure. On
appelle cette façon de coëffure, en-arriere.
L’on fait auffi des coëffures de geai monté fur du
fil-de-laiton, que l’on appelle coëffures en comete.
Ce feroit encore ici une longue affaire de nomenclature,
que de rapporter toutes les variétés que les
coëffures ont eu, & tous les noms qu’on leur a donnés
félon ces variétés.
CO-ÉGALITÉ, f. f. (Théol.) terme qui exprime
le rapport qui fe rencontre entre plufieurs chofes égales;
Voye^ Eg a l it é .
La do&rine de l’Eglife catholique touchant la T rinité,
eft que,1e Fils 6c le S. Efprit font co-égaux au
Pere. Les Ariens nioient la co-égalité des Perfonnes
divines. Voye^ Ariens & T r in it é . (G)
CCELESIRIE ou COE L É , (Géog. anc.) contrée de
Syrie qui comprenoit, félon les uns , la vallée qui
s’étend entre le Liban 6c l’Antiliban ; félon d’autres,
le même efpace , avec le pays de D amas, & ce qui
eft entre la Syrie propre, la Phénicie, &laPalefti-
ne. Il y en a qui ne la bornent qu’à l’Arabie & à l’Egypte.
Elle fe nomme aujourd’hui Bocalbalbec.
COELIAQUE, en Anatomie, fe dit d’un artere
qui provient antérieurement & un peu à gauche du
tronc descendant de l’aorte dans l’abdomen, vis-à-
vis le cartilage qui eft entre la derniere vertebre du
dos de la première des lombes. Voye^ A o r t e , Ar tere
, &c.
Elle produit d’abord après fa naiffance deux petites
arteres, quelquefois une feule , quifediftribue
à droite 6c à gauche du diaphragme : elle communique
avec les diaphragmatiques fupérieures ; & peu
après elle donne une branche qu’on appelle artere
coronaire fiomachique, ou artere gaftrique fupérieure ,
ou artere gaffrique : ineontiriant* après elle fe divife
on deux autres branches ; l’une à droite , nommée at-
tere hépatique ; l’autre à gauche , appellée artere fplér
nique. Quelquefois elle le. divife tout-à-coup en ces
trois branches Voye{ chacune à leur article , HEPATIQUE,
&c. (L)
C oeliaque , f. f. (Medec.) la coeliaque, ou pour
mieux parler, Yaffection coeliaque , la pajjîon coeliaque
, eft une efpece de flux de ventre copieux & fréquent,
dans lequel l’on rend par l’anus les alimens
digérés, mais avec du chyle qui s’y trouve confon-
du.
Hippocrate ne fait aucune mention de cette maladie.
Aretée eft le premier parmi les Grecs qui en
ait donné la defcriptiôn, & très-exaâement, l. II.
ch. vij. il appelle ceux qui en font affligés xoiXiako).
Coelius Aurelianus les nomme ventriculoji, & indique
la maniéré de les guérir , liv. IV . ch. iij. Mais •
ce que Celfe appelle maladie coeliaque de l'efiomac ,
& qu’il décrit, liv. IV. ch. x ij. comme accompagnée
de douleurs dans le bas-venfre, d’une conftipation
fi violente que les vents ne peuvent fortir, d’un
froid aux extrémités, 6c d’une grande difficulté de
relpirer, eft une maladie également différente de
celle dont parlent Aretée & Coelius Aurelianus, 6c
de la nôtre.
Quelques modernes.prétendent que la paffion coeliaque
6c la lienterie ne different abfolument qu’en
degré ; cependant il faut encore y ajouter cette différence
, que dans la lienterie les alimens fortenf
prefque cruds ; ce qui indique que l’eftomac n’a pu
les diffoudre, au lieu que dans la paffion coeliaque le
chyle fort avec les excrémens ; ce qui montre que
,1’eftomac a bien la force jde broyer, de digérer les
alimens, mais que les vaiffeaux laûées f les glandes
C d L 591
inteftinales, font obftruées, en forte que le chyle
n’y peut paffer.
Freind diftingue la paffion coeliaque du flux chyleux
; mais cette diftinftion eft à mon fens trop raffinée
: car foit que l’obftruftion procédé des vaiffeaux
laftées ou des glandes inteftinales, qui ne
fourniffent pas affez de lymphe pour délaye.r le chyle
de l’eftomac , & le mettre en état de paffer dans les
vaiffeaux lattées ,«il en réfultera toûjours le même
effet ; le chyle fera précipité hors du corps avec les
matières fécales.
Ainfi le danger du mal fe trouve dans la grandeur
de l’obftruéHon, 6c dans fa durée. La cure confifte
donc à employer dans les commencemeps lesfecours
propres à lever les obftruétions des vaiffeaux laétées,
des glandes des inteftins, 6c de celles du méfentere
qui peuvent être affeétées.
.Pour procurer cet effet il faut d’abord mettre en
ufage les purgatifs légers donnés en petite quantité,
mais à plufieurs reprifes ; enfuite les réfolutifs , les
apéritifs ; tant intérieurement qu’en applications extérieures
fur le bas-ventre, avec de fréquentes frictions
qu’on y joindra.
Puiique le flux de ventre régné dans l’affeétion coeliaque
, ne feroit-il pas à-propos de l’arrêter par les
meilleurs aftringens ? Nullement : il ne s’agir pas ici
de refferrer les glandes inteftinales, ni les orifices
des vaiffeaux laétées ; il s’agit de les defobftruer. Mais
en échange YipecacUanha, les antimoniaux donnés à
petites dofes, ne répondent-ils pas à l’indication du
mal ? c’eft ce dont on nè peut guere douter. Tournez
toûjours les remedes contre la caufe de la maladie
, 6c vous réuffirezen Médecine comme en Droit
politique. Ici vous détruirez la pareffe par la vanité
, par le point d’honneur ; & là vous ne vaincrez
que par l’apas du gain. Tantôt le flux de ventre demande
des refferrans, 6c tantôt des dcfobftruans' ;
l’application des remedes mal dirigée gâte tout. A r t.
de M. le Chevalier DE J A U.COVRT.
* CCELISPEX, (M y th .')furnom d’Apollon, ainfi
appelle à Rome de la ftatue qu’il avoit dans la onzième
région. Cette ftatue regardoit ou le ciel, ou
le mont Coelius.
* COELIUS, ( m o n s ) Hijl. anc. le mont Coelius ;
une des fept montagnes de Rome, ainfi nommée
d’un Coelius ou Coelès Vibenna , chef des Etruriens.
qui fecourut Romulusou Tarquin, C’eft aujourd’hui
le mont Saint-Jean.
* C (ELU S , f. m. (Myth,') dieu du paganifme : il
étoit époux & fils de la Terre ; i l eut de fa mere Saturne,
R héa, l’Océan.,& les Titans. Saturne rompit
les chaînes dont il avoit été chargé par fon pere, délivra
fes freres 6c fa fceur, 6c coupa les tefticules à
Coelus. De ces tefticules coupés naquirent les Nymphes
, les Géans, les Furies, & la mere de l’Amour.
COENE, f. f. (Anatomie.) croûte ordinairement
blanche, dont le fang eft quelquefois recouvert
après la faignée dans le vaiffeau où elle eft faite.
Le mot de coëne pourroit bien avoir été formé de
kenn , qui dans la langue du pays de Galles fignifie
peau, cuir, d’où vient le terme angiois skin, qui veut
dire la même chofe.
La coëne eft cette humeur concrète du fang refroidi
6c en repos, formée fur fa fuperficie en une efpece
de croûte ordinairementpâle, épaiffe, & tenace.
Lorfqu’on a tiré du fang d’une perfonne qui eft attaquée
d’une inflammation violente, on apperçoit le
phénomène dont nous venons de parler, 6c qui eft
fort furprenant. Tout le monde fait que le fang que
l’on reçoit dans un vaiffeau à mefure qu’il fort de la
veine, fe fige auffitôt après & fe fépare en deux parties
; l’une blanche-jaunâtre appellée férofîté ; l’autre
rouge, qui flotte ordinairement dans la première
comme une île : mais dans la plupart des maladies