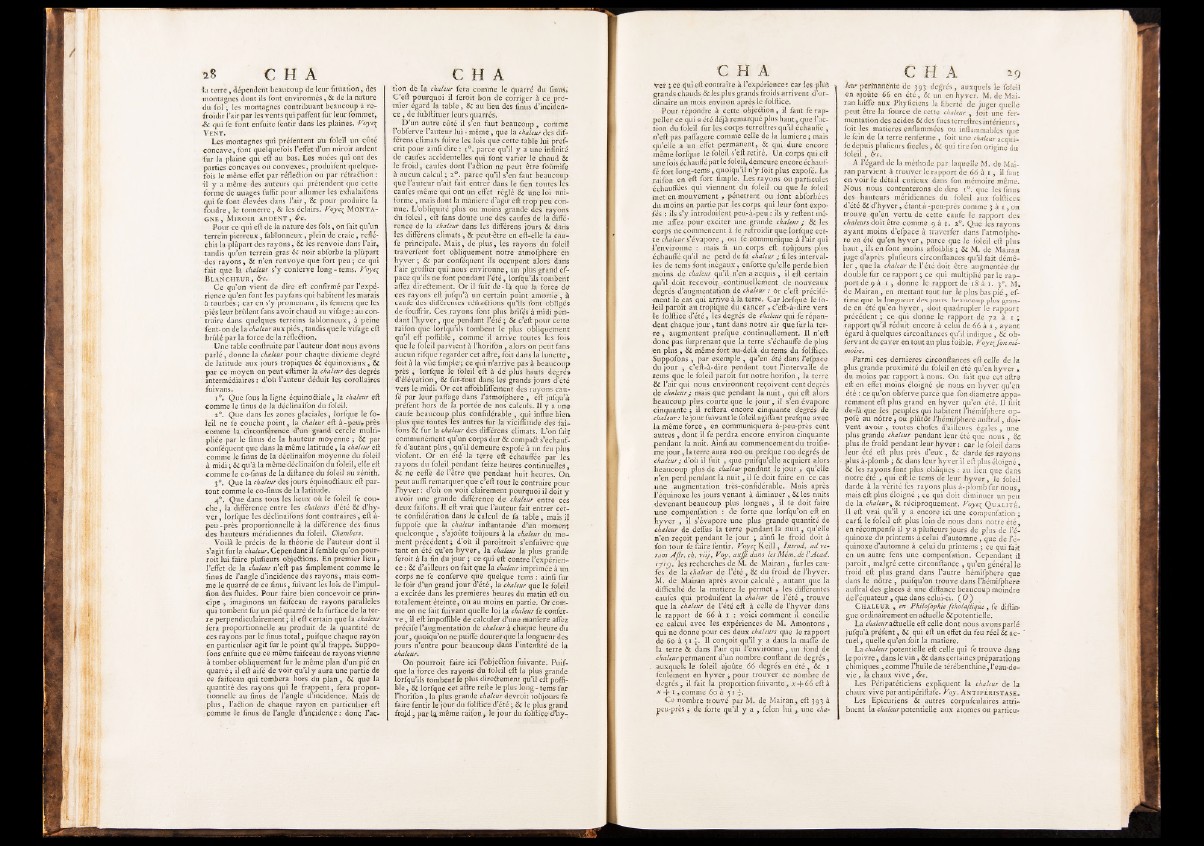
ia terre, dépendent beaucoup de leur fitflatîon, des
montagnes dont ils font environnés ,& de la nature
du fol ; les montagnes contribuant beaucoup à re>-
froidir l’air par les vents qui paffent fur leur fommet,
£c qui fe font enfuite fentir dans les plaines, Voye^
V en t.
Les montagnes qui préfentent au foleil un côté
concave , font quelquefois l’effet d’un miroir ardent
fur la plaine qui eft au bas. Les nuées qui ont des
parties concaves ou convexes, produifent quelquefois
le même effet par réflettion ou par réfraûion :
i l y a même des auteurs qui prétendent que cette
forme de nuages fuffit pour allumer les exhalaifons
qui fe font élevées dans l’air, & pour produire la
foudre, le tonnerre, & les éclairs. Voye^ Mo n t a g
n e , Miro ir a r d en t , &c.
Pour ce qui eft de la nature des fols, on fait qu’un
terrein pierreux, fablonneux, plein de craie, réfléchit
la plupart des rayons, & les renvoie dans l’air,
tandis qu’un terrein gras & noir abforbe la plûpaft
des rayons, & n’en renvoyé que fort peu ; ce qui
fait que la chaleur s’y conferve long-tems. Voye^
Blan ch eu r , & c.
Ce qu’on vient de dire eft confirmé par l’expérience
qu’en font les payfans qui habitent les marais
à tourbes ; car en s’y promenant, ils Tentent que les
piés leur brûlent fans avoir chaud au vifage : au contraire
dans quelques terreins fablonneux, à peine
fent-on de la chaleur aux piés, tandis que le vifage eft
brûlé par la force de la réfleftion.
Une table conftruite par l’auteur dont nous avons
parlé, donne la chaleur pour chaqtie dixième degré
de latitude aux jours tropiques & équinoxiaux, &
par ce moyen on peut eftimer la chaleur des degrés
intermédiaires : d’où l’auteur déduit lfes corollaires
fui vans.
i° . Que fous la ligne équinoôiale, la chaleur eft
comme le finus de la déclinaifon du foléil.
z°. Que dans les zones glaciales, lorfque le foleil
ne fe couche point, la chaleur eft à-peu*près
comme la circonférence d’un grand cercle multipliée
par le finus de la hauteur moyenne ; & par
conféquent que dans la même latitude,, la chaleur eft
comme le finus de la déclinaifon moyenne du foléil
à midi ; & qu’à la même déclinaifon du foleil, elle eft
comme le co-finus de la diftance du foleil au zénith.
3°. Que la chaleur des jours équino&iaux eft partout
comme le co-finus de la latitude.
4°. Que dans tous les lieux où le foleil fe couche
, la différence entre les chaleurs d’été & d’hy-
v e r , lorfque les déclinaifons font contraires, eft à-
peu - près proportionnelle à la différence des finus
des hauteurs méridiennes du foleil. Chambers.
Voilà le précis de la théorie de l’auteur dont il
s’agit fur la chaleur. Cependant il femble qu’on pour-
roit lui faire plufieurs objections. En premier lieu ,
l’effet de la chaleur n’eft pas Amplement comme le
finus de l’angle d’incidence des rayons, mais comme
le quarré de ce finus, fuivant les lois de l’impul-
fion des fluides. Pour faire bien concevoir ce principe
, imaginons un faifceau de rayons parallèles
qui tombent fur un pié quarré de la furface de la terre
perpendiculairement ; il eft certain que la chaleur
fera proportionnelle au produit de la quantité de
ces rayons par le finus total, puifque chaque rayon
en particulier agit fur le point qu’il frappe. Siippo-
fons enfuite que ce même faifceau de rayons vienne
à tomber obliquement fur le même plan d’un pié en
quarré ; il eft aifé de voir qu’il y aura une partie de
ce faifceau qui tombera hors du plan, ôc que la
quantité des rayons qui le frappent, fera proportionnelle
au finus de l’angle d’incidence. Mais de
plus, l’aétion de chaque rayon en particulier eft
comme le finus de l’angle d’incidence ; donc Taction
dé la chaleur fei‘a comme le quarré du finus*
C ’eft pourquoi il ferait bon de corriger à ce premier
égard la table, & au lieu des finus d’incidence
, de fubftituer leurs quarrés.
D ’un autre côté il s’en faut beaucoup , comme
l’obferve l’auteur lui - même, que la chaleur des différens
climats fuive les lois que cette table lui prefi*
crit pour ainfi dire : i° , parce qu’il y a une infinité
de caufes accidentelles qui font varier le chaud &
le froid, caufes dont l’aftion ne peut être foûmife
à aucun calcul ; 2°. parce qu’il s’en faut beaucoup
que l’auteur n’ait fait entrer dans lé fien toutes les
caufes même qui ont un effet réglé & une loi uniforme
, mais dont la màniere d’agir eft trop peu connue.
L’obliquité plüS Ou moins grande des rayons
du foleil, eft fans doute une des caufes de la différence
de la chaleur dans les différens jours & dans
les différens climats, & peut-être en eft-elle la cau-
fe principale. Mais, de plus, les rayons du foleil
traverfent fort obliquement notre atmofphere en
' hy ver ; & par conféquent ils occupent alors dans
l’air groffier qui nous environne, un plus grand ef-
pace qu’ils ne font pendant l’é té, lorfqu’ils tombent
aflez direûement. Or il fuit de-là que la force de
ces rayons eft jufqu’à un certain point amortie', à
caufe des différentes réfraôions qu’ils font obligés
. de fouffrir. Ces rayons font plus brifés à midi pendant
l’hy v er , que pendant Tété ; & c’eft pour cette
raifon que lorfqu’ils tombent le plus obliquement
qu’il eft poflîble, comme il arrive toutes les fois
que le foleil parvient à l’horifon , alors on peut fans
aucun rifque regarder cet aftre, foit dans la lunette ,
foit à là vûe Ample*; ce qui'n’ arrive pas à beaucoup
près , lorfque le ibleil eft à de^ plus hauts degrés
d’élévation, & fur-fotit dans les1 grands jours d’été
vers le midi. Or cet affbibliffement des rayons câu-
fé par leur paffage dans l’atmofphere , eft jufqù’a
préfent hors de la portée de nos calculs. II y a une
caufe beaucoup plus Confidérable , qui influe bien
plus que toutes les autres fur la viciflïtude dés fai-
fôns & fur la chaleur des différens climats. L’on fait
communément qu’un corps dur & compaft s’échauffe
d’autant plus, qu’il demeure expofé à un feu pliis
violent. Or en été la terre eft échauffée par lés
rayons du foleil pendant feize heures continuelles ,
&. ne ceflè de l’être que pendant huit heures. On
peut aufli remarquer que c’eft tout le contraire pour
Thy ver : d’où on voit clairement pourquoi il doit y
avoir une grande différence dé chaleur entre cés
deux faifohs. Il eft vrai que l’auteur fait entrer cette
confidération dans le:calcul de fa table, mais il
fuppofe que la chaleur inftantanée d’un moment
quelconque , s’ajoûte toujours à la chaleur du moment
précédent ; d’où il paroîtroit s’enfuivre que
tant en été qu’en hyver, la chaleur la plus grande
feroit à la fin du jour ; ce qui eft contre l’expérieri-
ce : & d’ailleurs on fait que la chaleur imprimée à un
corps ne fe conferve que quelque tems : ainfi fur
le foir d’un grand jour d’été, la chaleur que le foleil
a excitée dans les premières heures du matin eft oti
totalement éteinte, ou au moins en partie. Or comme
on ne fait fuivant quelle loi la chaleur fe conferve
, il eft impoflible de calculer d’une maniéré affez
précife l’augmentation de chaleur à chaque heure du
jo u r , quoiqu’on ne puiffe douter que la longueur des
jours n’entre pour beaucoup dans l’intenfité de la
chaleur.
On pourroit faire ici l’objedion fuivante. Puifque
la force des rayons du foleil eft la plus grande
lorfqu’ils tombent le plus direftement qu’il eft poffi-
b le, & lorfque cet aftre refte le plus long - tems fur
l’horifon, la plus grande chaleur devroit toûjours fe
faire fentir le jour du foïftice d’été ; & le plus grand
froid, par la même raifon, le jour du foïftice d’hy-
Ver ; ce qui eft contraire à l’expériêncei car les plûS
grands chauds & les plus grands froids arrivent d’ordinaire
un mois environ après le foïftice.
Pour répondre à cette objection, il faut fe rap-
peller ce qui a été déjà remarqué plus haut, que l ’action
du foleil fur les corps terreftres qu’il échauffe ,
n’eft pas paffagere comme celle de la lumière ; mais
qu’elle a un effet permanent, & qui dure encore
même lorfque le foleil s’eft retiré. Un corps qui eft
une fois échauffé par le foleil, demeure encore échauffé
fort long-tems, quoiqu’il n’y foit plus expofé i La
raifon en eft fort limple. Les rayons ou particules
échauffées qui viennent du foleil ou que le foleil
met en mouvement , pénètrent ou font abforbécs
du moins en partie par les corps qui leur font expo-
fés : ils s’y introdüifent peu-à-peu : ils y reftent mê'-
rae affez pour exciter une grande chaleur ; & les
corps ne commencent à fe refroidir que lorfque cette
chaleur s’évapore , 011 fe communique à l ’air qui
l ’environne : mais fi un corps eft toûjours plus
échauffé qu’il ne perd de fa chaleur ; files intervalles
de tems font inégaux, enforte qu’elle perde bien
moins de chaleur qu’il n’en a acquis , il eft certain
qu’il doit recevoir- .continuellement de nouveaux
degrés d’augmentation de chaleur : ôr c’eft précifé-
•ipent le cas qui arrive à la terre. Gar lorfque le foleil
paraît au tropique du cancer , c’eft-à-dire vers
le folfticè d’é té, les degrés de chaleur qui fe répandent
chaque jour, tant dans notre air que fur la terre
, augmentent prefque continuellement. Il n’eft
donc pas furprenant que la terre s’échauffe dé plus
_fen plus , & même fort au-delà du tems du folfticev
Suppofons * par exemple , qu’en été dans l’efpace
du jour -, c’eft-à- dire pendant tout l’intervalle de
tems que le foleil paroit fur notre horifon, la terré
& l’air qui nous environnent reçoivent cent degrés
de chaleur ; mais que pendant la n u it, qui eft alors
beaucoup plus courte que le jo u r , il s’en évapore
cinquante ; il reftera encore cinquante degrés de
chaleur : le jour fuivant le foleil agiffant prefque avec
la même force, en communiquera à-peu-près cent
autres , dont il fe perdra encore environ cinquante
pendant la nuit. Ainfi au commencement du troifie-
me jour, la terre aura 100 ou prefque 100 degrés de
chaleur; d’où il fuit , que puifqu’elle acquiert alors
beaucoup plus de chaleur pendant le jour , qu’elle
n’en perd pendant la nu it, il fe doit faire en ce cas
une augmentation très-confidérable. Mais après
l’équinoxe les jours venant à diminuer , & les nuits
devenant beaucoup plus longues , il le doit faire
une compenfation : de forte que lorfqu’on eft en
hyver , il s’évapore une plus grande quantité de
chaleur de deffus la terre pendant la nu it, qu’elle
n’en reçoit pendant le jour ; ainfi le froid doit à
fon tour fe faire fentir. Voye^ K e ill, Introd. ad ve-
tam Ajîr. ch. viij, Voy. aujji dans les Mem. de C Acad,
ific ). les recherches de M. de Mairan, furies caufes
de la chaleur de Tété , & du froid de Thy ver.
M. de Mairan après avoir calculé , autant que la
difficulté de la matière le permet , les différentes
caufes qui produifent la chaleur de l’été , trouve
que la chaleur de Tété eft à celle de l’hyver dans
le rapport de 66 à 1 : voici comment U concilie
ce calcul avec les expériences de M. Amontons ,
qui ne donne pour ces deux chaleurs que le rapport
de 60 à 51 7. Il conçoit qu’il y a dans la maffe de
la terre & dans l’air qili l ’environne, un fond de
chaleur permanent d’un nombre confiant de degrés,
. auxquels le foleil ajoûte 66 degrés en é té , & 1
feulement en hyver ; pour trouver ce nombre de
degrés , il fait la proportion fuivante, x + 6 è eft à
x -j-1 , comme 60 à 51 -j-.
Ce nombre trouvé par M. de Mairan , eft 393 à
peu-près ; de forte qu’il y a , félon lui , une chaleur
périnariênte de ^93 degrés, auxquels le foleil
en ajoûte 66 en é té , & un en hyver. M. de Mairan
laiffe aux Phyficie'ns la liberté de juger quelle
peut etre la fource de cette chaleur , foit une fermentation
des acides & des fucs terreftres intérieurs
foit les matières enflammées ou inflammables que
le fein de la terre renferme , foit une chaleur acqui-
fe depuis plufieurs fiecles, & qui tire fon origine du
fo le il, &c.
A l’égard de la méthode par laquelle M. de Mairan
parvient à trouver le rapport de 66 à 1 , il faut
en voir le detail curieux dans fon mémoire même.
Nous nous contenterons de dire i°. que les finus
des hauteurs méridiennes du foleil aux folftices
d’été & d’hy v e r , étant à - peu-près comme 3 à 1 , on
trouve qu’en vertu de cette caufe le rapport des
Chaleurs doit être comme 9 à 1. 20. Que les rayons
ayant moins d’efpace à traverfer dans l’atmofphere
en été qu’en h y v e r , parce que le foleil eft plus
haut, ils en font moins affoiblis ; & M. de Mairan
juge d’après plufieurs circonftances qu’il fait démêler
, que la chaleur de Tété doit être augmentée du
double fur ce rapport ; ce qui multiplie par le rapport
de 9 à 1 , donne le rapport de 18 à 1. 30. M.
de Mairan, en mettant tout fur le plus bas pié , ef-
time que la longueur des jours beaucoup plus grande
en été qu’en h y v e r , doit quadrupler le rapport
précédent ; ce qui donne le rapport de 72 à 1 ;
rapport qu’il réduit encore à celui de 66 à 1 , ayant
égard à quelques circonftances qu’il indique, & ob-
fervant de caver en tout au plus rbible, Voye^fon mémoire.
Parmi ces dernieres circonftances eft celle de la
plus grande proximité du foleil en été qu’en hyver ,
du moins par rapport à nous. On fait que cet aftre
eft en effet moins éloigné de nous en hyver qu’en
été : ce qu’on obferve parce que fon diamètre apparemment
eft plus grand en hyver qu’en été. Il fuit
de-Ià que les peuples qui habitent Thémifphere op-
pofé au nôtre j ou plûtôt l’hémifpheré auftral, doivent
avoir , toutes chofes d’ailleurs égales , une
plus grande chaleur pendant leur été que nous , Ôc
plus de froid pendant leur hyver : car le foleil dans
leur été eft plus près d’eux -, & darde fes rayons
plus à-plomb ; & dans leur hyver il eft plus éloigné,
& les rayons font plus obliques : au lieu que dans
notre été , qui eft le tems de leur h y v e r , le foleil
darde à la vérité fes rayons plus à-plomb fur nous,
mais eft plus éloigné ; ce qui doit diminuer un peu
de la chaleur, & réciproquement. Foyei Q u al ité .
Il eft vrai qu’il y a encore ici une compenfation ;
car fi le foleil eft plus, loin de nous dans notre été
en récompenfe il y a plufieurs jours de plus de l’équinoxe
du printems à celui d’automne , que de l’équinoxe
d’automne à celui du printems ; ce qui fait
en un autre fens une compenfation. Cependant il
paroît, malgré cette eirconftance , qu’en général le
froid eft plus grand dans l’autre hémifphere que
dans le nôtre , puifqu’on trouve dans Thémifphere
auftral des glaces à une diftance beaucoup moindre
de l’équateur , que dans celui-ci. ( O )
CHALEUR , en Philofophie fcholaflique , fe diftin-
gue ordinairement en a&uelle & potentielle.
La càd/ewr afruelle eft celle dont nous avons parlé
jufqu’à préfent, & qui eft un effet du feu réel & actuel,
quelle qu’en foit la matière.
La chaleur potentielle eft celle qui fe trouve dans
le poivre, dans le vin , & dans certaines préparations
chimiques , comme l’huile de térébenthine, l’eau-de-
vie , la chaux v iv e , &c.
Les Péripatéticiens expliquent la chaleur de la
chaux vive par antipériftafe. Voy. ANtipéristase.
Les Épicuriens & autres corpufculaires attribuent
la chaleur potentielle aux atomes ou particu