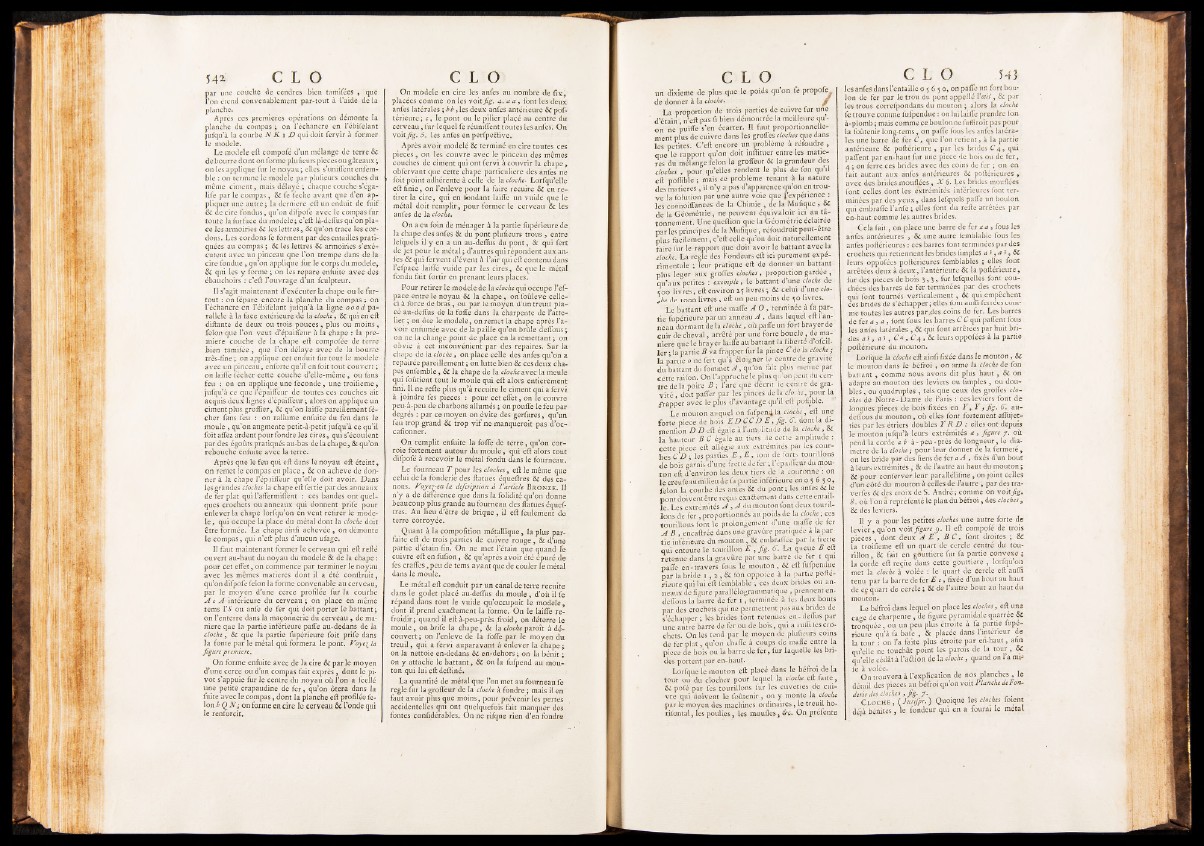
par une couche de cendres bien tamifées , que
l’on étend convenablement par-tout à l’aide delà
planche.
Après ces premières opérations on démonte la
planche du compas ; on l’échancre en l’ébifelant
jufqu’à la courbe N K i D qui doit fervir à former
le modèle.
Le modèle eft compofé d’un mélange de terre &
de bourre dont on forme plufieurs pièces ou gâteaux ;
on les applique fur le noyau ; elles s’unifient enfem-
ble : on termine le modèle par plufieurs couches du
même ciment, mais délayé ; chaque couche s’éga-
life par le compas, 6c fe feche avant que d’en appliquer
une autre ; la derniere eft un enduit de fuif
6c de cire fondus, qu’on difpofe avec le compas fur
toute la furface du modèle ; c’eft là-defl’us qu’on place
les armoiries 6c les lettres, & qu’on trace les cordons.
Les cordons fe forment par des entailles pratiquées
au compas ; 6c les lettres 6c armoiries s’exé--
eurent avec un pinceau qne l’on trempe dans de la
cire fondue, qu’on applique fur le corps du modèle,
6c qui les y forme ; on les repare enfuite avec des
ébauchoirs : c’eft l’ouvrage d’un fculpteur.
II s’agit maintenant d’exécuter la chape ou le fur-
tout : on fépare encore la planche du compas ; on
l’échancre en l’ébifelant jufqu’à la ligne oood parallèle
à la face extérieure de la cloche, 6c qui en eft
diftante de deux ou trois pouces, plus ou moins,
félon que l’on veut d’épaiffeur à la chape : la première
couche de la chape eft compofée de terre
bien tamifée, que l’on délaye avec de la bourre
très-fine ; on applique cet enduit fur tout le modèle
avec un pinceau, enforte qu’il en foit tout couvert ;
on laifi'e lécher cette couche d’elle-même, ou fans
feu : on en applique une fécondé, une troifieme,
jufqu’ à ce que l’épaiffeur de toutes ces couches ait
acquis deux lignes d’épaiffeur ; alors on applique un
ciment plus groflier, 6c qu’on laifi'e pareillement fé-
cher fans feu : on rallume enfuite du feu dans le
moule , qu’on augmente petit-à-petit jufqu’à ce qu’il
foit affez ardent pour fondre les cires, qui s’écoulent
par des égouts pratiqués au-bas de la chape, & qu’on
rebouche enfuite avec la terre.
Après que le feu qui eft dans le noyau eft éteint,
on remet le compas en place, 6c on achevé de donner
à la chape l’épaiffeur qu’elle doit avoir. Dans
les grandes cloches la chape eft fertie par des anneaux
de fer plat qui l’affermiffent : ces bandes ont quelques
crochets ou anneaux qui donnent prife pour
enlever la chape lorfqu’on en veut retirer le modèle
, qui occupe la place du métal dont la cloche doit
être formée. La chape ainfi achevée , on démonte
le compas, qui n’eft plus d’aucun ufage.
Il faut maintenant former le cerveau qui eft refté
ouvert au-haut du noyau du modèle & de la chape :
pour cet effet, on commence par terminer le noyau
avec les mêmes matières dont il a été conftruit,
qu’on difpofe félon là forme convenable au cerveau,
par le moyen d’une cerce profilée fur la courbe
A e ,^-interieure du cerveau ; on place en même
tems l’S ou anfe de fer qui doit porter le battant ;
on l’enterre dans la maçonnerie du cerveau , de maniéré
que la partie inférieure paffe au-dedans de la
cloche, 6c que la partie fupérieure foit prife dans
la fonte par le métal qui formera le pont. Voye^ la
figure première.
On forme enfuite avec de la cire 6c par le moyen
d’une cerce ou d’un compas fait exprès, dont le pivot
s’appuie fur le centre du noyau où l’on a fcellé
une petite crapaudine de fe r , qu’on ôtera dans la
fuite avec le compas, dont la planche eft profilée félon
b Q N ; on forme en cire le cerveau 6c l’onde qui le renforcit.
On modèle en cire les anfes au nombre de l ïx ,
placées comme on les voit fig. 4. a a,, font les deux
anfes latérales ; b b , les deux anfes antérieure 6c pof-
térieure; c , le pont ou le pilier plaçé au centre du
cerveau, fur lequel fe réunifient toutes les anfes'. On
voit fig. 5. les anfes en perfpe&ive.
Après avoir modelé & terminé en cire touteis ces
pièces, on les couvre avec le pinceau des mêmes'
couches de ciment qui ont fervi à couvrir la chape ,
obfervant que cette chape particulière des anfes ne
foit point adhérente à celle de la cloche■ Lorfqu’elle
eft finie, on l’enleve pour la faire recuire & en retirer
la cire, qui en fendant laiffe un vuide que le
métal doit remplir, pour former le cerveau 6c les
anfes de la cloche.
On a eu foin de ménager à la partie fupérieure de.
la chape des anfes & du pont plufieurs trous , entre
lefquels il y en a un au-deffus du pont, & qui fert
de jet pour le métal ; d’autres qui répondent aux anfes
6c qui fervent d’évent à l’air qui eft contenu dans
l’efpace laiflé vuide par les cires, 6c que le métal
fondu fait fortir en prenant leurs places.
Pour retirer le modèle de la cloche qui occupe l’e f pace
entre le noyau 6c la chape, on foûleve celle-
ci à force de bras, ou par le moyen d’un treuil placé
au-deffus de la foffe dans la charpente de l’atte-
lier ; on ôte le modèle, on remet la chape après l’avoir
enfumée avec de la paille qu’on brûle deffous ;
on ne la change point de place en la remettant ; on
obvie à cet inconvénient par des repaires. Sur la
chape de la cloche, on place celle des anfes qu’on a
repairée pareillement ; on lutte bien 6c ces deux chapes
enfemble, 6c la chape de la cloche avec la meule
qui foutient tout le moule qui eft alors entièrement
fini. Il ne refte plus qu’à recuire le ciment qui a fervi
à joindre fes pièces : pour cet effet, on le couvre
peu-à-peu de charbons allumés ; on pouffe le feu par
degrés : par ce moyen on évite des gerfures, qu’un
feu trop grand 6c trop v i f ne manqueroit pas d’oc-
cafionner.
On remplit enfuite la foffe de terre, qu’on corroie
fortement autour du moule, qui eft alors tout
difpofé à recevoir le métal fondu dans le fourneau.
Le fourneau T pour les cloches, eft le même que
celui de la fonderie des ftatues équeftres 6c des canons.
Eoye^-enla defeription à l'article Bronze. Il
n’y a de différence que dans la folidité qu’on donne
beaucoup plus grande au fourneau des ftatues équeftres.
Au lieu d’être de brique , il eft feulement de
terre corroyée.
Quant à la compofition métallique, la plus parfaite
eft dé trois parties de cuivre rouge, & d’une
partie d’étain fin. On ne met l’étain que quand le
cuivre eft en fufion, 6c qu’après avoir été épuré de
fes craffes, peu de tems avant que de couler le métal
dans le moule.
Le métal eft conduit par un canal de terre recuite
dans le godet placé au-deffus du moule, d’où il fe
répand dans tout le vuide qu’occupoit le modèle,
dont il prend exa&ement la forme. On le laiffe refroidir;
quand il eft à-peu-près ffroid, on déterre le
moule, on brife la chape, & la cloche paroît à découvert
; on l’enleve de la foffe par le moyen du
treuil, qui a fervi auparavant à enlever la chape ;
on la nettoie en-dedans 6c en-dehors ; on la bénit ;
on y attache le battant, 6c on la fufpend au mouton
qui lui eft deftiné.
La quantité de métal que l’on met au fourneau fe
réglé fur la groflèur de la cloche à fondre ; mais il en
faut avoir plus que moins, pour prévenir les pertes
accidentelles qui ont quelquefois fait manquer des
fontes confidérables. On ne rifque rien d’en fondre
un dixième de plus que le poids qu’on fe propofe^
de donner à la cloche.
La proportion de trois parties de cuivre fur une
d’étain n’eft pas fi bien démontrée la meilleure qu’on
ne puiffe s’en écarter. Il faut proportionnelle*
ment plus de cuivre dans les groffes cloches que dan9
les petites. C ’eft encore un problème à réfoudre ,
que le rapport qu’on doit inftituer entre les matières
du mélange félon là groffeur 6c la grandeur des
cloches i pour, qu’elles rendent le plus-de fon qu’il
eft poffible ; mais ce problème tenant à la nature
des matières , il n’y a pas d’apparence qu’On en trouv
e la folution par une autre voie que l’expérience :
les connoiffances de la Chimie , de la Mufique, 6c
de la Géométrie, ne peuvent équivaloir ici au tâ-
îônnèmenfi. Une queftion que la Géométrie éclairée
par les principes1 de la Mufique, réfoudroit peut-être
plus facilement, c’eft celle qu’on doit naturellement
faire fur le rapport que doit avoir le battant avec la’
cloche. La réglé des Fondeurs eft ici purement expérimentale
; leur pratique eft de donner un battant
plus léger aux groffes cloches, proportion gardée , '
qu’a ux petites : exemple , le battant d une cloche de •
5O0 livres, eft environ 25 livrés ; 6c celui d’une clo-
Ike de 1000 livres, eft un peu moins de 50 livres.
Le battant eft une maffe A 0 , terminée à fa partie
fupérieure par un anneau A , dans lequel eft 1 anneau
dormant de la cloche, où paffe un fort brayer de
cuir de cheval, arrêté par une forre boucle , de maniéré
que le brayer laiffe aü battant la liberté d’ofcil-
ler ; la partie B va frapper fur la pince C de la cloche ;
la partie 0 ne fert qu’à éloigner le centre de gravité
du battant du fommet A , qu’Ôn fait plus menue par
cette raifon. On l’ approche le plus qu’on peut du centre
de la poire B ; l’arc qüê décrit le cenire de grav
i t é , doit paffer par les pinces delà cloche, pour la
frapper avec le plus d’avantage qu’il eft poffible. *'
Le mouton auquel ôn fufpenc^la cloche, eft une
forte piece de bois E D C.C D É t fig.'jF.; dont ta di-
menfion D D eft égale à l’anîplitude de la cloche , 6c
la hauteur B C égalé au tiers de cette amplitude :
cette piece eft allégie aux extrémités par les courte
s C D ; les parties E , E , font de forts tourillons
de bois garnis d’une frette clefer ; l’epaiffeur du mpu-
ion.eft d’environ les deux tiers dé jà epuronhe : on
le créufe au milieu de fa partie inférieure en 0 5 6 5 0,
félon la courbe des anfes & du pont; les anfes & le
pont doivent être reçus exadement dans c^tte entaille.
Les extrémités A , A du mouton font deux tourillons
de fer , proportionnés au poids de la cloche ; ces
tourillons font le prolongement d une maffe de fer
A B , encaftrée dans une gravûre pratiquée à la partie
inférieure du mouton , 6c embraffée par la frette
qui entoure le tourillon E , fig. 67 La queue B eft
retenue dans la gravure par une barre de fer 1 qui
paffe en-travers fous le mouton, 6c eft fulpendue
par la bride 1 , 2 , 6c fpn oppofée à la partie p'ofté-
rieure qui lui eft fëmblâble' ; ces deux brides ,ôù anneaux
de figure parallélôgrammatique , prennent en-
deffous la barre de fer 1 , terminée à fes deux bouts
par des crochets qui ne permettent pas aux brides de
s’échapper; les bridés font retenues en- deffus par
une autre barre de fer ou de bois, qui a auffi fes crochets.
On les tend par le moyen de plufieurs coins
de fer plat, qu’on chaffe à coups de maffe entre la
piece de bois ou la barre.de fer, fur laquelle les brides
portent par en-haut.
Lorfque le mouton eft place dans le béfroi de la
tour ou du clocher pour lequel la cloche eft faite,
6c pofé par fes tourillons fur les cuvettes de cuivre
qui doivent le foûtenir, on y monte la cloche
par le moyen des machines ordinaires, le treuil ho-
rifontal, les poulies, les moufles, On prefente
les anfes dans l’entaille o 5 6 5 o, on pafle un fort boulon
de fer par le troll du pont appellé l’oeil, 6c par
les trous correfpondans du mouton ; alors la cloché
fe trouve comme fufpendue : on lui laiffe prendre fon
à-plomb ; mais comme ce boulon ne fuffiroit pas pour
la foûtenir long-tems, on paffe fous les anfes latérales
une barre de fer C , que l’on retient, à la partie
antérieure 6c poftérieure , par les brides C 4 , qui
paffent par en-haut fur une piece de bois ou de fer,
4 ; on ferre, ce§ brides avec des coins de fer ; on en
fait autant aux anfes antérieures 6c poftérieures ,
avec des brides mouflées , X 6. Les brides mouflées
font celles dont les extrémités inférieures font terminées
par des yeux, dans lefquels paffe un boulon
qui embraffe l’anfe ; elles font du refte arrêtées par
en-hâut comme les autres brides.
Cela fa it , on.place une barre de fer a a > fous les
anfes antérieures , 6c une autre lèmblable fous les
anfes poftérieures : ces barres font terminées par des
crochets qui retiennent les brides Amples a î , a 3 , 6c
leurs oppofées poftérieures femblables ; elles font
arrêtées deux à deux, l’antérieure 6c la poftérieure,
fur des pièces de bois 3,3 , fur lefquelles font couchées
des barres de fer terminées par des crochets
qui- font tournés verticalement, 6c qui.empêchent
ces brides de s’échapper; elles font auffi ferrées comme
toutes les autres par .des coins de fer. Les barres
de fer a , a , font fous les barres C C quipaffent fous
les anfes latérales , 6c qui font arrêtées par huit brides
a 3, a 3, C 4 , C 4 , 6c leurs oppofées à la partie
poftérieure du mouton.
Lorfque la cloche eft ainfi fixée dans le mouton, 6c
le mouton dans le béfroi , on arme la cloche de Ton
battant , comme nous avons dit plus haut , & on
adapte au mouton des leviers ou Amples , ou doubles
, ou quadruples , tels que ceux des groffes c/o-
ches dé Notre-Dame de Paris : ces levièrs font de
longues pièces de bois‘fixées en Y", Y , fig. 67 au-
deffous du mouton , où elles font fortement affujet-
tiès par les étriers doubles Y R D : elles ont depuis
le mouton jufqu’à leurs extrémités a , figure 7 . où
pehd la corde a b à - peu - près de longueur, le diamètre
de la cloche ; pour leur donner de la fermeté,
, On les bride par des liens de fer a A , fixés d’un bout
à leurs extrémités , & de l’autre au haut du mouton ;
6c pour conlerver leur parallélifme, on joint celles
d’un côté du mouron à celles de l’autre , par des tra-
verfes 6c des croix de S. André; comme on voit fig.
8. où l’on a repréfenté le plan du béfroi, des cloches ,
6c des leviers.
Il y à pour les petites cloches une autre forte de
levier, qu’on voit figure g . Il eft compofé' de trois
pièces , dont deux A E , B C , font droites ; &
la troifieme eft un quart de cercle centré du tourillon
, & fait en gouttière fur fa partie convexe ;
la corde eft reçue dans cette gouttière , lorfqu’on
met la cloche à volee : le quart de Cercle eft auflï
tenu par la barre de fer E e , fixée d’un bout au haut
de ce quart de cercle ; 6c de l’autre bout au haut du
mouton.
Le béfroi dans lequel on place les cloches, eft une
cage de charpente , de figure pyramidale quarree 6c
tronquée, ou un peu plus étroite à fa partie fupérieure
qu’à fa bafe , & placée dans l’intérieur de
la tour : on l’a faite plus étroite par en-haut, afin
qu’elle ne touchât point les parois de la tour, 6c
qu’elle cédât à l’aftion de la cloche, quand pn l’a mile
à volée. ; ;>• . , ; r - , , .
On trouvera à l’explication de nos planches , le
détail des pièces au béfroi qu’on voit Planche de Fonderie
des cloches , fig. y. .
C lo ch e , ( Jurifpr. ) Quoique les cloches loient
déjà bénites, le fondeur qui en a fourni le métal