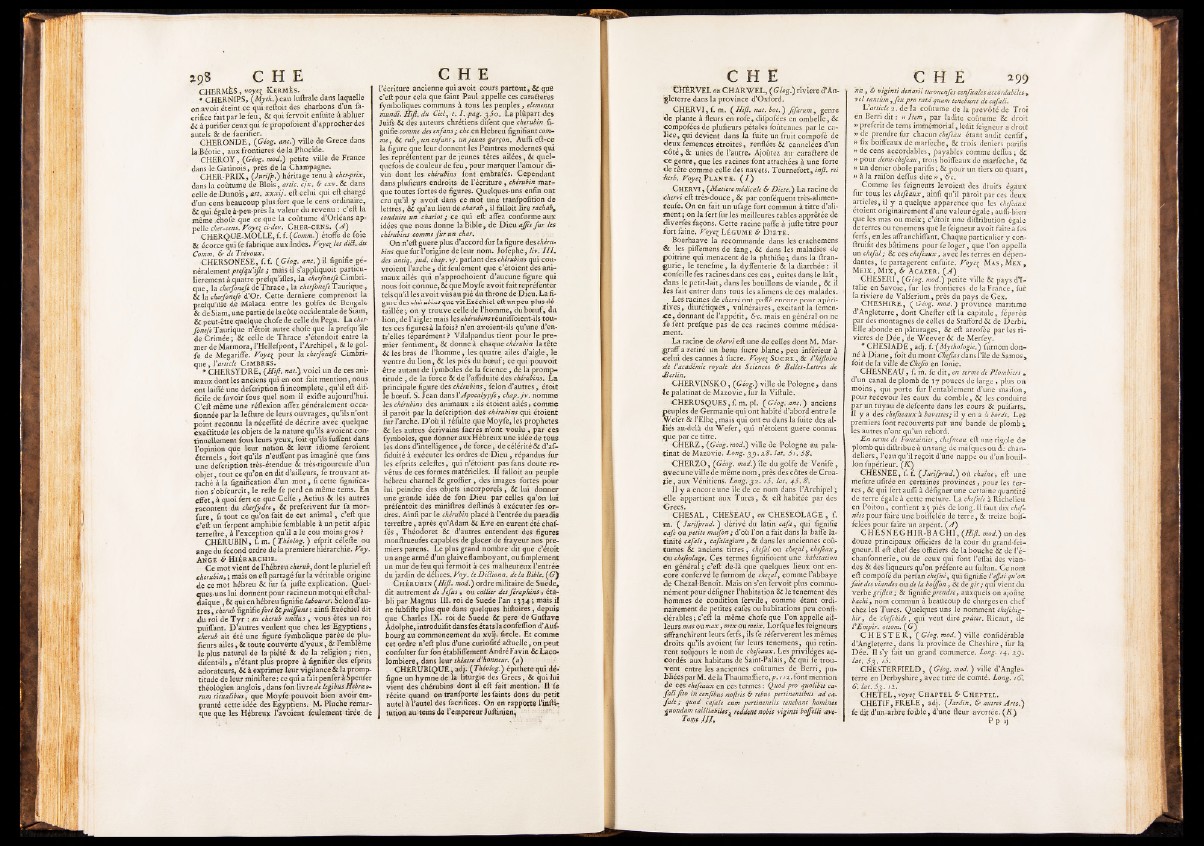
. GHERMÈS., voy.‘ t K e r m è s . '
* CHERNIPS, (IWyrA.)eau luftrale dans laquelle
on avoir éteint ce qui reftoit des charbons d’un fa-
crifice fait par le feu, & qui fervoit enfuite à abluer
& à purifier ceux qui fe propofoient d’approcher des
autels & de facrifier. ,
CHERONDE, {Géog. anc.') ville.de Grece dans
laBéotie, aux frontières delaPhocide.
CHERO Y , {Géog. mod.) petite ville de France
dans le Gatinois, près de la Champagne.
CHER-PRIX, (Jurifp.) héritage tenu à cher-prix,
dans la coûtume de Blois, artic. c jx .& cxv. & dans
celle de Dunois, art. x x x ij. eft celui qui eft chargé
d’un cens beaucoup plus fort que le cens ordinaire,
& qui. égale à-peu-près la valeur du revenu : c’eft la
même .chofe que ce.que la coutume d Orléans appelle
cher-cens. Voyei ci-dev. CtiER-CENS. {A)
CHiERQUE-MOLLE, f. f. {Comm.) étoffe de foie
& écorce qui 1e fabrique auxlndes. Voye{ les dut, du
Comm. & de Trévoux.
CHERSONESE, f .f . {Géog. anc.) il lignifie g é néralement
prefqu'ijle $ mais i l s.appliquoit particulièrement
à,quatre prefqu’ifles, la cherfonefe Cimbri-
que, la cherfonefe de'Thrace, la cherfonefeTauricpe,
& la cherfonefe d’Or. Cette derniere comprenoit la
prefqu’ifle de Malaca entre les golfes de Bengale
& deSiam,une partie de laeôte occidentale de Siam,
& peut-être quelque chofe de celle du Pegu. La cher-
fonefe Taurique n’étoit autre chofe que laprefqu’île
de Crimée ; & celle de Thrace s’étendoit entre la
mer de Marmora, l’Hellefpont, l’Archipel, & le golfe
de Megariffe. Voye^ pour la cherfonefe Cimbri-
qu e , 1’'article ÇiMBRES.
* CHERSYDRE, (Hijl. nat.) voici un de ces animaux
dont les anciens qui en ont fait mention, nous
ont laifle une defcription lï incomplète, qu’il eft difficile
de /avoir fous quel nom il exifte aujourd’hui.
C ’eft même une réflexion aflëz généralement o.cca-
fionnée par la lefture de leurs ouvrages, qu’ils n’ont
point reconnu la néceflité de décrire avec quelque
exaûitude les objets de la nature qu’ils avoient continuellement
fous leurs yeux, foit qu’ils fuffent dans
l ’opinion que leur nation & leur idiome feroient
éternels , foit qu’ils n’euffent pas imaginé que fans
une defcription très-étendue & très-rigoureufe d’un
objet, tout ce qu’on en dit d’ailleurs, le trouvant attaché
A la lignification d’un mot, fi cette fignifica-
tion s’obfcurcit, le refte fe perd en même tems. En
effet, à quoi fert ce que Çelfe , Aetius & les autres
racontent du cherfydre, 6c prefcrivent fur fa mor-
fure fi tout ce qu’on fait de cet animal, c’eft que
c’eft’un ferpent amphibie femblable à un petit afpic
terreftre, à l’exception qu’il a le cou moins gros ?
CHÉRUBIN, f. m. ( Théolog. ) efprit célefte ou
ange du fécond ordre de la première hiérarchie. Voy.
Ange & Hiérarchie.
Ce mot vient de l’hébreu cherub, dont le pluriel eft
chérubin, ; mais on eft partagé fur la véritable origine
de ce mot hébreu 6c fur fa jnfte explication. Quelques
uns lui donnent pour racine un mot qui eft chal-
daïque , 8c qui en hébreu lignifie labourer. Selon d’autres
, cherub lignifie/or/ 8c puiffant : ainfi Ezéchiel dit
du roi de T y r : tu cherub unctus , vous êtes un roi
puiffant. D ’autres veulent que chez les Egyptiens,
cherub ait été une figure fymbolique parée de plu-
fieurs ailes, & toute couverte d’y eux , & l’emblème
le plus naturel de la piété & de la religion ; rien,
difent-ils, n’étant plus propre à lignifier des efprits
adorateurs, & à exprimer leur vigilance & la promptitude
de leur miniuere : ce qui a fait penfer à Spenfer
théologien anglois, dans fon l i v r e t legibusHebrao-
rum ritualibus, que Moyfe pouvoit bien avoir emprunté
cette idée des Egyptiens. M- Pluche remarque
que les Hébreu* l’avoieat feulement tirée de
l’écriture ancienne qui avoit cours partout, 8c que
c’eft pour cela que faint Paul appelle ces caraéteres
fymboliques communs à tous les peuples., elementct
mundi. Hijl. du Ciel, 1 .1. pag. g 5o. La plûpart des
Juifs 8c des auteurs chrétiens difent que chérubin lignifie
comme des enfans; cke enHebreu lignifiant comme,
ÔC rub , un enfant, un jeune garçon. Aufli eft-ce
la. figure que leur donnent les Peintres modernes qui
les repréfontent par de jeunes têtes ailées, & quelquefois
de couleur de feu, pour marquer l’amour divin
dont les chérubins font embrafés. Cependant
dans plufieurs endroits de l’écriture , chérubin marque
toutes fortes de figures. Quelques-uns enfin ont
cru qu’il y avoit dans ce mot une tranfpofition de
lettres, 8c qu’au lieu de charab ,.il falloit lire rachàb^
conduire un chariotg ce qui eft alfez conforme aux
idées que nous donne la B ible, de Dieu ajjis fur les
chérubins comme fur un char.
On n’eft guere plus d’accord fur la figure des chérubins
que fur l’origine de leur nom. Jofephe, liv. 1 1 1 .
des antiq. jud. chap. vj. parlant des chérubins qui cou-
vroient l’arche , dit feulement que c ’étoient des animaux
ailés qui n’approchoient d’aucune figure qui
nous foit connue, 8c que Moyfe avoit fait repréfenter
tels qu’il les avoit vus au pié du throne de Dieu. La figure
des chérubins que vit Ezéchiel eft un peu plus détaillée;
on y trouve celle de l’homme, du boeuf, du
lion, de l’aigle: mais les chérubins réuniffoient-ils toutes
ces figures à la fois? n’en avoient-ils qu’une d’en-
tr’elles féparément ? Vilalparidus tient pour le premier
fentiment, 8c donne à chaque chérubin la tête
& les bras de l’homme, les quatre ailes d’aigle, le
ventre du b on, 8c les piés du boeuf ; ce qui pouvoit
être autant de fymboles de la fcience, de la promptitude
, de la force & de l’afliduité des chérubins. La
principale figure des chérubins, félon d’autres, étoit
le boeuf. S. Jean dans VApocalypfe, chap.jv. nomme
les chérubins des animaux : ils étoient ailés, comme
il paroît par la defcription des chérubins qui étoient
fur l’arche. D ’où il réfulte que Moyfe, les prophètes
& les autres écrivains facrés n’ont voulu , par ces
fymboles, que donner aux Hébreux une idée de tous
les dons d’intelligence, de force, de célérité 8c d’af-
fiduité à exécuter les ordres de D ie u , répandus fur
les efprits celeftes, qui n’étoient pas fans doute revêtus
de ces formes matérielles. Il falloit au peuple
hébreu charnel 8c groflier, des images fortes pour
lui peindre des objets incorporels, & lui donner
une grande idée de fon Dieu par celles qu’on lui
préfentoit des miniftres deftinés à exécuter fes ordres.
Ainfi par le chérubin placé à l’entrée du paradis
terreftre, après qu’Adam 8c Eve en eurent été chaf-
f é s , Théodoret 6c d’autres entendent des figures
| monftrueufes capables de glacer de frayeur nos premiers
parens. Le plus grand nombre dit que c’étoit
un ange armé d’un glaive flamboyant, ou Amplement
un mur de feu qui rermoit à ces malheureux L’entrée
du jardin de délices. Voy. le Diclionn. de la Bible. (GJ
C hérubin ( Hijl. mod.') ordre militaire de Suède,
dit autrement de Jefus, ou- collier des féraphins 9 éfà-
bli par Magnus III. roi de Suede l’an 1334 ; mais il
ne lubfifte plus que dans quelques hiftoires, depuis
que Charles IX. roi de Suede 8c pere de Guftave
Adolphe, introduifit dans fes états la confeflîon d’Auf-
bourg au commencement du xvij. fiecie. Et comme
cet ordre n’eft plus d’une curiofité aâuelle, on peut
confulter fur fon établiflement André Favin 6c Laco-
lombiere, dans leur théâtre d ’honneur, (a)
CHÉRUBIQUE, adj. {Théolog.) épirhete qui dé-
figne un hymne de la liturgie des Grecs, & qui lui
vient des chérubins dont il eft fait mention. U fe
récite quand on tranfporté les faints dons du petit
autel à l’autel des facrifices. On en rapporte l’infti-
tutjon au tems de l’empereur Juftinjen,
CkÈRVÈL ou CHARWEL, {Géog.) riviere d’Ân-
'gléterre dans la province d’Oxford.
CHERVI, f. m. ( Hift. nat. bot..) Jifarum, genre
de plante à fleurs en rofe, difpofées en ombelle, 6c
compofées de plufieurs pétales foûtenues par le calice
, qui devient dans la fuite un fruit compofé de
•deux iemences étroites, renflées ôc cannelées d’un
« ô té , 6c unies de l’autre. Ajoutez au- caraftere de
ce genre, que les racines font attachées à une forte
de tête comme celle des navets. Tournefort, injl. rèi
■ herb. Voye{ Pl àNTE. ( /.)
C herv ï , {Matière médicale & Diete.) La racine de
fhervi eft très-douce, 6c par conféquent très-alimen-
teufe. On en fait un ufage fort commun à titre d’aliment
; on la fert furies meilleures tables apprêtée de
diverfes façons. Cette racine paffe à jufte titre pour
fort faine. Voyc^ L égume & D ie t e .
Boerhaave la recommande dans les crachemens
■ 6c les piffemens de fang , 6c dans les maladies de
poitrine qui menacent de la phthifie ; dans la ftran-
gurie, le tenefme, la dyffenterie 8c la diarrhée : il
confeillc fes racines dans ces cas, cuites dans le lait,
dans le petit-lait, dans les bouillons de viande, 6c il
les fait entrer dans tous les alimens de ces malades.
Les racines de chervi ont paffé encore pour apéri-
f iv e s , diurétiques, vulnéraires, excitanb la femen-
c e , donnant de l’appétit, &c. mais en général on ne
f e fert prefque pas de ces racines comme médicament.
La racine de chervi eft une de celles dont M. Mar-
jgraff a retiré un beau fucre blanc, peu inférieur à
celui des cannes à fucre. Voye{ Sucre , & l'hifioire
.de l'académie royale des Sciences & Belles-Lettres de
•Berlin,
CHERVINSKO, {Géog.) ville de Pologne, dans
le palatinat de Mazovie, fur la Viftule.
CHERUSQUES, f. m. pl. ( Géog. anc. ) anciens
peuples de Germanie qui ont habité d’abord entre le
^Wèfer 8c l’Elbe , mais qui ont eu dans la fuite des alliés
au-delà du W efer, qui «’étoient guere connus
que par ce titre.
CHERZ, {Géog. mod.) ville de Pologne au pa-la-
tinat de Mazovie. Long. 3 g . 2.8. lat. 5-r. 6S\
CHERZO, {Géog. mod.) île du gôlfe de Venife,
ôvec une ville de même nom, près des côtes de Croat
ie , aux Vénitiens. L o n g e z . iS. lat. 46. 8.
Il y a encore une île de ce nom dans l’Archipel \
elle appartient aux Turcs, 8c eft habitée par des
Grecs.
CHESAL, CHENEAU, où CHËSÉOLAGE , f.
m. ( Jurifprud. ) dérivé du latin cafa, qui lignifie
café ou petite maifon ; d’où Fon a fait dans la baffe latinité
cafale , cafalagium , 8c dans les anciennes coû-
tumes & anciens titres, chefal oü cheçàl, chefeau,
Ou chefeolage. Ces termes fignifioient une habitation
en général; c’eft de-là que quelques lieux ont encore
confervé le furnorn de chenal, cbmme l’abbaye
de Chezal-Benoît. Mais on s’en fervoit plus communément
pour défigner l’habitation & le tenement des
hommes de condition fer v ile , comme étant ordinairement
de petites cafés ou habitations peu confi-
dérables ; c’eft la même chofe que l’on appelle ailleurs
mas ou max, mex ou meix. Lorfque les lèigneufs
affranchirent leurs ferfs, ils fe réferverent les mêmes
droits qu'ils avoient fur leurs tenemens, qui retinrent
toûjours le nom de chefeaux. Les privilèges accordés
aux habitans de Saint-Palais, & qui fe trouvent
entre les anciennes coûtumes de Berri, publiées
par M. delaThaumafliere,/». / i z .font mention
de ces chefeaux en ces termes : Quodpro quolibet ca-
fali fito in cenfibus noßris & rebus pertinentibùs ad cafale
; quod cafale cum pertinent iis tenebant homines
ÿuondam tailliabilcs'i rçddwt nçbis yiginti boffelli ave-
Torpf l j f p
hie y & vigimi deriarii turonèhfes ccnfuahs accordabiles ,
vel tantum , feu pro rata, quant tenebunt de cafali.
L article z . de la Coutume de la prévôté de Troi
en Berri dit : « Item, par ladite coûtume & droit
» prefcrit de te'ms immémorial, ledit feigneur a droit
» dé prendre fur chacun éhefeàu étant audit cenfif,
>> fix boiffeaüx dé marfeche, & trois deniers parifis
»de cens accordables, payables cômme deffus; &
» pour demi-chefeau, trois boiffeaüx de màffechc, 6c
» un denier obole parifis ; & pôur un tiers ou quart,
» à la raifon deffus dite » , '&c.
Comme les feignéurs le voient des droits égàuX
fur tous les chefeaux, ainfi qu’il pàroît pat ces deux
articles,il y a quèlq'ïie apparence que les chefeaux
étoient originairement d’une valeur égalé, auffi-bien
que lés mas Ou meix; c’étoit une diftributiôn égale
de terres ou ténemens què 'le feigneur avoit faite à fes
ferfs, en les affranchiffant. Chaque particulier y con-
ftruifit des bâtimens pour fe loger, que l’on âppellà
un chefal; 8c ces chefeaux, avec les teïrès èn dépendantes,
fe partagèrent enfuite. Voye1 Ma s , Me x ,
Meix , Mix , & A cà zer . { A )
CHESERI, {Géog. mod.) petite ville & pays d’Italie
en Savoie, fur les frontières de la France, fut
la riviere de Valferium, près du pays de Gex.
CHESHIRE, {Géog, mod.) province maritime
d’Angleterre, dont Chefter eft la capitale, féparée
par des montagnes de celles de Stafford & de Derbi.
Elle abonde en pâturages, & eft arrofée par les rivières
de D é e , de Weever & de Merfey.
* CHESIADE, adj. f. '{Mythologie.) furnorn donné
à D iane, foit du m’ont Chef as dans n ie de Samos,
foit de la ville As Chefio en Ionie-.
CHESNEAU, f. m. fe dit , en terme de Plbmbiers ,
d’un canal de plomb de 17 pouces de large , plus où
moins, qui porte fur l’entablement d’une maifon,
pour recevoir les eaux du comble, & les conduire
par un tuyau dè defeente dans les cours 8c puifarts-
II y a des ckefneaux à bavettes; il y en a à bords. Les
premiers font recouverts par une bande de plomb ;
les autres n’ont qu’un rebord.
En terme de Fontainier, chefneau eft une rigole dé
plomb qui diftribue à un rang de màfques ou ae chandeliers,
l’eau qu’il reçoit d’une nappe ou d’un bouillon
fupéfieur. {K)
CHESNÉE, f. f. {jurifprud.) où chaîne y eft une
mefure ufiréê ên certaines provinces, pour les terres
, & qui fert aufli à défigner une certaine quantité
de terre égale à cette mefure. La thefnée à Richelieu
en Poitou, contient ï j piés de long. Il faut dix chej-
nées pour fairé une boiffèlée de terre, 8c treize boif-
felées pour faire un arpent. {A)
CH E SN E G H IR -B A G H I , { É i f mod.) un des
douze principaux officiers de la cour du grand-fei-
gnèur. Il eft chef des officiels de la bouche & de l’é-
chanfonnerie, ou dé ceux qui font l’effai des viandes
8c des liqueurs qu’on prefente au fultan. Ce nom
eft compôfé du perfan chef né P qui fignifie l'tfjai qu'on
fait des viandes ou de la boiffon , 8c de gir ; qüi vient du
Verbe grijlen ; 8c fignifie prendre, auxquels on ajoûte
■ bàchiy nom commun à beaucoup de charges en chef
chez les Turcs. Quelques-uns le nomment chefchig-
hir y de chèfch'ide, qui veut dire goûter. Ricaut, dè
VEmpir. ottom. (G)
C H E S T E R , ( Géog. mod. ) ville c’onfidérablè
d’Angleterre, dans la province dè Cheshire, fur la
Dée. Il s’y fait un grand Commercé. Long. 14. zcj\
la t . j j . t -Sl
CHESTERFIELD, {Géog. mûd.) ville d’Angleterre
en Derbyshire, avec titre de comté. Long. rC\
C. lat. 5g. /i.
CHETEL, voyei C hapTel & «CAeptel.
CHETIF, FRELE, adj. {Jardin. & autres A rts.)
fe dit d’un.arbre foible, 4’une fleur avortée. {K )
p P ij