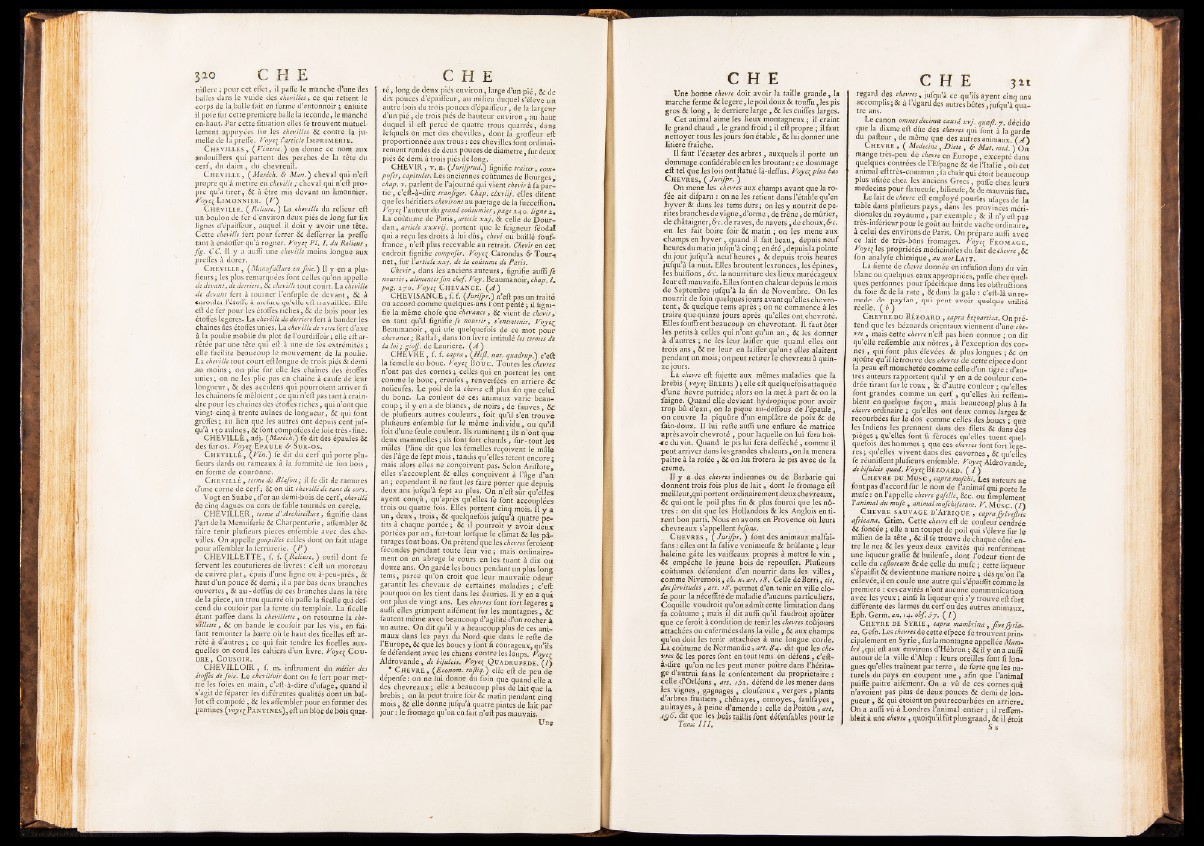
niftere ; pour cet effet, il paffe le manche d’une des
balles dans le vuide des chevilles, ce qui retient le
-corps de la.balle fait en forme d’entonnoir ; enliiite
il pôle fur cette première balle la leconde, le manche
. en-haut. -Par cette fituation elles fe trouvent mutuellement
appuyées fur les chevilles 8c contre la jumelle
de lapreffe. Voye^ Carticle Imprimerie.
C hev illes, ( Vénerie. ) on donne ce nom aux
andouillers qui partent des perches de la tête du
ce rf, du daim, du chevreuil.
C h e v il l e , ( Maréch. & Man. ) cheval qui n’eft
propre qu’à mettre en cheville ; cheval qui n’eft propre
qu’à tirer, 8c à être mis devant un limonnier.
-Voyc^ L imonnier. {V )
C hev ille. ( Reliure. ) La cheville du relieur eft
un boulon de fer d’environ deux piés de long fur fix
lignes d’épaifleur, auquel il doit y avoir une tête.
Cette cheville fert pour ferrer 8c defferrer la preffe
tant à endoffer qu’à rogner. Voye{ PL. I. du Relieur ,
fig. CC. Il y a aufti une cheville moins longue aux
preffes à dorer.
C heville , (Manufacture en foie.') Il y en a plu-
fieurs ; les plus remarquées font celles qu’on appelle
de devant, de derrière, & cheville tout court. La cheville
-de devant fert à tourner l’enfuple de devant, 8c à
enrouler l’étoffe à mefure qu’elle eft travaillée. Elle
eft de fer pour les étoffes riches, 8c de bois pour les
étoffes legeres. La cheville de derrière fert à bander les
chaînes des étoffes unies. La cheville de verre fert d’axe
à la poulie mobile du plot de l’ourdiffoir ; elle eft arrêtée
par une tête qui eft à une de fes extrémités ;
elle facilite beaucoup le mouvement de la poulie.
La cheville tout court eft longue de trois piés & demi
£11 moins ; on plie fur elle les chaînes des étoffes
unies ; on ne les plie pas en chaîne à caufe de leur
longueur, & des accidens qui pourroient arriver fi
les chaînons fe mêloient ; ce qui n’eft pas tant à craindre
pour les chaînes des étoffes riches, qui n’ont que
vingt- cinq à trente aulnes de longueur, 8c qui font
groffes ; au lieu que les autres ont depuis cent jufqu’à
150 aulnes, 8c font compofées de foie très - fine.
CHEVILLÉ, adj. {Maréch.) fe dit des épaules 8c
des fur-os. Voye^ Epaule & Sur-os.
C h e v il l é , {Vend) fe dit du cerf qui porte plu-
fieurs dards ou rameaux à la fommité de fon bois,
en forme de couronne.
C hevillé , terme de Blafon; il fe dit de ramures
d’une corne de ce rf; 8c on dit chevillé de tant de cors.
Vogt en Suabe, d’or au demi-bois de cerf, chevillé
de cinq dagues ou cors de fable tournés en cercle.
CHEVILLER) terme d'Architecture , lignifie dans
l’art de la Menuiferie & Charpenterie, affembler &
faire tenir plufieurs pièces enfemble av.ee des chevilles.
On appelle goupilles celles dont on fait ul'age
pour affembler la ferrurerie. {P )
CHEVILLETTE, f. f. {Reliure. ) outil dont fe
fervent les couturières de livres : c’eft un morceau
de cuivre plat, épais d’une ligne ou à-peu-près, &
haut d’un pouce 8c demi ; il a par bas deux branches
-ouvertes, & au - deflus de ces branches dans la tête
de la piece, un trou quarré oii paffe la ficelle qui def-
cend du coufoir par la fente du temploir. La ficelle
étant paffée dans la chevillette, on retourne la che-
villette, 8c on bande le coufoir par les vis,.en fai-
fant remonter la barre oii le haut des ficelles eft arrêté
à d’autres ; ce qui fait tendre les ficelles auxquelles
on coud les cahiers d’un livre. Voye^ C oudre
, C ousoir.
CHEVILLOIR , f. m. infiniment du métier des
étoffes de foie. Le chevilloir dont on fe fert pour mettre
les foies en main, c’eft-à-dire d’ufage, quand il
s’agit de féparer les différentes qualités dont un ballot
eft compofé, 8c les affembler pour en former des
pantines {voye^ Pantines), eft un bloc de bois quarr
é , long de deux piés environ, large d’un pré, 8c de
dix pouces d’épaiflèur, 311 milieu duquel s’élève un
autre bois de trois pouces d’.épaifléur, de la largeur
d’un pié , de trois piés de hauteur environ, au haiit
duquel il eft percé de quatre trous quarrés, dans
lefquels on met des chevilles, dont la groffeur eft
proportionnée aux trous : ces chevilles font ordinairement
rondes de deux pouces de diamètre, fur deux
piés & demi à trois piés de long.
CHEVIR, v . n. {Jurifprudd) lignifie traiter -, com-
pofer, capituler. Les anciennes coutumes de Bourges 1
chap. v. parlent de l’ajourné qui vient chevir à fa partie
, c’eft-à-dire tranfiger. Chap. clxviij. elles difent
que les héritiers cheviront au partage de la fucceffion.
V?ye{ l’auteur du grand coutumier , page 240. ligne z i
La coutume de Paris, article x x j. & celle de Dour-
dan, article xxxvij. portent que le feigneur féodal
qui a reçu les droits à lui dûs, chevi ou baillé fouf-
france, n’eft plus recevable au retrait. Chevir en cet
endroit fignifie compofer. Voye[ Carondas & Tour«*
net, fur l’article ; xxj.. de la coutume de Paris.
Chevir, dans les anciens auteurs, fignifie auffi Je
nourrir, alimenter fon chef. V>y. Beaumanoir, chap. /.
pag. 2 y o. Voye1 C h E VAN CE. {A )
CHEVISANCE, f. f. {Jurifpr.) n’eft pas un traité
ou accord comme quelques-uns l’ont penfé ; il lignifie
la même chofe que chevance, 8c vient de chevir d
en tant qu’il fignifie fe nourrir, s'entretenir. Voye%_
Beaumanoir, qui ufe quelquefois de ce mot pour
chevance; Raftal, dans fon livre intitulé les termes de
la loi; gloff. de Lauriere. {A )
CHEVRE, f. f. capra, {Hifi. nat. quadrup.) c’eft
la femelle du bouc. Voye{ B o u c . Toutes les chevres
n’ont pas des cornes ; celles qui en portent les ont
comme le bouc, creufes , renverfées en arriéré 8c
noiieufes. Le poil de la chevi e eft plus fin que celui
du bouc. ; La couleur de ces animaux varie beaucoup
; il y en a de blancs, de noirs, de fauves, 8c
de plufieurs autres couleurs, foit qu’il s’en trouve
plufieurs enfemble fur le même individu, ou qu’il
foit d’une feule couleur. Ils ruminent ; ils n’ont que
deux mammelles ; ils font fort chauds, fur - tout les
mâles Pline dit que les femelles reçoivent le mâle
dès l’âge de fept m ois, tandis qu’elles tetent encore ;
mais alors elles ne conçoivent pas. Selon Ariftote,
elles s’accouplent & elles conçoivent à l’âge d’un
an ; cependant il ne faut les faire porter que depuis
deux ans jufqu’à fept au plus. On n’eft sûr qu’elles
ayent conçû, qu’après qu’elles fe font accouplées
trois ou quatre fois. Elles portent cinq mois. Il y a
un, deux, trois, 8c quelquefois jufqu’à quatre petits
à chaque portée ; 8c il pourroit y avoir deux
portées par an , fur-tout lorfque le climat 8c les pâturages
font bons. On prétend que les chevres feraient
fécondes pendant toute leur vie ; mais ordinairement
on en abrégé le cours en les tuant à dix on
douze ans. On garde les boucs pendant un plus long
tems, parce qu’on croit que leur mauvaife odeur
garantit les chevaux de certaines maladies ; c’eft:
pourquoi on les tient dans les écuries. Il y en a qui
ont plus de vingt ans. Les chevres font fort legeres 5
auffi elles grimpent aifément fur les montagnes, 8c
fautent même avec beaucoup d’agilité d’un rocher à
un autre. On dit qu’il y a beaucoup plus de ces animaux
dans les pays du Nord que dans le refte de
l’Europe, & que les boucs y font fi courageux, qu’ils
fe défendent avec les chiens contre les loups. Voyeç
Aldrovande, de bijulcis. Voye{ Q uadrupède. { !)
* C hevre , {Econom. rufliq.) elle eft de peu de
dépenfe : on ne lui donne du foin que quand elle a
des chevreaux ; elle a beaucoup plus de lait que la
brebis ; on la peut traire foir & matin pendant cinq
mois, & elle donne jufqu’à quatre pintes de lait par
jour : le fromage qu’on en fait n’eft pas mauvais.
Une
Unè bonne chevre doit avoir la taille grande, la
marche ferme 8c legere, le poil doux & touffu, les pis
gros & long , le derrière large , 8c les cuiffes larges.
Cet animal aime les lieux montagneux ; il craint
le grand chaud , le grand froid ; il eft propre ; il faut
nettoyer tous les jours fon étable, 8c lui donner une
litiere fraîche.
Il faut l’écarter des arbres , auxquels il porte un
dommage confidérable en les broutant: ce dommage
eft tel que.les lois ont ftatué là-deffus. Voye^plus bas
C h e v r e s , ( Jurifpr. )
On mène les chevres aux champs avant que la ro-
fée ait difparu : on ne les retient dans l’étable qu’en
hyver & dans les tems durs ; on les y nourrit de petites
branches de vigne, d’orme, de frêne, de mûrier,
de châtaigner,6*c. de raves, de navets, de choux,&c.
on les fait boire foir 8c matin ; on les mene aux
champs en hyver , quand il fait beau, depuis neuf
heures du matin jufqu’à cinq ; en é té, depuisla pointe
du jour jufqu’à neuf heures , & depuis trois heures
jufqu’à la nuit. Elles broutent les ronces, les épines ,
les buifions, &c. la nourriture des lieux marécageux
leur eft mauvaife. Elles font en chaleur depuis le mois
de Septembre jufqu’à la fin de Novembre. On les
nourrit de foin quelques jours avant qu’elles chevrotent
, & quelque tems après ; on ne commence à les
traire que quinze jours après qu’elles ont,chevroté.
Elles fouffrent beaucoup en chevrotant. Il faut ôter
les petits à celles qui n’ont qu’un an , & les donner
à d’autres ; ne les leur laiffer que quand elles ont
trois ans , 8c ne leur en laiffer qu’un : elles alaitent
pendant un mois; onpeut retirer le chevreau à quinze
jours.
La chevre eft fujette aux mêmes maladies que la
brebis ( voye{ Brebis ) ; elle eft quelquefois attaquée
d ’une fievre putride ; alors on la met à part & on la
faigne. Quand elle devient hydropique pour avoir
trop bû d’eau , on la pique au-deffous de l’épaule,
on couvre la piquûre d’un emplâtre de poix 8c de
fain-doux. Il lui refte auffi une enflure de matrice
après avoir chevroté , pour laquelle on lui fera boi-
•ce du vin. Quand le pis lui fera defféçhé , comme il
peut arriver dans les grandes chaleurs ,on la mènera
paître à la rofée , 8c on lui frotera le pis avec de la
ereme. .
Il y a des chevres indiennes ou de Barbarie qui
donnent trois fois plus de la it , dont le. fromage eft
meilleur,qui portent ordinairement deux chevreaux,
8c qui ont le poil plus fin & plus fourni que les nôtres
: on dit que les Hollandois & les Angfois en tirent
bon parti. Nous en ayons en Provence oii leurs
chevreaux s’appellent befons.
C hevres , ( Jurifpr. ) font des animaux malfai-
fans : elles, ont la falive venimeufe & brûlante ; leur
haleine gâte les vaiffeaux propres à mettre le vin ,
8c empêche le jeune bois de repouffer. Plufieurs
çoûtumes défendent d’en nourrir dans les villes,
comme Nivernois, ch. x.art. 18. Celle deBerri, tit.
desfervitudes, art. 18. permet d’en tenir en ville clo-
fe pour la néceffité de maladie d’aucuns particuliers.
Coquille voudrait qu’on admît cette limitation dans
fa coûtume ; mais il dit auffi qu’il faudrait ajoûter
que ce ferait à condition de tenir les chevres toujours
attachées pu enfermées dans la v ille , 8c aux champs
qu’on doit les tenir attachées à une longue corde.
La coûtume de Normandie, art. 84. dit que Içs chèvres
8c les porcs font en tout tems en dérens , c’eft-
à-dire qu’on ne les peut mener paître dans l’héritage
d’autrui fans le confentement du proprietaire :
celle d’Orléans , art. iàz. défend de les mener dans
les vignes, gagnages , cloufeaux, vergers , plants
d’arbres fruitiers , chênayes, ormoyes, faulfayes ,
aulnayes, à peine d’amende : celle de Poitou , art.
*$6. que les bois taillis font défenfables pour le ;
Tome I I I ,
regard des chevres, jufqu’à ce qu’ils ayent cinq ans
accomplis ; & à l’égard des autres bêtes, jufqu’à quatre
ans. ^
Le canon omnes decimtt causa xvj. quoefl. y . décide
que la dixme eft dûe des chevres qui font à la garde
du pafteur , de même que des autres animaux ( ,4 )
C hevre , ( Médecine , Dicte , & Mat. med. ) On
mange très-peu de chevre en Europe, excepté dans
quelques contrées de l’Efpagne 8c de l’Italie , oii cet
animal eft très-commun ; fa chair qui étoit beaucoup
plus ufitee chez les anciens Grecs, paffe chez leurs
médecins pouf flatueufe, bilieufe, & de mauvais fuc.
Le lait de chevre eft employé pourles ufages de la
table dans plufieurs pa ys, dans les provinces méridionales
du royaume, par exemple ; & il n’y eft pas
très-inférieur pour le goût au lait de vache ordinaire,
à celui des environs de Paris. On prépare auffi avec
ce lait de très-bons fromages. Voye{ Fr om a g e .
Voyei les propriétés médicinales du lait de chevre, 8c
fon analyfe chimique, au mot L a i t .
La fiente de chevre donnée en infufion dans du vin
blanc ou quelques eaux appropriées, paffe chez quel*
ques perfonnes pour fpécifique dans les obftru&ions
du foie 8c de la rate , & dans la gale : c’eft-Ià un re-
mede de payfan, qui peut avoir quelque utilité
réelle. ( b )
C hevre du Bezo ard , capra be^oartica. On prétend
que les bézoards orientaux viennent d’une chevre
, mais cette chevre n’eft pas bien connue ; on dit
qu’elle refl'emble aux nôtres, à l’exception des cornes
, qui font plus élevées & plus longues ; 8c on
ajoute qu’il fe trouve des chevres de cette efpece donc
la peau eft mouchetée comme celle d’un tigre ; d’autres
auteurs rapportent qu’il y en a de couleur cendrée
tirant fur le roux , & d’autre couleur ; qu’elles
font grandes comme un cerf , qu’ elles 2ui reffem-
blent en quelque façon, mais beaucoup! phis à la
chevre ordinaire ; qu’elles ont deux cornes larges 8c
recourbées fur le dos comme celles des boucs ; que
les Indiens les prennent dans des filets 8c dans des
pièges ; qu’elles font fi féroces qu’elles tuent quelquefois
des hommes ; que ces chevres font fort legeres
; qu’elles vivent dans des cavernes, & qu’elles
fe réunifient plufieurs enfemble. Voyei Aldrovande
debifulcis quad. Voye^BÉZOARD. { I )
C hevre du M u s e , captamofçki. Les auteurs ne
font pas d’accord fur le nom de l’animal qui porte le
mufe : on l’appelle chevre gafelle, 8cc. ou Amplement
Il animal du mufe , attimalmofchiferum. V. Musc . (T)
C hevre sauvage d’Afrique , capraJylveJlris
africana. Grim. Cette chevre eft de couleur cendrée
8c foncée ; elle a un toupet de-poil qui s’élève fur le
milieu de la tê te , & il fe trouve de chaque, côté entre
le nez & les yeux deux cavités qui renferment
une liqueur graffe & huileufe, dont l’odeur rient de
celle du cajloreum & d e celle du mufe ; cette liqueur
s’épaiffit & devient une matière noire ; dès qu’on l’a
enlevée, il en coule une autre qui s’épaiffït comme la
première : c es cavités n’ont aucune communicatio»
avec les yeux; ainfi la liqueur qui s’y trouvé eft fort
différente des larmes du cerf ou des autres animaux
Eph. Germ. an. 14. obf $y. { I )
C hevre de Syr ie , capra mambrina, fivefyria*
ca. Gefn. Les chevres de cette efpece fe trouvent principalement
en Syrie, fur la montagne appellée Mam-
bré, qui eft aux environs d’Hébron ; 8c il y en a auflï
autour de la ville d’AIep : leurs oreilles font fi fougues
qu’elles traînent par terre, de forte que les na-
turels du pays en coupent une, afin que l’animal
puiffé paître aifément. On a vû de ces cornes qui
n’avoient pas plus de deux pouces 8c demi de longueur
, 8c qui étoient un peu recourbées en arriéré;
On a auffi vû à Londres l’animal entier ; il reffem-
bleit à une chevre, quoiqu’il fût plus grand, 8c il étoit
S s '