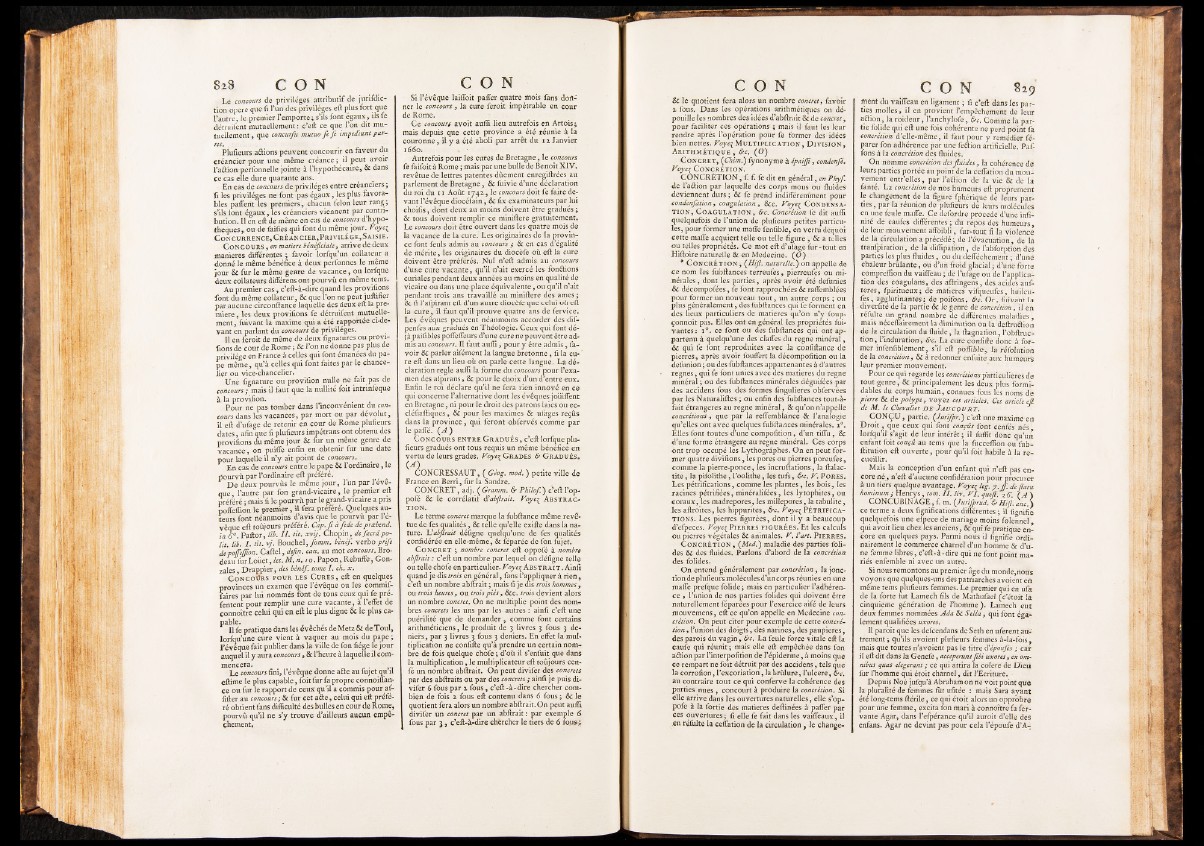
8i8 C O N
Le concours de privilèges attributif de jurifdic-
tion opéré que fi l’un des privilèges eft plus fort que
l’autre, le premier l’emporte ; s’ils font égaux , ils fe
dètruifent mutuellement: c’eft ce que l’on dit mutuellement
, que concurfu mutuo fc Je impediunt par-
Plufieurs aâions peuvent concourir en faveur du
créancier pour une même créance ; il peut avoir
l’aûion perfonnelle jointe à l’hypothecaire, & dans
ce cas elle dure quarante ans.
En cas de concours de privilèges entre créanciers ;
fi les privilèges ne font pas égaux, les plus favorables
pafferit les premiers, chacun félon leur rang ;
s’ils font égaux, les créanciers viennent par contribution.
Il en eft de même en cas de concours d’hypotheques,
ou de faifies qui font du même jour. Voyez
C o n c u r r e n c e , C r é a n c i e r , P r i v i l è g e , S a i s i e .
C oncours , en mature bénéficiait, arrive de. deux
maniérés différentes ; favoir lorfqu’un collateur a
donné le même bénéfice à deux perfonnes le meme
jour & fur le même genre de vacance, ou lorfque
deux collateurs différens ont pourvû en même tems.
Au premier ca s, c’eft-à-dire quand les provifions
font du même collateur, & que l’on ne peut juftifier
par aucune circonftance laquelle des deux eft la première
, les deux provifions fe dètruifent mutuellement,
fuivant la maxime qui a été rapportée ci-de-
yant en parlant du concours de privilèges.
Il en feroit de même de deux fignatures ou provifions
de cour de Rome ; & l’on ne donne pas plus de
privilège en France à celles qui font émanées du pape
même, qu’à celles qui font faites par le chancelier
ou vice-chancelier.
Une fignature ou provifion nulle ne fait pas de
concours ; mais il faut que la nullité foit intrinfeque
à la provifion. t , . ,
Pour ne pas tomber dans l’inconvement du concours
dans les vacances, par mort ou par dévolut,
il eft d’ufage de retenir en cour de Rome plufieurs
dates, afin que fi plufieurs impétrans ont obtenu des
provifions du même jour & fur un meme genre de
vacance, on puiffe enfin en obtenir fur une date
pour laquelle il n’y ait point de concours.
En cas de concours entre le pape & l’ordinaire, le
pourvu par l’ordinaire eft préféré. ^ r A
De deux pourvus le meme jour, l ’un par l’eve-
que, l’autre par fon grand-vicaire, le premier eft
préféré ; mais fi le pourvû par le grand-vicaire a pris
poffeflion le premier, il fera préféré. Quelques auteurs
font néanmoins d’avis que le pourvû par l’évêque
eft toûjours préféré. Cap.fi àfede de prabend.
in 6°. Paftor, lib. 11. tit. xvij. Chopin, de facrâpolit.
lib. I . tit. vj. Bouchel ,fomm, bénéf. verbo prife
de pojfejjion. Caftel, dtfin. can. au mot concours. Bro-
deau furLoiiet, lu. M .r i.io . Papon, Rebuffe, Gonzales
, Drappier, des bénéf. tome I . ch. x .
C oncours pour les Cures, eft en quelques
provinces un examen que l’évêque ou les commif-
faires par lui nommés font de tous ceux qui fe pré-
fentent pour remplir une cure vacante, à l’effet de
connoître celui qui en eft le plus digne & le plus Capable.
» FT.
Il fe pratique dans les évêchés de Metz & de Toul,
lorfqu’une cure vient à vaquer au mois du pape ;
l’éveque fait publier dans la v ille de fon fiége le jour
auquel il y aura concours, & l’heure à laquelle il commencera.
Le concours fini, l’évêque donne aae au fujet qu il
eftime le plus capable, foit fur fa propre connoiffan-
ce ou fur le rapport de ceux qu’il a commis pour af-
fifter au concours; & fur cet a â e , celui qui eft préféré
obtient fans difficulté des bulles en cour de Rome,
pourvû qu’il ne s’y trouve d’ailleurs aucun empêchement.
C O N
Si l’évêque laiffoit paffer quatre mois fans doit-
ner le concours, la cure feroit impétrable en cour
de Rome.
Ce concourt avoit aufli lieu autrefois en Artois;
mais depuis que cette province a été réunie à la
couronne, il y a été aboli par arrêt du 12 Janvier
1660.
Autrefois pour les cures de Bretagne, le concours
fe faifoit à Rome ; mais par une bulle de Benoît XIV.
revêtue de lettres patentes dûement enregiftrées au
parlement de Bretagne, & fuivie d’une déclaration
du roi du 11 Août 1742, le concours doit fe faire devant
l’évêque diocéfain, & fix examinateurs par lui
choifis, dont deux au moins doivent être gradués ;
& tous doivent remplir ce miniftere gratuitement.
Le concours doit être ouvert dans les quatre mois de
la vacance de la cure. Les originaires de la province
font feuls admis au concours ; & en cas d’égalité
de mérite, les originaires du diocèfe oii eft la cure
doivent être préférés. Nul n’eft admis au concours
d’une cure vacante, qu’il n’ait exercé les fondions
curiales pendant deux années au moins en qualité de
vicaire ou dans une place équivalente, ou qu’il n’ ait
pendant trois ans travaillé au miniftere des âmes ;
& fi l’afpirant eft d’un autre diocèfe que celui où eft
la cure, il faut qu’il prouve quatre ans de fervice.
Les évêques peuvent néanmoins accorder des dif-
penfes aux gradués en Théologie. Ceux qui font déjà
paifibles poffeffeurs d’une cure ne peuvent être admis
au concours. Il faut aufli, pour y être admis, favoir
& parler aifément la langue bretonne, fi la eu- ’
re eft dans un lieu où on parle cette langue. La déclaration
réglé aufli la forme du concours pour l’examen
des afpirans , & pour le choix d’un d’entre eux.
Enfin le roi déclare qu’il ne fera rien innové en ce
qui concerne l’alternative dont les évêques joüiffent
en Bretagne, ni pour le droit des patrons laïcs ou ec-
cléfiaftiques, & pour les maximes & ufages reçûs
dans la province, qui feront obfervés comme par
le paffé. (A )
Concours entre Gradués , c’ eft lorfque plufieurs
gradués ont tous requis un même bénéfice en
vertu de leurs grades. Voyez Grades & Gradués.
H M .............................
CONCRESSAUT, ( Géog. mod. ) petite ville de
France en Berri, fur la Sandre.
CO NCR ET , adj. (Gramm. & Philof.) c’eft l’op-
pofé & le corrélatif d’abfirait. Voyez Abstraction.
Le terme concret marque la fubftance même revêtue
de fes qualités, & telle qu’elle exifte dans la nature.
L'abflrait défigne quelqu’une de fes qualités
confidérée en elle-même, & féparée de fon lujet.
Concret ; nombre concret eft oppofé à nombre
abfirait : c’eft un nombre par lequel on défigne telle
ou telle chofe en particulier. Voyez Abstrait. Ainfi
quand je dis trois en général, fans l’appliquer à rien,
c’eft un nombre abftrait ; mais fi je dis trois hommes ,
ou trois heures , ou troispiés, & c . trois devient alors
un nombre concret. On ne multiplie point des nombres
concrets les uns par les autres : ainfi c’eft une
puérilité que de demander , comme font certains
arithméticiens, le produit de 3 livres 3 fous 3 deniers
, par 3 livres 3 fous 3 deniers. En effet la multiplication
ne confine qu’à prendre un certain nombre
de fois quelque chofe ; d’où il s’enfuit que dans
la multiplication, le multiplicateur eft toûjours cen-
fé un nombre abftrait. On peut divifer des concrets
par des abftraits ou par des concrets ; ainfi je puis divifer
6 fous par 2 fous, c’eft -à-dire chercher combien
de fois 2 fous eft contenu dans 6 fous ; & le
1 quotient fera alors un nombre abftrait. On peut aufli divifer un concret par un abftrait : par exemple 6
fous par 1 , c’eft-à-dire chercher le tiers de 6 fous-*
C O N
& le quotient fera alors un nombre concret, favoir
2 fous. Dans les opérations arithmétiques on dépouille
les nombres des idées d’abftrait & de concret ,
pouf faciliter ces opérations ; mais il faut les leur
rendre après l’opération pour fe former des idées
bien nettes. Voyez Mu l t ip l ic a t io n , D iv is io n ,
A rithm é t iq u e , &c. (O)
C o n cr e t , (Chimi) fynonyme à épaijji, condenfé.
Voyez C o n cr é t io n .
CONCRÉTION, f. f. fe dit en général, en Phyf.
de l’a&ion par laquelle des corps mous bu fluides
deviennent durs ; & fe prend indifféremment pour
condenfation, coagulation, & c . Voyez CONDENSATION,
C o a g u l a t io n , &c. Concrétion fe dit aufli
quelquefois de l’union de plufieurs petites particules,
pour former une maffe fenfible, en vertu deqiioi
cette maffe acquiert telle ou telle figure , & a telles
ou telles propriétés. Ce mot eft d’ufage fur-tout en
Hiftoire naturelle & en Medecine. (O )
* C o n c r é t io n ; (Hifi. naturelle.') on appelle de
ce nom les fubftances terreufes, pierreufes ou minérales
, dont les parties, après avoir été defunies
& décompofées, fe font rapprochées & raffemblées
pour former un nouveau tou t, un autre corps ; ou
plus généralement, des fubftances qui fe forment en
des lieux particuliers de matières qu’on n’y foup-
çonnoit pas. Elles ont en général les propriétés fui-
vantes: i° . ce font ou des fubftances qui ont appartenu
à quelqu’une des claffes du régné minéral,
& qui fe font reproduites avec la confiftance de
pierres, après avoir fouffert la décompofition ou la
defunion ; ou des fubftances appartenantes à d’autres
régnés, qui fe font unies avec des matières du régné
minéral ; ou des fubftances minérales déguifées par
des accidens fous des formes fingulieres obfervées
par les Naturaliftes ; ou enfin des fubftances tout-à-
fait étrangères au régné minéral, & qu’on n’appelle
concrétions, que par la reflemblance & l’analogie
qu’elles ont avec quelques fubftances minérales. 20.
Elles font toutes d’une compofition, d’un tiffu, &
d ’une forme étrangère au régné minéral. Ces corps
Ont trop occupé les Lythogrâphes. On en peut former
quatre divifions, les pores ou pierres poreufes,
comme la pierre-ponce, les incruftations, la ftalac-
tite , la pifolithe, l ’oolithe, les tufs, &c. V. Pores.
Les pétrifications, comme les plantes, les bois, les
racines pétrifiées, minéralifées, les lytophites, ou
coraux, les madrépores, les millepores, la tabulite,
les aftroïtes, les hippurites, &c. Voyez Pé tr if ic a t
io n s . Les pierres figurées, dont il y a beaucoup
d’efpeces. Voyez Pierres f igu rées. Et les calculs
ou pierres végétales & animales. V. Part. Pierres.
C o n c r é t io n , (Med.) maladie des parties foli-
des & des fluides. Parlons d’abord de la concrétion
des folides.
On entend généralement par concrétion, la jonction
de plufieurs molécules d’un corps réunies en une
maffe prefque folide ; mais en particulier l’adhérence
, l ’union de nos parties folides qui doivent être
naturellement féparees pour l’exercice aifé de leurs
mouvemens, eft ce qu’on appelle en Medecine concrétion.
On peut citer pour exemple de cette concrétion
, l’union des doigts, des narines, des paupières,
des parois du v agin, &c. La feule force vitale eft la
caufe qui réunit ; mais elle eft empêchée dans fon
aérion par l’interpofition de l’épiderme, à moins que
ce rempart ne foit détruit par des accidens, tels que
la corrofion, l ’excoriation, la brûlure, l’ulcere, &c.
au contraire tout ce qui conferve la cohérence des
parties nues , concourt à produire la concrétion. Si
elle arrive dans les ouvertures naturelles, elle s’op-
pofe à la fortie des matières deftinées à paffer par
ces ouvertures; fi elle fe fait dans les vaiffeaux, il
.en réfulte la ceffation de la circulation, le change-
C O N $29
ment du vaiffeau en ligament ; fi c’eft dans les parties
molles, il en provient l’empêchement de leur
aétion , la roideur, l’anchylofe, &c. Comme la partie
folide qui eft une fois cohérente ne perd point fa
concrétion d’elle-même, il faut pour y remédier fé-
parer fon adhérence par une feétion artificielle. Paf-
fons à la concrétion des fluides.
On nomme concrétion des fluides , la cohérence de
leurs parties portée au point de la ceffation du mouvement
entr’elles, par l’aftion de la vie & de là
fanté. La concrétion de nos humeurs eft proprement
le changement de la figuré fphériquè dé leurs parties
, par la réunion de plufieurs de leurs molécules
en une feule maffe. Ce defordre procédé d’une infinité
de càufes différentes ; dit repos des humeurs ,
de leur mouvement affaibli, fur-toüt fi la violence
de la circulation a précédé ; de l’èvacüatiôh, de la
transpiration, de la diflipation, de l’abforption des
parties les plus fluides, ou du defféchem'ent ; d’unë
chaleur brûlante, oit d’un froid glacial ; d’urië forte
compreffion du vaiffeau ; de l’ufage ou de l’application
des coagulans, des aftringens, des acides auf-
teres, /piritueux; de matières vifqtieufes, hüiîéti-
fes, agglutinâmes ; de pbifons, &c. O r , fuivant la
- diverfité de la partie & le genre de concrétion, il en
réfulte un grand nombre de différentes maladies,
mais neceffairement la diminution ou la deftrii&ion
de la circulation du fluide, la ftagnation, l’obftruc-
tion, l’induration-, 6-c. Là cure confifte dohe à former
infenfiblement, s’il eft poflîble,. la réfointion
de la concrétion, & à redonner enfuite aux hùmeurâ
leur premier mouvement.
Pour ce qui regarde les concrétions particulières de
tout genre, & principalement les deux plus formidables
du corps humain, connues fous les noms de
pierre & de polype , v o ye z ces articles. Cet article efi
de M. le Chevalier DE J a u c o v r t .
C O N Ç U , partie. ( Jurijpr.jc'eft. une maxime en
D ro it , que ceux qui font conçus font cènfés nés
lorfqu’il s’agit de leur intérêt ; il fuffit dohe qu’un
enfant foit conçu au tems que la fiiceeflion ou fub-
ftitution eft ouverte, pour qu’il foit habile à la recueillir.
Mais la conception d’un enfant qui n’eft pas encore
n é , n’eft d’aucune confidération pour procurer
à un tiers quelque avantage. Voyez leg- 7 -ff- deftatu
hominum ; Henrys, tom. I I . liv. P I . que fi. 26". ( A )
CONCUBINAGE, f. m. ( Jurifprud. & Hifi. anc.j
ce terme a deux fignifications différentes ; il fignifie
quelquefois une etpece de mariage moins folenneï ,
qui avoit lieu chez les anciens, & qui fe pratique encore
en quelques pays. Parmi nous il fignifie ordinairement
le commerce charnel d’un homme & d’une
femme libres, c ’eft-à-dire qui ne font point mariés
enfemble ni avec un autre.
Si nous remontons au premier âge du monde,nous
voyons que quelques-uns des patriarches avoient en
même tems plufieurs femmes. Le premier qui en ufa
de la forte fut Lamech fils de Mathufael (c’étoit là
cinquième génération de l’homme). Lamech eut
deux femmes nommées Ada & S e lla , qui font également
qualifiées uxores.
Il paroît que les defeendans deSeth en uferent autrement;
qu’ils avoient plufieurs femmes à-la-fois,
mais que toutes n’avoient pas le titre d’époufes ; car
il eft dit dans la G enefe, acceperunt fib i uxores , ex omnibus
quas elegerant ; ce qui attira la Colere de Dieu
fur l’homme qui étoit charnel, dit l’Ecriture.
Depuis Noé julqu’à Abraham on ne voit point quô
la pluralité de femmes fût ufitée : mais Sara ayant
été long-tems ftérile, ce qui étoit alors un opprobre
pour une femme, excita fon mari à connoître fa fer-
vante Agar, dans l’efpérance qu’il auroit d’elle des
enfans. Agar ne devint pas pour cela l’époufe d’A