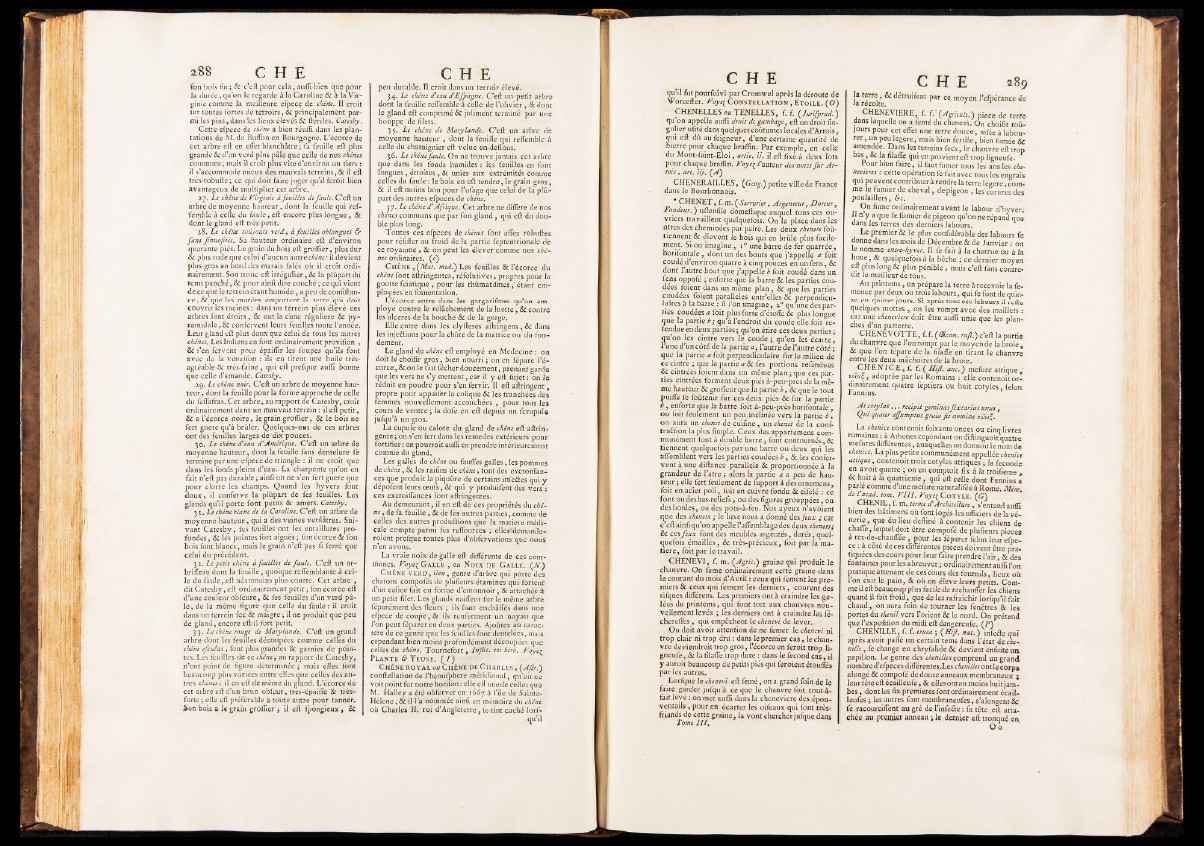
fon bois fin ; & c’ eft pour cela, aufli-bien que pour
fa durée, qu’on le regarde à la Caroline & à la Virginie
comme la meilleure efpece de chérie. Il croît
lur toutes fortes de terroirs, & principalement parmi
les pins, dans les lieux élevés & ftérileS. Catesby.
Cette efpece de chêne a bien réufli dans les plantations
de M.de Buffon en Bourgogne. L’écorce de
cet arbre eft en effet blanchâtre ; fa feuille eft plus
grande &c d’un verd plus pâle que celle de nos chênes
communs; mais il croît plus vite d’environ un tiers :
il s’accommode mieux des mauvais terreins, & il efl
tr-ès-robufte ; ce qui doit faire juger qu’il feroit bien
avantageux de multiplier cet arbre.
27. Le chêne de Virginie à feuilles de faule. C ’eft un
arbrç de moyenne hauteur, dont la feuille qui reffemble
à celle du faule, eft encore plus longue, &
dont le gland eft très-petit.
'2-8. Le chêne toujours verd, à feuilles oblongues &
fans finuofitls. Sa hauteur ordinaire eft d’environ
quarante piés. Le grain du bois eft groflîer, plus dur
& plus rude que celui d’aucun autre chêne: il devient
plus gros au bord des marais falés oit il croît ordinairement.
Son tronc eft irrégulier, & la plupart du
tems panché, & pour ainfi dire couché ; ce qui vient
de ce que le terrein étant humide, a peu de confiftan-
c e , & que les marées emportent la terre qui doit
couvrir les racines : dans un terrein plus élevé ces
arbres font droits, & ont la cime régulière & pyramidale
, & confervent leurs feuilles toute l’annee.
Leur gland eft plus doux que celui de tous les autres
chênes. Les Indiens en font ordinairement provifion ,
& s’en fervent pour épaiflir les foupes qu’ils font
avec de la venaifon : ils en tirent une huile très-
agréable & très-faine , qui eft prefque aufli bonne
que celle d’amande. Catesby.
20. Le chêne noir. C ’eft un arbre de moyenne hauteur,
dont la feuille pour la forme approche de celle
du faffaffas. C et arbre, au rapport de Catesby, croît
ordinairement dans un mauvais terrein : il eft petit,
& a l’écorce noire, le grain groflier, & le bois ne
fert guere qu’à briller. Quelques-uns de ces arbres
ont des feuilles larges de dix pouces.
30. Le chêne d'eau d'Amérique. C ’eft un arbre de
moyenne hauteur, dont la feuille fans dentelure fe
termine par une efpece de triangle : il ne croît que
dans les fonds pleins d’eau. La charpente qu’on en
fait n’eft pas durable ; ainfi on ne s’en fert guere que
pour clorre les champs. Quand les hyvers font
doux, il conferve la plupart de fes feuilles. Les
glands qu’il porte font petits & amers. Catesby.
31 .Le chêne blanc de la Caroline. C ’eft un arbre de
moyenne hauteur, qui a des veines verdâtres. Suivant
Catesby, fes feuilles ont les entaillures profondes
, & les pointes fort aiguës ; fon écorce & fon
bois font blancs, mais le grain n’eft pas fi'ferré que
celui du précédent.
32. Le petit chêne à feuilles de faule. C’eft un ar-
briffeau dont la feuille, quoique reffemblante à celle
du faule, eft néanmoins plus côutte. Cet arbre ,
dit Catesby, eft ordinairement petit ; fon écorce eft
d’ une cou leur obfcure, & fes feuilles d’un verd pâle
, de la même figure que celle du faule : il croît
dans un terrein feç & maigre ; il ne produit que peu
de gland, encore eft-il fort petit.
33 .L e chêne rougi de Mary lande. C ’eft un grand
arbre dont les feuilles découpées comme celles du
chêne efculus, font plus grandes & garnies de pointes.
Les feuilles de cé chêne, au rapport de Catesby,
n’ont point de figure déterminée ; mais elles font
beaucoup plus variées entre elles que celles des autres
chênes: il en eft de même du gland. L’écorce de
cet arbre eft d’un brun obfcur, très-épaiffe & très-
forte ; elle eft préférable à toute autre pour tanner.
£on bois a le grain groftier ; il eft fpongieux, de
peu durable. Il croît dans un terroir élevé.
34. Le chêne d'eau d'Efpagne. C ’eft un petit arbrè
dont la feuille reffemble à celle de l’olivier, & dont
le gland eft comprimé & joliment terminé par une
houppe de filets.
35. Le chêne de Mary lande. C ’eft un arbre de
moyenne hauteur , dont la feuille qui reffemble à
celle du châtaignier eft velue en-deffous.
36. Le chêne faule. On ne trouve jamais cet arbre
que dans les fonds humides : les feuilles en font
longues, étroites, & unies aux extrémités comme
celles du faule : le bois en eft tendre, le grain gros,
& il eft moins bon pour l’ufage que celui de la plupart
des autres efpeces de chêne.
37. Le chêne d'Afrique. Cet arbre ne différé de nos
chênes communs que par fon gland, qui eft dü double
plus long.
Toutes ces efpeces de chênes font affez robuftes
pour réfifter au froid de la partie feptentrionale de
ce royaume, & on peut les élever comme nos chênes
ordinaires, (c)
C hêne , {Mat. med.') Les feuilles & l’écorce du
chêne font aftringentes, réfolutives, propres pour la
goutte feiatique , pour les rhûmatifmes, étant employées
en fomentation.
L’écorce entre dans les gargarifmes qu’ôn employé
contre le relâchement de la luette, & contre
les ulcérés de la bouche & de la gorge.
Elle entre dans les clyfteres aftringens, & dans
les injeâions pour la chute de la matrice ou du fondement.
Le gland de chêne eft employé en Medecine : on
doit le choifir gros, bien nourri ; on en fépàre l’écorce
, & on le fait fécher doucement, prenant garde
que les vers ne s’y mettent, car il y eft fujet : on le
réduit en poudre pour s’en fervir. Il eft aftringent,
propre pour appaifer la colique & les tranchées des
femmes nouvellement accouchées , pour tous les
cours de ventre ; la dofe en eft depuis un fcrupule
jufqu’à un gros.
La cupule ou calote du gland de chêne eft aftrin-
gente ; on s’en fert dans les remedes extérieurs pour
fortifier : on pourroit aufli en prendre intérieurement
comme du gland.
Les galles de chêne ou fauffes galles, les pommes
de chêne, & les raifins de chêne, (ont des excroiffan-
ces que produit la piquûre de certains infeâes qui y
dépofent leurs oeufs, & qui y produifent des vers :
ces excroiffancés font aftringentes.
Au demeurant, il en eft de ces propriétés du chêne
» de fa feuille, & de fes autres parties, comme de
celles des autres produ&ions que la matière médicale
compte parmi fes reffourcès ; elles&demande-
roient prefque toutes plus d’obfervations que nous
n’en avons.
La vraie noix de galle eft différente de ces communes.
Voyê^Gallé , ou N o ix de G a lle. (iV)
C hêne v e r d , ilex y genre d’arbre qui porte des
chatons compdfés de plufieurs étamines qui fortent
d’un calice fait en forme d’entonnoir, & attachés ^
un petit filet. Les glands naiflènt fur le même arbre
féparément des fleurs ; ils font enchâffés dans une
efpece de coupe, & ils renferment un noyau que
l’on peut féparer en deux parties. Ajoutez au carac-
tere de ce genre que lès feuilles font dentelées, mais
cependant bien moins profondément découpées que
celles du chêne. Toürnefort, Inflit. rei herb. Voyez
Plante & Y euse. ( / )
C hêne RO y a l ou C hêne de C harles , (Afir.y
conftellation de l’hémifphere méridional, qu’on ne
voit point fur notre horilon : elle eft une de celles que
M. Halley a été obferver en-1667 à l’île de Sainte-
Hélene ,& il l ’a nommée ainfi en mémoire du .chêne
oti Charles IL roi d’Angleterre, fe tint caché lorfqu’il
qu'il fûtpourfuivi parCromwel après la déroute de
Worcefter. ■ P'oyti C onste llatio n , Eto ile . (O)
CHENELLES m TENELLES, f. f. ( Jurifrrui.)
1 qu’on appelle aufli droit de gambage, eft un droit fin-
gulier ufité dans quelques coutumes locales d’Artois,-
qui eft dû aufeigneur, d’une certaine quantité de
bierre pour chaque braflin. Par exemple, en celle
du Mont-faint-Eloi, artic. ij. il eft fixé à deux lots
pour chaque braflin. Voye{ /’auteur des notes fur Artois
, art. iij. {A')
CHENER AILLES, ([Geog.) petite ville de France
dans le Bourbonnois, *
* CHENET, f. m. ( Serrurier y Argenteur, Doreur,
Fondeur. ) uftenfile domeftique auquel tous ces ouvriers
travaillent quelquefois. On le place dans les
atres des cheminées par paire. Les deux chenets foû-
tiennent & élevent le bois qui en brûle plus facilement.
Si on imagine , i° une barre de fer quarrée,
horifontale , dont un des bouts que j’appelle a foit
coude d’environ quatre à cinq pouces en un fens, &
dont l’autre bout que j’appelle b foit coudé dans un
fens oppofe ; enforte que la barre & les parties coudées
foient dans un même plan, & que les parties
coudees foient parallèles entr’elles & perpendiculaires
a la barre : fi l’on imagine, 20 qu’une des parties
coudées a foit plus forte d’étoffe & plus longue
.que la partie b j qu’à l’endroit du coude elle foit refendue
en deux parties ; qu’on étire ces deux parties ;
qu’on les cintre vers le coude ; qu’on les écarte,
l’une d’un côté de la partie a, l’autre de l’autre côté ;
que la partie a foit perpendiculaire fur le milieu de
ce cintre ; que la partie a & fes portions refendues
& cintrées loient dans un même plan ; que ces parties
cintrées forment deux piés à-peu-près de la même
hauteur & groffeur que la partie b, & que le tout
puiffe fe foûtenir fur ces deux piés & fur la partie
b , enforte que la barre foit à-peu-près horifontale,
ou foit feulement un peu inclinée vers la partie b ,
on aura un chenet de cuifine , un chenet de la conf-
truftion la plus fimple. Ceux des appartemens communément
font à double barre, font contournés,, &
tiennent quelquefois par une barre ou deux qui les
affemblent vers les parties coudées b , & les confervent
à une diftance parallèle & proportionnée à la
grandeur de l’atre ; alors la partie a a peu de hauteur
; elle fert feulement de fupport à desornemens,
foit en acier poli, foit en cuivre fondu & cifelé : ce
font ou des bas-reliefs, ou des figures grouppées, ou
des boules, ou des pots-à-feu. Nos ayeux n’avoient
que des chenets ; le luxe nous a donné des feux ; car
c’eft ainfi qu’on appelle l’affemblage des deux chenets;
& ces feux font des meubles argentés, dorés, quelquefois
émaillés, & très-précieux, foit par la matière,
foit par le travail.
CHENEVI, f. m. (Agric.) graine qui produit le
chanvre. On feme ordinairement cette graine dans
le courant du mois d’Avril : ceux qui fement les premiers
& ceux qui fement les derniers, courent des
rifques différens. Les premiers ont à craindre le.s. gelées
du printems, qui font tort aux chanvres nouvellement
levés ; les derniers ont à craindre les fé-
chereffes, qui empêchent le chenevi de lever.
On doit avoir attention de ne femer le chenevi ni
trop clair ni trop dru : dans le premier ca s, le chanvre
deviendroit trop gros, l’écorce en feroit trop, li-
gneufe, & la filaffe trop dure : dans le fécond ca s, il
y auroit beaucoup de petits piés qui feroient étouffes
par les autres.
Lorfque le chenevi eft femé, on a grand foin de le
faire garder jufqu’à çe que le chanvre foit.tout-à-
fait leve : on met aufli dans la cheneviere des épou- i
veiitails , pour en écarter les oifeaux qui font très-
friands de cette graine, la vont chercher jufque dans
Tome I I I ,
la S ^ détruifent par ce moyen l’éfpérance de
CHENEVIERE, f. f. (Agricult.) pièce de terre
dans laquelle on a femé du chenevi. On choifit toû-
jours pour cet effet une terre douce, aifée à labourer,
un peu legere, mais bien fertile, bien fumée &
amendée. Dans les terreins fecs, le chanvre eft trop
bas, & la filafle qui en provient eft trop ligneufe.
Pourbifen faire, il faut fumer tous les ans les ehe-
neyieres : cette opération fe fait avec tous les engrais
qui peuvent contribuer à rendre la terre legere i com-
me le fumier de cheval, de pigeon, les curures des
poulaillers, & c .
On fume ordinairement avant le labour d’hyver.’
Il n’y a que le fvtmier de pigeon qu’on ne répand que
dans les terres des derniers labours.
Le premier & le plus confidérable des labours fe
donne dans les mois de Décembre & de Janvier: on
le nomme mtrc-hyycr. Il fe fait à la charrue ou à la
houe, & quelquefois à la bêche ; ce dernier moyen
eft plus long & plus pénible , mais c’eft fans contre-
dit le meilleur de tous.
Au printems, on prépare la terre à recevoir la fe-
mence par deux ou trois labours, qui fe font de quinze
en quinze jours. Si après tous ces labours il reflet
quelques mottes , on les rompt avec des maillets :
car une cheneviere doit être aufli unie que les planches
d’nn parterre.
CHENEVOTTE, f f. ( OE con . ru ß .) c ’eft la partie
du chanvre que l’on rompt par le moyen de la broie ,
& que l ’on fépare de la filaffe en tirant le chanvre
entre les deux mâchoires de la broie.
^ CH EN IC E , f. f. { H i ß . a n c.') mefure attique
xojviZ, adoptée par les Romains : elle pontenoit ordinairement
quatre feptiers ou huit cotyles félon
Fannius.
A t co ty la S. . . te tip it gemirlas f e x ta r iu s unus ,
Q u i quater aßumptus graio f i t nomirte xioTvif;.
La chenice contenoit foixante onces ou cinq livres
romaines : à Athènes cependant on diftinguoit quatre
mefures différentes, auxquelles on donnoitle nom de
chenice. La plus petite communément appellée chenice
a ttiq u e , contenoit trois cotyles attiques ; la fécondé
en avoit quatre ; on en comptoit fix à la troifieme ,
& huit à la quatrième, qui eft celle dont Fannius a
parle comme d’une mefure naturalifée à Rome. M ém .
d e l'a c a d . tom. V I I I . Voye^ C O T Y L E . ( G )
CHENIL, f. m. terme £ Architecture, s’entend aufli
bien des bâtimens où font logés les officiers de la vénerie,
que du lieu deftiné à contenir les chiens de
chaffe, lequel doit être compofé de plufieurs pièces
à rez-de-chauffée, pour les féparer félon leur efpece
: à cote de ces differentes pièces doivent être pratiquées
des cours pour leur faire prendre l’air, & des
fontaines pour les abreuver ; ordinairement aufli l’on
pratique attenant de ces cours des fournils, lieux où
l’on cuit le pain, & où on éleve leurs petits. Comme
il eft beaucoup plus facile de rechauffer les chiens
quand il fait froid , que de les rafraîchir lorfqu’il fait
chaud, on aura foin de tourner les fenêtres & les
portes du chenil vers l’orient & le nord. On prétend
que l’expofition du midi eft dangereufe. (P)
CHENILLE, f. f. eruca ; ( H iß . n a t. ) infeâe qui
après avoir paffé un certain tems dans l’état de chen
ille , fe change en chryfalide & devient enfuite un
papillon. Le genre des chenilles comprend un grand
nombre d’efpeces différentes.Les chenilles ont le corps
alongé & compofé de douze anneaux membraneux ;
leur tête eft écailleufe, & elles ont au moins huit jambes
, dont les fix premières font ordinairement écail-
leufes ; les autres font membraneufes, s’alongent &
fe racourciffent au gré de l’infede : fa tête eft attachée
au premier anneau ; le dernier eft tronqué eu,
O o