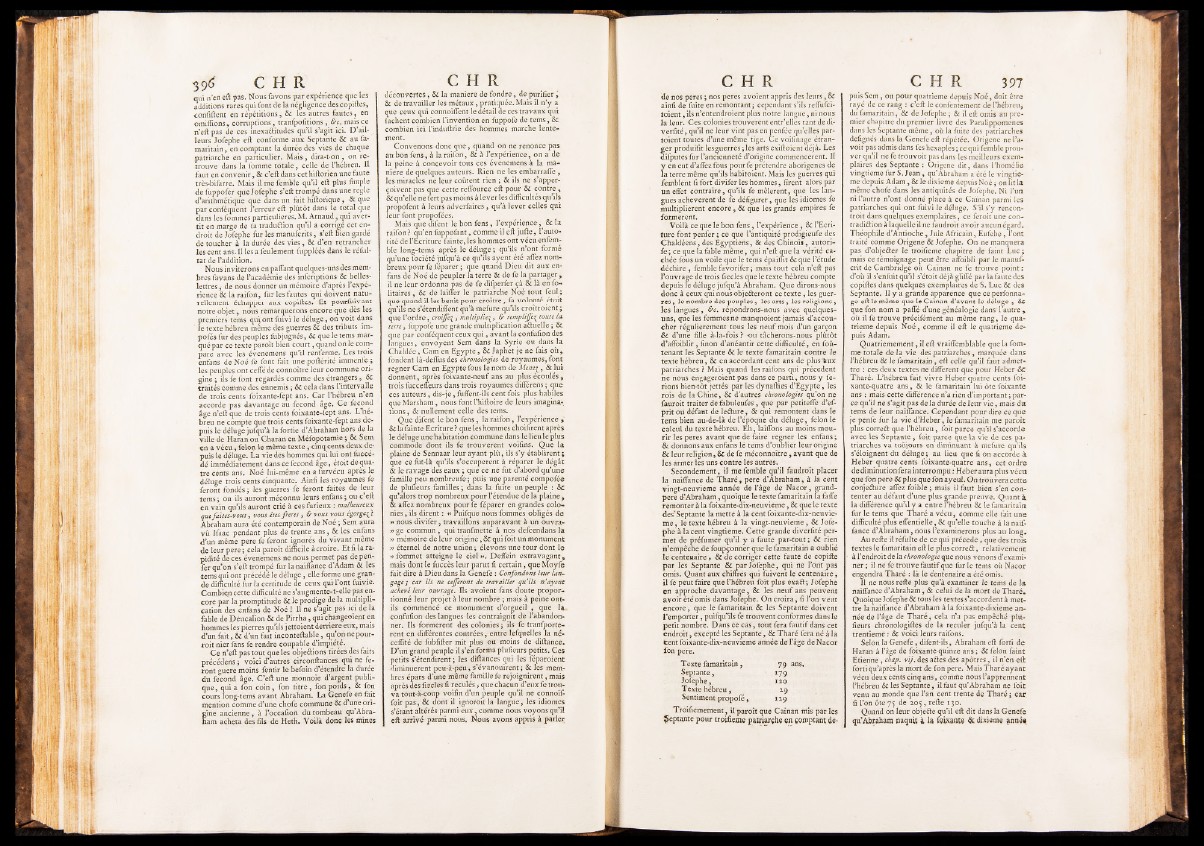
qui n’en eft pas. Nous favons par expérience que les
additions rares qui font de la négligence des copiftes,
confiftent en répétitions, 6c les autres fautes, en
omiffionscorruptions, tranfpolitions, &c. mais ce
n’eft pas de ces inexa&itudes qu’il s’agit ici. D ’ail-
leurs Jofephe eft conforme aux Septante 6c au fa-
maritain, en comptant la durée des vies de chaque
patriarche en particulier. Mais, dira-t-on, on retrouve
dans la fomme totale, celle de l’hébreu. Il
faut en convenir, & c’eft dans cet hiftorien une faute
très-bifarre. Mais il me femble qu’il eft plus fimple
de fuppofer que Jofephe s’eft trompé dans une réglé
d’arithmétique que dans un fait hiftorique , & que
par conféquent l’erreur eft plutôt dans le total que
dans les fommes particulières. M. Arnaud, qui avertit
en marge de là tradu&ion qu’il a corrigé cet endroit
de Jofephe fur les manufcrits, s’eft Bien gardé
de toucher à la durée des vies , 6c d’en retrancher
les cent ans. Il les a feulement füppléés dans le réful-
tat de l’addition.
Nous inviterons en paffant quelques-uns des membres
favans de l’académie des infcriptions 6c belles-
lettres , de nous donner un mémoire d’après l’expe-
rience 6c la raifon, fur les fautes qui doivent naturellement
échapper aux copiftes. Et pourfuivant
notre objet, noüs remarquerons encore que dès les
premiers tems qui. ont fuivi le déluge, on voit dans
le texte hébreu meme des guerres & des tributs im-
pofés fur des peuples fubjugués, & que le tems marqué
par c e texte paroît bien court, quand on le compare
avec les évenemens qu’il renferme. Les trois
enfans de Noé fe font fait une poftérité immenfe ;
les peuples ont ceffé de connoître leur commune origine
; ils fe font regardés comme des étrangers, 6c
traités comme des ennemis ; 6c cela dans l’intervalle
de trois cents foixante-fept ans. Car l’hébreu, n’en
accorde pas davantage au fécond âge. Ce fécond
âge n’eft que de trois cents foixante-fept ans. L hébreu
ne compte que trois cents foixante-fept ans depuis
le déluge jufqu’à la fortie d’Abraham hors de la
ville de Haran ou Charan en Méfopotamie ; 6c Sem
en a v é cu , félon le même texte, cinq cents deux depuis
le déluge. La v ie des hommes qui lui ont fuccé-
dé immédiatement dans ce fécond âge, étoit de quatre
cents ans. Noé lui-même en a furvécu après le
déluge trois cents cinquante. Ainfi les royaumes fe
feront fondés ; les guerres fe feront faites de leur
tems ; ou ils auront méconnu leurs enfans ; ou c’eft
en vain qu’ils auront crié à ces furieux : malheureux
que faites-vous , vous êtes freres , & vous vous égorgé f l
Abraham aura été contemporain de Noé ; Sem aura
vû Ifaac pendant plus de trente ans, & les enfans
d’un même pere fe feront ignorés du vivant meme
de leur pere ; cela paroît difficile à croire. Et fi. la rapidité
de ces évenemens ne nous permet pas de pen-
fer qu’on s’eft trompé fur la naiffance d’Adam & les
•tems qui ont précédé le déluge, elle forme une grande
difficulté lur la certitude de ceux qui l’ont fuivie.
Combien cette difficulté ne s’augmente-t-elle pas encore
par la promptitude & le prodige de la multiplication
des enfans de Noé ! Il ne s’agit pas ici de la
fable de Deucalion & de Pirrha, qui changeoient en
hommes les pierres qu’ils jett'oient derrière eux, mais
d’un fait, 6c d’un fait inconteftable, qu’on ne pour-
roit nier fans fe rendre coupable d’impiété.
Ce n’eft pas tout que les obje&ions tirees des faits
précédens ; voici d’autres circonftances qui ne feront
guere moins fentir le befoin d’étendre là durée
du fécond âge. C ’eft une monnoie d’argent publique,
qui a fon coin, fon titre , fon poids, & fon
cours long-tems avant Abraham. La Genefe en fait
mention comme d’une chofe commune 6c d’une origine
ancienne, à l’occafion du tombeau qu’Abra-
ham acheta des fils de Heth. Voilà donc les mines
découvertes, & la maniéré de fondre, de purifier ÿ
& de travailler les métaux, pratiquée. Mais il n’y a
que ceux qui connoiffent le détail de ces travaux qui
fâchent combien l’invention en fuppofe de tems, 6c
combien ici l’induftrie des hommes marche lentement.
Convenons donc que, quand on ne renonce pas
au bon fens, à la raifon, 6c à l’expérience, on a de
la peine à concevoir tous ces évenemens à la maniéré
de quelques auteurs. Rien ne les embarraffe ,
les miracles ne leur coûtent rien ; & ils, ne s’apper-
çoivent pas que cette reffource eft pour & contre,
& qu’elle ne lert pas moins à lever les difficultés qu’ils
propofent à leurs adverfaires, qu’à lever celles qui
leur font propofées.
Mais que difent le bon fens, l’expérience, & la
raifon? qu’en fuppofant, comme il eft jufte, l’autorité
de l’Ecriture fainte, les hommes ont vécu enfem-
ble long-tems après le déluge ; qu’ils n’ont formé
qu’une fociété jufqu’à ce qu’ils ayent été affez nombreux
pour fe féparer ; que quand Dieu dit aux enfans
de Noé de peupler la terre & de fe la partager ,
il ne leur ordonna pas de fe difperfer çà & là en fo-
litaires, 6c de laifîer le patriarche Noé tout feul ;
que quand il les bénit pour croître, fa volonté étoit
qu’ils ne s’étendiffent qu’à mefure qu’ils croîtroient ;
que l’ordre, croijfe^, multiplie£, & rempliffe£ toute la
terre , fuppofe une grande multiplication aéhielle ; &
que par conféquent ceux q ui, avant la confufion des
langues, envoyent Sem dans la Syrie ou dans la
Chaldée, Cam en Egypte, 6c Japhet je ne fais où ,
fondent là-delfus des chronologies de royaumes, font
regner Cam en Egypte fous le nom de Meneç , & lui
donnent, après foixante-neuf ans au plus écoulés,
trois fucceffeurs dans trois royaumes différens ; que
ces auteurs, dis-je, fuffent-ils cent fois plus habiles
que Marsham, nous font l’hiftoire de leurs imaginations
, & nullement celle des tems.
Que difent le bon fens, la raifon, l’expérience *
6c la fainte Ecriture? qùe les hommes choifirent après
le déluge une habitation commune dans le lieu le plus
. commode dont ils fe trouvèrent voifins. Que la
plaine de Senhaar leur ayant plû, ils s’y établirent ;
que ce fut-là qu’ils s’occupèrent à réparer le dégât
& le ravage des eaux ; que ce ne fut d’abord qu’une
famille peu nombreufe ; puis une parenté compoféè
de plufieurs familles ; dans la fuite un peuple : 6c
qu’alors trop nombreux pour l’étendue de la plaine ,
& affez nombreux pour fe féparer en grandes colonies
, ils dirent : « Puifque nous fommes obligés de
» nous divifer, travaillons auparavant à un ouvra-
» ge commun, qui tranfmette à nos defcendans la
» mémoire de leur origine, 6c qui foit un monument
» éternel de notre union ; élevons une tour dont le
» fommet atteigne le ciel ». Dêffein extravagant,
mais dont le fuccès leur parut fi certain, que Moyfe
fait dire à Dieu dans la Genefe : Confondons leur langage;
car ils ne cejferont de travailler qu'ils n'ayent
achevé leur ouvrage. Ils avoient fans doute proportionné
leur projet à leur nombre ; mais à peine ont-
ils commencé ce monument d’orgueil , que la.
confufion des langues les contraignit de l’abandonner.
Ils formèrent des colonies; ils fe tranfporte-
rent en différentes contrées,~ entré lefquelles la né-
ceffité de fubfifter mit plus ou moins de diftance.
D’un grand peuple il s’en forma plufieurs petits. Ces
petits s’étendirent ; les diftances qui les' féparoient
diminuèrent peu-à-peu, s’évanouirent; & les membres
épars d’une meme famille fe rejoignirent, mais
après des fiecles fi reculés, que chacun d’eux fe trouva
tout-à-coup voifin d’un peuple qu’il ne connoif-
foit pas, & dont il ignoroit la langue, les idiomes
s’étant altérés parmi eux, comme nous voyons qu’il
eft arrivé parmi nous. Nous avons appris à parler
de nos peres ; nos peres avoient appris des leurs, Sc
ainfi de fuite en remontant ; cependant s’ils reffufci-
toient, ils n’entendroient plus notre langue, ni nous
la leur. Ces colonies trouvèrent entr’elles tant de di-
verfité, qu’il ne leur vint pas en penfée qu’elles par-
toient toutes d’une même. tige. Ce voifinagc étranger
produifit les guerres ; les arts exiftoient déjà. Les
difputes fur l’ancienneté d’origine commencèrent. Il
y en eut d’affezfous pourfe prétendre aborigènes de
la terre même qu’ils habitoient. Mais les guerres qui
femblent fi fort divifer les hommes, firent alors par
un effet contraire, qu’ils fe mêlèrent, que les langues
achevèrent de le défigurer, que les idiomes fe
multiplièrent encore, 6c que les grands empires fe
formèrent.
Voilà ce que le bon fens, l’expérience, 6c l’Ecriture
font penfer ; ce que l’antiquité prodigieufe des
Chaldéens, des Egyptiens, & des Chinois, autori-
fe; ce que la fable même, qui n’eft que la vérité cachée
fous un voile que le tems épaimt 6c que l’étude
déchire , femble favorifer ; mais tout cela n’eft pas
l’ouvrage de trois fiecles que le texte hébreu compte
depuis le déluge jufqu’à Abraham. Que dirons-nous
donc à ceux qui nous objecteront ce texte , les guerres
, le nombre des peuples, les a rts, les religions,
les langues, &c. répondrons-nous avec quelques-
uns, que les femmes ne manquoient jamais d’accoucher
régulièrement tous les neuf mois d’un garçon
6c d’une fille à-la-fois ? -ou tâcherons-nous plûtôt
d’affoiblir, finon d’anéantir cette difficulté, en fou-
tenant les Septante 6c le texte famaritain contre le
texte hébreu, & en accordant cent ans de plu sïu x
patriarches ? Mais quand les raifons qui précèdent
ne nous engageroient pas dans ce parti, nous y ferions
bien-tôt jettés par les dynafties d’Egypte, les
rois de la Chine, 6c d’autres chronologies qu’on ne
fauroit traiter de fabuleufes, que par petiteffe d’efi-
prit oti défaut de leélure, & qui remontent dans le
tems bien au-dé-là de l’époque du déluge, félon le
Calcul du texte hébreu. Eh, laiffons au moins mourir
les peres avant que de faire regner les enfans ;
& donnons aux enfans lé tems d’oublier leur origine
& leur religion, & de fe méconrioître, avant que de
les armer les uns contre les autres.
Secondement, il me femble qu’il faudroit placer
la naiffance de Tharé, pere d’Abraham, à la cent
vingt-neuvieme année de l’âge de Nacor, grand-
pere d’Abraham, quoique le texte famaritain la faffe
remonter à la foixante-dix-neuvieme, 6c que le texte
des'Septante la mette à la cent foixante-dix-neuvieme
, lé texte hébreu à la vingt-neuvieme, 6c Jofephe
à la cent vingtième. Cette grande diverfité permet
de préfumer qu’il y a faute par-tout ; 6c rien
n’empêche de foupçonner que le famaritain a oublié
le centenaire, 6c de corriger cette fauté de copifte
par les Septante 6c par Jofephe, qui ne l’ont pas
omis. Quant aux chiffrés qui fuivent le centenaire,
il fe peut faire que l’hébreu foit plus exaft; Jofephe
en approche davantage, 6c les neuf ans peuvent
avoir été omis dans Jofephe. On croira, fi l’ori veut
encore, que le famaritain 6c les Septànte doivent
remporter, puifqu’ils fe trouvent conformes dans le
petit nombre. Dans ce cas , tout fera fautif dans cet
endroit, excepté les Septante, 6c Tharé fera né à la
tent foixânte-dix-neuvieme année de l’âge de Nacor
Ion père.
Texte famaritain, 79 ans.
Septante, 179
Jofephe, i zo
Texte hébreu, 19
Sentiment propofé, 119
Troifiemement, il paroît que Caïnan mis par les
{Septante pour troifieme patriarçhç en comptant depuis
Sem, ou pour quatrième depuis N o é, doit être
rayé de ce rang : c’eft le confentement de l’hébreu*
du famaritain, 6c de Jofephe ; & il eft omis au premier
chapitre du premier livre des Paralippomenes
dans les Septante même, où la fuite des patriarches
defignés dans la Genefe eft répétée. Origene ne l’a-
voit pas admis dans fes hexaples ; ce qui femble prouver
qu’il ne fe trouvoit pas dans les meilleurs exemplaires
des Septante : Origene dit, dans l ’homélie
vingtième fur S. Jean, qu’Abraham a été le vingtième
depuis Adam, & le dixième depuis Noé ; on lit la
même chofe dans les antiquités de Jofephe. Ni l’un
ni l’autre n’ont donné place à ce Caïnan parmi les
patriarches qui ont fuivi le déluge. S’il s’y rencon-
troit dans quelques exemplaires, ce feroit une contradiction
à laquelle il ne faudroit avoir aucun égard.
Théophile d’Antioche, Jule Africain, Eufebe, l’ont
traité comme Origene & Jofephe. On ne manquera
pas d’obje&er le troifieme chapitre de faint Luc ;
mais Ce témoignage peut être affoibli par le manuf*
crit de Cambridge où Caïnan ne fe trouve point :
d’où il s’enfuit qu’il s’étoit déjà gliffé par la faute des
copiftes dans quelques exemplaires de S. Luc 6c des
Septante. Il y a grande apparence que ce perfonna-
ge eft le même que le Caïnan d’avant le déluge , 6c
que fon nom a paffé d’une généalogie dans1 l’autre ,
où il fe trouve précifément au même rang, le quatrième
depuis N o é, comme il eft le quatrième depuis
Adam.
Quatrièmement, il eft vraiffemblable que la fomme
totale de la vie des patriarches, marquée dans
l’hébreu & le famaritain, eft celle qu’il faut admettre
: ces deux textes ne different que pour Heber 6c
Tharé. L’hébreu fait vivre Heber quatre cents foi-
xante-quatre ans, & le famaritain lui ôte foixante
ans : mais cette différence n’a rien d’important ; parce
qu’il ne s’agit pas de la durée de leur v ie , mais du
tems de leur naiffance. Cependant pour dire ce que
je penfe fur la vie d’Heber, le famaritain me paroît
plus correft que l’hébreu, foit parce qu’il s’accorde
avec les Septante, foit parce que la v ie de ces patriarches
va toujours en diminuant à mefure qu’ils
s’éloignent du déluge ; au lieu que fi on accorde à
Heber quatre cents foixante-quatre ans, cet ordre
de diminution fera interrompu : Heber aura plus vécu
que fon pere & plus que fon ayeul. On trouvera cette
conjeftùre affez foible ; mais il faut bien s ’en contenter
au défaut d’une plus grande preuve. Quant à.
la différence qu’il y a entre l’hébreu 6c le famaritain
fur le tems que Tharé a v écu , comme elle fait une
difficulté plus effentielle, 6c qu’elle touche à la naiffance
d’Abraham, nous l’examinerons plus au long.
Au refte ilréfulte de ce qui précédé, que des trois
textes le famaritain eft le plus correél, relati vement
• à l’endroit de la chronologie que nous venons d’examiner
; il ne fe trouve fautif que fur le tems où Nacor
engendra Tharé : là le centenaire a été omis.
Il rie nous refte plus qu’à examiner le tems de la
naiffance d’Abraham, & celui de la mort de Tharé.
Quoique Jofephe & tous les textes s’accordent à mettre
la naiffance d’Abraham à la foixante-dixieme année
de l’âge de Tharé * cela n’a pas empêché plufieurs
chroriologiftes de la reculer jufqu’à la cent
trentième : & voici leurs raifons.
Selon la Genefe, diferit-ils, Abraham eft forti de
Haran à l’âge de foixante-quinze ans ; & félon faint
Etienne, chap. vij. des aâes des apôtres, il n’en eft
forti qu’âprès la mort de fori pere. Mais Tharé ayant
vécu deux cents cinq ans, Corinne nous l’apprennent
l’hébreu & les Septante, il faut qu’Abraham ne foit
venu au monde que l’an cent trente de Tharé ; car
fi l’on ôte 75 de 205, refte 130.
Quand on leur objette qu’il eft dit dans la Genefe
qu’Abraham naquit à la fixan te & dixième année