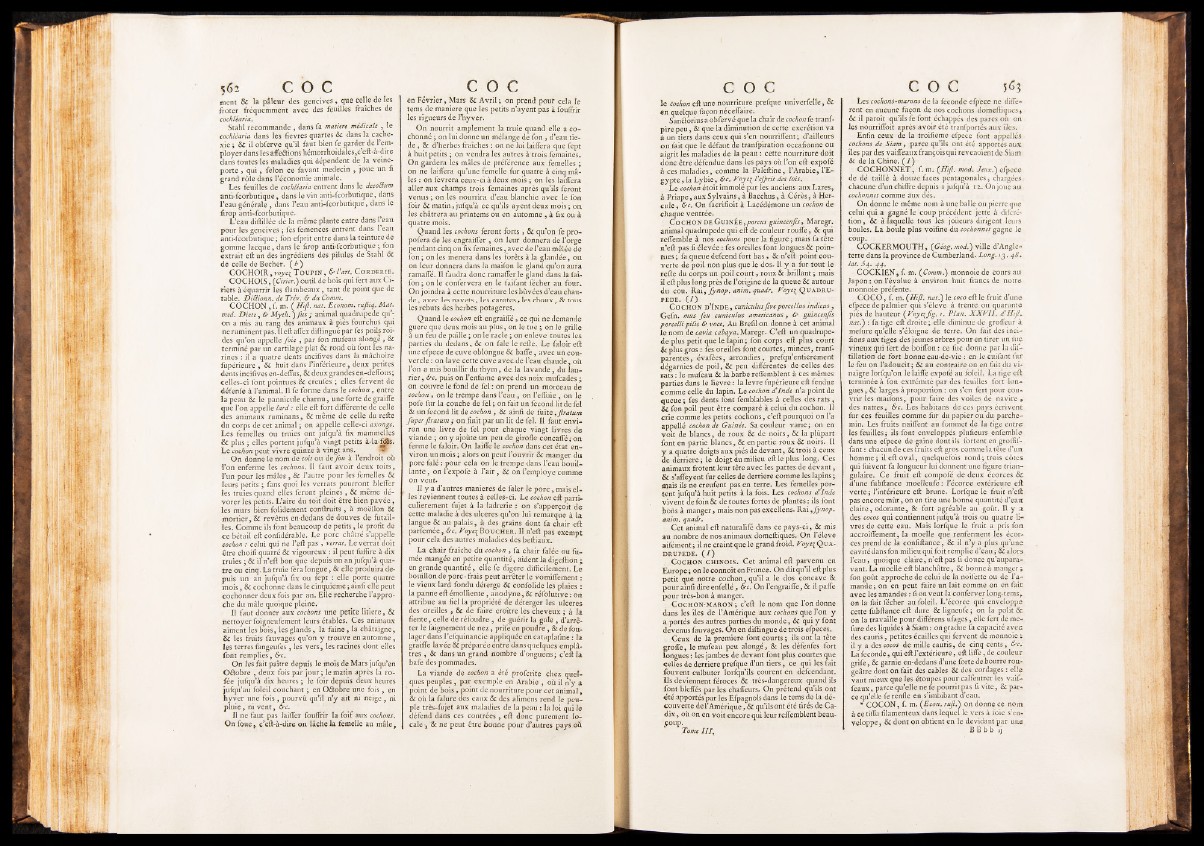
\6i C O c
ment & la pâleur des gencives , que celle de les
froter fréquemment avec des feuilles fraîches de
cochléaria.
Stahl recommande , dans fa matière médicale , le
cochléaria dans les fievres quartes & dans la cachexie
; & il obferve qu’il faut bien fe garder de l’employer
dans les affettions hémorrhoïdales,c’eft-à-dire
dans toutes les maladies qui dépendent de la veine-
porte , q u i, félon ce favant médecin , joue un fi
grand rôle dans l’économie animale.
Les feuilles de cochléaria entrent dans le decoclum
anti-feorbutique, dans le vin anti-feorbutique, dans
l’eau générale, dans l’eau anti-feorbutique, dans le
firop anti-feorbutique.
L’eau diftillée de la même plante entre dans l’eaü
pour les gencives ; fes femences- entrent dans l’eau
anti-feorbutique; fon efprit entre dans la teinture de
gomme lacque, dans le firop anti-feorbutique ; fon
extrait eft un des ingrédiens des pilules de Stahl &
de celle de Becher. ( b )
COCHOIR, voyei T oupin , & l'are. C orderie.
COCHOIS, (Cirier.) outil de bois qui fert aux Ci-
riers à équarrir les flambeaux, tant de point que de
table. Diclionn. de Trév. & du Comm.
CO CH O N , f. m. ( Hifi. nat. Econom. rufiiq. Mat.
med. Dicte, & Myth. ) fus ; animal quadrupède qu’on
a mis au rang des animaux à piés fourchus qui
ne ruminent pas. Il eft affez diftingué par fes poils roi-
des qu’on appelle foie , par fon mufeau alonge, &
terminé par un cartilage plat & rond où font les narines
: il a quatre dents incifives dans la mâchoire
fupérieure , & huit dans l’inférieure, deux petites
dents incifives en-deflùs., & deux grandes en-deffous;
celles-ci font pointues & creufes ; elles fervent de
défenfe à l’animal. Il fe forme dans le cochon, entre
la peau & le pannicule charnu, une forte de graille
que l’on appelle lard : elle eft fort différente de celle
des animaux ruminans, & même de celle du refte
du corps de cet animal ; on appelle celle-ci axonge.
Les femelles ou truies ont jufqu’à fix mammelles
& plus ; elles portent jufqu’à vingt petits à-la-fdls.
Le cochon peut vivre quinze à vingt ans.
On donne le nom de toit ou de fou à l’endroit où
l’on enferme lés cochons. Il faut avoir deux toits,
l’un pour les mâles , & l’autre pour les femelles &
leurs petits ; fans quoi les verrats pourront bleffer
les truies quand elles feront pleines , & même dér-
vorer les petits. L’aire du toit doit être bien pa vé e,
les murs bien folidement conftruits , à moellon &
mortier, & revêtus en-dedans de douves de futailles.
Comme ils font beaucoup de petits, le profit de
c e bétail eft confidérable. Le porc châtré s’appelle
cochon : celui qui ne l’eft pas , verrat. Le verrat doit
être choifi quarré & vigoureux : il peut fuffire à dix
truies ; & il n’eft bon que depuis un an jufqu’à quatre
ou cinq. La truie fera longue, & elle produira depuis
un an jufqu’à fix ou fept : elle porte quatre
mois, & cochonne dans le cinquième ; ainfi elle peut
cochonner deux fois par an. Elle recherche l’approche
du mâle quoique pleine.
Il faut donner aux cochons une petite litiere, &
nettoyer foigneufement leurs étables. Ces animaux
aiment les bois, les glands, la faine, la châtaigne,
& les fruits fauvages qu’on y trouve en automne ,
les terres fangeufes , les vers, les racines dont elles
font remplies, &c.
On les fait paître depuis le mois de Mars jufqu’en
Oftobre , deux fois par jour ; le matin après la ro-
fée jufqu’à dix heures ; le foir depuis deux heures
jufqu’au foleil couchant ; en Oftobre une fois , en
hyver une fois , pourvu qu’il n’y ait ni neige , ni
pluie, ni vent, bc.
Il ne faut pas laiffer fouffrir la foif aux cochons.
On foue, c’eft-à-dire on lâche la femelle au mâle,
C O C
en Février, Mars & Avril ; on prend pour cela le
tems de maniéré que les petits n’ayent pas à fouffrir
les rigueurs de l’hyver.
On nourrit amplement la truie quand elle a cochonné
; on lui donne un mélange de fon , d’eau tie-
de , & d’herbes fraîches : on ne lui laiffera que fept
à huit petits ; on vendra les autres à trois femaines.
On gardera les mâles de préférence aux femelles ;
on ne laiffera qu’une femelle fur quatre à cinq mâles
: on fevrera ceux-ci à deux mois ; on les laiffera
aller aux champs trois femaines après qu’ils feront
venus ; on les nourrira d’eau blanchie avec le fon
foir & matin, jufqu’à ce qu’ils ayent deux mois ; on,
les châtrera au printems ou en automne , à fix ou à
quatre mois.
Quand.les cochons feront forts , & qu’on fe pro-
pofera de les engraiffer , on leur donnera de l’orge
pendant cinq ou fix femaines, avec de l’eau mêlée de
fon ; on les mènera dans les forêts à la glandée, ou
on leur donnera dans la maifon le gland qu’on aura
ramaffé. Il faudra donc ramaffer le gland dans la fai*
fon ; on le confervera en le faifant fécher au four.
On joindra à cette nourriture les bùvées d’eau chaude
, avec les navets, les carotes, les choux, & tous
les rebuts des herbes potagères.
Quand le cochon eft engraiffé, ce qui ne demande
guere que deux mois au plus, on le tue ; on le grille
• à un feu de paille ; on le racle ; on enleve toutes les
parties du dedans, & on fale le refte. Le faloir eft
une efpece de cuve oblongue & baffe, avec un couvercle
: on lave cette cuve avec-de l’eau chaude, où
l’on a mis bouillir du thym, de. la lavande, du laurier
, &c. puis on l’enfume avec des noix mufeades ;
on couvre le fond de fel: on prend un morceau de
cochon, on le trempe dans l’eau , on l’effuie, on le
pofe fur la couche de fél ; on fait un fécond lit de fel
& un fécond lit de cochon, & ainfi de fuite, firatum
fuperfiratum ,* on .finit par un lit de fel. Il faut environ
une livre de fel pour chaque vingt livres de
viande ; on y ajoute un peu de girofle concaffé ; on
ferme le faloir. On laiffe le cochon dans cet état environ
un mois ; alors on peut l’ouvrir & manger du
porc falé : pour cela on le trempe dans l’eau bouillante
, on l’expofe à l’a ir , & on l’employe comme
on veut.
Il y a d’autres maniérés de faler le p o r c , mais elles
reviennent toutes à celles-ci. L e cochon eft particulièrement
fujet à la ladrerie : on s’apperçoit de
cette maladie à des ulcérés qu’on lui remarque à la
langue & au palais, à des grains dont fa chair eft
parfemée, &c. Foye^ Bo u ch er . Il n’eft pas exempt
pour cela des autres maladies des beftiaux.-
La chair fraîche du cochon , fa chair falée ou fumée
mangée en petite quantité, aident la digeftion ;
en grande quantité, elle fe digéré -difficilement. Le
bouillon de porc-frais peut arrêter le vomiffement :
le vieux lard fondu déterge & confolide les plaies :
la panne eft émolliente, anodyne, & réfolutive : on
attribue au fiel la propriété de déterger les ulcérés
des oreilles , & de faire croître les cheveux ; à la
fiente, celle de réfoudre, de guérir la gale , d’arrêter
le faignement de n ez, prife en poudre, & de fou-
lager dans l ’efquinancie appliquée en cataplafme : la
graiffe lavée & préparée entre dans quelques emplâtres
, & dans un grand nombre d’onguens ; c’eft la
bafe des pommades.
La viande de cochon a été proferite chez quelques
peuples, par exemple en Arabie , où il n’y a
point de bois, point de nourriture pour cet animal,
& où la falure des eaux & des alimens rend le peuple
très-fujet aux maladies de la peau : la loi qui le
défend dans ces contrées, eft donc purement locale,
& ne peut être bonne pour d’autres pays où
C O C
le Cochon eft une nourriture prefque univerfelle, &
en quelque façon néceffaire.
Sanélorius a obfervé que la chair de cochon fe tranf-
pire peu, & que la diminution de cette excrétion va
à un tiers dans ceux qui s’en nourriffent ; d’ailleurs
on fait que lé défaut de tranfpiration occafionne ou
aigrit les maladies de la peau : cette nourriture doit
donc être défendue dans les pays où l’on eft expofé
à ces maladies, comme la Paleftine, l’Arabie, l’Egypte
, la L ybie, &c. Voyeç T efprit des lois. I
Le cochon étoit immolé par les anciens aux Lares,
à Priape, aux Sylvains, à Bacchus, à Cérès, à Hercule
, &c. On facrifioit à Lacédémone un cochon de
chaque ventrée.
C o ch o n de G u inée,porcus guincenfis, Maregr.
animal quadrupède qui eft de couleur rouffe, & qui
reffemble à nos cochons pour la figure ; mais fa tête
n’eft pas fi élevée : fes oreilles font longues & pointues;
fa queue defeend fort bas, & n’eft point couverte
de poil non plus que le dos- Il y a fur tout le
refte du corps un poil court, roux & brillant ; mais
il eft plus long près de l’origine de la queue & autour
du cou. Rai, fynop. anim. quadr. Voye\_ Q uadrupède.
( / )
C o ch o n d’Ind e, cuniculusfiveporcellus indiens,
Gefn. mus feu cuniculus americanus, & guincenfis
porcelli pilis & voce. Au Brefil on donne à cet animal
le nom de cavia cabaya. Maregr. C ’eft un quadrupède
plus petit que le lapin; fon corps eft plus court
& plus gros : les oreilles font courtes, minces, tranfi
parentes, évafées, arrondies, prefqu’entierement
dégarnies de poil, & peu différentes de celles des
rats : le mufeau & la barbe reffemblent à ces mêmes
parties dans le lievre : la levre fupérieure eft fendue
comme celle du lapin. Le cochon d'Inde n’a point de
queue ; fes dents font femblables à celles des rats ,
& fon poil peut être comparé à celui du cochon. Il
crie comme les petits cochons, c’eft pourquoi on l’a
appellé cochon de Guinée. Sa couleur varie ; on en
voit de blancs, de roux & de noirs, & la plupart
font en partie blancs, & en partie roux & noirs. Il
y a quatre doigts aux piés de devant, & trois à ceux
de derrière; le doigt du milieu eft le plus long. Ces
animaux frotent leur tête avec les pattes de devant,
& s’affeyent fur celles de derrière comme les lapins ;
mais ils ne creufent pas en terre. Les femelles portent
jufqu’à huit petits à la fois. Les cochons d'Inde
vivent de foin& de toutes fortes de plantes : ils font
bons à manger, mais non pas excellens. R a i,fynop.
anim. quadr.
Cet animal eft naturalifé dans ce pays-ci, & mis
au nombre de nos animaux domeftiques. On l’éleve
aifément ; il ne craint que le grand froid. Foye{ Q uadrupède.
( / )
Cochon ch in o is . Cet animal eft parvenu en
Europe ; on le connoît en France. On dit qu’il eft plus
petit que notre cochon, qu’il a le dos concave &
pour ainfi dire enfellé , &c. On l’engraiffe, & il paffe
pour très-bon à manger.
C ochon-maron ; c’eft le nom que l’on donne
dans les îles de l’Amérique aux cochons que l’on y
a portés des autres parties du monde, & qui y font
devenus fauvages. On en diftingué de trois efpeces.
Ceux de la première font courts ; ils ont la tête
groffe, le mufeau peu alongé, & les défenfes fort
longues : les jambes de devant font plus courtes que
celles de derrière prefque d’un tiers, ce qui les fait
fouvent culbuter lorfqu’ils courent en defeendant.
Ils deviennent féroces & très-dangereux quand ils
font bleffés par les chaffeurs. On prétend qu’ils ont
été apportés par les Efpagnols dans le tems de la découverte
de l’Amérique, & qu’ils ont été tirés de Cadix
, où on en voit encore qui leur reffemblent beaucoup.
Tome I I f
C O C
Les cochonS-marons de la fécondé efpece ne diffe»
rent en aucune façon de nos cochons domeftiques,
& il paroît qu’ils fe font échappés des pares où on
les nourriffoit après avoir été tranfportés aux îles.
Enfin ceux de la troifieme efpece font appelles
cochons de Siam, parce qu’ils ont été apportés aux
îles par des vaiffeauxfrançoisqui revenoient de Siam
& de la Chine. ( 7)
COCHONNET, f. m. {Hifi. mod. Jeux.) efpece
de dé taillé à douze, faces pentagonales j chargées.
chacune d’un chiffre depuis i jufqu’à 12. On joue au
cochonnet comme aux dés.
On donne le même nom à une balle ou pierre que
celui qui a gagné le coup précédent jette à diferé-
tion, & à laquelle tous les joiieurs dirigent leurs
boules. La boule plus voifine du cochonnet gagne le
coup.
COCKERMOUTH, (Géog.mod.) ville d’Angleterre
dans la province de Cumberland. Long. 13.48*
loti 64. 44.
- COCK.IEN, f. m. {Comm.) monnoie de cours au
Japon : on l’évalue à environ huit francs de notre
monnaie préfente.
. C O C O , f. m. {Hifi. nat.) le coco eft le fruit d’uné
efpece de palmier qui s’élève à trente ou quarante
piés de hauteur {Foye^fig. 1. Plan. X X F I I . d'Hifi*
nat.) : fa tige eft droite ; elle diminue de groffeur à
mefure qu’elle s’éloigne de terre. On fait des inci-
fions aux tiges des jeunes arbres pour en tirer un fuc
vineux qui lert de boiffon : ce fuc donne par la distillation
de fort bonne eau-de-vie : en le Cuifant fui*
le feu on,l’adoucit; & au contraire on en fait du vinaigre
lorfqu’on le laiffe expofé au foleil. La tige eft
terminée à fon extrémité par des feuilles fort longues,
ôc larges à proportion : on s’en fert pour couvrir
les mailons, .pour faire des voiles de navire ,
des nattes, &c. Les habitans de ces pays écrivent
fur ces feuilles comme iiir du papier ou du parchemin.
Les fruits naiffent au fommet de la tige entre
les feuilles; iis font enveloppés plufieurs enfemble
dans une efpece de gaîne dont ils Sortent en groflïf-
fant : chacun de ces fruits eft gros comme la tête d’un
homme ; il eft oval, quelquefois rond ; trois côtes
qui Suivent fa longueur lui donnent une figure triangulaire.
Ce fruit eft compofé de deux écorces &
d’une fubftance moelleufe : l’écorce extérieure eft
verte ; l’intérieure eft brune. Lorfque le fruit n’eft
pas encore mur, on en tire une bonne quantité d’eair
claire, odorante, & fort agréable au goût. Il y a
des cocos qui contiennent jufqu’à trois ou quatre livres
de cette eau. Mais lorfque le fruit a pris fon
accroiffement, la moelle que renferment les écorces
prend de la confiftance, & il n’y a plus qu’une
cavité dans fon milieu qui foit remplie d’eau ; & alors
l’eau, quoique claire, n’eft pas fi douce qu’aupara-
vant. La moelle eft blanchâtre, & bonne à manger ;
fon goût approche de celui de la noifette ou de l’amande
; on en peut faire un lait comme on en fait
avec les amandes : fi on veut la conferver long-tems,
on la fait fécher au foleil. L ’écorce qui enveloppe
cette fubftance eft dure & ligneufe; on la polit &
on la travaille pour différens ufages, elle fert de mefure
des liquides à Siam : on gradue fa capacité avec
des cauris, petites écailles qui fervent de monnoie i
il y a des cocos de mille cauris, de cinq cents, &c
La fécondé, qui eft l’extérieure, eft liffe, de couleur
grife, & garnie en-dedans d’une forte de bourre rougeâtre
dont on fait des cables & des cordages : elle
vaut mieux que les étoupes pour calfeutrer les vaif*
féaux, parce qu’elle ne fe pourrit pas fi vîte, & parce
qu’elle fe renfle en s’imbibant d’eau.
* COCON, f. m. {Econ. rufi.) on donne ce nom
à ce tiffu filamenteux dans lequel le vers à foie s’enveloppe
, & dont on obtient en le dévidant par une
B B b b i j