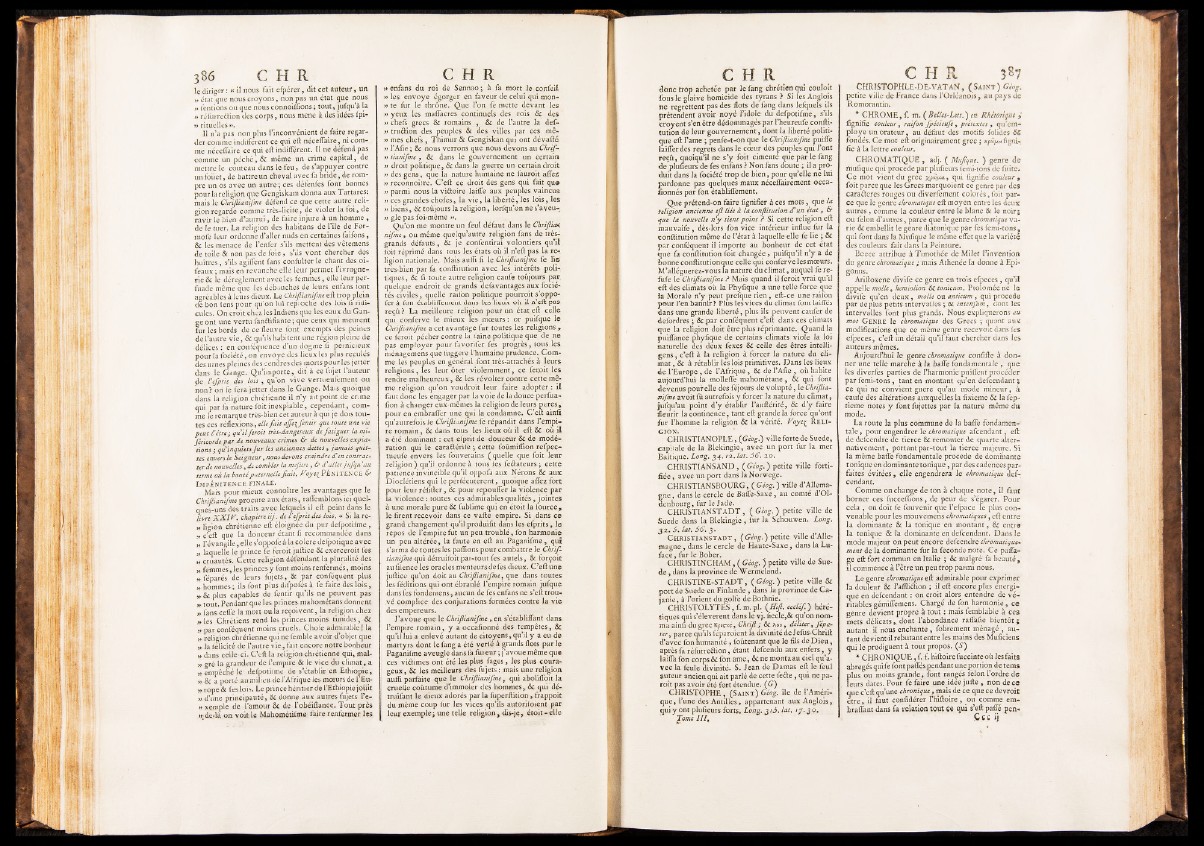
le diriger : « il nous fait efpérer, dit cet auteur, uu
» état que nous croyons, non pas un état que nous
» fendons ou que nous connoiflions ; tout, jufqu’à la
» rélurrettion des corps, nous mene à des idées Ipi-
» rituelles ». _ \ •
Il n’a pas non plus l’inconvénient de faire regarder
comme indifférent ce qui eft neceffaire, ni comme
néceffaire ce qui eft indifférent. Il ne défend pas
comme un pcché, 6c même un crime capital, de
mettre le couteau dans le feu, de s’appuyer contre
unfoiiet, de battre un cheval avec fa bride, de rompre
un os avec un autre ; ces défenfes font bonnes
pour la religion que Gengiskam donna aux Tartares:
mais le Chrifiianifme défend ce que cette autre religion
regarde comme très-licite, de violer la fo i, de
ravir le bien d’autrui, de faire injure à un homme ,
de le tuer. La religion des habitans de l’île de For-
mofe leur ordonne d’aller nuds en certaines faifons,
& les menace de l’enfer s’ils mettent des vêtemens
de toile & non pas de foie , s’ils vont chercher des
huîtres, s’ils agiffent fans confulter le chant des o i-
feaux ; mais en revanche elle leur permet l’ivrognerie
6c le déreglement avec les femmes, elle leur per-
fuade même que les débauches de leurs enfans lont
agréables à leurs dieux. Le Chrifiianifme eft trop plein
de bon fens pour qu’on lui repioche des lois fi ridicules.
On croit chez les Indiens que les eaux du Gange
ont une vertu fanttifiante ; que ceux qui meurent
fur les bords de ce fleuve font exempts des peines
de l’autre v ie , 6c qu’ils habitent une région pleine de
délices : en conféquence d’un dogme fi pernicieux
pour la fociété, on envoyé des lieux les plus recules
des urnes pleines des cendres des morts pour les jetter
dans le Gange. Qu’importe, dit à ce fujet l’auteur
de l'e fp r it des lo is , qu’on vive vertueufement ou
non? ori fe fera jetter dans le Gange. Mais quoique
dans la religion chrétienne il n’y ait point de crime
qui par fa nature foit inexpiable, cependant, comme
le remarque très-bien cet auteur à qui je dois toutes
ces réflexions, élit f a i t a jfe { fen tir que toute une vie
p eu t l'ê tr e ; q u 'il fc r o it trïs-dangereux de fatig ue r la mi-
féricorde p a r de nouv eaux crimes & de nouvelles ex p ia tion
s ; qu'inquiets J u r les anciennes dettes , jam a is quittes
envers U S e ign eu r , nous devons craindre d 'en contracter
de nou v elle s, de combler la mefure , & d 'a lle r ju fq u 'au
terme ou la b onté paternelle f in it . Voye{ Pén itence &
Impén itence finale.
Mais pour mieux connoître les avantages que le
Chrifiianifme procure aux états, raffemblons ici quelques
uns des traits avec lel'quels il eft peint dans le
livre X X I V . ckapitre i j . de l'e fp r it des lois. « Si lare-
„ ligion chrétienne eft éloignée du pur defpotifme,
„ c’eft que la douceur étant fi recommandée dans
>, l’évangile, elle s’oppofe à la colere defpotique avec
„ laquelle le prince fe feroit juftice & exerceroit fes
» cruautés. Cette religion défendant la pluralité des
» femmes, les princes y font moins renfermés, moins
„ féparés de leurs fujets, & .par conféquent plus
» hommes; ils font plus difpofés à fe faire des lois,
» 6c plus capables de fentir qu’ils ne peuvent pas
„ tout. Pendant que les princes mahométans donnent
» fansceffe la mort ou la reçoivent, la religion chez
„ les Chrétiens rend les princes moins timides, &
»■ par conféquent moins cruels. Çhofe admirable ! la
» religion chrétienne qui ne l'emble avoir d’objet que
». la félicité de L’autre v ie , fait encore notre bonheur
» dans celle-ci. C’eft la religion chrétienne qui, mal-
» gré la grandeur de l’empire & le vice du climat, a
» empêché le defpotilme de s’établir en Ethiopie,
» & a porté au milieu de l’Afrique les moeurs de i’Eu-
» rope & fes lois. Le prince héritier de l'Ethiopie joüit
».d’une principauté, 6c donne aux autres fujets l’e-
»xemple de l’amour & de Tobéiflance. Tout près
rçdedà on voit, le Mahométifme faire renfermer les
» enfans du roi de Sennao ; à fa mort le co,nfeil
» les envoyé égorger en faveur de celui qui mon-
» te fur le thrône. Que l’on fe mette devant les
» yeux les maffacres continuels des rois 6c des
» chefs grecs & romains , & de l’autre la def-
» truttion des peuples & des villes par ces mê-
» mes chefs, Thimur & Gengiskan qui ont dévafté
» l’Afie ; 6c nous verrons que nous devons au Chrif-
» tianifme , 6c dans le gouvernement un certain
» droit politique, 6c dans la guerre un certain droit
» des gens, que la nature humaine ne fauroit allez
» reconnoître. C ’eft ce droit des gens qui fait qu»
» parmi nous la vittoire laiffe aux peuples vaincus
» ces grandes chofes, la v ie , la liberté, les lois, les
» biens, 6c toujours la religion, lorfqu’on ne s’a v eu-
» gle pas foi-même ».
Qu’on me montre un feul défaut dans le Chrifiia*,
nifme, ou même quelqu’autre religion fans de très-
grands défauts, & je confentirai volontiers qu’il
l'oit réprimé dans tous les états où il n’eft pas la re-;
ligion nationale. Mais aufli li le Chrifiianijme fe lie
très-bien par fa conftitution avec les intérêts polir
tiques, 6c fi toute autre religion caufe toujours par,
quelque endroit de grands defavantages aux focié-
tés civiles, quelle railon politique pourroit s’oppo-
fer à fon établiflement dans les lieux où il n’eft pas
reçu ? La meilleure religion pour un état eft celle
qui; conferve le mieux les moeurs : or puifque le
Chrifiianifme a cet avantage fur toutes les religions,
ce feroit pécher contre la laine politique que de ne
pas employer pour favorifer fes progrès, tous les
ménagemens que luggere l’humaine prudence. Com*
me les peuples en général font très-attachés à leurs
religions , les leur ôter violemment, ce feçoit les
rendre malheureux, & les révolter contre cette même
religion qu’on voudroit leur faire adopter : il
faut donc les engager par la voie de la douce perfua-
fion à changer eux-mêmes la religion de leurs peres,
pour en embraffer une qui la condamne. C’eft ainfi
qu’autrefois le ChrifiiimiJ’me fe répandit dans l’empire
romain, 6c dans tous les lieux où il eft 6c où il
a été dominant : cet efprit de douceur 6c de modération
.qui le carattérife ; cette foûmiflion refpec-
tueufe envers les fouverains ( quelle que foit leur
religion ) qu’il ordonne à tous fes fettateurs ; cette
patience invincible qu’il oppofa aux Nérons & aux
Dioclétiens qui le perfécuterent, quoique affez fort
pour leur réfifter, 6c pour repoulfer la violence par
la violence : toutes ces admirables qualités, jointes
à une morale pure 6c fublime qui en étoit la fourçe ^
le firent recevoir dans ce vafte empire. Si dans ce
grand changement qu’ il produifit dans les efprits, le
repos de l’empire fut un peu troublé, fon harmonie
un peu altérée, la faute en eft au Paganifme, qui
s’arma de toutes les pallions pour combattre le Chrif-
tianifme qui détruifoit par-tout fes autels, & forçoit
aufilence les oracles menteurs de fes dieux. C ’eft une
juftice qu’on doit au Chrijlianifme, que dans toutes
les féditions qui ont ébranlé l’empire romain jufque
dans fes fondemens, aucun de fes enfans ne s’eft trou-.
,vé complice des conjurations formées contre la vie
des empereurs.
J’avoue que le Chrijlianifme, en s’établiffant dans
l’empire romain, y a occafionné des tempêtes, &
qu’il lui a enlevé autant de citoyens, qu’il y a eu de
martyrs dont lefang a été verle à grands flots parle
Paganifme aveugle dansfa fureur ; j’avoue même que
ces vittimes ont été les plus fages, les plus courageux,
6c les meilleurs des fujets: mais une religion
auffi parfaite que le ChriJHaniJme, qui abolilToit la
cruelle coutume d’immoler des hommes, 6c qui dé-
truifant le dieux adorés parla fuperftition, frappoit
du même coup fur les vices qu’ils autoriloient par
leur exemple; une telle religion, dis-je, étoit-elle
donc trop achetée par le fang chrétien qui couïoit
fous le glaive homicide des tyrans ? Si les Anglois
lie regrettent pas des flots de fang dans lefquels ils
prétendent avoir noyé l’idole du defpotifme, s’ils
croyent s’en être dédommagés par l’heureufe conftitution
de leur gouvernement, dont la liberté politique
eft l’ame ; penfe-t-on que le Chrifiianifme puiffe
iaifferdes regrets dans le coeur des peuples qui l’ont
reçû, quoiqu’il ne s’y foit cimenté que par le fang
de plufieurs de fes enfans ? Non fans doute ; il a produit
dans la fociété trop de bien, pour qu’elle ne lui
pardonne pas quelques maux néceffairement occasionnés
par fon établiflement.
Que prétend-on faire fignifier à ces mots, que la
teligion ancienne éfi liée à la confiitution d'un état, &
que la nouvelle n'y tient point ? Si cette religion eft
mauvaife, dès-lors fon vice intérieur influe fur la
conftitution même de l’état à laquelle elle fe lie ; 6c
par conféquent il importe au bonheur de cet état
que fa conftitution foit changée , puifqu’il n’y a de
bonne conftitution que celle qui conferve les moeurs.
M’alléguerez-vous la nature audimat, auquel fe re-
fufe le Chrifiianifme ? Mais quand il feroit vrai qu’il
eft des climats où la Phyfique a une telle force que
la Morale n’y peut prefque rien, eft-ce une raifon
pour l’en bannir? Plus les vices du climat font lailfés
dans une grande liberté, plus ils peuvent caufer de
defordres ; & par conféquent c’eft dans ces climats
que la religion doit être plus réprimante. Quand la
puiffance phyfique de certains climats viole la loi
naturelle des deux fexes 6c celle des êtres intelli-
gens, c ’eft à la religion à forcer la nature du climat
, & à rétablir les lois primitives. Dans les lieux
de l ’Europe , de l’Afrique, & de l’Afie , où habite
aujourd’hui la mollefle mahométane, & qui font
devenus pouf elle des féjours de volupté, le Chrifiia-
nifmc avoit fû autrefois y forcer la nature du climat,
jufqu’au point d’y établir l’auftérité, & d’y faire
fleurir la continence, tant eft grande la force qu’ont
fur l’homme la religion & la vérité. Voye{ Relig
io n .
CHRISTIANOPLE, (Géog.') ville forte de Suede,
capitale de la Blekingie, avec un port fur la mer
Baltique. Long. 3 4 . 12. lat. 56. 20.
CHRISTIANSAND, {Géog.) petite ville fortifiée,
avec un port dans la Norvège.
CHRISTIANSBOURG, ( Géog. ) ville d’Allemagne
, dans le cercle de Baffe-Saxe, au comté d’Oldenbourg,
fur le Jade.
CHRISTIANSTADT, ( Géog. ) petite ville de
Suede dans la Blekingie , fur la Schouven. Long»
j 2. 5. lat. 56. 3* ■
C h r is t ia n s t a d t , {Géog.) petite ville d’AIIe*
magne, dans le cercle de Haute-Saxe, dans la Lu-
face , fur le Bober.
CHRISTINCHAM, ( Géog. ) petite ville de Suede
, dans la province de Wermeland.
CHRISTINE-STADT, {Géog.) petite ville &
port de Suede en Finlande, dans la province de Ca-
ianie, à l’orient du golfe de Bothnie.
CHRISTOLYTES, f. m. pi. {Hifi. eccléf.^ ) hérétiques
qui s’élevèrent dans le vj. fiecle,& qu’on nomma
ainfi du grec Kpiçoc, Chrifi ; & Xuo, déliter, fépa-
rer, parce qu’ils féparoient la divinité de Jefus-Chrift
d’avec fon humanité, foûtenant que le fils de D ie u ,
après fa réfurrettion, étant defeendu aux enfers , y
laiffa fon corps & fon ame, & ne monta au ciel qu’avec
la feule divinité. S. Jean de Damas eft le feul
auteur ancien qui ait parlé de cette fette, qui ne pa-
roît pas avoir été fort étendue. (G)
CHRISTOPHE, (Sa in t ) Géog. île de l’Amérique
, l’une des Antilles, appartenant aux Anglois,
qui y ont plufieurs forts. Long. 3 /5. lat, /7.30.
Tome ƒ//,
CHRISTOPHLE-DE-VATAN, (Saint) Géog.
petite ville de France dans l’Orléanois , au pays de
Romorantin.
* CHROME, f. m. {Belles-Lett.) en Rhétorique
lignifie couleur, raifon fpécieufe, prétextes , qu'employé
un orateur, au défaut des motifs folides &C
fondés. C e mot eft originairement grec ; Kpapaiigni*.
fie à la lettre couleur.
CHROMATIQUE , adj. ( Mufique. ) genre de
mufique qui procédé par plufieurs lemi-tons de fuite.
Ce mot vient du grec xpaput, qui lignifie couleur,
foit parce que les Grecs marquoient ce genre par des
caratteres rouges ou diverfement colorés, foit parce
que le genre chromatique eft moyen entre les deux
autres, comme la couleur entre le blanc 8t le noir;
où félon d’autres, parce que le genre chromatique varie
& embellit le genre diatonique par fes femi-tons,
qui font dans la Mufique le même effet que la variété
des couleurs fait dans la Peinture.
Boece attribue à Timothée de Milet l’invention
du genre chromatique ; mais Athenée la donne à Epi*
gonus.
Ariftoxene divife Ce genre en trois efpeces, qu’il
appelle molle, hemiolion 6c tonicum. Ptolomée ne le
divife qu’en deux, molle ou anticüm, qui procédé
par de plus petits intervalles ; & intenfum, dont les
intervalles font plus grands. Nous expliquerons au
mot Genre le chromatique des Grecs ; quant aux
modifications que ce même genre recevoir dans fes
elpeces, c’eft un détail qu’il faut chercher dans les
auteurs mêmes.
Aujourd’hui le gente chromatique confifte à donner
une telle marche à la baffe fondamentale , que
les diverfes parties de l’harmonie puiffent procéder
par femi-tôns, tant en montant qu’en defeendant ;
ce qui ne convient guere qu’au mode mineur, à
caufe des altérations auxquelles la fixieme & lafep-
tieme notes y font fujettes par la nature même du
mode.
La route la plus commune de la baffe fondamentale
, pour engendrer le chromatique afeendant, eft
de defeendre dê tierce 6c remonter de quarte alternativement,
portant par-tout la tierce majeure. Si
la même baffe fondamentale procédé de dominante
tonique en dominante tonique, par des cadences parfaites
évitées , elle engendrera le chromatique defeendant.
Comme on change de ton à chaque note, il faut
borner ces fuccefiions, de peur de s’égarer. Pour
cela , on doit fe fouvenir que l’efpace le plus convenable
pour les mouvemens chromatiques, eft entre
la dominante & la tonique en montant, & entra
la tonique & la dominante en defeendant. Dans le
mode majeur on peut encore defeendre chromatique-
ment de la dominante fur la fécondé note. Ce paffa-
ge eft fort commun en Italie ; 6c malgré fa beauté ,
il commence à l’être un peu trop parmi nous.
Le genre chromatique eft admirable pour exprimer,
la douleur 6c l’afflittion ; il eft encore plus énergique
en defeendant : on croit alors entendre de véritables
gémiffemens. Chargé de fon harmonie, ce
genre devient propre à tout : mais femblable à ces
mets délicats ^ dont l’abondâncè rafî'afie bientôt ;
autant il nous enchante, fobrement ménagé , autant
devient-il rebutant entre les mains des Muficiens
qui le prodiguent à tout propos. { S )
* CHRONIQUE, f. f. hiftoirefuccinteoù les faits
abrégés qui fe font paffés pendant une portion de tems
plus ou moins grande, font rangés félon l’ordre de
leurs dates. Pour fe faire une idée jufte , non de ce
que ç’eft qu’une chronique, mais de ce que ce devroit
être, il mut confidérer l’hiftoire, ou comme em-
braffant dans fa relation tout ce qui s’eft paffé pen