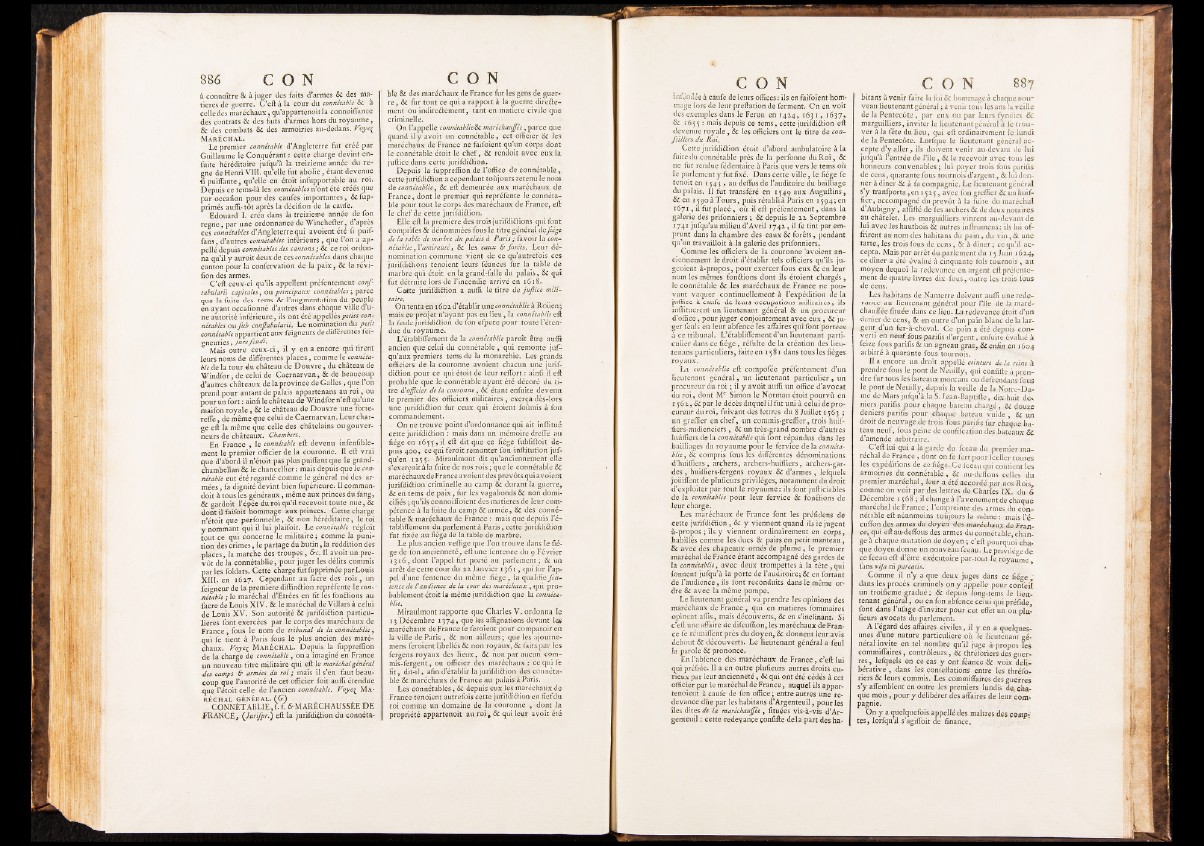
à connoître & à juger des faits d’armes 8c des matières
de guerre. C ’eft à la cour du connétable 8c à
celle des maréchaux, qu’appartenoit la connoiffance
des contrats & des faits d’armes hors dii royaume,
& des combats 8c des armoiries au-dedans. Vyye(
Maréchal.
Le premier connétable d’Angleterre fut créé par
Guillaume le Conquérant : cette charge devint en-
fuite héréditaire jufqu’à la treizième année du régné
de Henri VIII. qu’elle fut abolie, étant devenue
fi puiffante, qu’elle en étoit infupportable au roi.
Depuis ce tems-là les. connétables n’ont été créés que
par occafion p.our des caufes importantes, 8c fup-
primés auffi-tôt après la décifion de la caufe.
Edouard I. créa dans la treizième année de fon
régné, par une ordonnance de"Wmchefter, d’après
ces connétables d’Angleterre qui avoient été fi puif-
fans, d’autres connétables inférieurs , que l’on a ap-
pellé depuis connétables des cantons j8 c ce roi ordonna
qu’il y auroit deux de ces connétables dans chaque
canton pour la confervation de la paix, & la révision
des armes.
C’eft ceux-ci qu’ils appellent préfentement conf.
tabulant capitales, ou principaux connétables ; parce
que la fuite des tems & l’augmentation du peuple
en ayant occalionné d’autres dans chàque ville d’une
autorité inférieure, ils ont été appellés petits connétables
ou fub conjlabularii. Le nomination du petit
connétable appartient aux feigneurs de différentes Seigneuries
, jurefeudi. ^ . .
Mais outre ceux-ci, il y en a encore qui tirent
leurs noms de différentes places, comme le connétable
de la tour du château de D ouv re, du château de
Windfor, de celui de Caernarvan, & de beaucoup
d’autres châteaux de la province de Galles, que l’on
prend pour autant de palais appartenans au ro i, ou
pour un fort : ainfi le château de 'Windfor n’eft qu’une
maifon royale, & le château de Douvre une forte-
reffe, de même que celui de Caernarvan. Leur charge
eft la même que celle des châtelains ou gouver^
neurs de châteaux. Chambers.
En France , le connétable eft devenu infenfible-
ment le premier officier de la couronne. Il eft vrai
que d’abord il n’étoit pas plus puiffant que le grand-
chambellan 8c le chancellier : mais depuis que le connétable
eut été regardé comme le général né des armées
, fa dignité devint bien fupérieure. Il coraraan-
doit à tous les généraux, même aux princes du fang,
& gardoit l’épée du roi qu’il recevoit toute nue, 8c
dont il faifoit hommage aux princes. Cette charge
n’étoit que perfonnelle, & non héréditaire, le roi
y nommant qui il lui plaifoit. Le connétable régloit
tout ce qui concerne le militaire ; comme la punition
des crimes, le partage du butin, la reddition des
places, la marche des troupes, &c. Il avoit un prév
ô t de la connétablie, pour juger les délits commis
parles foldats. Cette charge fut fupprimée par Louis
XIII. en 1617. Cependant au facre des rois, un
feigneur de la première diftinttion repréfente le co n nétable
; le maréchal d’Etrées en fit les fondions au
facre de Louis XIV. & le maréchal de Villars à celui
de Louis X V . Son autorité & jurifdiûion particulières
font exercées par le corps des maréchaux de
France, fous le nom de tribunal de la connetablie,
qui fe tient à Paris fous le plus ancien des maréchaux.
Voye^ Maréchal. Depuis la fuppreffion
de la charge de connétable , on a imaginé en France
un nouveau titre militaire qui eft le maréchal général
des camps & armées du roi ; mais il s’en faut beaucoup
que l’autorité de cet officier foit auffi étendue
-que l’etoit celle de l’ancien connétable. Voye{ Maréchal
GÉNÉRAL. (G )
CONNÉTABLIE, f. f. & MARÉCHAUSSÉE D E
FRANCE, (Jurifpr.) eft la jurifdiéUon du conuétable
& des maréchaux de France fur les gens de guerre
, 8c fur tout ce qui a rapport à la guerre direfte-
ment ou indiredement, tant en matière civile que
criminelle.
On l’appelle connétablie 8c maréchaujfée, parce que
quand il y avoit un connétable, cet officier 8c les
maréchaux de France ne faifoient qu’un corps dont
le connétable étoit le chef, 8c rendoit avec eux la
juftice dans cette jurifdidion.
Depuis la fuppreffion de l’office de connétable,
cette jurifdidion a cependant toujours retenu le nom
de connétablie, & eft demeurée aux maréchaux de
France, dont le premier qui repréfente le connétable
pour tout le corps des maréchaux de France, eft
le chef de cette jurifdidion.
Elle eft la première des trois jurifdidiôns qui font
comprifes & dénommées fous le titre général defiége
de la table de marbre du palais à Paris ; fa voir la connétablie
,V amirauté, 8c les eaux & forêts. Leur dénomination
commune vient de ce qu’autréfois ces
jurifdidiôns tenoient leurs féances fur la table de
marbre qui étoit en la grand-fallè du palais, 8c qui
fut détruite lors de l’incendie arrivé en 1618.
Cette jurifdidion a auffi le titre de jufiice militaire.
On tenta en 1602 d’établir une connétablie à Roiien;
mais ce projet n’ayant pas eu lieu, la connétablie eft
la feule jurifdi£Hon de fon efpece pour toute l’étendue
du royaume.
L’établiffement de la connétablie paroît être auffi
ancien que celui du connétable , qui remonte jusqu’aux
premiers tems de la monarchie. Les grands
officiers de la couronne avoient chacun une jurif-.
didion pour ce qui étoit de leur reffort : ainfi il eft
probable que le connétable ayant été décoré du titre
officier de la couronne, 8c étant cnfuite devenu
le premier des officiers militaires , exerça dès-lors
une jurifdidion fur ceux qui étoient fournis à fon
commandement.
On ne trouve point d’ordonnance qui ait inftitué
cette jurifdidion : mais dans un mémoire dreffé au
liège en 1655, il eft dit que ce fiége fubfiftoit depuis
400, ce qui feroit remonter fon inftitution juf-
qu’en 1255. Miraulmont dit qu’anciennement elle,
s’exerçoitàia fuite de nos rois ; que le connétable 8c
maréchaux de France avoient des prévôts qui avoient
jurifdidion criminelle au camp 8c durant la guerre,
& en tems de paix, fur les vagabonds 8c non domiciliés
; qu’ils connoiffoient des matières,de leur compétence
à la fuite du camp 8c armée, 8c des connétable
& maréchaux de France : mais que depuis l’é—
tabliffement du parlement à Paris, cette jurifdidion
fut fixée au fiége de la table de marbre.
Le plus ancien veftige que l’on trouve dans le fiége
de fon ancienneté, eft une fentence du 9 Février
1316, dont l’appel fut porté au parlement; & un
arrêt de cette cour du 22 Janvier 136 1 , qui fur l’appel
d’une fentence du même liège , la qualifie fentence
de l'audience de la cour des maréchaux, qui probablement
étoit la même jurifdidion que la connétablie
.M
iraulmont rapporte que Charles V . ordonna le
13 Décembre 1374, que les affignations devant lç£
maréchaux de France fe feroient pour comparoir en
la ville de Paris , 8c non ailleurs ; que les ajourne-
mens feroient libellés 8c non royaux, 8c faits par les
fergens royaux des lieux, 8c non par aucun com-
mis-fergent, ou officier des maréchaux : ce qui fe
fit, dit-il, afin d’établir la jurifdidion des connétable
& maréchaux de France au palais à Paris.
Les connétables, 8c depuis eux les maréchaux de
France tenoient autrefois cette jurifdidion en fief du
roi comme un domaine de la couronne , dont la
propriété appartenait au r o i, 8c qui leur avoit été
inféodée à caufe de leurs offices : ils en faifoient hommage
lors de leur preftation de ferment. Gn en voit
des exemples dans le Feron en 1424, 16 3 1 , 1637,
"8c 1655 : mais depuis ce tems, cette jurifdidion eft
devenue royale, & les officiers ont le titre de con-
feillers du Roi.
Cette jurifdidion étoit d’abord ambulatoire à la
fuite du connétable près de la perfonne du R o i, 8c
ne fut rendue fédentaire à Paris que vers le tems oit
le parlement y fut fixé. Dans cette v ille , le fiége fe
tenoit en 1543» au deffus de l’auditoire du bailliage
du palais. Il fut transféré en 1549 aux Auguftins,
& en 1590 à Tours, puis rétabli à Paris en 1594; en
16 7 1 , il fiit p lacé, oit il eft préfentement, dans la
galerie des prifonniers ; 8c depuis le 22 Septembre
1741 jttfqu’au milieu d’Avril 1742, il fe tint par emprunt
dans la chambre des eaux 8c forêts, pendant
qu’on travailloit à.la galerie des prifonniers.
Comme les officiers de la couronne [avoient anciennement
le droit d’établir tels officiers qu’ils ju-
geoient à-propos, pour exercer fous eux 8c en leur
nom les mêmes fondions dont ils étoient chargés,
le connétable 8c les maréchaux de France ne pouvant
vaquer continuellement à l’expédition de la
juftice à caufe de leurs occupations militaires, ils
inftituerent un lieutenant général & un procureur
d’office, pour juger conjointement avec eu x, & juger
feuls en leur abfence les affaires qui font portées
à ce tribunal. L’établiffement d’un lieutenant particulier
dans ce fiége, réfulte de la création des lieu-
tenans particuliers, faite en 1581 dans tous les fiéges
royaux.
La connétablie eft compofée préfentement d’un
lieutenant général, un lieutenant particulier, un
procureur du roi ; il y avoit auffi un office d’avocat
du roi, dont Me Simon le Norman étoit pourvu en
1562, & par le décès duquel il fut uni à celui de procureur
du roi, fuivant des lettres du 8 Juillet 1563 ;
un greffier en chef, un commis-greffier, trois huif-
fiers-audienciers, 8c un très-grand nombre d’autres
huiffiers de la connétablie qui font répandus dans les
bailliages du royaume pour le fervice de la connétablie
, & compris fous les différentes dénominations
d’huiffiers , archers, archers-huiffiers, archers-gardes
, huiffiers-fergens royaux 8c d’armes , lefquels
joiiiffent de plufieurs privilèges, notamment du droit
d’exploiter par tout le royaume: ils font jufticiables
de la connétablie pour leur fervice & fondions de
leur charge.
Les maréchaux de France font les préfidens de
cette jurifdiftion, 8c y viennent quand ils le jugent
à-propos ; ils y viennent ordinairement en corps,
habillés comme les ducs & pairs en petit manteau,
& avec des chapeaux ornés de plume , le premier
maréchal de France étant accompagné des gardes de
la connétablie, avec deux trompettes à la tête ,qui
fonnent jufqu’à la porte de l’auditoire; & en fortant
de l’audience, ils font reconduits dans le même ordre
& avec la même pompe.
Le lieutenant général va prendre les opinions des
maréchaux de France , qui en matières fommaires
opinent affis, mais découverts, & en s’inclinant. Si
c’eft une affaire de difcuffion, les maréchaux de France
fe réunifient près du doyen, 8c donnent leur avis
debout & découverts. Le lieutenant général a feul
la parole 8c prononce.
En l’abfence des maréchaux de France, c’eft lui
qui préfide. Il a en outre plufieurs autres droits curieux
par leur ancienneté, 8c qui ont été cédés à cet
officier par le maréchal de France, auquel ils appar-
tenoient à caufe de fon office ; entre autres une redevance
dûe par les habitans d’Argenteuil, pour les
îles dites de la maréckauffiée , fituées vis-à-vis d’Argenteuil
: cette redevance çonfifte delà part des habitans
à venir faire la foi 8c hommage à chaque nouveau
lieutenant général ; à venir tous les ans la veille
de la Pentecôte, par eux ou par leurs fyndics 8c
marguilliers, inviter le lieutenant général à fe trouver
à la fête du lieu, qui eft ordinairement le lundi
de la Pentecôte. Lorfque le lieutenant général accepte
d’y aller, ils doivent venir au-devant de lui
jufqu’à l’entrée de l’île , 8c le recevoir avec tous les
honneurs convenables ; lui payer trois fous parifis
de cens, quarante fous tournois d’argent, & lui donner
à dîner & à fa compagnie. Le lieutenant général
s’y tranfporta, en 1525, avec fon greffier & un huif-
fier, accompagné du prévôt à la fuite du maréchal
d’Aubigny, affifté de fes archers 8c de deux notaires
au châtelet. Les marguilliers vinrent au-devant de
lui avec les hautbois 8c autres inftrumens : ils lui offrirent
au nom des habitans du pain, du v in , & une
tarte, les trois fous de cens, & à dîner ; ce qu’il accepta.
Mais par arrêt du parlement du 15 Juin 1624,
ce dîner a été évalué à cinquante fols tournois , au
moyen dequoi la redevance en argent eft préfentement
de quatre livres dix fo.us, outre les trois fous
de cens.
Les habitans de Nanterre doivent auffi une redevance
au lieutenant générai pour l’île de la maré-
chauffée fituée dans ce lieu. La redevance étoit d’un
denier de cens, & en outre d’un pain blanc de la largeur
d’un fer-à-cheval. Ce pain a été depuis converti
en neuf fous parifis d’argent, enfuite évalué à
feize fous parifis & un agneau gras,.& enfin en 1604
arbitré à quarante fo\is tournois.
•Il a encore un droit appelle ceinture de là reine à
prendre fous le pçnt de Neuilly, qui çonfifte àpren-
dre fur tous les bateaux montans ou defeendans fous
le pont de Neuilly, depuis la veille de la Notre-Dame
de Mars jufqu’à ;la S. Jean-Baptifte, dix-huit dev
niers parifis pour chaque bateau chargé,, 8c dwze
deniers parifis pour chaque bateau vuide , & un
droit de neuvage de trois fous parifis fur .chaque bateau
neuf, fous peine de confiscation des-bateaux &
d’amende arbitraire.
r C eft lui qui a la garde du fceau du premier maréchal
de France, dont on fe fert pour fceller toutes
les expéditions de ce fiége..Ce fceau qui contient les
armoiries du connétable, 8c au-deffous celles du
premier maréchal, leur ;a,été accordé paréos Rois,
comme.qn voit par des lettres de,Charles IX. du 6
Décembre 1568 ; il change,à l’avenement de chaque
maréchal de France ; l ’empreinte :des armes du connétable
eft néanmoins tçjûjours la même-: mais l’é-
euffon des armes du doyen des maréchaux.de France,
qui eft au-deffous des . armes du connétable change
à chaque mutation de doyen ; c’eft pourquoi chaque
doyen donne un nouveau fceau. L e privilège de
ce fceau eft d’être exécutoire partout fe royaume
fans vijam pareatis.
Comme il n’y a que deux juges dans ce fiége,
dans les procès criminels on y appelle pour çonfeil
un troifieme gradué.; & depuis long-tems le lieutenant
général, ou en fon abfence celui qui préfide
font dans l’ufage d’inviter pour cet effet un ou plufieurs
avocats du parlement.
A l’égard des affaires civiles.,.il y e n a quelques-
unes d’une nature particulière oîi le lieutenant général
invite en tel nombre qu’il juge à-propos les
commiffaires, contrôleurs., & thréloriersdes guerres,
lefquels en ce cas ;y ont féance & voix délibérative
, dans les conteftations entre les thréfo-
riers 8c leurs commis. Les commiffaires des guerres
s’y affemblent en outre les premiers lundis de. chaque
mois ,,pour y délibérer des affaires de leur compagnie.
On y a quelquefois appellé des maîtres des compi
tes, lorfqu’il s’agiffoit de finance.