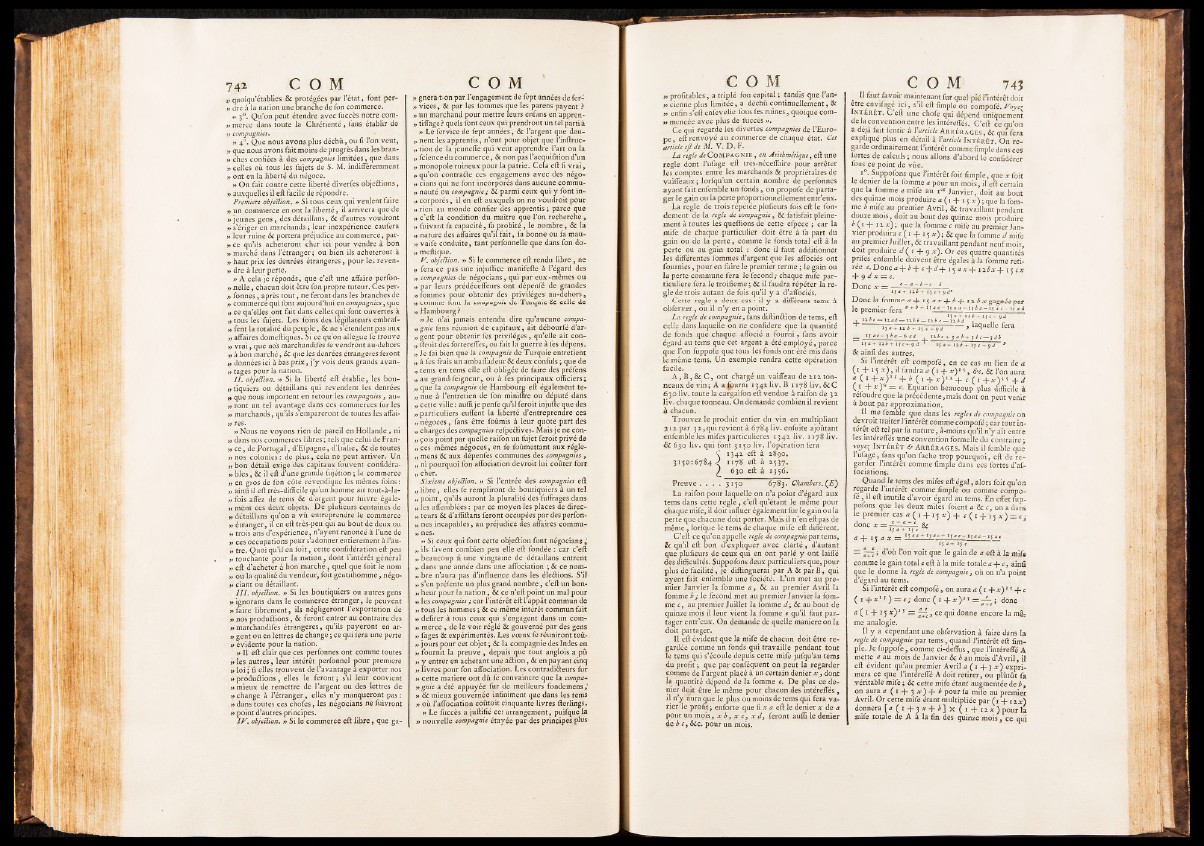
74* C O M
d quoiqu’établies & protégées par l’état, font per-
» dre à la nation une branche de fon commerce.
>» 3°. Qu’on peut étendre avec fuccès notre com-
» merce dans toute la Chrétienté, fans établir de
» compagnies.
» 4°. Que nous avons plus déchu, ou li l’on veut,
» que nous avons fait moins de progrès dans les bran-
» ches confiées à des compagnies limitées, que dans
» celles où tous les fujets de S. M. indifféremment
» ont eu la liberté du négoce,
» On fait contre cette liberté diverfes objections,
» auxquelles il eft facile de répondre.
Première objection. » Si tous ceux qui veulent faire
» un commerce en ont la liberté, il arrivera que de
» jeunes gens, des détaillans, 6c d’autres voudront
» s’ériger en marchands ; leur inexpérience caufera
» leur ruine & portera préjudice au commerce, par-
» ce qu’ils achèteront cher ici pour vendre à bon
» marché dans l’étranger ; ou bien ils achèteront à
» haut prix les denrées étrangères, pour les reven-,
» dre à leur perte.
» A cela je réponds, que c’eft une affaire perfon-
» nelle, chacun doit être fon propre tuteur. Ces per-
» fonnes, après tout, ne feront dans les branches de
>> commerce qui font aujourd’hui en compagnies, que
» ce qu’elles ont fait dans celles qui font ouvertes à
» tous les fujets. Les foins des légiflateurs embraf-
» fent la totalité du peuple, & ne s’étendent pas aux
» affaires domeftiques. Si ce qu’on allégué fe trouve
,, v rai, que nos marchandifes fe vendront au-dehors
» à bon marché, & que les denrées étrangères feront
» données ici à bas prix, j’y vois deux grands avanie
tages pour la nation.
II. objection. » Si la liberté eft établie, les bou-
» tiquiers ou détaillans qui revendent les denrées
» que nous importent en retour les compagnies , au-
» ront un tel avantage dans ces commerces fur les
» marchands, qu’ils s’empareront de toutes les affai-
» res.
» Nous ne voyons rien de pareil en Hollande, ni
» dans nos commerces libres ; tels que celui de Fran-
» ce , de Portugal, d’Efpagne, d’Italie, 6c de toutes
» nos colonies : de plus, cela ne peut arriver. Un
» bon détail exige des capitaux fouvent confidéra-
» b lés, 6c il eft d’une grande fujétion ; le commerce
„ en gros de fon côté révendique les mêmes foins :
» ainfi il eft très-difficile qu’un homme ait tout-à-la-
» fois affez de tems 6c d’argent pour luivre égale- ;
» ment ces deux objets. De plufieurs centaines de
» détaillans qu’on a vû entreprendre le commerce
» étranger, il en eft très-peu qui au bout de deux ou
» trois ans d’expérience, n’ayent renoncé à l’une de
„ ces occupations pour s’adonner entièrement à l’au-
» tre. Quoi qu’il en foit, cette confidération eft peu
„ touchante pour la nation, dont l’intérêt général
» eft d’acheter à bon marché, quel que foit le nom
» ou la qualité du vendeur, foit gentilhomme, négo-
» ciant ou détaillant.
II I . objection. » Si les boutiquiers ou autres gens
» ignorans dans le commerce étranger, le peuvent
» faire librement, ils négligeront l’exportation de
» nos productions, & feront entrer au contraire des
» marchandifes étrangères, qu’ils payeront en ar-
» gent ou en lettres de change ; ce qui lèra une perte
» évidente pour la nation.
» Il eft clair que ces perfonnes ont comme toutes
» les autres, leur intérêt perfonnel pour première
*» loi ; fi elles trouvent de l’avantage à exporter nos
» productions, elles le feront ; s’il leur convient
» mieux de remettre de l ’argent ou des lettres de
» change à l’étranger, elles n’y manqueront pas :
» dans toutes ces chofes, les négocians ne fuivront
i> point d’autres principes.
IK. objection. » Si le commerce eft libre, que ga-
C O M
» gnera-t on par l’engagement de fept années de fer-
» v ices, & par les lommes que les parens payent ?
» un marchand pour mettre leurs enfans en appren-
» tiffage ? quels font ceux qui prendront un tel parti à
» Le fervice de fept années, 6c l’argent que don-
» nent les apprentis, n’ont pour objet que l’inftruc-
»tion de la jeuneffe qui veut apprendre l’art ou la
» fcience du commerce, & non pas l’acquifition d’un
» monopole ruineux pour la patrie. Cela eft fi v rai,
» qu’on contraûe ces engagemens avec des négo-
» dans qui ne font incorporés dans aucune commu-
» nauté ou compagnie; 6c parmi ceux qui y font in-
» corporés, il en eft auxquels on ne voudroit pour
»rien au monde confier des apprentis; parce que
» c’eft la condition- du maître que l’on recherche >
» fuivant fa capacité, fa probité , le nombre, & la
» nature des affaires qu’il fait, fa bonne ou fa mau-
» vaife conduite, tant perfonnelle que dans fon do-
» meftique.
V. objection. » Si le commerce eft rendu libre, ne
» fera-ce pas une injuftice manifefte à l’égard des
y, compagnies de négocians,-qui par eux-mêmes ou
» par leurs prédéceffeurs ont dépenfé de grandes
» fommes pour obtenir des privilèges au-dehors,
» comme font la compagnie de Turquie 6c celle de
» Hambourg ?
» Je n’ai jamais entendu dire qu’aucune compa-
» gnie fans réunion de capitaux, ait débourfé d’ar-
» gent pour obtenir fes privilèges, qu’elle ait con-
» llruit des fortereffes, ou-fait la guerre à fes dépens.
» Je fai bien que la compagnie de Turquie entretient
» à fes frais un ambaffadeur & deux confuls ; que de
» tems en tems elle eft obligée de faire des préfens
»au grand-feigneur, ou à fes principaux officiers ;
» que la compagnie de Hambourg eft également te-
» nue à l’entretien de fon miniftre ou député dans
» cette ville: auffi je penfe qu’il feroit injufte que des
» particuliers euffent la liberté d’entreprendre ces
» négoces, fans être foûmis à leur quote part des
» charges des compagnies refpe&ives. Mais je ne con-
» çois point par quelle raifon un fujet feroit privé de
» ces mêmes négoces, en fe foumettant aux régle-
» mens 6c aux dépenles communes des compagnies >
» ni pourquoi fon affociation devroit lui coûter fort
»cher.
Sixième objection. » Si l’entrée des compagnies eft
» libre, elles fe rempliront de boutiquiers à un tel
» point, qu’ils auront la pluralité des fuffrages dans
» les affemblées : par ce moyen les places de direc-
» teurs 6c d’afîiftans feront occupées par des perfon-
» nés incapables, au préjudice des affaires commu-
» nés.
» Si ceux qui font cette objeftion font négocians
» ils favent combien peu elle eft fondée : car c’eft
» beaucoup fi une vingtaine de détaillans entrent
» dans une année dans une affociation ; & ce nom-
» bre n’aura pas d’influence dans les élevions. S’il
» s’en préfente un plus grand nombre, c’eft un bon-
» heur pour la nation, 6c ce n’eft point un mal pour
» les compagnies ; car l’intérêt eft l’appât commun de
» tous les hommes ; & ce même intérêt commun fait
» defirer à tous ceux qui s’engagent dans un corn-
» merce , de le voir réglé & gouverné par des gens
» fages & expérimentés. Les voeux fe réuniront toû-
» jours pour cet objet ; 6c la compagnie des Indes en
» fournit la preuve , depuis que tout anglois a pu
» y entrer en achetant une â â ion , & en payant cinq
» livres pour fon affociation. Les contradicteurs fur
» cette matière ont dû fe convaincre que la compa-
» gnie a été appuyée fur de meilleurs fondemens
» 6c mieux gouvernée infiniment que dans les tems
» où l’affociation coûtoit cinquante livres fterlings.
» Le fuccès a juftifié cet arrangement, puifque la
» nouvelle compagnie étayée par des principes plus
C O M
» profitables, a triplé fon capital ; tandis que I’an-
» cienne plus limitée, a déchû continuellement, &
» enfin s’eft enfevelie fous fes ruines, quoique eom-
» mencée avec plus de fuccès ».
Ce qui regarde les diverfes compagnies de l’Europe
, eft renvoyé au commerce de chaque état. Cet
article eft de M. V. D . F.
La réglé de C om pagn ie , en Arithmétique, eft une
réglé dont l’ufage eft très-néceffaire pour arrêter
les comptes entre les marchands & propriétaires de
vaiffeaux ; lorfqu’un certain nombre de perfonnes
ayant fait enfemble un fonds, on propofe de partager
le gain ou la perte proportionnellement entr’eux,
La réglé de trois répétée plufieurs fois eft le fondement
de la réglé de compagnie, 6c fatisfait pleinement
à toutes les queftions de cette efpece ; car la
mife de chaque particulier doit être à fa part du
gain ou de la perte, comme le fonds total eft à la
perte ou au gain total : donc il faut additionner
les différentes fommes d’argent que les affociés ont
fournies, pour en faire le premier terme ; le gain ou
la perte commune fera le fécond,* chaque mife particulière
fera le troifieme ; 6c il faudra répéter la réglé
de trois autant de fois qu’il y a d’affociés.
Cette réglé a deux cas : il y a différens tems à
obferver, ou il n’y en a point.
La réglé de compagnie, fans diftinCtion de tems, eft
celle dans laquelle on ne confidere que la quantité
de fonds que chaque affocié a fourni, fans avoir
égard au tems que cet argent a été employé, parce
que l’on fuppofe que tous les fonds ont été mis dans
le même tems. Un exemple rendra cette opération
facile.
A , B , & C , ont chargé un vaiffeau de z i z tonneaux
de v in; A a fourni 134Z liv. B 1178 liv. & C
6 ro liv. toute la cargaifon eft vendue à raifon de 31
liv. chaque tonneau. On demande combien il revient
à chacun.
Trouvez le produit entier du vin en multipliant
3.1 z par 3 z , qui revient à 6784 liv. enfuite ajoûtant
enfemble les mifes particulières 134Z liv. 1178 liv.
& 630 liv. qui font 3150 liv. l’opération fera
C 134Z eft à z8po.
3150:6784 1178 eft à Z537.
/ 630 eft à 1356.
Preuve. . . . 3150 6783. Chambers.{E)
La raifon pour laquelle on n’a point d’égard aux
tems dans cette rég lé, c’eft qu’étant le même pour
chaque mife, il doit influer également fur le gain ou la
perte que-çhacune doit porter. Mais il n’en eft pas de
même, lorlque le tems de chaque mife eft différent.
C ’eft ce qu’on appelle réglé de compagnie par tems,
& qu’il eft bon d’expliquer avec clarté, d’autant
que plufieurs de ceux qui en ont parlé y ont laiffé
des difficultés. Suppofons deux particuliers que, pour
plus de facilité, je diftinguerai par A & par B , qui
ayent fait enfemble une fociété. L’un met au premier
Janvier la fomme a , 6c au premier Avril la
fomme b ; le fécond met au premier Janvier la fomme
c, au premier Juillet la fomme d; 6c au bout de
quinze mois il leur vient la fomme e qu’il faut partager
entr’eux. On demande de quelle maniéré on la
doit partager.
Il eft évident que la mife de chacun doit être regardée
comme un fonds qui travaille pendant tout
le tems qui s’écoule depuis cette mife jufqu’au tems
du profit ; que par çonféquent on peut la regarder
comme de l’argent placé à un certain denier x , dont
la quantité dépend de la fomme e. De plus ce denier
dpjt être le même pour chacun des intéreffés,
il n’y aura que le plus ou moins de tems qui fera varier
ie profit; enforte que fi x a eft ie denier x de a
pour un mois, x b3 x c , x d3 feront auffi le denier
4e b Cy & c , pour un mois.
C O M 743
| P favoir maintenant fur quel pié l’intérêt doit
etre envifage ic i, s’il eft fimple ou compofé. Poye^
In t érê t. C ’eft une chofe qui dépend uniquement
^ convention entre les intéreffés. C ’eft ce qu’on
a déjà fait fentir à l’article A rrérages, & qui fera
expliqué plus en détail à Yarticle Intérê t. On regarde
ordinairement l ’intérêt comme fimple dans ces
fortes de calculs ; nous allons d’abord le confidérer
fous ce point de vûe.
■ 1°. Suppofons que Kntérêt foit fimple, que * foit
le denier de la fomme a pour un mois, il eft certain
que la fomme «z mife au i er Janvier, doit au bout
des quinze mois produire « (1 + 15 x ) ; que la fomme
b mife au premier Avril, & travaillant pendant
douze mois., doit au bout des quinze mois produire
b (1 4- i z x ) ; que la fomme c mife au premier Janvier
produira c ( 1 + 15 x') ; 6c que la fomme d mife
au premier Juillet, 6c travaillant pendant neuf mois,
doit produire d ( 1 4- 9 x'). Or ces quatre quantités
prifes enfemble doivent être égales à la fomme retirée
e. Donc a-\-b-\~ c-\-d-{- 15 ax-\- ixbx-\- 15c:*:
+ 9 d x = e.
Donc * = - <Ç_
Donc la fomme a- f- i ^ a x r j - b - f - n b x gagnée par
le premier fera a + b+ a e - is * * - 1; b a - 1; a c - i f „ a
e — 1 xab — 1:
- , laquelle fera
___ I f a e - 3 b a - 6 ad 12 b e + 3 a b + 3 bc — 3 dl
I J a + 1 2 6 + I J C + 9 d 15 a-t- 12 b ■+■ i j c + ç) d 9
& ainfi des autres.
Si l’intérêt eft compofé, en ce cas au lieu de a
U ,+ > 5 *) ., ilfaudra a ( i + & l’on aura
a, + d
VIr'*'*r)9 = e• Equation beaucoup plus difficile à
refoudre que la précédente,mais dont on peut venir
a bout par approximation.
Il me femble que dans les réglés de compagnie on
devroit traiter l ’intérêt comme compofé ; car tout interet
eft tel par fa nature, à-moins qu’il n’y ait entre
les intéreffés une convention formelle du contraire ;
voyei In t érê t & A rrérages. Mais il femble que
1 ufage, fans qu’on fâche trop pourquoi, eft de regarder
l’interet comme fimple dans ces fortes d’af-
fociation$.
Quand le tems des mifes eft égal, alors foit qu’on
regarde l ’intérêt comme fimple ou comme compofé
, il eft inutile d’avoir égard au tems. En effet fup-
pofons que les deux mifes foient a 6c c, on a dans
le premier cas a ( i + 15 x ) + c ( 1 + 1 5 x') - e j
donc x = Yj'a+ 1 5 &
a -4- iç a x = 1 JJac+ Il ae a*
Imsmiaam
= — ^ d’où l’on voit que le gain de a eft à la mife
comme le gain total c eft à la mife totale a -f- c, ainfi
que le donne la regle de compagnie, où on n’a point
d’égard au tems.
Si l’intérêt eft compofé, on aura a ( 1 - f x ) 1 1 4- c
( i + x 1J ) == e ; donc ( 1 - f x ) 1J = A~e ; donc
<* ( 1 + 15 * ) 1 * ?= , ce qui donne ençore la mê;
me analogie.
Il y a cependant une obfervation à faire dans la
réglé de, compagnie par tems, quand l’intérêt eft fimple.
Je fuppofe , comme ci-deffus, que l’intéreffé A
mette a au mois de Janvier & b au mois d’Avril, il
eft évident qu’au premier Avril a ( 1 -f- 3 x') exprimera
ce que l’intereffé A doit retirer, ou plûtôt fa
véritable mife ; 6c cette mife étant augmentée de b ,
on aura a ( 1 4 - 3 * ) + * pour la mife au premier
Avril. O r cette mife étant multipliée par (1 + i z * )
donnera [<* ( i + 3 * -M ] X ( i - f i z * ) pour la
mife totale de A à la fin des quinze mois, ce qui