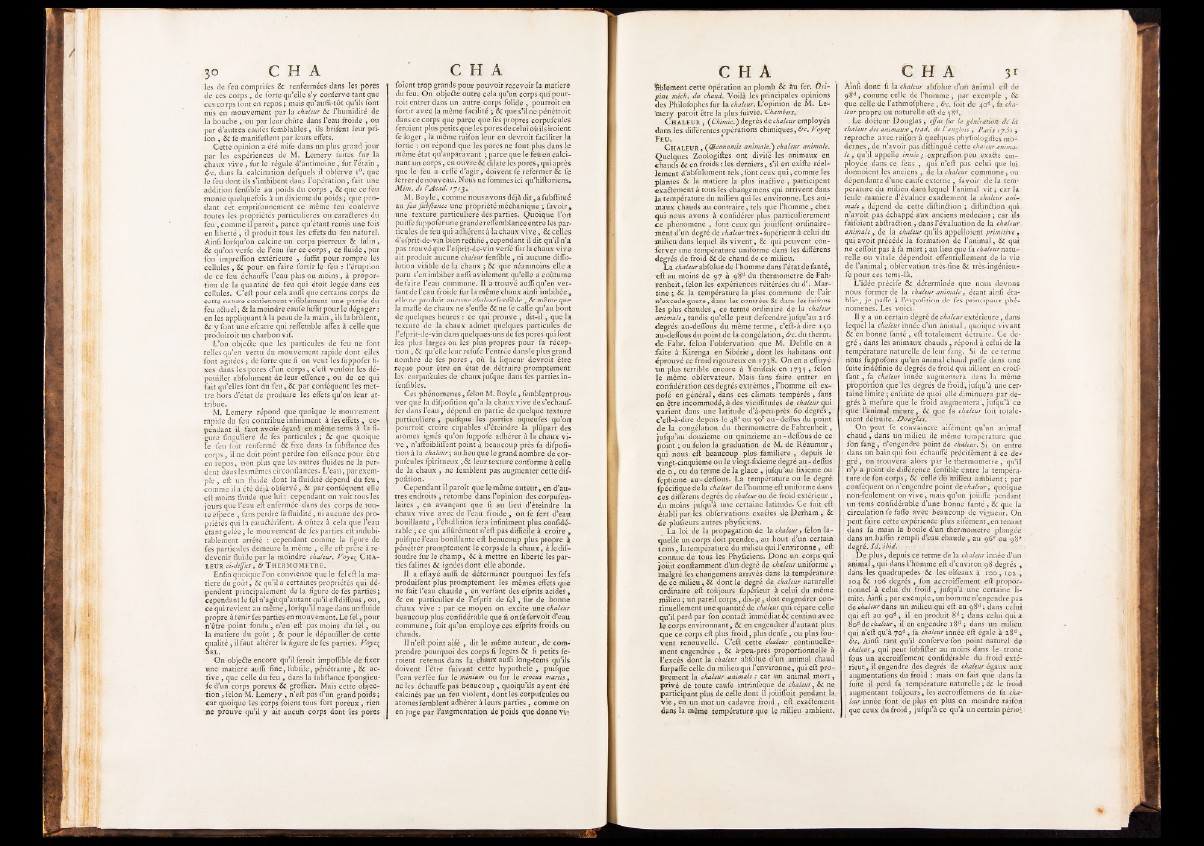
À !
les de feu comprifes & renfermées dans les pores
de ces corps , de forte qu’elle s’y conferve tant que
ces corps font en repos ; mais qu’auffi-tôt qu’ils font
mis en mouvement par la chaleur & l’humidité de
la bouche , ou par leur chute dans l’eau froide , ou
par d’autres caufes femblables, ils brifent leur pri-
fon , & fe manifeftent par leurs effets.
Cette opinion a étémife dans un plus grand jour
par les expériences de M. Lemery faites fur la
chaux v iv e , fur le régule d’antimoine, fur l’étain ,
&c. dans la calcination defquels il obfërve ï° , que
le feu dont ils s’imbibent dans l’opération, fait une
addition fenfible au poids du corps , & que ce feu
monte quelquefois à un dixième du poids; que pendant
cet emprifonnement ce même feu conferve
toutes les propriétés particulières ou caraéteres du
feu , comme il paroît, parce qu’étant remis une fois
en liberté , il produit tous les effets du feu naturels
Ainfi lôrfqu’on calcine un corps pierreux & falin ,
& qu’on verfe de l’eau fur ce corps, ce fluide, par
fon impreffion extérieure , fuffit pour rompre les
cellules , Sc pour en faire fortir le feu : l’éruption
de ce feu échauffe l’eau plus ou moins, à proportion
de la quantité de feu qui étoit logée dans ces
cellules. C ’eft pour cela auffi que certains corps de
cette nature contiennent vifiblement une partie du
feu aétuel ; & la moindre caufe fuffit pour le dégager :
en les appliquant à la peau de la main, ils la brûlent,
& y font une efearre qui reffemble affez à celle que
produiroit un charbon vif.
L’on objeéle que les particules de feu ne font
telles qu’en vertu du mouvement rapide dont elles
font agitées ; de forte que fi on veut les fuppofer fixes
dans les pores d’un corps, c’eft vouloir les dépouiller
abfolument de leur effence , ou de ce qui
fait qu’elles font du feu, & par conféquent les mettre
hors d’état de produire les effets qu’on leur attribue.
M. Lemery répond que quoique le mouvement
rapide du feu contribue infiniment à fes effets , cependant
il faut avoir égard en même teins à la figure
finguliere de fes particule^ ; & que quoique
le feu foit renfermé & fixe dans la fubftance des
corps , il ne doit point perdre fon effence pour être
en repos, non plus que les autres fluides ne la perdent
dans les mêmes circonftarices. L’eau , par exemple
, eft un fluide dont la-iluidité dépend du feu ,
comme il a été déjà obfervé, & par conféquent elle
eft moins fluide que lui: Cependant on voit tous les
jours que l’eau eft enfermée dans des corps de toute
efpece , fans perdre fa fluidité, ni aucune des propriétés
qui la cara&érifent. A oûtez à cela que l ’eau
étant gelée, le mouvement de fes parties eft indubitablement
arrêté : cependant comme la figure de
fes particules demeure la même , elle eft prete à redevenir
fluide par la moindre chaleur. Voye%_ C haleur
d-dejjiis, & T hermomè tre.
Enfin quoique l’on convienne que le fel eft la matière
du goût, & qu’il a certaines propriétés qui dépendent
principalement de la figure de fes parties ;
cependant le fel n’agit qu’autant qu’il eft diffous, ou ,
ce qui revient au meme, lorfqu’il nage dans un fluide
propre à tenir fes parties en mouvement. Le fe l, pour
n’être point fondu, n’en eft pas moins du f e l, ou
la matière du goût ; & pour le dépouiller de cette
qualité, il faut altérer la figure de fes parties. Voye^
-Sel.
On objette encore qu’il feroit impoffible de fixer
une matière auffi fine, fubtile, pénétrante , & active
, que celle du feu., dans la liibftance fpongieu-
fe d’un corps poreux & groffier. Mais cette objection
, félon M. Lemery , n’eft pas d’un grand poids;
car quoique les corps foient tous fort poreux , rien
ne prouve qu’il y ait aucun corps dont les pores
foient trop grands pour pouvoir recevoir la matière
du feü. On objeûe outre cela qu’un corps qui pour-
roit entrer dans un autre corps folide , pourroit en
fortir avec la même facilité ; & que s’il ne pénétroit
. dans ce corps que parce que-fes propres corpulcules
feroient plus petits que les pores de celui oii ilsiroient
fe loger , la même raifon leur en devroit faciliter la
fortie : on répond que les pores ne font plus dans le
même état qu’auparavant ; parce que le feü en calcinant
un corps, en ouvre & dilate les pores, qui après
que le feu a ceffé d’agir','doivent fe refermer & fe
ferrer de nouveau. Noiis ne fommes ici qu’hiftoriens.
Mém. de lAcad, /y/j1.
M. Boyle, comme nous avons déjà dit, afubftitué
au feu fubjlance une propriété méchanique ; favoir ,
une texture particulière des parties. Quoique l’oit
puiffe fuppofer une grande reffemblance entre les particules'
de feu qui adhérent à la chaux V iv e , & celles
d’elprit-de-vin bien rectifié, cependant il dit qu’il n’a
pas trouvé que l’efprit-de-vin verfé fur la chaux v ive
ait produit aucune chal'eür fenfible , ni aucune diffo-
lution vifible de là chaux ; & que néanmoins elle a
paru s’en imbiber aufîi avidement qu’elle à coûtume
défaire l’eau commune. Il a trouvé auffi qu’en ver-
fant de l’eau froide fur la même chaux ainfi imbibée ,
elle ne produit aucune cAà/ewr fenfible ,• & même que
la malfe de chaux ne s’enfle & ne fe cafte qu’au bout
de quelques heures : ce qui prouve , d it-il, que la
texture de la chaux admet quelques particules de
l’efprit-de-vin dans quelques-uns de fes pores qui font
les plus larges ou lés plus propres pour fa réception
, &: qu’elle leur refufe l’entrée dans le plus grand
nombre de fes pores , oit la liqueur devroit .être
reçue pour être en état de détruire promptement
les corpufcules de chaux jufque dans fes parties in-
fenfibles.
Ces phénomènes, félon M. Boyle, femblentprouver
que la difpofition qu’a la chaux vive de s’échauffer
dans l’eau , dépend en partie de quelque texture
particulière , puifque les parties aqueufes qu’on
pourroit croire capables d’éteindre la plûpart des
atomes ignés qu’on fuppofe adhérer à la chaux viv
e , n’affoibliffent point à beaucoup près fa difpofition
à la chaleur ; au lieu que le grand nombre de corpufcules
fpiritueux ,& leur texture conforme à celle
de la chaux , ne femblent pas augmenter cette dif-.
pofition.
Cependant il paroît que le même auteur, en d’autres
endroits, retombe dans l’opinion des corpufcu-
laires , en avançant que fi au lieii d’éteindre la
chaux vive avec de Fèau froide , on fe fert d’eau
bouillante , l’ébullition fera infiniment plus confidé-
rable ; ce qui aflûrément n’eft pas difficile à croire ,
puifque l’eau bouillante eft beaucoup plus propre à
pénétrer promptement le corps de la chaux, àled if-
foudre fur le champ, & à mettre en liberté les parties
falines & ignées dont elle abonde.
II a eflTayé auffi de déterminer pourquoi les fels
produifent plus promptement les mêmes effets que
ne fait l’eau chaude , en verfant des efprits acides,
& en particulier de l’efprit de f e l , fur de bonne
chaux vive : par ce moyen on excite une chaleur
beaucoup plus confidérable que fi onfefervoit d’eau
commune, foit qu’on employé ces efprits froids ou
chauds.
Il n’eft point aifé , dit le même auteur, de comprendre
pourquoi des corps fi légers & fi petits feroient
retenus dans la chaux auffi long-tems qu’ils
doivent l’être fuivant cette hypothefe , puifque
l’eau vèrfée fur le minium ou fur le crocus martis,
ne les échauffe pas beaucoup , quoiqu’ils ayent été
calcinés par un feu violent, dont les corpufcules ou
atomes femblent adhérer à leurs parties , comme on
en juge par l’augmentation de poids que donne vT;
Ifiblemerit cette Opération au plomb & au féf. Origine
méch. du chaud. Voilà les principales opinions
des Philofophes fur la chaleur. L’opinion de M. Le-
taery paroît être la plus fuivie. Ckàmbers.
CHALEUR , ( Chimie.) degrés de chaleur employés
dans les différentes opérations chimiques -f &c. Foye{
Feu-.
C haleur , (<'Economie animale.) chaleur animale.
Quelques Zoologiftes ont divifé les animaux en
chauds & en froids : les derniers, s’il en exifte réellement
d’abfoliunent tels, font ceux qui, comme les
plantes & la matière la plus ina&ive ; participent
exactement à tous les chàngéhiens qui arrivent dans
la température du milieu qui les environne. Les animaux
chauds au contraire, tels que l’homme, chez
qui nous avons à confidérer plus particulièrement
c e phénomène , font ceux qui joiiiffent ordinairement
d’un degré de chaleur très - fupérieur à celui du !
milieu dans lequel ils v iv en t , & qui peuvent con- :
ferver une température uniforme dans les différens 1
degrés de froid & de chaud de ce milieu.
La chaleur abfolue de l’homme dans l’état de fanté,
eft au moins de 97 à q8d du thermomètre de Fahrenheit,
félon les expériences réitérées du d'y Martine
; & la température la plus commune de Pair
n’excede guere, dans les contrées & dans les faifons
les plus chaudes, ce terme ordinaire de la chaleur
■ animale , tandis qu’elle peut defcendre jufqu’au 216
degrés au-defibus du même terme, c’eft-à-dire 150
àu-deffous du point de la congélation, &c. du therm.
de Fahr. félon l’obfervation que M. Delifle en a
faite à Kirenga en Sibérie, dont les habitans ont.
éprouvé ce froid rigoureux en 1738. On en a efluyé
un plus terrible encore à Yenifeik en 1735 , félon
le même obfervateur. Mais fans faire, entrer en
iconfidération ces degrés extrêmes, l’homme eft ex-
pofé en général, dans ces climats tempérés , fans
en être incommodé, à des yiciffitudes de chaleur qui
varient dans une latitude d’à-pëii-près 60 degrés,
c ’eft-à-dire depuis le 48e ou 50e au-deffus du point,
de la congélation du thermomètre de Fahrenheit,
jufqu’au douzième ou quinzième au-deffous de ce
point ; ou félon la graduation de M. de Réaumur,
qui nous eft beaucoup plus familière , depuis le
vingt-cinquieme ou le vingt-fixieme degré au - deffus
de o , ou du terme de la glace , jufqu’au fixieme ou
feptieme au-deffous. La température ou" le degré
fpécifique de la chaleur de l’homme eft uniforme dans
ces différens degrés ào chaleur ou dé froid extérieur ,
du moins .jufqu’à une certaine latitude. Ce fait eft
établi par les obferyations exaftes deDerham., &
de plufieurs autres phyficiens.
La loi ;de la propagation de la chaleur , félon laquelle
un corps, doit prendre ,<au bout d ’un certain
tems,Ta température du milieu qui l’enyironne r eft
connue de tous les Phyficiens. Donc un corps qui
jouit.copftamment.d’un degré de chaleur uniforme |g
malgré les changemens arrivés dans la température
de ce milieu, & dont ,1c degré de chaleur naturelle ,
ordinaire eft toûjours fupérieur à celui du même,,
milieu; un pareil corps, dis-je, doit engendrer con-'
tinuellement une quantité de chaleur qui répare celle
qu’il perd par fon eontaft immédiat & continu avec
le corps environnant, & en engendrer d’autant plus-
que ce corps eft plus froid, plus denfe ,;ou plus;lou-
yent renouvelle. C ’eft^ cette chaleur continuelle-,
ment engendrée , & à-peu-près proportionnelle à:
l ’excès dont la chaleur abfolue d’un animal; chaud
furpaffe celle du milieu qui l’environne,, qui eft proprement
la chaleur animale : car un animal; m o r t,
privé de toute' caufe intrinfeque de chaleur, & ne,
participant plus de celle dont il joiiiffoit pendant la,
v ie , en un mot un cadavre froid , eft; exactement
dans la même température que le milieu ambient.
Ainfi donc fi la chaleur abfolue d’un ânirftaï eft de
98e*, comme celle de l’homme, par exemple , &
que célle de l’athmofphere , &c. foit de 40**, fa chaleur
propre: ou naturelle eft de «j8d.
Le doCteur Douglas ; effai fur la génération de là
chaleur des animaux, trad. de l'angloisParis i j ô ’t > •
reproche avec raifon'à quelques phyfiologiftes modernes,
de n’avoir pas diftingué cette chaleur animale
y qu’il appelle innée y expreffi.on peu exaCte employée
dans ce fens , qui n’eft pas celui que lui
donnoient les anciens , de la chaleur commune, ou
dépendante d’une caufe externe , favoir de la température
du miljeu dans lequel l’animal v it ; car la
l’eule maniéré d’évaluer exactement la chaleur animale
dépend de cette diftinCtion ; diftinCtion qui
n’a voit pas échappé aux anciens médecins; car ils
faifoient abftraCtion , dans l’évaluation de la chaleur
animale , de la chaleur qu’ils appelloient primitive ,
qui avoit précédé la formation de l’animal, & qui
ne ceffoit pas à fa mort ; au lieu que fa chaleur naturelle
ou vitale dépendoit effentiellement de la vie
de l’animal ; obfervation très-fine & très-ingénieu-
fe pour ces tems-là. -
L’idée précife & déterminée que nous devons
nous former de la chaleur animale , étant ainfi établie
, je paffe à l’expofition de fes principaux phénomènes.
Les voici.
Il y â un certain degré de chaleur extérieure, dans
lequel la chaleur innée d’ün ânimal, quoique vivant
& en bonne fànté , eft totalement détruite. Ce degré
» dans les animaux chauds , répond à celui de la
température naturelle de leur fang. Si dé ce terme
n'ous fuppofons qu’un ânimal chaud paffe dans une
fuite indéfinie de degrés de froid qui aillent en croif-
fàpt %.fa chaleur innée augmentera dans la même
piropOrtiod que'les dëgrés de froid/, jufqu’à une cer-
tàiné lifhite'; énfüite dé.quoi elle diminuera par de-
gfrés à riiefufé qüèTe froid augmentera , jufqu’à ce
qtiè l’animal-meure , & que fa chaleur foit totalement
détruite. Dôiïgïaï.
On peut fe convaincre àifé'ment qu’un animal
chaud, dans im iUilieit de même température que
fon fang,' rt’eiîgeiidre point de chaleur. Si on entre
* dans un bain qui foit échauffé précifémént à ce de-
■ gré , Pn:trouvera’ alors par le thermomètre , qu’il
' n?y a point;de différeheè fenfible entre la tempéra-
1 titré de fon cotpis, '& cëllé 'dû ’milieu arhbient ; par
cOUféquent on n’engéndre point de chaleur, quoique
: non-feulement on v iv e , mais qu’on joûiffe pendant
* un tems confidérable d’une bonne'fanté, & que la
circulation fe faffe ave.c beaucoup de vigueur. On
■ peut faire cette expérience plus aifément, en tenant
dans fa main la boule :d’un thermomètre plongée
j dans im baffin rempli d’eau chaude , au 96e ou 98e
: degré. Id. 'ibid.:
;D e plus, depuis çe terme de la chaleur innée d’un
; animal.,,qui dans l’h'omme eft d’environ.98 degrés ,
; dans les quadrupèdes'& les oifeaux à 100,102 ,
| 10 4 & 106 degrés, fon accroiffement eft propôr-
: tionnei à 'celui du froid , " jufqu’à'une certaine li-
i mife> Ainfi ; par exemple, un homme n’engendre pas
; de chaleur dans un milieu qui eft au 98e1; dans celui
i qui.eft .au 9011, il ie.n .produit 8d ; dans celui qui a
Bp^'de chaleur, il en engendre i8d ; dans un milieu
j qui n’eft qu’à 7od j fa.chaleur innée eft égale à 28d ;
; èç . Ainfi tant qu’il conferve fon point naturel de
i chaleur-i qui peut fubfifter au moins dans le, tronc
; fqus un accroiffement confidérable du froid exté-
; rieur, il engendre des degrés de chaleur égaux aux
: augmentations du froid : mais on fait que dans la
1 fuite il perd fa température naturelle ; & le froid
i augmentant toûjours, les accroiffemens de fa cha-
j leur, innée ..font de plus en plus en moindre raifon
; que ceux du froid, jufqu’à ce qu’à un certain périoî