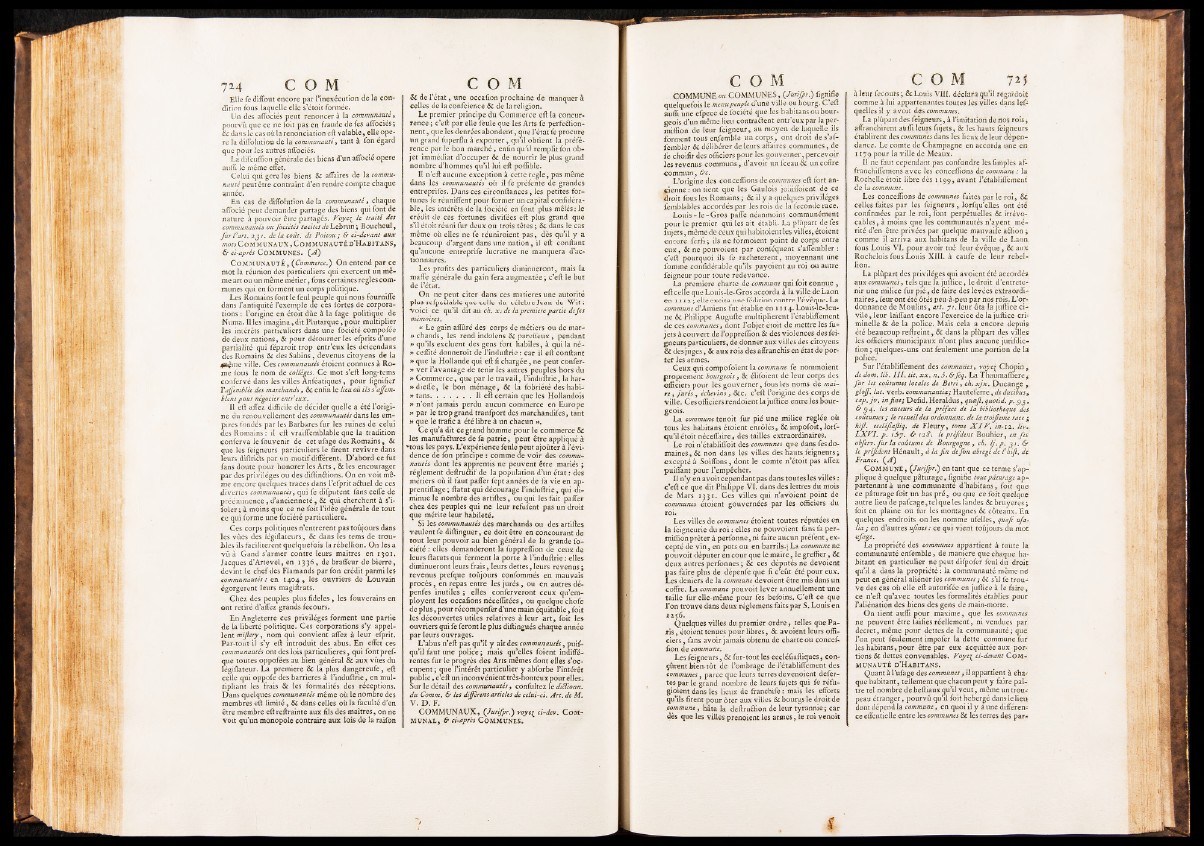
Elle fe diffout encore par l’inexécution de la condition
fous laquelle elle s’étoit formée.
Un des affociés peut renoncer à la communauté ,
pourvu que ce ne foit pas en fraude de fes affociés;
& dans le cas où la renonciation eft valable, elle opéré
la diffolution de la communauté, tant à fon égard
que pour les autres affociés.
La difeuflion générale des biens d’un affocié opéré
aufli le même effet.
Celui qui gere les biens & affaires de la communauté
peut être contraint d’en rendre compte chaque
année.
En cas de diffolution de la communauté, chaque
affocié peut demander partage des biens qui font de
nature à pouvoir être partagés. Voye^ le traité des
communautés ou fociétés tacites de Lebrun ; Boucheul,
fu r L'art. 231. de la coût, dt Poitou ; & ci-devant aux
mots Communaux , Communauté d’Habitans,
6* ci-après COMMUNES. (A )
C ommunauté, ('Commerce.) On entend par ce
mot la réunion des particuliers qui exercent un même
art ou un même métier, fous certaines réglés communes
qui en forment un corps politique.
Les Romains font le feul peuple qui nous fourniffe
dans l'antiquité l’exemple de ces fortes de corporations
: l’origine en étoit due à la fage politique de
Numa. Il les imagina, dit Plutarque, pour multiplier
les intérêts particuliers dans une fociété compofée
de deux nations, & pour détourner les efprits d’une
partialité qui féparoit trop entr’eux les delcendans
des Romains & des Sabins, devenus citoyens de la
4H$me ville. Ces communautés étoient connues à Rome
fous le nom de collèges. Ce mot s’eft long-tems
confervé dans les villes Anféatiques, pour fignifier
Yaffemblée des marchands , &C enfin le lieu où ils s'affem-
blent pour négocier entr eux.
Il eft affez difficile de décider quelle a été l’origine
du renouvellement des communautés dans les empires
fondés par les Barbares fur les ruines de celui
des Romains : il eft vraiffemblable que la tradition
conferva le fouvenir de cet ufage des Romains, &
que les feigneurs particuliers le firent revivre dans
leurs diftricts par un motif différent. D ’abord ce fut
fans doute pour honorer les A rts, & les encourager
par des privilèges ou des diftinftions. On en voit même
encore quelques traces dans l’efprit aâuel de ces
diverfes communautés, qui fe difputent fans ceffe de
prééminence, d’ancienneté, & qui cherchent à s’i-
loler ; à moins que ce ne foit l’idée générale de tout
ce qui forme une fociété particulière.
Ces corps politiques n’entrerent pas toujours dans
les vues des légiflateurs, & dans les tems de troubles
ils facilitèrent quelquefois la rébellion. On les a
vu à Gand s’armer contre leurs maîtres en 1301.
Jacques d’Artevel, en 1336, de braffeur de bierre,
devint le chef des Flamands par fon crédit parmi les
communautés: en 1404, les ouvriers de Louvain
égorgèrent leurs magiftrats.
Chez des peuples plus fideles, les fouverains en
ont retiré d’affez grands fecours.
En Angleterre ces privilèges forment une partie
de la liberté politique. Ces corporations s’y appellent
miftery, nom qui convient affez à leur efprit.
Par-tout il s’y eft introduit des abus. En effet ces
communautés ont des lois particulières, qui font pref-
que toutes oppofées au bien général & aux vues du
légiflateur. La première & la plus dangereufe, eft
celle qui oppofe des barrières à l’induftrie, en multipliant
les frais & les formalités des réceptions.
Dans quelques communautés même où le nombre des
membres eft limité, & dans celles où la faculté d’en
être membre eft reftrainte aux fils des maîtres, on ne
voit qu’un monopole contraire aux lois de la raifon
& de l’etat, une occafion prochaine de manquer à
celles de la confidence & de la religion.
Le premier principe du Commerce eft la concurrence
; c’eft par elle feule que les Arts fe perfeélion-
nent, que les denrées abondent, que l’état fe procure
un grand fuperflu à exporter, qu’il obtient la préférence
par le bon marché, enfin qu’il remplit fon objet
immédiat d’occuper & de nourrir le plus grand
nombre d’hommes qu’il lui eft poffible.
Il n’eft aucune exception à cette réglé, pas même
dans les communautés où il fe préfente de grandes
entreprifes. Dans ces circonftances, les petites fortunes
fe réunifient pour former un capital confidéra-
ble, les intérêts de la fociété en font plus mêlés: le
crédit de ces fortunes divifées eft plus grand que
s’il étoit réuni fur deux ou trois têtes ; & dans le cas
même où elles ne fe réunirôient pas, dès qu’il y a
beaucoup d’argent dans une nation, il eft confiant
qu’aucune entreprife lucrative ne manquera d’actionnaires.
Les profits des particuliers diminueront, mais la
maffe générale du gain fera augmentée ; c’eft le but
de l’état.
On ne peut citer dans ces matières une autorité
plus refpeâable que celle du célébré Jean de Wit :
"Voici ce qu’il dit au ch. x i de la première partie de fes
mémoires.
« Le gain affûré des corps de métiers ou de marc
h a n d s , les rend indolens & pareffeux , pendant
» qu’ils excluent des gens fort habiles, à qui la né-
» cefîité donneroit de l’induftrie : car il eft confiant
f* que la Hollande qui eft fi chargée, ne peut confer-
» ver l’avantage de tenir les autres peuples hors du
» Commerce, que par le travail, l’induftrie, la har-
»dieffe, le bon ménage, & la fobriété des habi-
» tans. . . . . . . Il eft certain que les Hollandois
» n’ont jamais perdu aucun commerce en Europe
» par le trop grand tranfport des marchandifes, tant
» que le trafic a été libre à un chacun ».
Ce qu’a dit ce grand homme pour le commerce &
les manufaélures de fa patrie, peut être appliqué à
‘tous les pays. L’expérience feule peut ajouter à l’évidence
de fon principe : comme de voir des communautés
dont les apprentis ne peuvent être mariés ;
réglement deflru&if de la population d’un état : des
métiers où il faut paffer fept années de fa v ie en ap*
prentiffage ; flatut qui décourage l’induftrie, qui diminue
le nombre des artiftes, ou qui les fait paffer
chez des peuples qui ne leur réfutent pas un droit
que mérite leur habileté.
Si les communautés des marchands ou des artiftes
veulent fe diftinguer, ce doit être en concourant de
tout leur pouvoir au bien général de la grande fociété
: elles demanderont la fuppreflion de ceux de
leurs ftatuts qui ferment la porte à l’induftrie : elles
diminueront leurs frais, leurs dettes, leurs revenus ;
revenus prefque toujours confommés eu mauvais
procès, en repas entre les jurés, ou en autres dé-
penfes inutiles ; elles conferveront ceux qu’em-
ployent les occafions nécefiitées, ou quelque chofc
de plus, pour récompenfer d’une main équitable, foit
les découvertes utiles relatives à leur art, foit les
ouvriers qui fe feront le plus diftingués chaque année
par leurs ouvrages.
L’abus n’eft pas qu’il y ait des communautés, puif-
qu’il faut une police ; mais qu’elles foient indifférentes
fur le progrès des Arts mêmes dont elles s’occupent
; que l’intérêt particulier y abforbe l’intérêt
public, c’eft un inconvénient très-honteux pour elles.
Sur le détail des communautés, confultez le diclionn.
du Comm. & les différais articles de celui-ci. Art. de M.
V . D. F.
COMMUNAUX, ([Jurifpr.) voye^ ci-dev. COMMUNAL,
& ci-après Communes.
C O M
COMMUNE ou COMMUNES, (Jurifpr.) figftjfie
quelquefois le menu peuple d une ville ou bourg. C eft
aufli une efpece de fociété que les habitans ou bourgeois
d’un même lieu contrarient entr’eux par la per-
miflion de leur feigneur, au moyen de laquelle ils
forment tous ensemble un corps, ont droit de s’af-
fembler & délibérer de leurs affaires communes, de
fe choifir des officiers pour les gouverner, percevoir
les revenus communs, d’avoir un fceau & un coffre
commun, &c.
L’origine des conceflions de communes eft fort ancienne
: on tient que les Gaulois joüiffoient de ce
droit fous les Romains ; & il y a quelques privilèges
ièmblables accordés par les rois çle la fécondé race.
Louis - le - Gros paffe néanmoins communément
pour le premier qui les ait établi. La plupart de fes
fujets, même de ceux qui habitoientles villes, étoient
encore ferfs ; ils ne formoient point de corps entre
eu x, & ne pouvoient par conlequent s’affembler :
c’eft pourquoi ils fe rachetèrent, moyennant une
fomme confidérable qu’ils payoient au roi ou autre
feigneur pour toute redevance.
La première charte de commune qui foit connue ,
eft celle que Louis-le-Gros accorda à la ville de Laon
en 111 z ; elle excita une fédition contre l’évêque. La
commune d’Amiens fut établie en 1114. Louis-le-Jeu-
he & Philippe Augüfte multiplièrent l’établiffement
de ces Communes, dont l’objet étoit de mettre les fu-
jets à couvert de l’oppreflion & des violences des feigneurs
particuliers, de donner aux villes des citoyens
& des juges, & aux rois des affranchis en état de porter
les armes.
Ceux qui compofoient la commune fe nommoierit
proprement bourgeois, & élifoient de leur corps des
officiers pour les gouverner, fous les noms de maire
, jurés, èchevins , & c . c’eft l’origine des corps de
ville. Ces officiers rendoient la juftice entre les bour-
geois.
La commuât tenoit fur pié une milice réglée où
tous les habitans étoient enrôlés, & impofoit, lorsqu’il
étoit néceffaire, des tailles extraordinaires.
Le roi n’établifl’oit des communes que dans fes domaines,
& non dans les villes des hauts feigneurs ;
excepté à Soiffons, dont le comte n’étoit pas affez
puiffant pour l ’empêcher.
Il n’y en avoit cependant pas dans toutes les villes :
c’eft ce que dit Philippe VI. dans des lettres du mois
de Mars 1331. Ces villes qui n’avoient point de
communes etoient gouvernées par les officiers du
roi.
Les villes de communes étoient toutes réputées en
la feigneurie du roi : elles ne pouvoient fans fa per-
mifîion prêter à perfonne, ni faire aucun préfent, excepté
de v in , en pots ou en barrils.j La commune ne
pouvoit députer en cour que le maire, le greffier, &
deux autres perfonnes ; &c ces députés ne dévoient
pas faire plus de dépenfe que fi c’eût été pour eux.
Les deniers de la commune dévoient être mis dans un
coffre. La commune pouvoit lever annuellement une
taille fur elle-même pour fes befoins. C ’eft ce que
l ’on trouve dans deux réglemens faits par S. Louis en
2156.
Quelques villes du premier ordre s telles qüe Paris
, étoient tenues pour libres, & avoiènt leurs officiers
, fans avoir jamais obtenu de charte ou concef-
fion de commune.
Les feigneurs, & fur-tout les eedéfiaftiques, conçurent
bien-tôt de l’ombrage de l’établiffement des
communes, parce que leurs terres devenoient defer-
tes par le grand nombre de leurs fujets qui fe réfü-
gioient dans les lieux de franchife : mais les efforts
qu’ils firent pour ôter aux villes Si bourgs le droit de
commune, hâta la deftruûion de leur tyrannie ; car
dès que les villes prenoient les armes, le roi venoit
à leur fecouls; & Louis VIIL déclara qu’il régaïdoit
comme à lui appartenantes toutes les villes dans lefc
quelles il y à voit dés communes.
La plûpart des feigneurs, à l’imitatiOri de tto$ rois,
affranchirent aufli leurs fujets, & les hauts feigneurs
établirent des communes dans les lieux de leur dépendance.
Le comte de Champagne en accorda une en
1179 pour la ville de Meaux.
Il ne faiit cependant pas confondre lés firiiples af-
franchiffeffiens avec les conceflions de commuât : la
Rochelle étoit libre dès 1199; avant l’établiffement
de la commune.
Les conceflions de communis faites par le roi, S t
celles faites par les feigneurs, lorfqu’ elles ont été
confirmées par le roi, font perpétuelles Si irrévocables
, à moins que les communautés n’ayent mérité
d’en être privées par quelque mauvaiie aâion ;
comme il arriva aux habitans de la ville de Laon
fous Louis VI. pour avoir tué leur évêque , S i aux
Rochelois fous Louis XIÏ1. à caitfe de leur rébellion.
La plupart des privilèges qui avoient été accordés
aux communes, tels que la juftice, le droit d’entretenir
une milice fur p ié, de faire des levées extraordinaires
, leur ont été ôtés peu-à-peu par nos rois. L’ordonnance
de Moulins, art. j i . leur ôta la juftice civile
, leur laiffant encore l’exercice de la juftice criminelle
& de la police. Mais cela a encore depuis
été beaucoup reftreint, & dans la plûpart des villes
les officiers municipaux n’ont plus aucune jürifdic-
tion ; quelques-uns ont feulement une portion de la
police;
Sur l’établiflèmènt des communes, voÿeç Chopin ,
de dom. lib. I I I . tit. x x . n. S. &feq. La Thaumafliere ,
fu r les coutumes locales de Befri, ch. x j x . Ducange ,
glojf. lat. verb. communantia; Hauteferre yde ducibus,
c a p .jv . in fine} Defid. Heraldus, quoefi. quotid. p . 9 3 .
& $ 4 . les auteurs de la préfacé de la bibliothèque des.
Coutumes ; le recueil des ordonnant. de la troifieme race jj
hiß. eceléfiafiiq. de Fleury, iöme X I V . in-12. liv-.
L X V I . p. i $ j . & 1281 le prèfident Boiihier, en fe s
obferv. fu r la coutume de Bourgogne , ch. Lji p . 31. &
le prèfident Hénault, à la fin de fo n abrégé de l'hifi, de
France. (A ')
Commune, (\Jurifpr.) en tant que ce terme s’applique
à quelque pâturage, fignifie tout pâturage appartenant
à une communauté d ’habitans, foit que
ce pâturage foit un bas pré, ou que ce foit quelque
autre lieu de pafcage,telque les landes & bruyères ;
foit en plaine ou fur les moiltag-nes & côteaux. En
quelques endroits on les nomme ufelles, que f i ufa-
lia ; en d’autres ufints : ce qui vient toujours du mot
ufage.
La propriété des communes appartient à foute la
communauté enfemble, de maniéré que chaque habitant
en particulier ne peut difpofer feiil du droit
qu’il a dans la propriété : la communauté même ne'
peut en général aliéner fes communes ; & s’il fe trou-
v e des cas où elle eft autorifée en juftice à le faire,
ce n’eft qu’avec toutes les formalités établies pour
l’aliénation des biens des gens de main-morte.
On tient aufli pour maxime, que les communes
ne peuvent être faifies réellement, ni vendues par
decret, même pour dettes de la communauté; que
l’on peut feulement impofer la dette commune fur
les habitans, pour êtte par eux acquittée aux portions
& dettes convenables. Voye£ ci-devant Communauté
d’Habitans.
Quant à l’ufage des communes > il appartient à chaque
habitant, tellement que chacun peut y faire paître
tel nombre de beftiaux qu’il veut, même un troupeau
étranger, pourvû qu’il foithebergé dans le lieu
dont dépend la commune , en quoi il y a une différent
ce effentielle entre les communes Si les terres des par