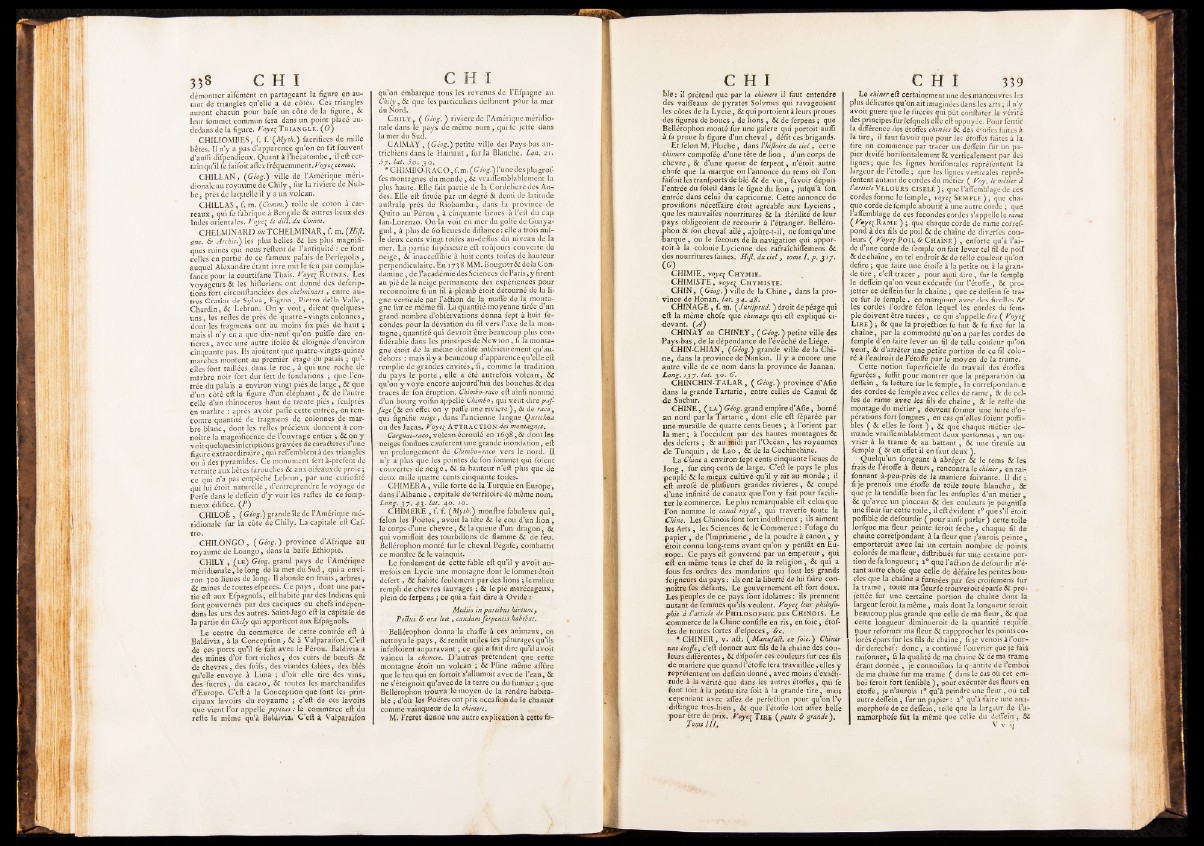
3 ? 8 C H I
démontrer aifément en partageant la figure en autant
de triangles qu’elle a de côtés. Ces triangles
auront chacun pour bafe un côté de la figure, &
leur fommet commun fera dans un point placé an-
dedans de la figure. Voyc[ T rian g l e. {O)
CHILIOMBES, f. f. {Myth.) facrifices de mille
bêtes. Il n’y a pas d’apparence cju’on en fît fouvent
d’auffi difpendieux. Quant à l’hecatombe, il eft certain
qu’il le faifoit affez fréquemment. V y e{ ce met.
CHILLAN, {Géog.) ville de l’Amérique méridionale
au royaume de C h ily , fur la riviere de Nub-
be, près de laquelle il y a un volcan.
CHILLAS, f. m. ([Cornrn.) toile de coton à carreaux
, qui fe fabrique à Bengale 8c autres lieux des
Indes orientales. Voye^ Le dia.du Comm.
CHELMINARD ou TCHELMIN AR, f. m. {Hift.
anc. & Archit.') les plus belles 8c les plus magnifiques
ruines qui nous relient de l’antiquité : ce font
celles en partie de ce fameux palais de Perfepolis ,
auquel Alexandre étant ivre mit le feu par complai-
fance pour la courtifane Thais. Voyeç Ruines. Les
voyageurs & les hiftoriens ont donné des defcrip-
tions fort circonftanciées des chelminars , entre autres
Gratias de S ylva, Figroa, Pietro délia Valle ,
Chardin, 8c Lebrun. On y v o it , difent quelques-
uns, les reftes de près de quatre-vingts colonnes,
dont les fragmens ont au moins fix pies de haut ;
mais il n’y en a que dix-neuf qu’on puiffe dire entières
, avec une autre ifolée 8c éloignée d’environ
cinquante pas. Ils ajoutent que quatre-vingts-quinze
marches montent au premier étage du palais ; qu’elles
font taillées dans le ro c , à qui une roche de
marbre noir fort dur fert de fondations ; que l’entrée
du palais a environ vingt piés de large, & que
d’un côté eft la figure d’un éléphant, 8c de l’autre
celle d’un rhinocéros haut de trente piés , fculptés
en marbre : après avoir paffé cette entrée, on rem-
contre quantité de fragmens de colonnes de marbre
blanc, dont les reftes précieux donnent à con-
noître la magnificence de l’ouvrage entier ; 8c on y
voit quelquesinfcriptions gravées de cara&eres d’une
figure extraordinaire, qui reffemblent à des triangles
ou à des pyramides. Ce monument fert à-prefent de
retraite aux bêtes farouches 8c aux oifeauxde proie :
ce qui n’a pas empêché Lebrun, par une ctiriofite
qui lui étoit naturelle, d’entreprendre le voyage de
Perfe dans le'deffein d’y voir les reftes de ce fomp-
tueux édifice. {P)
CHILOÉ , {Gcog.') grande île de l’Amérique méridionale
fur la côte de Chily. La capitale eft Caf-
tro.C
HILONGO , ( Gcog. ) province d’Afrique au
royaume de Loango, dans la baffe Ethiopie.
CHILY , ( le) Gcog. grand pays de l’Amérique
méridionale le long de la mer du Sud, qui a environ
300 lieues de long. Il abonde en fruits, arbres,
& mines de toutes efpeces. Ce pa ys, dont une partie
eft aux Efpagnols ; eft habité par des Indiens qui
font gouvernés par des caciques ou chefs indépen-
dans les uns des autres. Saint-Jago eft la capitale de
la partie du Chily qui appartient aux Efpagnols;
Le centre du commerce de cette contrée eft à
Baldivia, à la Conception, 8c à Valparaifon. C’eft
de ces ports qu’il fe fait avec le Pérou. Baldivia a
des mines d’or fort riches, des cuirs de boeufs 8c
de chevres, des fuifs, des viandes falées, des blés
qu’elle envoyé à Lima ; d’où elle tire des vins,
des fucres, du cacao, 8c toutes les marchandifes
d’Europe. C ’eft à la Conception que font les principaux
lavoirs du royaume ; c’eft de ces lavoirs
que vient l’or appellé pepitas : le commerce eft du
refte le même qu’à Baldivia. C ’eft à Valparaifon
C H I
qu’on embarque tous les revenus de l’Efpagne au
Chily, 8c que les particuliers deftinent pour la mer
du Nord.
C h il y , ( Gcog. ) riviere de l’Amérique méridionale
dans le pays de même nom, qui fe jette dans
la mer du Sud.
C A IM A Y , ( Gcog.) petite ville des Pays-bas autrichiens
dans le Hainaut, fur la Blanche. Lon, z i .
5y. lat. 5 0. 30.
* CHIMBO-RACO, f.m. {Géog.) l’une desplu grof-
fes montagnes du monde , 8c vraiffemblablement la
plus haute. Elle fait partie de la Cordeliere des Andes.
Elle eft fituée par un degré & demi de latitude
auftrale près de Riobamba, dans la province de
Quito au Pérou , à cinquante lieues à l’eft du cap
fan-Lorenzo. On la voit en mer du golfe de Guaya-
guil, à plus de 60 lieues de diftance : elle a trois mille
deux cents vingt toifes au-deffus du niveau de la
mer. La partie fupérieure eft toujours couverte de
neige, & inacceffible à huit cents toifes de hauteur
perpendiculaire.En 1738 MM.Bouguer&delaCon-
damine, de l’académie des Sciences de Paris, y firent
au pié de la neige permanente des expériences pour
reconnoître fi un fil à-plomb étoit détourné de la ligne
verticale par l’aêHon de la maffe de la montagne
fur ce même fil. La quantité moyenne' tirée d’un
grand nombre d’obfervations donna fept à huit fécondés
pour la déviation du fil vers l’axe de la mon-
tagne, quantité qui devroit être beaucoup plus con-
fidérable dans les principes de Newton, fi. la montagne
étoit de la même denfité intérieurement qu’au-
dehors : mais il y a beaucoup d’apparence qu’elle eft
remplie de grandes cavités, f i , comme la tradition
du pays le porte, elle a été autrefois volcan, 8c
qu’on y voye encore aujourd’hui des bouches & des
traces de fon éruption. Chimbo-raco eft ainfi nommé
d’un bourg voifin appellé Chimbo, qui veut dire paß
fagc (& en effet on y paffe une riviere ) , & de race y
qui fignifie neige, dans l’ancienne langue Quctchoa
ou des Jacas. Voyc^ A t t r a c t io n des montagnes.
Carguai-raco, volcan écroulé en 1698,8c dont les
neiges fondues cauferent une grande inondation, eft
un prolongement de Chimbo-raco vers le nord. Il
n’y a plus que les pointes de fon fommet qui foient
couvertes de neige, 8c fa hauteur n’eft plus que de
deux mille quatre cents cinquante toifes.
CHIMERA, ville forte de la Turquie en Europe-,
dans l ’Albanie, capitale de territoire de même nom*
Long, 3 7 , 43. lat. 40. 10.
CHIMERE , f. f. {Myth.) monftre fabuleux qui,
félon les Poètes , avoit la tête & le cou d’un lion ,
le corps d’une chevre, 8c la queue d’un dragon, 8c
qui vomiffoit des tourbillons de , flamme 8c de feu.
Bellérophon monté fur le cheval Pégafe, combattit
ce monftre 8c le vainquit.
Le fondement de cette fable eft qu’il y avoit autrefois
en Lycie une montagne dont le fommet étoit
defert, 8c habité feulement par des lions ; le milieu
rempli de chevres fauvages ; 8c le pié marécageux,
plein de ferpens ; ce qui a fait dire à Ovide :
Mediis in partibus hircum ,
Peclus & ora Ica , càudam ferpentis habebat.
Bellérophon donna la chaffe à ces animaux, en
nettoya le pays, 8c rendit utiles les pâturages qu’ils
infeftoient auparavant ; ce qui a fait dire qu’il avoit
vaincu la chimère. D ’autres prétendent que cette
montagne étoit un volcan ; 8c Pline même affure
que le feu qui en fortoit s’allumoit avec de l’eau, 8c
ne s’éteignoit qu’avec de la terre ou du fumier ; que
Bellérophon trouva le moyen de la rendre habitable
; d’où les Poètes ont pris occafion de le chanter
comme vainqueur de la chimère. ,
M. Freret donne une autre explication à cette fa-
C H I
ble : il prétend que par la chimère il faut enteridre
des vaiffeaux de pyrates Solymes qui ravageoient
les côtes de la Ly c ie, 8c qui portoient à leurs proues
des figures de boucs , de lions , 8c de ferpens ; que
Bellérophon monté fur une galere qui portoit aufiî
à fa proue la figure d’un ch eval, défit ces brigands.
Et félon M. Pluche, dans Ÿhijloire du ciel, cetre
chimere compofée d’une tête de bon , d’un corps de
chevre, 8c d’une queue de ferpent, n’étoit autre
chofe que la marque ou l’annonce du tems où l’on
faifoit les tranfports de blé 8c de v in , favoir depuis
l ’entrée du foleil dans le ligne du lion , jufqu’à fon.
entrée dans celui du capricorne. Cette annonce de
provifions néceffaire étoit agréable aux Lyciens ,
que les mauvaifes nourritures 8c la ftérilite de leur
pays obligeoient de recourir à l’étranger. Bellérophon
8c fon cheval aîlé, ajoûte-t-il, ne font qu’une
Barque , ou le fecours de la navigation qui appor-
to ità la colonie Lycienne des rafraîchiffemens 8c
des nourritures faines. Hift. du ciel, tome I. p. 3/7.
(C)C
HIMIE, voye[ C h ym ië .
CHIMISTE, voyesç C h ym is tE.
CHIN, ( Géog. ) ville de la Chine, dans la pro-
yince de Honan. lat. 3 4. 48.
CHINAGE , f. m. {Jurifprud. ) droit de péage qui
eft la même chofe que chemagc qui eft expliqué ci-
devant. {A)
CHINAY e« CHINEY, ( Géog. ) petite ville des
Pays-bas, de la dépendance de l’évêché de Liège.
CHIN-CHIAN, {Géog.) grande ville de la Chin
e , dans la province de Nankin. II y a encore une
autre ville de ce nom dans la province de Jannan.
Long. 137. lat. 30. G.
CHINCHIN-TALAR, ( Géog.) province d’Afie
dans la grande Tartarie, entre celles de Camul 8c
4e Suchur.
CHINE, ( l a ) Géog. grand empire d’Afie, borné
au nord par la Tartarie, dont elle eft féparée par
une muraille de quatre cents lieues ; à l ’orient par
la mer ; à l’occident par des hautes montagnes 8c
des deferts ; 8c au: üfiidi par l’Océan, les royaumes
de Tunquin , de Lao , 8c de la Cochinchine.
La Chine a environ fept cents cinquante lieues de
long , fur cinq cents de large. C ’eft le pays le plus
peuplé 8c le ànieux cultivé qu’il y ait au monde ; il
eft arrofé dè pmfieurs grandes rivières, 8c coupé
d’une infinité de canaux que l’on y fait pour faciliter
le commerce. Le plus remarquable eft celui que
Ton nomme le canal royal, qui traverfe toute la
Chine. Les Chinois font fort induftrieux ; ils aiment
les Arts , les Sciences 8c le Commerce : l’ufage du
papier , de l’Imprimerie, de la poudre à canon, y
étoit connu long-tems avant qu’on y penlât en Europe.
Ce pays eft gouverné par un empereur, qui
eft en même tems le chef de la religion , 8c qui a
fous fes ordres des mandarins qui font les grands
feigneurs du pays : ils ont la liberté de lui faire con-
noitre fes défauts. Le gouvernement eft fort doux.
Les peuples de ce pays font idolâtres : ils prennent
:autant de femmes qu’ils veulent. Voye{ leur philofo-
phie à l'article de Philosophie DES CHINOIS. Le
commerce de la Chine confifte en ris, en foie, étoffes
de toutes fortes d’efpeces, &c.
* CHINER , V. aû. ( Manufacl. en foie. ) Chiner
une étoffe , c’eft donner aux fils de la chaîne dés couleurs
différentes, 8c difpofer ces couleurs fur ces fils
de maniéré que quand l’étoffe fera travaillée, elles y
repréfentent un deffein donné, avec moins d’exafti-
tude à la vérité que dans les autres étoffes, qui fe
font foit à la petite tire foit à la grande tire, mais
cependant avec affez de perfe&ion pour qu’on l’y
diftingùe très-bien, 8c que l’étoffe lbit affez belle
pour être de prix. .^oyc^ TIRE {petitç & grande ) .
J om m *
C H I 339
Le chiner eft certainement une des manoeuvres les
plus délicates qu’on ait imaginées dans les arts ; 11 n’y
avoit guere que le fuccès qui pût conftater la vérité
des principes fur lefquels elle eft appuyée. Pour fentir
la différence des étoffes chinées 8c dés étoffes faites à
la tire, il faut favoir que pour les étoffes faites à la
tire on commence par tracer un deffein fur un papier
divifé horifontalement 8c verticalement par des
lignes ; que les lignes horifontales répréfentent là
largeur de l’étoffe ; que les lignes verticales repréfentent
autant de cordes du métier ( Voy. le métier à
C article V e l o u r s C I S E L É ) ; que l’â ffem b la g e de ces
cordes forme le femple, voyc^ Semple ) ; que chaque
corde de femple aboutit à une autre corde ; que
l’affemblage de ces fécondés cordes s’appelle le ramé
{ P R a m e ) ; que chaque corde de rame coftef-
pond à des fils de poil 8c de chaîne de diverfes couleurs
( Voye^ P o i l & C h a în e ) , enforte qu’à l’aide
d’une corde de femple on fait lever tel fil de poil
8cde chaîne, en tel endroit 8c de telle couleur qu’ort
defire ; que faire une étoffe à la petite ou à la graii-
de tire, c’eft tracer , pour ainfi dire , fur le femple
le deffein qu’on veut exécuter fur l’étoffe , 8c pro*;
jetter ce deffein fur la chaîne ; que ce deffein fe trace
fur le femple, en marquant avec des ficelles 8c
les cordes l’ordre félon lequel les cordes du femple
doivent être tirées , ce qui s’appelle lire { Voyer^
L i r e ) ; 8c que la projeftion fe fait 8c fe fixe fur la
chaîne, par la commodité qu’on a par les cordes de
femple d’en faire lever un fil de telle couleur qu’on
veut, 8c d’arrêter une petite portion de ce fil colo-,
re à l’endroit de l’étoffe par le moyen de la trame.
Cette notion fuperficieile du travail des étoffes
figurées , fuffit pour montrer que la préparation du
deffein, fa le&ure fur le femple, la correfpondance
des cordes de femple avec celles de rame, 8c de celles
de rame avec les fils de chaîne , 8c le refte du
montage du métier , doivent former une fuite d’operations
fort longues , en cas qu’elles foient poflï-
bles ( 8c elles le font ) , 8c que chaque métier demande
vraiffemblablement deux perfonnes, un ouvrier
à la trame 8c au battant, 8c une tireufe au
femple ( 8c en effet il en faut deux ).
Quelqu’un fongeant à abréger 8c le tems 8c les
frais de l’étoffe à fleurs, rencontra le chiner, en rai-,
fonnant à-peu-près de la maniéré fuivante. Il dit t
fi je prenois une étoffe de toile toute blanche, 8c
que je la tendiffe bien fur les enfuples d’un métier ,
8c qu’avec un pinceau 8c des couleurs je peigniffe
une fleur fur cette toile, il eft évident i° que s’il étoit
poflible de defourdir ( pour ainfi parler ) cette toile
lorfque ma fleur peinte feroit feche , chaque fil de
chaîne correfpondant à la fleur que j’aurois peinte,
emporteroit avec lui un certain nombre de points
colores de ma fleur, diftribués fur une certaine portion
de fa longueur ; a° que l’ afrion de defourdir n’étant
autre chofe que celle de défaire les petites boucles
que la chaîne a formées par fês croifemens lur
la trame , toute ma fleur fe trouveroit éparfe 8c proje
té e fur une certaine portion de chaîne dont là
largeur feroit la même, mais dont la longueur feroit
beaucoup plus grande que celle de ma fleur, 8c que
cette longueur diminueroit de la quantité requifè
pour reformer ma fleur 8c rappprocher lés points colorés
épars fur les fils de chaîne, fi je venois à l’ourdir
derèchef : donc, a continué l’ouvrier que je faiâ
raifonner, fi la qualité de ma chaîne 8c de ma tramé
étant donnée , je connoiffois la quantité de l emboi
de ma chaîne fur ma trame ( dans le Cas où cet em-
boi feroit fort fenfible ) , pour exécuter des fleurs eh
étoffe, je n’aurois i° qu’à peindrê une fleur, ou tel
autre deffein, fur un papier : i ° qu’à faire une ana-
morphofe de ce deffein, tellé que la largeur de IV-
namorphofe fût là même que celle du deffein , Ht