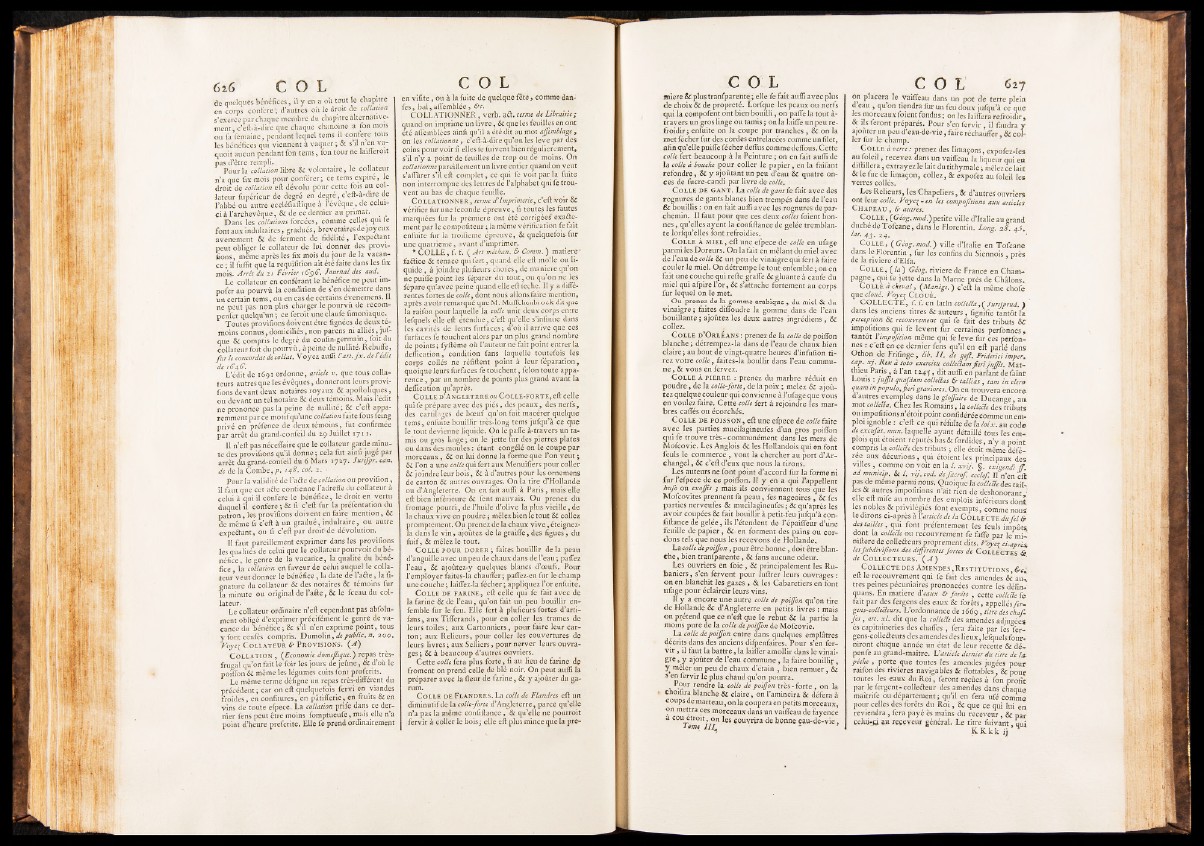
6i 6 C O L
de quelques bénéfices, il y en a où tout le chapitre
en corps conféré ; d’autres où le droit de collation
s ’exerce par chaque membre du chapitre alternativement
, c’eft-à-dire que chaque chanoine a fon mois
ou fa femaine, pendant lequel tems il conféré tous
les bénéfices qui viennent à vaquer ; & s’il n’en v a-
quoit aucun pendant fon tems, fon tour ne laifferoit
pas d’être rempli*
Pour la collation libre & volontaire, le collateur
n’a que fix mois pour conférer ; ce tems expire, le
droit de collation eft dévolu pour cette fois au collateur
fupérieur de degré en degre, c’eft-à-dire de
l’abbé ou autre eccléfiaftique à l’évêque , de celui-
c i à l’archevêque, & de ce dernier au primat. ^
Dans les collations forcées, comme celles qui le
font aux indultaires, gradués, brevetairesde joyeux
avenement & de ferment de fidélité, l’expeCtant
peut obliger le collateur de lui donner des provie
n s , meme après les fix mois du jour de la vacance
; il fuffit que la requifition ait été faite dans les fix
mois. Arrêt du zi Février /éTcjtf. Journal des aud.
L e collateur en conférant le bénéfice ne peut im-
pofer au pourvu la condition de s’en demettre dans
un certain tems, ou en cas de certains evenemens. Il
ne peut pas non plus charger le pourvû de récom-
penfer quelqu’un ; ce feroit une claufe fimoniaque.
Toutes provifions doivent être lignées de deux témoins
connus, domiciliés, non parens ni alliés, juf-
que & compris le degré du coufin-germain, foit du
collateur foit du pourvû, à peine de nullité. Rebuffe,
fur le concordat de collât. Voyez auffi l ’art.-jx. de l’édit
de 1G46'. 4 ..." *k - H H H '■
L ’édit de 1691 ordonne, article v. que tous colla-
teurs autres que les évêques, donneront leurs provi-
lions devant deux notaires royaux & apoftohques,
ou devant un tel notaire & deux témoins. Mais l’édit
ne prononce pas la peine de nullité ; & c’eft apparemment
par ce m otif qu’une collation faite fous feing
privé en préfence de deux témoins , fut confirmée
par arrêt du grand-confeil du 19 Juillet 1711.
Il n’eft pas néceffaire que le collateur garde minute
des provifions qu’il donne ; cela fut ainfi juge par
arrêt du grand-conleil du 6 Mars 1 7 *7 ’ I urifpr- can-
de d e là Combe,/». 148. col. z. •
Pour la validité de l’a été de collation ou provifion,
il faut que cet aéte contienne l’adrelfe du collateur à
celui à qui il conféré le bénéfice, le droit en vertu
duquel il conféré ; & fi c’eft fur la préfentation du
patron, les provifions doivent en faire mention, &
de même fi c’eft à un gradué, indultaire, ou autre
expettant, ou fi c’eft par droit>de dévolution.
Il faut pareillement exprimer dans les provifions
les qualités de celui que le collateur pourvoit dubé-
néfice, le genre de la v ac ance, la qualité du bénéfice
la collation en faveur de celui auquel le collateur
veut donner le bénéfice, la date de l’aéte, la fi-
gnature du collateur & des notaires & témoins fur
la minute ou original de l’aéte, &C le fceau du collateur.
1
Le collateur ordinaire n’eft cependant pas abfolu-
ment obligé d’exprimer précifément le genre de vacance
du bénéfice; & s’il n’en exprime point, tous
yfon teenfés compris. Dumolin, de public, n. zoo.
Foye[ C ollateur & Provisions. (A)
C ollation , (Economie domeflique.') repas très-
frugal qu’on fait le foir les jours de jeûne, & d’où le
poiffon & même les légumes cuits font proferits.
Le même terme défigne un repas très-différent du
précédent ; car on eft quelquefois fervi en viandes
froides, en confitures, en pûtifferie, en fruits & en
vins de toute efpece. La collation prife dans ce dernier
fens peut être moins fomptueufe, mais elle n’a
point d’heure preferite. Elle fe prend ordinairement
C O L
en v ifite, ou à la fuite de quelque fête, comme dan-
fes, bal ,.affemblée, &c.
COL LA TIO NN ER , verb. a£t. terme de Librairie;
quand on imprime un liv re , & que les feuilles en ont
été affemblées ainfi qu’il a été dit au mot ajfemblage ,
on les collationne, c’eft-à-dire qu’on les leve par des
coins pour voir fi elles fe fuivent bien régulièrement,
s’il n’y a point de feuilles de trop ou de moins. On
collationne pareillement un livre entier quand on veut
s’affûrer s’il eft complet, ce qui. fe voit par la fuite
non interrompue des lettres de l’alphabet qui fe trouvent
au bas de chaque feuille.
C o l l a t i o n n e r , terme d’imprimerie, c’eft voir &
vérifier lur une fécondé épreuve , fi toutes les fautes
marquées fur la première ont été corrigée^ exaCte-
ment par le compofiteur ; la même vérification fe fait
enfuite fur la troifieme épreuve, & quelquefois fur
une quatrième, avant d’imprimer.
* C O L L E , f. f. ( Art méchan. & Comm. ) matière*
faCtice & tenace qui fert,. quand elle eft molle ou liquide
, à joindre plufieurs chofes, de maniéré qu’on
ne puiffe point les féparer du tout, ou qu’on ne les
fépare qu’avec peine quand elle eft lèche. II y a différentes
fortes de colle, dont nous allons faire mention,
après avoir remarqué que M. Muffchenbroek dit que
la raifon pour laquelle la colle unit deux corps entre
lefquels elle eft étendue, c’eft qu’elle s’infinue dans
les cavités de leurs furfaces; d’où il arrive que ces
furfaces fe touchent alors par un plus grand nombre
de points ; fyftème où l’auteur ne fait point entrer la
déification, condition fans laquelle toutefois les
corps collés ne réfiftent point à leur féparation,
quoique leurs furfaces fe touchent, félon toute apparence
, par un nombre de points plus grand avant la
déification qu’après.
C o l l e d ’A n g l e t r r e o w C o l l e -f o r t e , eft celle
qui fe prépare avec des p ié s, des p e au x , des nerfs ,
des cartilages de boeuf qu’on fait macérer quelque
tems, enfuite bouillir très-long tems jufqu’à ce que
le tout devienne liquide. On le paffe à-travers un tamis
ou gros linge ; on le jette lur des pierres plates
ou dans des moules : étant congélé on le coupe par
morceaux, & on lui donne la forme que l’on veut ;
& l’on a une colle qui fert aux Menuifiers pour coller
& joindre leur b o is, & à d’autres pour les ornemens
de carton & autres ouvrages. On la tire d’Hollande
ou d’Angieterre. On en fait aulfi à P aris, mais elle
eft bien inférieure & fent mauvais. Ou prenez du
| fromage pourri, de l’huile d’olive la plus vieille, de
la chaux vive en poudre ; mêlez bien le tout & collez
promptement. Ou prenez de la chapx v iv e , éteignez-
la dans le v in , ajoûtez de la graiffe, des figues, du
fu if, & mêlez le tout.
C o l l e p o u r d o r e r ; faites bouillir de la peau
d’anguille avec un peu de chaux dans de l’eau ; paffez
l’e au , & ajoûtez-y quelques blancs d’oeufs. Pour
llî’employer faites-la chauffer ; paffez-en fur le champ
une couche ; laiffez-la fécher ; appliquez l’or enfuite.
C o l l e d f . f a r i n e , eft celle qui fe fait avec de
la farine & de l’e au , qu’on fait un peu bouillir en-
femble fur le feu. Elle fert à plufieurs fortes d’arti-
fan s, aux Tifferands, pour en coller les trames de
leurs toiles ; aux Cartonniers, pour faire leur carton;
aux Relieurs, pour coller les couvertures de
leurs livres; aux Selliers, pour nerver leurs ouvrages
; & à beaucoup d’autres ouvriers.
Cette colle fera plus forte, fi au lieu de farine de
froment on prend celle de blé noir. On peut auffi la
préparer avec la fleur de farine, & y ajoûtér du ga-
mm.
C o l l e d e F l a n d r e s . La colle de Flandres eft un
diminutif de la colle-forte d’Angleterre, parce qu’elle
n’a pas la même confiftance, ôc qu’elle ne pourroit
fervir à coller le bois ; elle eft plus mince que la pre-
C 0 L
miere Sc plus tranfparente ; elle fe fait auffi avec plus
de choix & de propreté. Lorfque les peaux ou nerfs
qui la compofent ont bien bouilli, on paffe la tout à-
travers un gros linge ou tamis ; on ia laiffe un peu refroidir
; enfuite on la coupe par tranches , & on la
met fécher fur des cordes entrelacées comme un filet,
afin qu’elle puiffe fécher deffus comme deffous. Cette
colle fert beaucoup à la Peinture ; on en fait auffi de
la colle à bouche pour coller le papier, en la faifant
refondre, & y ajoûtant un peu d’eau & quatre onces
de fucre-candi par livre de co//e. •
C o l l e d e g a n t . L a colle de gant le fait avec des
rognures de gants blancs bien trempés dans de l’eau
& bouillis : on en fait auffi avec les rognures de parchemin.
Il faut pour que ces deux colles foient bonnes
, qu’elles ayent la confiftance de gelée tremblante
lorfqu’elles font refroidies.
C o l l e à m ie l , eft une efpece de colle en ufage
parmi les Doreurs. On la fait en mêlant du miel avec
de l’eau de colle & un peu de vinaigre qui fert à faire
couler le miel. On détrempe le tout enlemble ; on en
fait une couche qui refte graffe & gluante à caufe du
miel qui afpirel’o r , & s’attache fortement au corps
fur lequel on le met;
Ou prenez de la gommé arabique, du miel & du
vinaigre ; faites diffoudre la gomme dans de l’eau
bouillante ; ajoûtez les deux autres ingrédiens , &
collez.
C o l l e d’Or l éa n s r prenez de la colle de poiffon
blanche ; détrempez-Ia dans de l’eau de chaux bien
c laire; au bout de vingt-quatre heures d’infufion tirez
votre colle, faites-la bouffir dans l’eau commun
e , & vous en fervez.
C o l l e à p ie r r e : prenez du marbre réduit en
p o u d re , de la colle-forte, de la poix ; melez & ajoûtez
quelque couleur qui convienne à l’ufage que vous
en voulez faire. Cette colle fert à rejoindre les marbres
caffés ou écorchés.
C o l l e de p o i s so n , eft une efpece de colle faite
avec les parties mucilagineufes d’un gros poiffon
qui fe trouve très-communément dans les mers de
Mofcovie. Les Anglois & les Hollandois qui en font
feuls le commerce, vont la chercher au port' d’Ar-
changel, & c’eft d’eux que nous la tirons.
Les auteurs ne font point d’accord fur la forme ni
fur l’efpece de ce poiffon. Il y en a qui l’appellent
hufo ou exojjis ; mais ils conviennent tous que les
Mofcovites prennent fa p e au , fes nageoires , & fes
parties nerveufes & mucilagineufes ; & qu’après les
avoir coupées & fait bouillir à petit-feu jufqu’à confiftance
de g e lé e , ils l’étendent de l’épaiffeur d’une
feuille de p ap ie r, &• en forment des pains ou cordons
tels que nous les recevons de Hollande.
La colle de poiffon, pour être bonne, doit être blanche
, bien tranfparente, & fans aucune odeur.
Les ouvriers en fo ie , & principalement les Rubaniers
, s’en fervent pour luftrer leurs ouvrages :
on en blanchit les gazes , & les Cabaretiers en font
ufage pour éclaircir leurs vins.
Il y a encore une autre colle de poiffon qu’on tire
de Hollande & d’Angleterre en petits livres ; mais
on prétend que ce n’eft que le rebut & la partie la
moins pure de la colle de poiffon de Mofcovie.
1 L a colle de poiffon entre dans quelques emplâtres
décrits dans des anciens difpenfaires. Pour s’en fervir
, il faut la b a ttre , la laiffer amollir dans le vinai-
g r e , y ajoûter de l’eau commune, la faire bouillir,
Jr mêler un peu de chaux d’étain , bien remuer, &
s en fervir le plus chaud qu’on pourra.
Pour rendre la colle de poiflon très-forte , on la
choifira blanche & claire, on l’amincira & défera à
coups de marteau, on la coupera en petits morceaux,
on mettra ces m orceaux dans un vaiffeau de fayence
à cou étroit, on les couvrira de bonne eau-de-vie,
Tome IIIA
C O L C i 7
on placera le Vaiffeau dans un pot de terré plein
d eau , qu on tiendra fur un feu doux jufqu’à ce que
les m orceaux foient fondus ; on les laiffera refroidir,
& ils feront préparés. Pour s’en fervir , il faudra y
ajoûter un peu d’eau J e - v i e , faire réchauffer & coller
fur le champ.
: - C o l l e à verre .- prenez des limaçons, expofez-Ies
au fo le il, recevez dans un vaiffeau la liqueur qui en
diftillera, extrayez le lait du tithymalé ; mêlez ce lait
& le ftféde liipaçon, collez, & expofez au foleil le»
Verres collés.
Les R elieurs, les'Ghapeliers, St d’ autres Ouvriers
ont leur colle. V->yt{ - en Us comportions aux articles
C hapeau , & autres.
C o l l e , (Géog. mod.') petite ville d’Italie au grand
duché de To fcane , dans le Florentin. Long. z 8 . 45.
lat. 43. 2.4. *
C o l l e , (Geog. mod.) ville d’Italie en Tofcarte
dans le Florentin , fur les confins du SiennOis , près
de la riviere d’Elfa.
C o l l e j ( / « ) Géog, riviere de France en Cham-*
pagn e, qui fe jette dans la Marne près de Chalons*.
C o l Lé à cheval, (Manège. ) c’eft la même chofe
que cloué. Foye^ CLOUÉ.
C O L L E C T E , f. f. en latin collecta, ( Jurifprud. )
dans les anciens titres & auteurs , fignifie tantôt la
perception & recouvrement qui fe fait des tributs &:
impositions qui fe lèvent lur certaines perfonnôs,
tantôt Yimpojîtion même qui fe leve fur ces perfon-
nes : c ’eft en ce dernier fens qu’il ert eft parlé dans
Othon de Frifinge, lib. II. de gefl. Friderici imper,
cap. xj. Rex à toto exercitu colleclam fieri jufjit. Matthieu
P a r is, à l’an 1 2 4 5 , dit auffi en parlant de fainC
Louis : jufjit quafdam collectas & tallias, tam in clero
quam in populo, fieri graviores. On en trouvera encor©
d autres exemples dans le gloffaire de Du can g e, a it
mot collecta. Chez le.s R omains, la collecte des tributs
ou impofitions n’étoit point confidérée comme un emploi
ignoble : c’eft ce qui réfuite de la loix, au code
de exeufat. mun. laquelle ayant détaillé tous les em- •
plois qui étoient réputés bas & fordides, n’y a point
compris la collecte des tributs ; elle étoit même déférée
aux décurions , qui étoient les principaux des ■
v ille s , comme on voit en la l. xvij. § . exigendi ff.
ad municip. & L vij. cod. de facrof. ecclef. Il n’en eft
pas de même parmi nous. Quoique la collecte des tail^
les & autres impofitions n’ait rien de déshonorant ’
elle eft mife au nombre des emplois inférieurs dont
les nobles & privilégiés font exempts, comme nous’
le dirons ci-après à l’article de la C o l l e c t e dufel &
des tailles, qui font préfentement les feuls impôts,
dont la collecte ou recouvrement fe faffe par le mi-
niftere de collerieurs proprement dits. Voye^ ci-après,
lesfubdivifions des différentes fortes de C o l l e c t e s &
de C o l l e c t e u r s . ( A )
C o l l e c t e de s Am endes , R e s t it u t io n s , & d
eft le recouvrement qui fe fait des amendes & a it.
très peines pécuniaires prononcées contre les délin-*'
quans. En matière d’eaux & forêts , cette collecte fe
fait par des fergens des eaux & forêts, appellésfer-
gens-collecteurs. L ’ordonnance de 1669 >tltrC des Gaffes
, art. xl. dit que la collecte des amendes adjugées
ès capitaineries des chaffes , fera faite par les 1er-
gens-colle&eurs des amendes des lieux, lefquels four*
n iront chaque année un état de leur recette & dé-
penfe au grand-maître. Varticle dernier du titre de les
pêche, porte que toutes les amendes jugées pouf
raifon des rivières navigables & flottables, & pour
toutes les eaux du R o i , feront reçûes à fon profit
par le fergent-collecteur des amendes dans chaque
maîtrife ou département ; qu’il en fera ufé comme
pour celles des forêts du R o i , & que ce qui lui en
reviendra , fera payé ès mains du receveur , & par
çelui-jû au receveur général. L e titre fuivant qui
K .K .k k ij