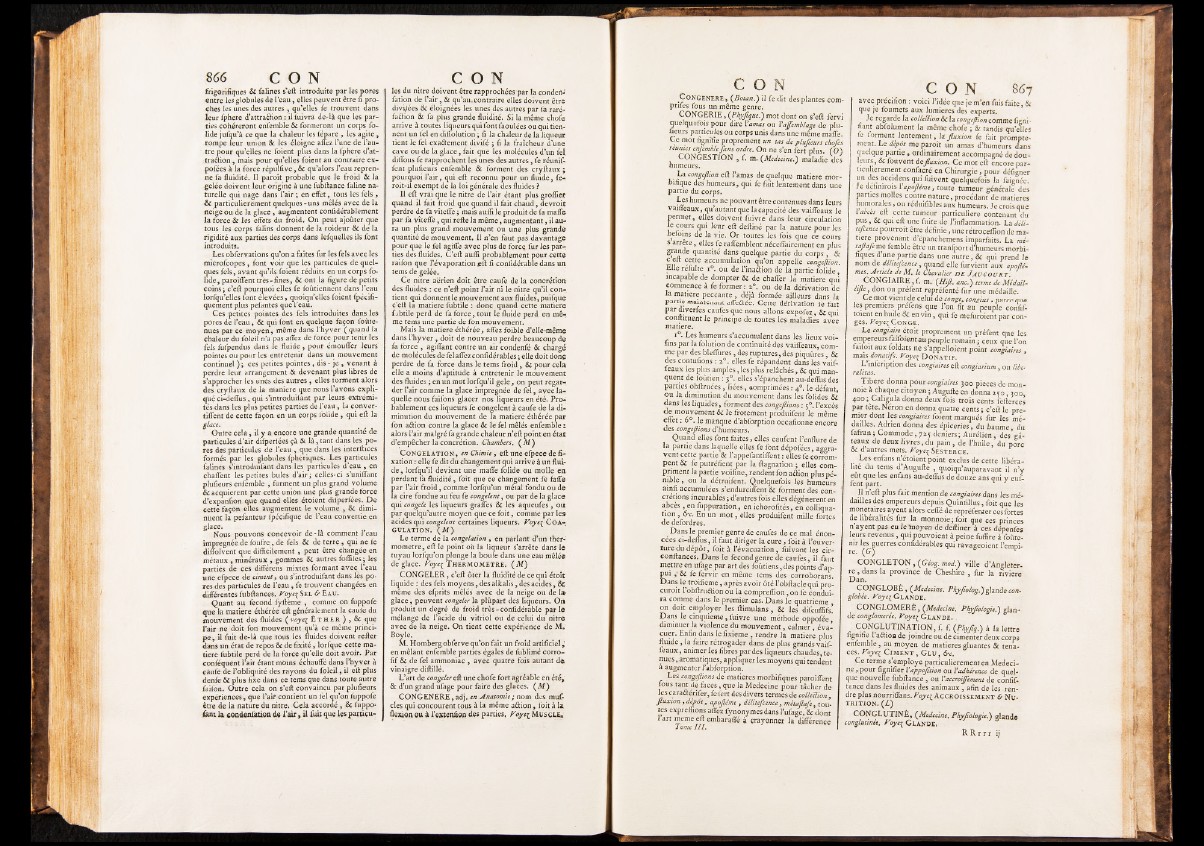
frigorifiques & falines s’eft introduite par les pores
entre les globules de l ’eau, elles peuvent être li proches
les unes des autres , qu’elles fe trouvent dans
leur fphere d’attraûion : il luivra de-là que les parties
cohéreront ensemble & formeront un corps fo-
lide jufqü’à ce que la chaleur les fépare , les agite,
rompe leur union & les éloigne affez l’une de l’autre
pour qu’elles ne foient plus dans la fphere d’at-
tra&ion, mais pour qu’elles foient au contraire ex-
pofées à la force répulfive, & qu’alors l’eau reprenne
fa fluidité. II paroît probable que le froid & la
gelée doivent leur origine à une fubftance faline naturelle
qui nage dans l’air ; en effet, tous les fels ,
& particulièrement quelques-uns mêlés avec de la
neige ou de la glace, augmentent confidérablement
la force & les effets du froid. On peut ajouter que
tous les corps falins donnent de la roideur & de la
rigidité aux parties des corps dans lefquelles ils font
introduits.
Les obfervations qu’on a faites fur les fels avec les
miçrofcopes, font voir que les particules de quelques
fels, avant qu’ils foient réduits en un corps folide,
paroiffent très-fines, & ont la figure de petits
coins ; c’eft pourquoi elles fe foûtiennent dans l’eau
lorfqu’elles font é levées, quoiqu’elles foient fpécifi-
quement plus pefantes que l’eau.
Ces petites pointes des fels introduites dans les
pores de l’eau, & qui font en quelque façon foûte-
nues par ce moyen, même dans l’hyver ( quand la
chaleur du foleil n’a pas affez de force pour tenir les
fels fufpendus dans le fluide , pour émouffer leurs
pointes ou pour les entretenir dans un mouvement
continuel ) ; ces petites pointes, dis - je , venant à
perdre leur arrangement & devenant plus libres de
s’approcher les unes des autres, elles torment alors
des cryftaux de la maniéré que nous l’avons expliqué
ci-deffus, qui s’introduifant par leurs extrémités
dans les plus petites parties de l’eau, la convertirent
de cette façon en un corps folide, qui eft la
glace.
Outre cela, il y a encore une grande quantité de
particules d ’air difperfées çà & là , tant dans les pores
des particules de l’eau , que dans les interfaces
formés par les globules fphériques. Les particules
falines s’introduifant dans les particules d’eau , en
chaflént les petites bules d’a ir; celles-ci s’unifiant
plufieurs enfemble , forment un plus grand volume
& acquièrent par cette union une plus grande force
d’expanfion que quand elles étoient difperfées. De
cette façon elles augmentent le volume , & diminuent
la pefanteùr fpécifique de l’eau convertie en
glace.
Nous pouvons concevoir de-là comment l’eau
imprégnée de foufre, de fels & de terre, qui ne fe
diflolvent que difficilement , peut être changée en
métaux , minéraux , gommes & autres foffiles ; les
parties de ces différens mixtes formant avec^l’eau
une efpeee de ciment, ou s’introduifant dans les pores
des particules de l’eau , fe trouvent changées en
différentes fubftances. Voye^ SEL & Eau.
Quant au fécond fyftème , comme on fuppofe
que la matière éthérée eft généralement la caule du
mouvement des fluides ( voye{ É th e r ) , & que
l’air ne doit fort mouvement qu’à ce même principe
» il fuit de-là que tous les fluides doivent refter
dans un état de repos & de fixité, lorfque cette matière
fubtile perd de la force qu’elle doit avoir. Par
conléquènt l’air étant moins échauffé dans l’hyver à
caufe de l’obliquité des rayons du foleil, il eft plus
denfe & plus fixe dans ce tems que dans toute autre
faifon. Outre cela on s’eft convaincu par plufieurs
expériences, que l’aif contient un l'el qu’on fuppofe
être de la nature du nitre. Cela accordé , & fuppo-
fant la condenlation de Pair » il fuit que les parùçules
du nitre doivent être rapprochées par la condert-
fation de l’a ir , & qu’au.contraire elles doivent être
divisées & éloignées les unes des autres par fa raré-
fa&ion & fa plus grande fluidité. Si la même chofe
arrive à toutes liqueurs qui font faoulées ou qui tiennent
un l'el en dillolution ; fi la chaleur de la liqueur
tient le fel exactement divifé ; fi la fraîcheur d’une
cave ou de la g lace, fait que les molécules d’un fel
diffous fe rapprochent les unes des autres, fe réunif-
fent plufieurs enfemble & forment des cryftaux ;
pourquoi l’air, qui eft reconnu pour un fluide, fe-
roit-il exempt de la loi générale des fluides }
Il eft vrai que le nitre de l’air étant plus groffier
quand il fait froid que quand il fait chaud, devroit
perdre de fa vîteffe ; mais auffi le produit de fa mafle
par fa vîteffe, qui refte la même, augmentant, il aura
un plus grand mouvement ou une plus grande
quantité de mouvement. Il n’en faut pas davantage
pour que le fel agiffe avec plus de force fur les parties
des fluides. C ’eft auffi probablement pour cette
raifon que l’évaporation eft fi confidérable dans un
tems de gelée.
Ce nitre aerien doit être caufe de la concrétion
des fluides : ce n’eft point l’air ni le nitre qu’il contient
qui donnent le mouvement aux fluides, puifque
c’eft la matière fubtile : donc quand cette matière
f.ibtile perd de fa force, tout le fluide perd en mê-,
me tems une partie de fon mouvement.
Mais la matière éthérée, affez foible d’elle-même
dans l’h y v e r , doit de nouveau perdre beaucoup de
fa force , agiffant contre un air condenfé & chargé
de molécules de fel affez confidérables ; elle doit donc
perdre de fa force dans le tems froid, & pour cela
elle a moins d’aptitude à entretenir le mouvement
des fluides ; en un mot lorfqu’il gele, on peut regar-,
der l’air comme la glace imprégnée de fe l, avec la-,
quelle nous faifons glacer nos liqueurs en été. Pro-;
bablement ces liqueurs fe congèlent à caufe de la diminution
du mouvement de la matière éthérée par
fon aâion contre la glace & le fel mêlés enfemble :
alors l’air malgré fa grande chaleur n’eft point en état
d’empêcher la concrétion. Chambers. ( d f )
C o n g é l a t i o n , en Chimie, eft une efpeee de fixation
: elle fe dit du changement qui arrive à un fluide
, iorfqu’il devient une mafle folide ou molle en
perdant l'a fluidité, foit que ce changement fê faffe
par l’air ffoid, comme lorfqu’un métal fondu ou dé
la cire fondue au feu fe congèlent, ou par de la glace
qui congèle les liqueurs graffes & les aqueufes , on
par quelqu’autre moyen que ce foit, comme par le9
acides qui congèlent certaines liqueurs. Voyt{ C o a g
u l a t i o n . ( A f )
Le terme de la congélation , en parlant d’un thermomètre,
eft le point où la liqueur s’arrête dans lé
tuyau lorfqu’on plonge la boule dans une eau mêlée
déglacé. / ^ « { T h e r m o m è t r e . (A f)
CONGELER, c’eft ôter la fluidité de ce qui étoit
liquide : des fels moyens, des alkalis, des acides, &C
même dés efprits mêlés avec de la neige ou de la
glace, peuvent congeler la plûparf dés liqueurs. On
produit un degré de froid très-confidérable pa rle
mélange de l’acide du vitriol ou de celui du nitre
avec de la neige. On tient cette expérience de M.'
Boyle.
M. Homberg obferve qu’on fait un froid artificiel»
en mêlant enfemble parties égales de fublimé corro-
fif & de fel ammoniac , avec quatre fois autant de
vinaigre diftillé.
L’art de congeler eft une chofe fort agréàble en été»
& d’un grand ufage pour faire des glaces. (M")
CONGENERE,adj. en Anatomie; nom des mut
çles qui concourent tous à la même adlion, foit à la
flexion ou à l’extenûon des parties. Voye^ M uscle*
CONGENERE» (Botan.) il fedit des plantes com-
prifes fous un même genre.
CONGERIE, ('Phyjîque.) mot dont on s’eft fervi
quelquefois pour dire Marnas ou Maffemblage de plufieurs
particules ou corps unis dans une même mafle.
Ce mot fignifie proprement un tas de plufieurs chofes
reunies enfemble fans ordre. On ne s’en fert plus. (O)
CONGESTION , f. m. (Medecine.) maladie des
humeurs.
La congefiion eft l’amas de quelque matière morbifique
des humeurs, qui fe fait lentement dans une
partie du corps.
Les humeurs ne pouvant être contenues dans leurs
Vaifleaux, qu’autant que la capacité des vaifleaux le
permet, elles doivent fuivre dans leur circulation
le cours qui leur eft deftiné par la nature pour les
déteins de la vie. Or toutes les fois que ce cours
s arrête, elles fe raffemblent néceffairement en plus
grande quantité dans quelque partie du corps , &
Cn^ ^ette accumulation qu’on appelle congefiion.
Elle refulte i° . ou de l’inadlion de la partie folide,
incapable de dompter & de chaffer la matière qui
commence à fe former : z°. ou de la dérivation de
la matière peccante, déjà formée ailleurs dans la
partie maintenant affeétee. Cette dérivation fe fait
par diverfes caufes que nous allons expofer, & qui
conftituent le principe de toutes les maladies avec
matière.
i° . Les humeurs s’accumulent dans les lieux voi-
fins par la folution de continuité des vaifleaux, comme
par des blefliires, des ruptures,dés piquûres, &
des.contufions : z°. elles fe répandent dans les vaif-
feaux les plus amples, les plus relâchés, & qui manquent
de foûtien : 30. elles s’épanchent au-deffus des
parties obftruées, liées, comprimées : 40. le défaut,
ou la diminution du mouvement dans les folides &
dans les liquides , forment des congefiions; ç°. l’excès
de mouvement & le frotement produifent le même
effet : 6°. le manque d’abforption occafionne encore
des congefiions d’humeurs.
Quand elles font faites, elles caufent l’enflure de
la partie dans laquelle elles fe font dépofées, aggravent
cette partie & l’appefantiffent : elles fe corrompent
& fe putréfient par la ftagnation ; elles compriment
la partie voifine, rendent fon aâion plus pé-
nible, ou la détruifent. Quelquefois les humeurs
ainfi accumulées s’endurciffent & forment des concrétions
incurables ; d’autres fois elles dégénèrent en
abcès , en fuppuration, en ichorofités, en colliqua-
tïon , &c. En un mot, elles produifent mille fortes
de defordres.
, Dans le premier genre de caufes de ce mal énoncées
ci-deffus, il faut diriger la cure , foit à l’ouver-
turedu dépôt, foit à l’évacuation, fuivant les cir-
conftances. Dans le fécond genre de caufes, il faut
mettre en ufage par art des foûtiens, des points d’appui
,• & fe fervir en même tems des corroborant.
Dans le troifieme, après avoir ôté l’obftacle quipro-
curoit l’obftruûion ou la compreflion, on fe conduira
comme dans, le premier, cas. Dans le quatrième
on doit employer les ftimulans, & les difeuffifs.
Dans le cinquième, fuivre une méthode oppofée,
diminuer la violence du mouvement, calmer, évacuer.
Enfin dans lefixieme , rendre la matière plus
fluide, la faire rétrogader dans de plus grands vaif-
feaux, animer les fibres par des liqueurs chaudes, tenues,
aromatiques, appliquer les moyens qui tendent
à augmenter l’abforption.
Les congefiions de matières morbifiques paroiffent
fous tant de faces, que la Medecine pour tâcher de
les caraâérifer, fe fert des divers termes de collection ,
fluxion , dépôt , apoflême , délitefcence, métafiafe, toutes
exprefîions affez fynonymes dans l’ufage, & dont
1 art meme eft embaraffé à crayonner la différence
Tome III.
avec precifion : voici l’idée que je m’en fuis faite, &
que je foumets aux lumières des experts.
Je regarde la collection & la congefiion comme lignifiant
abfolument la même chofe ; & tandis qu’elles
fe forment^ lentement, la fluxion fe fait promptement.
Le dépôt me paroît un amas d’humeurs dans
quelque partie, ordinairement accompagné de douleurs,
& fou vent defluxion. Ce mot eft encore particulièrement
confacré en Chirurgie, pour défigner
r n pvf ^ccj^ens qui fuivent quelquefois la faignée.
Je definirois 1 apoflême, toute tumeur générale des
parties molles contre nature, procédant de matières
humorales > ou reduifibles aux humeurs. Je crois que
Mabds eft cette tumeur particulière contenant du
pus, & qui eft une fuite de l’inflammation. La déli~
tefcence pourroit être définie, une rétroceflîon de matière
provenant d’épanchemens imparfaits. La mê-
taflafe me femble etre un tranfport d’humeurs morbifiques
d’une partie dans une autre, & qui prend le
nom de délitefcence, quand elle furvient aux àpoflê-
mes. Article de M. le Chevalier DE J A V COURT.
CONGIAIRE,f. m. (Hifi. anc.) terme de Médail-
lifte, don ou préfent repréfenté fur une médaille.
Ce mot vient de celui de conge, congius , parce que
les premiers prelens que l’on fit au peuple confif-
toient en huile & en v in , qui fe mefuroient par conges.
Voyei C onge.
Le congiaire etoit proprement un préfent que les
empereurs faifoient au peuple romain; ceux que l’on
faifoit aux foldats ne s’appelloient point congiaires ,
j mais donatifs. Voye{ D onatif .
L infeription des congiaires eft congiarium, ou libe<
[ ralitas.
Tibere donna pour congiaires 300 pièces de mon-
noie à chaque citoyen ; Augufte en donna 250,300,
400 ;^Caligula donna deux fois trois cents fefterces
par tête. Néron en donna quatre cents ; c’eft le pre-
mier dont les congiaires foient marqués fur les médailles.
Adrien donna des épiceries, du baume, du
fafran ; Commode, 715 deniers; Aurélien, des gâteaux
de deux livres,du pain, de l’huile, du porc
& d’autres mets. Voye{ Sesterce.
Les enfans n etoient point exclus de cette libéralité
du tems d’Augufte , quoiqu’auparavant il n’y
eut que les enfans au-deffus de douze ans qui y euf-
fent part. 1 J
Il n eft plus fait mention de congiaires dans les médailles
des empereurs depuis Quintillus, foit que les
monétaires ayent alors ceffé de repréfenter cesfortes
de libéralités fur la monnoie ; foit que ces princes
n’ayent pas eu le'hioyen de deftiner à ces depenfes
leurs revenus, qui pouvoient à peine fuffire à foûte-
nir les guerres confidérables qui ravageoient l’empire.
(G)
CO NG LE TO N , (Géog. mod.) ville d’Angleterre
, dans la province de Cheshire , fur la rivière
Dan.
CONG LO BÉ,-(Medecine. Phyfiolog.') glande con-
globée. Voye^ G lande.
CONGLOMÉRÉ, (Medecine. Phyfiologicf} glande
conglomérée. Voye{ Glande. .
CONGLUTINATION, f. f. {Phyfiq.) à la lettre
fignifie 1 aêtion de joindre ou de cimenter deux corps
enfemble, au moyen de matières gluantes & tenaces.
Voye{ C im ent , Gl u , &c.
Ce terme s’employe particulièrement en Medecine
, pour lignifier Mappofltion ou M adhérence de quelque
nouvelle fubftance , ou Maccroiffement de confif-
tance dans les fluides des animaux , afin de les rendre
plus nourriffans. ^^ «{Accroissement & Nut
r it io n . (£)
CONGLUTINÉ, (Medecin e, Phyfiologieé) glande
conglutince, V o y e ^ G L A N D E ,
R R r r r i;