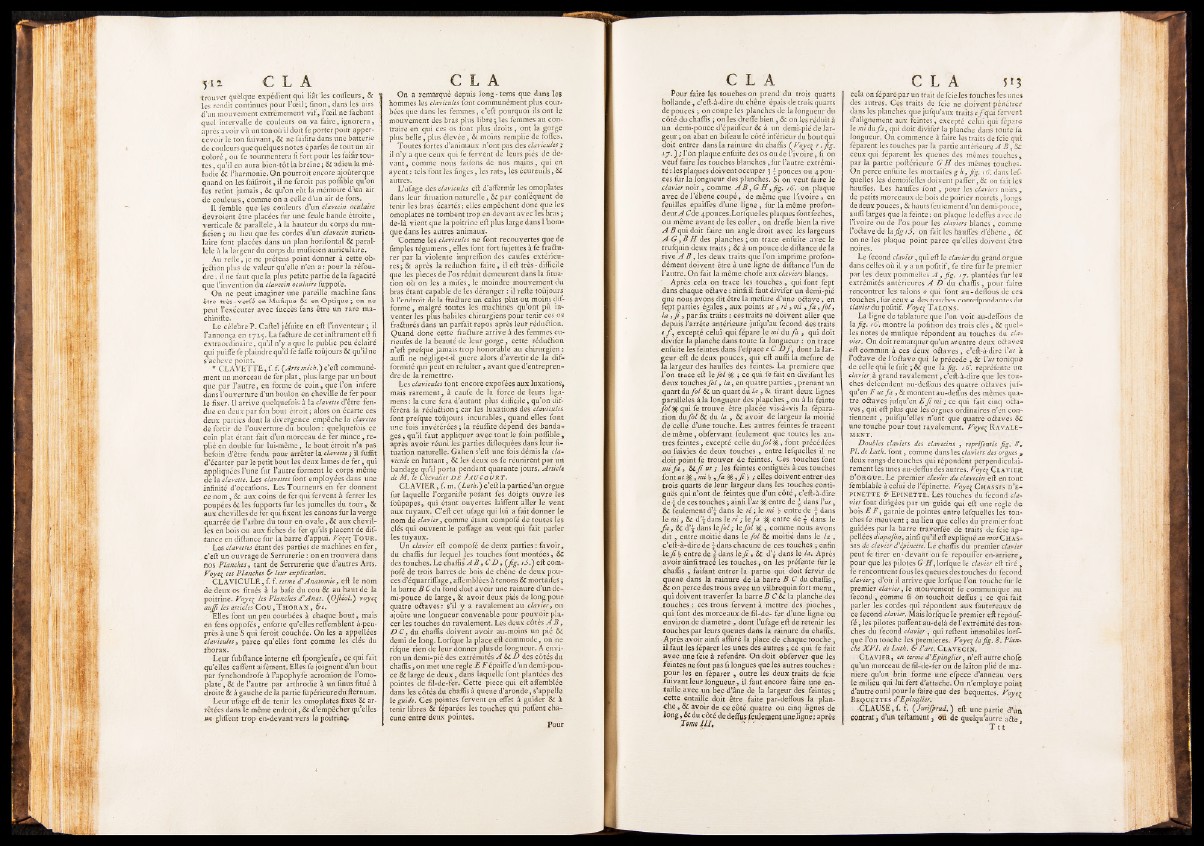
trouver quelque expédient qui liât les coüleurs, &
les rendît continues pour l’oeil; linon, dans les airs
*l’un mouvement extrêmement v if , l’oeil ne fachant ;
<juel intervalle de couleurs on va faire, ignorera ,
âpres avoir vu un ton où'il doit fe porter pour apper-
cevoir le ton fuivant, & ne faiîira dans une batterie ;
de couleurs que quelques notes éparfes de tout un air
coloré, ou le tourmentera fi fort pour les failir toutes
, qu’il en aura bien-tôt la brêlue ; & adieu la mélodie
& l’harmonie. On pourroit encore ajouter que
quand on les failiroit, il ne feroit pas poflible qu’on
les retînt jamais, & qu’on eût la mémoire d’-un- air
de couleurs, comme on a celle d’un air de fons.
Il femble que les couleurs d’un Clavecin oculaire
devroient être placées fur une feule bande étroite,
verticale & parallèle, à la hauteur du corps du mu-
ficien ; au lieu que les cordes d’un clavecin auriculaire
font placées dans un plan horifontal & parallèle
à la largeur du corps du mufteien auriculaire.
Au relie, je ne prétens point donner à cette ob-
jeftion plus de valeur qu’elle n’en a : pour la réfou-
dre, il ne faut que la plus petitepartie de la fagacité
que l’invention du clavecin oculaire fuppofe.
On ne peut imaginer une pareille machine'fans
être très-verfé en Mufique & en Optique; on ne
peut l’exéaiter avec fuccès fans être un rare ma-
chinifte.
Le célébré P. Caftel jéfuite en eft l’inventeur ; il
Fannonça en 1715. La fatture de cet inftrument eft li
extraordinaire, qu’il n’y a que le public peu éclairé
qui puiffe fe plaindre qu’il fe faffe toujours & qu’il ne
s’acheve point.
* C LA V E TTE ,f. f. (Artsméck. ) c’eft communément
un morceau de fer p lat, plus large par un bout
que par l ’autre, en forme de coin, que l’on inféré
dans l’ouverture d’un boulon en cheville de fer pour
le fixer. Il arrive quelquefois à la clavette d’être fendue
en deux par fon bout étroit ; alors on écarte ces
deux parties dont la divergence empêche la clavette
de fortir de l’ouverture du boulon : quelquefois ce
coin plat étant fait d’un morceau de fer m ince, replié
en double fur lui-même, le bout étroit n’a pas
befoin d’être fendu pour arrêter la clavette ; il fuffit
d’écarter par le petit bout les deux lames de fer, qui
appliquées l’une fur l’autre forment le corps même
de la clavette. Les clavettes font employées dans une
infinité d’occafions.. Les Tourneurs en fer donnent
ce nom, & aux coins de fer qui fervent à ferrer les
poupées & les fupports fur les jumelles du tour, &
aux chevilles de fer qui fixent les canons fur la verge
quarrée de l’arbre du tour en o vale, & aux chevilles
en bois ou aux fiches de fer qu’ils placent de distance
en diftance fur la barre d’appui. Foçe^ T our.
Les clavettes étant des parties de machines en fer,
c’eft un ouvrage de Serrurerie : on en trouvera dans
nos Planches, tant de Serrurerie que d’autres Arts.
Foye^ ces Planches & leur explication.
CLAVICULE, f. f. terme d'Anatomie, eft le nom
de deux os fitués à la bafe du cou & au haut de la
poitrine. Foye£ les Planches d'Anat. (OJléol.) voye[
aujji les articles C o u , T H O R A X , &c.
Elles font un peu courbées à chaque bout, mais
en fens oppofés, enforte qu’elles reffemblent à-peu-
près à une S qui feroit couchée. On les a appellées
clavicules, parce qu’elles font comme les clés du
thorax.
Leur fubftance interne eft fpongieufe, ce qui fait
qu’elles caftent aifément. Elles fe joignent d’un bout
par fynchondrofe à l’apophyfe acromion de l’omoplate
, & de l’autre par arthrodie à un finus fitué à
droite & à gauche de la partie fùpérieuredu fternum.
Leur ufage eft de tenir les omoplates fixes & arrêtées
dans le même endroit, & d’empêcher qu’elles
ne gliffent trop en-devant vers la poitrinç.
On a remarqué depuis long - tems que dans les
hommes les clavicules font communément plus courbées
que dans les femmes, c’eft pourquoi ils ont le
mouvement des bras plus libre ; les femmes au contraire
en qui ces os lont plus droits, ont la .gorge
plus belle, plus élevée, & moins remplie de fones.
Toutes fortes d’animaux n’ont pas des clavicules ;
il n’y a que ceux qui fe fervent de leurs piés de devant,
comme nous faifons de nos mains, qui en
ayent : tels font les finges, les rats, les écureuils, &
autres.
L’ufage des clavicules eft d’affermir les omoplates
dans leur fituarion naturelle, êc par conféquent de
tenir les bras écartés: elles empêchent donc que les
omoplates ne tombent trop en-devant avec les bras ;
de-là vient que la poitrine eft plus large dans l ’hom-
que dans les autres animaux.
Comme les clavicules ne font recouvertes que de
fimpïes tégumens, elles font fort fujettes à fe fraêht-
rer par la violente impreflîon des caufes extérieures;
& après la reduélion faite, il eft très - difficile
que les pièces de l’os réduit demeurent dans la fitua-
tion où on les a mifes, le moindre mouvement du
bras étant capable de les déranger : il refte toujours
à l’endroit de la ffafture un calus plus ou moins difforme
, malgré toutes les machines qu’ont pu inventer
les plus habiles chirurgiens pour tenir ces os
frafturés dans un parfait repos après leur rédu&ion.
Quand donc cette fraûure arrive à des femmes cu-
rieufes de la beauté de leur gorge, cette réduction
n’eft prefque jamais trop honorable au chirurgien :
auflî ne néglige-t-il guere alors d’avertir de la difformité
qui peut en réfulter, avant que d’entreprendre
de la remettre.
Les clavicules font encore expofées aux luxations,
mais rarement, à caufe de la force de leurs liga-
mens : la cure fera d’autant plus difficile, qu’on différera
la réduction ; car les luxations des clavicules
font prefque toûjours incurables, quand elles font
une fois invétérées ; la réuflite dépend des bandages
, qu’il faut appliquer avec tout le foin poflible,
après avoir réuni les parties disloquées dans leur fi-
tuation naturelle. Galien s’eft une fois démis la clavicule
en luttant, & les deux os fe réunirent par un
bandage qu’il porta pendant quarante jours. Article
de M. le Chevalier DE J AU COU RT.
CLAVIER, f. m. (Luth.') c’eft la partie d’un orgue
fur laquelle l’organifte polant fes doigts ouvre les
foûpapes, qui étant ouvertes laiffent aller le vent
aux tuyaux. C’eft cet ufage qui lui a fait donner le
nom de clavier, comme étant compofé de toutes les
clés qui ouvrent le paffage au vent qui fait parler
les tuyaux.
Un clavier eft compofé de deux parties : favoir,
du chafiis fur lequel les touches font montées, &
des touches. Le chaflis A B ,C D , (fig. iS.) eft compofé
de trois barres de bois de chêne de deux pouces
d’équarriffage, affemblées à tenons & mortaifes ;
la barre B C du fond doit avoir une rainure d’un demi
pouce de large, & avoir deux piés de long pour
quatre oftaves : s’il y a ravalement au clavier, on
ajoûte une longueur convenable pour pouvoir placer
les touches du ravalement. Les deux côtés A B ,
D C , du chaflis doivent avoir au-moins un pié &c
demi de long. Lorfque la place eft commode, on ne
rifque rien de leur donner plus de longueur. A environ
un demi-pié des extrémités A à cD des côtés du
chaflis, on met une réglé E F épaiffe d’un demi-pouce
& large de deux, dans laquelle font plantées des
pointes de fil-de-fer. Cette piece qui eft affemblée
dans les côtés du chaflis à queue d’aronde, s’appelle
le guide. Ces pointes fervent en effet à guider & à
tenir libres & féparées les touches qui paffent chacune
entre deux pointes.
Pour
Pour faire les touches on prend du trois quarts
hollande, c’eft-à-dire du chêne épais de trois quarts
de pouces ; on coupe les planches de la longueur du
côté du chaflis ; on les dreffe bien , & on les réduit à
un demi-pouce d’épaiffeur & à un demi-pié de largeur
; on abat en bifeàu le côté inférieur du bout qui
doit entrer dans la rainure du chaflis ( Foye^ r. fig.
t j . ) ; l’on plaque enfuite des os ou de l’ivoire, fi on
veu f faire les touches blanches ,fur l’autre extrémité
: les plaques doivent occuper 3 ~ pouces ou 4 pouces
fur la longueur, des planches. Si on veut faire le
clavier noir , comme A B ,G H , fig.. iG. on plaque
avec de l ’ébene coupé, de même que l ’iv o ire , en
feuilles epaiffes d’une ligne , fin: la même profondeur^
Cde 4pouces.Lorlque les plaques fontfeches,
ou même avant de les coller, on dreffe bien la rive
A B qui doit faire un angle droit avec les largeurs
A G ,B H des planches ; on trace enfuite avec le
îrufquin deux traits ; & à un pouce de diftance de la
rive A B , les deux traits que l’on imprime profondément
doivent être à une ligne de diftance l’un de
l ’autre. On fait la même chofe aux claviers blancs.
Après cela on trace les touches , qui font fept
dans chaque o&a ve : ainfi.il faut .divifer un demi-pié
que nous avons dit être la mefure d’une o fta v e, en
fept parties égales, aux points u t , ré, mi, f a , fo l,
la ,Ji., par fix traits : ces traits ne doivent aller que
depuis l’arrête antérieure jufqu’au fécond des traits
e f , excepté celui qui fépare le mi du fa , qui doit
divifer la planche dans toute fa longueur : on trace
enfuite les feintes dans l’efpace e C D f , dont la largeur
eft de deux pouces, qui eft aufli la mefure de
la largeur des hauffes des feintes. La première que
l ’on trace eft le Jol% ; ce qui fe fait en divifant les
deux to.uches f o l , la, en quatre parties , prenant un
quart du fo l & un quart du la ,Sc tirant deux lignes
parallèles à la longueur des planches, ou à la feinte
fo l qui fe trouve être placée vis-à-vis la fépara-
tioïi du fo l & du la , & avoir de largeur la moitié
de celle d’urie touche. Les autres feintes fe tracent
de même, obfervant. feulement que toutes les autres
feintes, excepté celle du fo l ^ , font précédées
ou fuivies de deux touches , entre lefqüelles il ne
doit point fe trouver de feintes. Ces touches font
.mi f a , & J i ut ; les feintes contiguës à ces touches
font u t^ ,m i\ , ,fa % ,J i [? ; elles doivent entrer des
trois quarts de leur largeur dans les touches contiguës
qui n’ont de feintes que d’un côté, c ’eft-à-dire
de | de ces touches ; ainfi Vue ^ entre de { dans Vue,
& feulement d’j dans le ré ; le mi b entre de | dans
le mi, & d’| dans le ré ; le fa % entre de •§• dans le
f a , & d’j dans lefo l ; le fo l % , comme nous avons
d i t , entre moitié dans le fo l & moitié dans le la ,
c’eft-à-dire de f dans chacune de ces touches.; enfin
leJî\j entre de { dans 1 t j î , Hz d’j dans le la. Après
avoir ainfi trace les touches, on les préfente fur le
chaflis , faifant entrer la partie qui doit fervir de
queue dans la rainure de la barre B C du chaflis ,
& on perce des trous avec un vilbrequin fort menu,
qui doivent traverfer la barre B C &c la planche des
.touches : ces trous fervent à mettre des pioches,
qui font des morceaux de fil-de- fer d’une ligne ou
environ de diamètre , dont l’ufage eft de retenir les
touches par leurs queues dans la rainure du chaflis.
Après avoir ainfi affûré la place de chaque touche,
i l faut les féparer les unes des autres ; ce qui fe fait
avec une feie à refendre. On doit obferver que les
feintes ne font pas fi longues que les autres touches :
pour les en féparer , outre les deux traits de feie
fuivant leur longueur, il, faut encore faire une entaille
avec un bec-d’âne de la largeur des feintes ;
cette entaille doit être faite par-deffous la plan-
che , 8c avoir de ce côté quatre ou cinq lignes de
long, & du côté de deffus feulement une ligne ; après
Jm e ///. "■ ‘ '
cela on fépare par un trait de feie les touches les unes
des autres. Ces traits de feie ne doivent pénétrer
dans les planches que jufqu’aux traits e f qui fervent
d’alignement aux feintes, excepté celui qui fépare
le mi du fa , qui doit divifer la planche dans toute fa
longueur. On commence à faire les traits de feie qui
féparent les touches par la partie antérieure A B ,&C
ceux qui féparent les queues des mêmes touches,
par la partie poftérieure G I I des mêmes touches.
On perce enfuite les mortaifes g h , fig. 16". dans lef-
quelles les demoifelles doivent paffer, & on fait les
hauffes. Les hauffes font , pour les claviers noirs ,
de petits morceaux de bois de poirier noircis , longs
de deux pouces, & hauts feulement d’un demi-pouce,
aufli larges que la feinte : on plaque le deffus avec de
l’ivoire ou de l’os pour les claviers blancs , comme
l’oclave de la fig iS. on fait les hauffes d’ébene, 8C
on ne les plaque point parce qu’elles doivent être
noires.
Le fécond clavier, qui eft le clavier du grand orgue
dans celles où il y a un pofitif, fe tire fur le premier
par les deux pommelles A , fig. iy. plantées fur les
extrémités antérieures A D du chaflis, pour faire
rencontrer les talons o qui font au-deffous de ces
touches, fur ceux a des touches correfpondantes du
clavier du pofitif. Foye{ T alons.
La ligne de tablature que l’on voit au-deflous de
la fig. iG. montre la pofition des trois clés, & quelles
notes de mufique répondent au touches du clavier.
On doit remarquer qu’un «rentre deux oftaves
eft commun à ces deux oélaves, c’eft-à-dire Vut à
l’oétave de l ’oélave qui le précédé , & Vue tonique
de celle qüi le fuit ;& que la fig. tG. repréfente un
clavier à grand ravalement, c’eft-à-dire que les touches
defeendent au-deffous des quatre oftaves juf-
qu’en F ut fa , & montent au-deffus des mêmes quatre
o&aves jufqu’en E J i mi ; ce qui fait cinq oéta-
v e s, qui eft plus que les orgues ordinaires n’en contiennent
, puifqu’elles n’orit que quatre oélaves &
une touche pour tout ravalement. Foyer Ravalem
en t .
Doubles claviers des clavecins , repréfentés fig. 8.
Pl. de Luth, font, comme dans les claviers des orgues 9
deux rangs de touches qui répondent perpendiculairement
lés unes au-deffus des autres. Foye^ C la vier
d’o r g u e . Le premier clavier du clavecin eft en tout
femblable à celui de Vépinette. Foye£ CHASSrs d’e-
p in e t t e & Ep ine tt e. Les touches du fécond clavier
font dirigées par un guide qui eft une réglé de
bois E F , garnie de pointes entre lefqüelles. les touches
fe meuvent ; au lieu que celles du premier font
guidées par la barre tràverfée de traits de feie appellées
diapafon, ainfi qu’il eft expliqué au mot CHASSIS
de clavier d'épinetté. Lé chaflis du premier clavier
peut fe tirer en-devant ou fe repouffer en-arriere,
pour que les pilotes G H , lorfque le clavier eft tiré ,
fe rencontrent fous les queues des touches du fécond
clavier ; d’où il arrive que lorfque l’on touche fur le
premier clavier, le mouvement fe communique au
fécond-, comme fi on touchoit deffus ; ce qui fait
parler les cordes qui répondent aux fautereaux de
ce fécond clavier. Mais lorfque le premier eft repôuf-
f é , les pilotes paffent au-delà de l’extrémité des touches
du fécond clavier, qui reftent immobiles lorfque
l’on touche les premières. Foyeç la fig. 8. Planche
X V I. de Luth. 6* l'an. CLAVECIN.
C la vier, en terme d'Epinglier, n’eft autre chofe
qu’un morceau de fil-de-fer ou de laiton plié de maniéré
qu’un brin forme une efpece d’anneau vers
le milieu qui lui fert d’attache. On n’employe point
d’autre outil pour le faire que des bequettes. Foyer
Bequettes d'Epinglier;
-CLAUSE, f. f. ( Jurifprud. ) eft une partie d’un
contrat ; d’un teftament, oti de quelqu’autre afte.
T t t