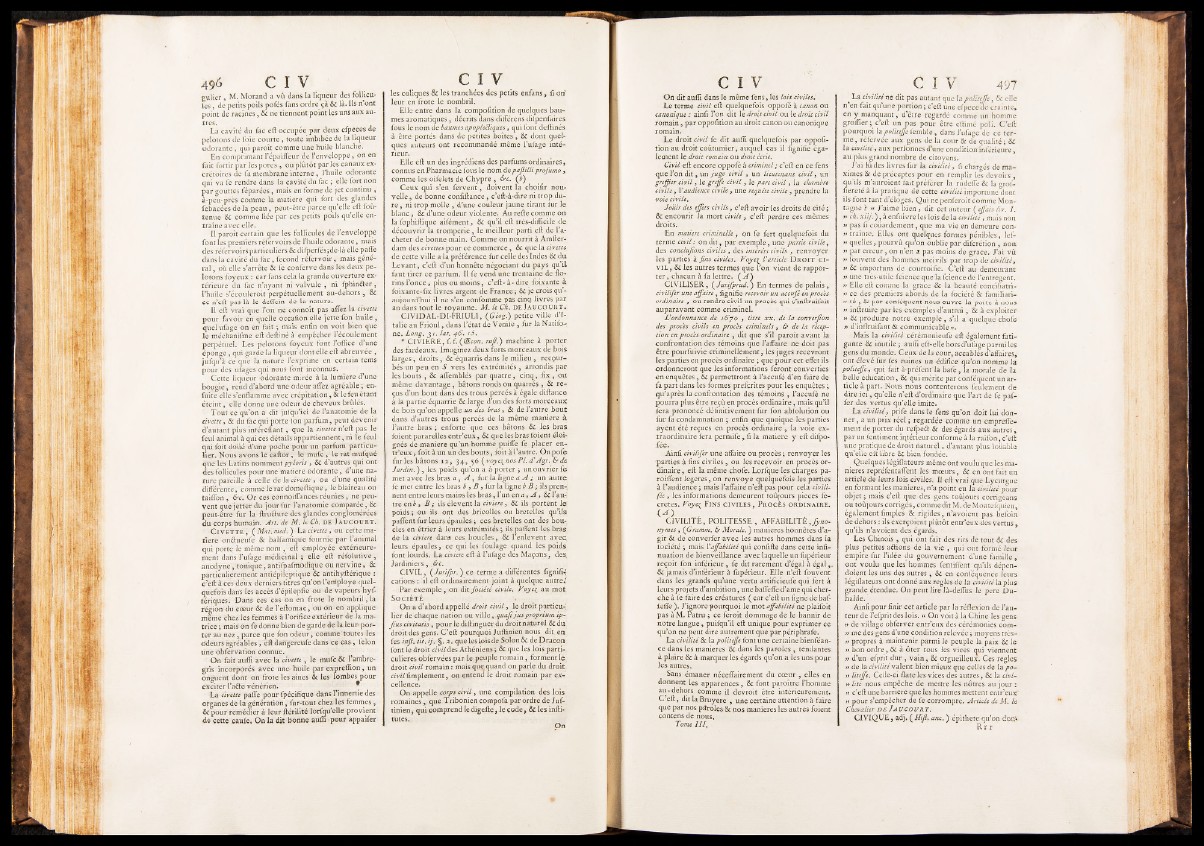
gulier , M. Morand a vû dans la liqueur des follicules
, de petits poils pofés fans ordre çà 6c là. Ils n’ont
point de racines, 6c ne tiennent point les uns aux autres.
La cavité du fac eft occupée par deux efpeces de
pelotons de foie courte , toute imbibée de la liqueur
odorante, qui paroît comme une huile blanche.
En comprimant l’épaiffeur de l’enveloppe, on en
fait fortir par les pores , ou plutôt par les canaux excrétoires
de fa membrane interne , l’huile odorante
qui va fe rendre dans la cavité du lac ; elle fort non
par gouttes féparées, mais en forme de jet continu ,
à-peu-près comme la matière qui fort des glandes
febacées de la peau, peut-être parce qu’elle eft foû-
tenue 6c comme liée par ces petits poils qu elle entraîne
avec elle.
Il paroît certain que les follicules de l’enveloppe
font les premiers réfervoirs de l’huile odorante, mais
des réfervoirs particuliers & difperfés;de-là elle paffe
dans la cavité du fa c , fécond réfervoir, mais général
, où elle s’arrête & fe conferve dans les deux pelotons
foyeux : car fans cela la grande ouverture extérieure
du fac n’ayant ni valvule , ni fphinâer,
l’huile s’écouleroit perpétuellement au-dehors , 6c
ce n’eft pas là le d'effein de la nature.
Il eft vrai que l’on ne connoît pas affez la civette
pour favôir en quelle occafion elle jette fon huile,
quel ufage on en fait ; mais enfin on voit bien que
le méchanifme eft deftiné à empêcher l’écoulement
perpétuel. Les pelotons foyeux font l’office d’une
éponge, qui garde la liqueur dont elle eft abreuvée ,
jufqu’à ce que la nature l’exprime en certain tems
pour des ufages qui nous font inconnus.
Cette liqueur odorante mirée à la lumière d’une
bougie, rend d’abord une odeur affez agréable ; en-
fuite elle s’enflamme avec crépitation, & le feu étant
éteint, elle donne une odeur de cheveux brûles.
Tout ce qu’on a dit jufqu’ici de ^anatomie de la
civette y & du fac qui porte Ion parfum, peut devenir
d’autant plus intéreflant , que la civette n’eft pas le
feul animal à qui ces détails appartiennent, ni le fèul
qui foit doué d’une poche pour un parfum particulier.
Nous avons lé caftor , le mufc, le rat mufqué
que lés Latins nomment pyloris , 6c d’autres qui ont
des follicules pour une rriatiere odorante , d’une nature
pareille à celle deïacivtrte, ou d’une qualité
différente , comme lé rat domeftique , le blaireau ou
taiffon , &c. Or ces.corinoiffancesréunies, ne peuvent
que jetter du jbvir iiir l’anatomie comparée, 6c
peut-être fur la ftruâure des glandes conglomérées
du corps humain. Art. de M. le Ch. de Ja u c o u r t .
C iv e t t e , ( Mat.med. ) La civette, ou cefte matière
onâueufe & balfamiqüe fournie par l’animal
qui porte le même nom , eft employée extérieurement
dans l’ufage médicinal ; elle eft réfolutive,
anodyne, tonique, antifpafmodique ou nérvine, &
particulièrement antiépilèptique 6c antihyftérique :
c ’eft à ces deux derniers titres qu’on l’employe quelquefois
dans les accès d’épilepfie ou de vapeurs hyf-
fériques. Dans ces 'cas•’on en frote le nombril, la
région du cdeur 6c de l’eftomac, ou on: en applique
même chez les femmes à l’orifice extérieur de la matrice
; mais’ ôn fe donné bien de garde de la leur* porter
au nez % parce que fon odeur, comme'toutes les
odeurs agréables , eft dangereufe dans ce ca s , lelon
line obférvation connue.
On fait auffi avec la civette , le mufc 6c l’ambre-
gris incorporés avec une- huile par expreffion, un
onguent dont on frote les aines & les lombes pour
exciter l’aâ:e vénérien.
La civette paffe pour fpécifique dans l’innertie des
organes de la génération, fur-tout chez les femmes ,
&pour remédier à leur ftérilité lorfqu’elle provient
de cette caule. On la dit bonne auffi pour appaifer
les coliques & les tranchées des petits enfans, fi on
leur en frote le nombril.
Elle entre dans la compofition de quelques baumes
aromatiques, décrits dans différens dilpenfaires
fous le nom de baumes apoplectiques, qui font deftinés
à être portés dans de petites boîtes, 6c dont quelques
auteurs ont recommandé même l’ufage intérieur.
Elle eft un des ingrédiens des parfums ordinaires,
connus en Pharmacie fous le nom depafiilli profumo >
comme les oifelets de Chypre , &c. (b)
Ceux qui s’en fervent, doivent la choifir nou-
v elle, de bonne confiftance, c’eft-à-dire ni trop dure
, ni trop molle , d’une couleur jaune tirant lur le
blanc, 6c d’une odeur violente. Au relie comme on
la fophiftique aifément, 6c qu’il eft très-difficile de
découvrir la tromperie, le meilleur parti eft de l’acheter
de bonne main. Comme on nourrit à Amfter-
dam des civettes pour ce commerce, 6c que la civette
de cette ville a la préférence fur celle des Indes 6c du
Levant, c’eft d’un honnête négociant du ‘pays qu’il
faut tirer ce parfum. Il fe vend une trentaine de florins
l’once, plus ou moins, c’eft-à-dire foixante à
foixante-fix livres argent de France ; 6c je crois qu’-
aujourd’hui il ne s’en confomme pas cinq livres par.
an dans tout le royaume. M. le Ch. de Ja u c o u r t .
CIVIDAL-DI-FRIULI, (Géog.) petite ville d’Italie
au Frioul, dans l’état de Venile , fur la Natifo-,
ne. Long. 31. lat. 46'. 16 . ■>
* CIVIERE, f.f. (JS.con. rufi!) machine à porter
des fardeaux. Imaginez deux forts morceaux de bois
larges, droits, 6c équarris dans le milieu , recourbés
un peu en S vers les extrémités , arrondis par
les bouts , 6c affemblés par quatre, cinq, fix , ou
même davantage, bâtons ronds ou quarrés , & reçus
d’un bout dans des trous percés à égale diftance
à la partie équarrie 6c large d’un des forts morceaux
de bois qu’on appelle un des bras, & de l’autre bout
dans d’autres trous percés de la même maniéré à
l’autre bras ; enforte que ces bâtons 6c les bras
foient pararelles entr’eux, & que les bras foient éloignés
de maniéré qu’un homme puiffe fe placer en-
tr’eux, foit à un un des bouts, foit àx l’autre. On pofe
fur les bâtons i z , 34, 56 (voye^nos PI. d'Agr. & de.
Jardin. ) , les poids qu’on a à porter ; un ouvrier fe
met avec les bras a , A , fur la ligne a A ; un autre
fe met entre les bras b , B , fur la ligne b B ; ils pren-;
nent entre leurs mains lès bras, l’un en a , A , 6c l’au-l
tre enb, B ; ils éleventla civiere, 6c ils portent le!
poids ; ou ils ont des bricolles ou bretelles qu’ils
paffent fur leurs épaules ; ces bretelles ont des bou-,
clés en étrier à leurs extrémités ; ils paffent les bras
de la civiere dans ces boucles, 6c l’enlevent avec;
leurs épaules, ce qui les foulage quand les poids
font lourds. La civiere eft à l’ufage des Maçons, des.
Jardiniers, .&c.
CIVIL, ( Jurifpr. ) ce terme a différentes fignifiJ
cations : il eft ordinairement joint à quelque autre.!
Par exemple, on dit fociété civile. Voye{ au mot
S o c i é t é .
On a d’abord appelle droit civil, le droit particu-.,
lier de chaque nation ou ville , ,quajijusproprium ip-
Jîus civitatis, pour le diftinguer du droit naturel & du
droit des gens. C ’eft pourquoi Juftinien nous dit en
fes injl. tit. ij. § . z . que les lois de Solon 6c deDracon
font le droit civil des Athéniens ; 6c que les lois particulières
obfervées par le peuple romain, forment le
droit civil romain: maisquequandqn parle du droit,
civi/Amplement, on entend le droit romain par excellence.
On appelle corps civil, une compilation des lois
romaines, que Tribonien compofa par ordre de Juf-
tinien, qui comprend le digefte, le code, 6c les infti-
tutes.
On
C I V
On dit auffi dans le même fens, les lois civilesi
Le terme civil eft quelquefois oppofé à canon ou
canonique : ainfi l’on dit le droit civil ou le droit civil
romain, par oppofition au droit canon ou canonique
romain.
Le droit civil fe dit auffi quelquefois par oppofition
au droit coutumier, auquel cas il fignifie également
le droit romain ou droit écrit.
Civil eft encore oppofé à criminel ; c’eft en ce fens
que l’on dit, un juge civil , un lieutenant civil, un
greffier civil, le greffe civil , le parc civil, la chambre
civile , Y audience civile , une requête civile, prendre la
voie civile.
Jouir des effets civils, e’eft avoir les droits de cité ;
& encourir la mort civile , c’eft perdre ces mêmes
droits.
En matière criminelle , on fe fert quelquefois du
terme civil : on d it, par exemple, une partie civile,
des concluions civiles, des intérêts civils , renvoyer
les parties à fins civiles. Voye^ L'article D r o it c iv
i l , 6c les autres termes que l’on vient de rapporter
, chacun à fa lettre. ( A \
CIVILISER, ( Jurifprud. ) En termes de palais,
civilijer une affaire, fignifie recevoir un accufé en procès
ordinaire , ou rendre civil un procès qui s’inftruifoit
auparavant comme criminel.
Üordonnance de 16j o , titre x x . de la. converjîon
des procès civils en procès criminels, & de la réception
en procès ordinaire , dit que s’il paroît avant la
confrontation des témoins que l’affaire ne doit pas
être pourfuivie criminellement, les juges recevront
les parties en procès ordinaire ; que pour cet effet ils
ordonneront que les informations feront converties
en enquêtes, 6c permettront à l’accufé d’en faire de
fa part dans les formes preferites pour les enquêtes ;
qu’après la confrontation des témoins , l’accufé ne
pourra plus être reçû en procès ordinaire, mais qu’il
fera prononcé définitivement fur fon abfolution ou
fur fa condamnation ; enfin que quoique les parties
ayent été reçues en procès ordinaire , la voie extraordinaire
fera permife, fi la matière y eft difpo-
iee.A
infi civilifer une affaire ou procès ; renvoyer les
•parties à fins civiles-, ou les recevoir en procès ordinaire
, eft la même chofe. Lorfque les charges pa-
Toiffent legeres, on renvoyé quelquefois- les parties
à l’audience ; mais l’affaire n’eft pas pour cela civili-
fée, les informations demeurent toûjours pièces fe-
cretes. Foye^ Fins civiles , Procès ordinaire.
m 1 ,
CIVILITÉ, POLITESSE , AFFABILITÉ,Jyno-
jymes, (Gramm. & Morale. ) maniérés honnêtes d’agir
& de converfer avec les autres hommes dans la
fociété ; mais Yaffabilité qui confifte dans cette infirmation
dé bienveillance avec laquelle un fupérieur
reçoit fon inférieur, fe dit rarement d’égal à éga l,.
& jamais d’inférieur à fupérieur. Elle n’eft fouvent
dans les grands qu’une vertu artificieufe qui fert à
leurs projets d’ambition, une baffeffe d’ame qui cherche
à fe faire des créatures ( car c’eft un figne de baffeffe
). J’ignore pourquoi le mot affabilité ne plaifoit
pas à M. Patru ; ce feroit dommage de le bannir de
notre langue, puifqu’il eft unique pour exprimer ce
qu’on ne peut dire autrement que par périphrafe.
La civilité & la politefle font une certaine bienféan-
ce dans les maniérés ôc.dans les paroles , tendantes
à plaire & à marquer les égards qu’on a les uns pour
les autres.
Sans émaner néceffairement du coeur , elles en
donnent les apparences, 6c font paroître l’homme
au-dehors comme il devroit être intérieurement.
C ’eft, dit la Bruyère , une certaine attention à faire
que par nos pàroles & nos maniérés les autres foient
contens de nous.
Tome III\
C I V 4 9 7
La civilité ne dit pas autant que la poliieffe, & elle
n’en fait qu’une portion; c’eft une efpecede crainte,
en y manquant, d’être regardé comme un homme
groffier; c’eft un pas pour être eftimé poli. C ’eft
pourquoi la politefife femble, dans l’ufage de ce ter-
me ? réservée aux gens de la cour & de qualité ; &
la civilité y aux perfonnes d’une conditioidnférieure,
au plus grand nombre de citoyens.
J’ai Ki des livres fur la civilité, fi chargés de maximes
& de préceptes pour en remplir les devoirs ,
qu’ils m’auroient fait préférer la rudeffe 6c la grof-
fierete à la pratique de cette civilité importune dont
ils font tant d’éloges. Qui ne penferoit comme Montagne
? « J’aime bien, dit cet auteur ( effais liv. I.
» ch. xiij.'), à enfuivre les lois de-la civilité, mais non
» pas fi coiiardement, que ma vie en demeure cont
ra in te . Elles ont quelques formes pénibles, lef-
» quelles, pourvu qu’on oublie par diferétion , non
» par erreur, on n’en a pas moins de grâce. J’ai vû
» fouvent des hommes incivils par trop de civilité,
» 6c importuns de courtoifie. C ’eft au demeurant
» une très-utile feiençe que la fcience de l’entregent.
>y Elle eft comme la grâce 6c la beauté conciliatri-
» ce des premiers abords de la fociété & familiarit
é , & par conféquent nous ouvre la porte à nous
» inftruire par les exemples d’autrui, & à exploiter
» 6c produire notre exemple, s’il a quelque chofe
» d’inftruifant & communicable».
Mais la civilité cérémonieufe eft également fatigante
& inutile; auffi eft-elle hors d’ufage parmi les
gens du monde. Ceux de la cour, accablés d’affaires,
ont elevé fur fes ruines un édifice qu’on nomme la
politeffe y qui fait à-préfent la bafe, la morale de la
belle éducation, 6c qui mérite par conféquent un article
à part. Nous nous contenterons feulement de
dire i c i , qu’elle n’eft d’ordinaire que l’art de fe paf-
fer des vertus qu’elle imite.
La civilité, prife dans le fens qu’on doit lui donner
, a un prix reel ; regardée comme un empreffe-
ment de porter du refpett & des égards aux autres,
par un fentiment intérieur conforme à la raifon, c’eft
une pratique de droit naturel, d’autant plus louable
qu’elle eft libre 6c bien fondée.
Quelques légiflateurs même ont voulu que les maniérés
repréfentaffent les moeurs, 6c en ont fait un
article de leurs lois civiles. Il eft vrai que Lycurgue
en formant les maniérés, n’a point eu la civilité pour
objet ; mais c’eft que des gens toûjours corrigeans
ou toûjours corrigés, comme dit M. de Montefquieu,
également fimples & rigides, n’avoient pas befoin
de dehors : ils exerçoient plutôt entr’eux des vertus ,
qu’ils n’avoient des égards.
Les Chinois , qui ont fait des rits de tout & des
plus petites actions de la vie , qui ont formé leur
empire fur l’idée du gouvernement d’une famille,
ont voulu que les* hommes fentiffent qu’ils dépen-
doient les uns des autres , 6c en conféquence leurs
légiflateurs ont donné aux réglés de la civilité la plus
grande étendue. On peut lire là-deffus le pere Duhalde.
Ainfi pour finir cet article par la réflexion de l’auteur
de l’efprit des lois. « On voit à la Chine les gens
» de village obferver entr’eux des cérémonies com-
» me des gens d’une condition relevée ; moyens très-
» propres à maintenir parmi le peuple la paix 6c le
» bon ordre, 6c à ôter tous les vices qui viennent
» d’un efprit dur , vain, & orgueilleux. Ces réglés
» de la civilité valent bien mieux que celles de la po-
» liteffe. Celle-ci flate les vices des autres, 6c la civi-
» lité nous empêche de mettre les nôtres au jour :
» c’eft une.barriere que les hommes mettent entr’eux'
: » pour s’empêcher de fe corrompre. Article de M. le
Chevalier D E J A V C O U R T .
CIVIQUE, adj. (Hijl. anc.) épithete qu’on donV
Rr r