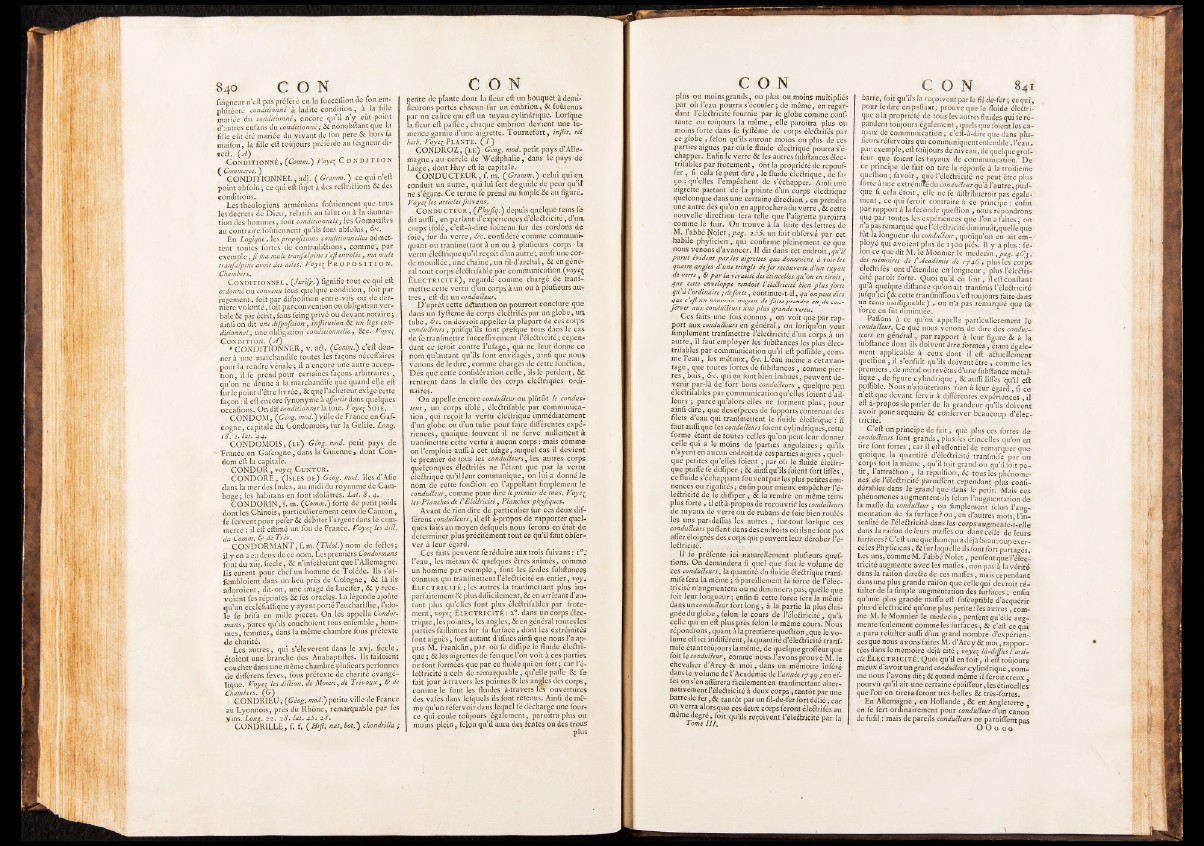
feigneur n’eft pas préféré en la fucceflion de fon em-
phitéote conditionné à ladite condition, la fille
mariée du conditionné, encore qu’il n’y eût point
d’autres enfans du conditionné; & nonobftant que la
fille eût été mariée du vivant de fon pere & hors fe
maifon, la fille eft toûjours préférée au feigneur dire#.
(A )
C onditionné, {Comm.) Foye1 C o n d it io n
( Commerce. ) t
CONDITIONNEL, adj. ( Gramm. ) ce qui n eft
point abfolu ; ce qui eft fujet à des reftriftions & des
conditions.
Les théologiens arméniens foûtiennent que tous
les decrets de D ieu , relatifs au falut ou à la damnation
des hommes, font conditionnels; les Gomariftes
au contraire foûtiennent qu’ils font ablolus, 6*c.
En Logique, les propojîtions conditionnelles admettent
toutes fortes de contradictions, comme, par
e x e m p l e ma mule tranfalpine s eft envolée , ma mule
tranjalpine avoit des ailes. Fvye^ PR O PO S IT IO N .
Chambets. > t
Conditionnel , ( Jurifp.) fignifie tout ce qui eft
ordonné ou convenu fous quelque condition, foit par
jugement, foit par difpofition entre-vifs ou de dernière
volonté, foit par convention ou obligation verbale
& par écrit, fous feing privé ou devant notaire ;
ainfi on dit une difpofition, injlitution & un legs conditionnel,
une obligation conditionnelle, & c . Foyez
C ondition. {A ) I H H , n ,
* CONDITIONNER, v. a#. (Comm.) c eft donner
à une marchandife toutes les façons néceflaires
pour la rendre vénale ; il a encore une autre acception
, il fe prend pour certaines façons arbitraires ,
qu’on ne donne à la marchandife que quand elle eft
furie point d’être livrée, & que l’acheteur exige cette
façon : il eft encore fynonyme à affortir dans quelques
occafions. On dit conditionner la foie. Frye^ Soie.
CONDOM, {Géog. mod.) ville de France en Gaf-
cogne, capitale du Condomois, fur la Gelife. Long.
%8. 2. lat. 44.
CONDOMOIS, (le) Géog. mod. petit pays de
•France en Gafcogne, dans la Guienne, dont Condom
eft la capitale.
CONDOR., voyei CUNTUR.
CO N D O R E , (Isles de) Géog. mod. îles d’Afie
dans la mer des Indes, au midi du royaume de Cam-
boge ; les habitans en font idolâtres. Lat. 8 .4 .
CO ND O RIN,f. m. {Comm.) forte de petit poids
dont les Chinois, particulièrement ceux de Canton,
fe fervent pour pefer & débiter l’argent dans le commerce
: il eft eftimé un fou de France. Foye^ les dict.
du Comm. & de Trév.
CONDORMANT, f.m. ( Tkéol.) nom de feftes;
il y en a eu deux de ce nom. Les premiers Condormans
font du xiij. fiecle, & n’infefterent que l’Allemagne.
Ils eurent pour chef un homme de Tolède. Ils s’af-
fembloient dans un lieu près de Cologne, & là ils
adoroient, dit-on, une image de Lucifer, & yrece-
voient fes réponfes & fes oracles. La légende ajqûte
qu’un eccléfiaftique y ayant porté l’euchariftie, l’idole
fe brifa en mille pièces. On les appella Condormans,
parce qu’ils couchoient tous enfemble, hommes,
femmes, dans la même chambre fous prétexte
de charité.- . . '
Les autres, qui s’élevèrent dans le xvj. fiecle,
étoient une branche des Anabaptiftes. Ils faifoient
coucher dans une même chambre plufieurs perfonnes
de différens fexes, fous prétexte de charité évangélique.
Foye{ les diction, de Moreri, de Trévoux, & de
Chambers. (G)
• CONDRIEU, {Géog. mod.) petite ville de France
au Lyonnois, près du Rhône, remarquable par fes
»vins. Long. 22. 28. lat. 46. 28.
CONDRILLE, f. f. {Hift, nat. bot,) chondrilla ;
genre de plante dont la fleur eft un bouquet à demi-
fleurons portés chacun fur un embriôn, & foûtenus
par un calice qui eft un tuyau cylindrique. Lorfque
la fleur eft paflee, chaque embrion devient une fe-
mence garnie d’une aigrette. Tournefort, injlit. rei
herb. Foye{ PLANTE. ( / )
CONDROZ, ( l e ) Géog. mod. petit pays d’Allemagne,
au cercle de ’Weftphalie, dans le pays de
Liège, dont Huy eft la capitale.
CONDUCTEUR, f. m. {Gramm.) celui qui en
conduit un autre, qui lui fert de guide de peur qu’il
ne s’égare. Ce terme fe prend au fimple &; au figuré.
Foye[ les articles fuivans.
C o n d u c t e u r ,{Phyfîq.) d ep u is qu elqu e tem s f »
d it a u fli, en p a rlan t d ’ex p é r ien c e s d’é le f t r ic ité , d’un,
c o rp s i fo lé , c’eft-à -dire foû ten u fur d e s co rd on s d e
f o i e , fu r du v e r r e , &c. eonfidéré comme communiqu
an t o u tran fme ttan t à un o u à plufieu rs corps_ la
v e r tu é le ftriq u e qu ’il re ço it d’un au tre ; a infi une co rde
m o u illé e , une ch a în e , un fil-d’a r c h a l, &c en génér
a l to u t c o rp s éle ftrifab le p a r com m un ica tion {voyeç
É l e c t r i c i t é ) , re g a rd é com m e ch a rg é d e t r a n s mettre
c e tte v e r tu d ’un c o rp s à un o u à plufieu rs au-,
t r è s , e ft dit u n conducteur.
D’après cette définition on pourroit conclure que
dans un fyftème de corps éleftriféspar un globe, un
tube, &c. on devroit appeller la plûpart de ces corps
conducteurs, puifqu’ils font prefque tous dans le cas
de. fe tranfmettre fucceflivement l’éleftricité ; cependant
ce feroit contre l’ufage, qui ne leur donne ce
nom qu’autant qu’ils font envifagés, ainfi que nous
venons de le dire, comme chargés de cette fonftion.
Dès que cette confidération cefle, ils le perdent, &:
rentrent dans la clafle des corps éleftriques ordinaires.
On appelle encore conducteur ou plûtôt le conducteur
, un corps, ifolé, éleftrifable par communication
, qui reçoit la vertu éleftrique immédiatement
d’un globe ou d’un tube pour faire différentes expériences,
quoique fouvent il ne ferve nullement à
tranfmettre cette vertu à aucun corps : mais comme
on l’emploie aufli à cet ufage, auquel cas il devient
le premier de tous les conducteurs, les autres corps
quelconques éleftrifés rie l’étant que par la vertu
éleftrique qu’il leur communique, on lui a donné le
nom de cette fonftion en l’appellant Amplement le
conducteur, comme pour dire le premier de tous. Foyeç
les Planches de l'Électricité, Planches phyfiques.
Avant de rien dire de particulier fur ces deux différens
conducteurs, il eft à-propos de rapporter quelques
faits au moyen defquels nous ferons en état de
déterminer plus précifément tout ce qu’il faut obfer-
ver à leur égard.
Ces faits peuvent fe réduire aux trois fuivans : i ° 2
l’eau, les métaux & quelques êtres animés, comme
un homme par exemple, font les feules fubftances
connues qui tranfmettent l’éleftricité en entier, v o y.
É l e c t r i c i t é ; les autres la tranfmettant plus imparfaitement
& plus difficilement, & en arrêtant d’autant
plus qu’elles font plus éleftrifables par frôlement,
voye{ É l e c t r i c i t é : z°. dans un corps électrique
, les pointes, les angles, & en général toutes les
parties faillantes fur fa furface, dont les extrémités
font aiguës, font autant d’iffues ainfi que nous l’a appris
M. Franklin, par où fe diflipe le fluide éleftri-
que ; &les aigrettes de feu que l’on voit à ces parties
ne font formées que par ce fluide qui en fort ; car l’é-
leftricité a cela de remarquable, qu’elle pafle & fe
fait jour â:travers les pointes & les angles des corps,
comme le font les fluides à-travers lés ouvertures
des vafes dans lefquèls ils font retenus. Ainfi de même
qu’un réfervoir dans lequel fe décharge une four-
ce qui coule toûjours également, paroitra plus ou
moins plein, feiçn qu’il aura des fentes ou des trous
plüs ou moins grands, ou plus ou moins multipliés
par où l’eau pourra s’écouler ; de même, en regardant
l’éleftricité fournie par le globe comme confiante
ou toûjours la même, elle paroîtra plus ou
moins forte dans le. fyftème de corps éleftrifés par
ce globe , félon qu’ils auront moins ou plus de ces
parties aiguës par où le fluide électrique pourra s’échapper.
Enfin le verre & les autres fubftances élec-
trifebles par frôlement, ont la propriété de repouffer
, fi cela fe peut dire , le fluide éleftrique, de fa-
-çon qu’elles l’empêchent de s’échapper. Ainfi une
aigrette partant de la pointe d’un corps éleftrique
quelconque dans une certaine direction , en prendra
une autre des qu’on en approchera du verre, & cette
nouvelle direction fera telle que l’aigrette paroîtra
comme le fuir. On trouve à la fuite des lettres de
M. l’abbé piolet ,pag. 2 $5. un fait obfervé par cet
habile phyficien, qui confirme pleinement ce que
nous venons d’avancer. Il dit dans cet endroit, qu'il
parut évident parles aigrettes que donnoient à voiries
quatre angles d'une tringle de fer recouverte d'un tuyau
de verre , & par la vivacité des étincelles qu'on en droit,
.que cette enveloppe rendoit l'électricité bien plus forte
qu a Vordinaire ; deforte, continue-t-il, qu'on peut dire
que c eft un nouveau moyen de faire prendre ou de con-
ferver aux conducteurs une plus grande vertu.
Ces faits une fois connus , on voit que par rapport
aux conducteurs en général , du lorfqu’on veut
Amplement tranfmettre l’éleftricité d’un corps à un
autre, il faut employer les fubftances les plus élec-
trifables par communication qu’il eft poflible, comme
l’eau, les métaux, &c. L’eau même a cet avantage
, que toutes fortes de fubftances , comme pierres
, bois, &c. qui en font bien imbues, peuvent devenir
par-là de fort bons conducteurs , quelque peu
éleftrifables par communication qu’elles foient d’ailleurs
; parce qu’alors elles ne forment plus, pour
ainfi dire, que des efpeces de fupports contenant des
filets d’eau qui tranfmettent le fluide éleftrique : il
faut aufli que les conducteurs foient cylindriques,cette
forme étant de toutes celles qu’on peut leur donner
celle qui a le moins de [parties angulaires ; qu’ils
n’ayent en aucun endroit de ces parties aiguës, quelque
petites qu’elles foient , par où le fluide éleftri-
que puifle fe diflïper ; & ainfi qu’ils foient fortlifles ,
ce fluide s’échappant, fouvent par les plus petites éminences
ou rigofite^ ; enfin pour mieux empêcher l’é—
leftricité de fe diflïper *•& la rendre en-même tems
plus forte , il eft à-propos de recouvrir les conducteurs.
de tuyaux de verre.ou de rubans de-foie bien roulés
les uns par-deflus les. autres , fur-tout lorfque ces
conducteurs paflent flans des endroits.où ils ne font pas
affez éloignés des corps qui peuvent leur dérober l’é-
leâricité.
Il fé préfente ici- naturellement plufieurs quef-
tions. On demandera fi quel que foit le volume de
ces conducteurs, la quantité du fluide élettrique tranf-
mife fera la même ; fi pareillement lâ fôrce de l’élec-
tricife n’augmentera ou ne diminuera pas, quelle que
foit leur longueur ; enfin fi cette force fera la même
dans un conducteur fort long, à la partie la pluséloi-
gnée du globe, félon; le cours .de l’éledricité, qu’à
celle qui en eft plus près félon le mêmercours. Nous
répondrons, quant à la première queftiôn, que le volume
eft ici indifférent , la.quantité d’éledricité tranf.
mife étant toûjours,fa.même, de quelque grofleurque'
foit le conducteur^ comme nous l’avonsprouyé M. le
chevalier d’Arcy &\moi, dans un .-mémoire inféré
dans le volume deTAcadémie de l'année, 174$ ,-en effet
on s’en affûrera.facilement en tranfmettant alternativement
l’éleâricité à deux corps j tantôt par une
barre de fer,& tantôt par un fil-de-ferfort délié; car
on verra alors que; çqs. deux corps feront éleftrifés au
nlem^ egr® > foit. qu?ils reçoivent l’électricité par la
Tome III,
baffe, foit qu’ils ia reçoivent par lé fflde-fer ; Ce qui,
pour le dire en paflaat, prouve que le fluide éleftri-
que a la propriété de tous les autres fluides qui fe répandent
toûjours également, quels que foient les ca-
lïuix de communication ; c’eft-à-dire que dans plu-
fieursréfervoirs qui communiquent enfemble, l’eau,
par exemple, eft toûjours de niveau, de quelque grof-
feur que foient les tuyaux de communication. De
ce principe de fait on tire la réponfe à la troifieme
queftiôn ; favoir, que l’éleélricité ne peut être plus
forte à une extrémité du conducteur qu’à l’autre, puif-
que fi cela etoit, elle ne fe diftribuéroit pas également,
ce qui feroit contraire à ce principe: enfin
par rapport à la fécondé queftiôn ,’ nous répondrons
que par toutes les expériences que l’on a faites, on;
n a pas remarque que l ’eleéfcricité diminuât,quelle que
fut la longueur du conducteur, quoiqu’on en ait employé
qui avoient plus de 1300 piés. Il y a plus : félon
ce que dit M. le Monnier le médecin, pag. 4GJ,v
des mémoires de ÜAcadémie de lyqG, plus les corps
e| eft ri fes ° ° t d’étendue en longueur, plus l’éleftri-
cité paroît forte. Quoiqu’il en fo it, il eft confiant
qu’à quelque diftance qu’on ait tranfmis l’éleftricité
jufqu’ic i(& cette tranfmiflions’efttoujours faite dans
un tems inaflignable) , on n’a pas remarqué que fa
force en fût diminuée.
Paflons à ce qu’on appelle particulièrement le
conducteur. Ce que nous venons de dire dés conducteurs
en général, par rapport à leur figure & à la
fubftanee dont ils doivent être formés, étant également
applicable à ceux dont il eft aftuellement
queftiôn, il s’enfuit qu’ils doivent être, comme les
premiers, de métal ourevêtus d’une fubftanee métallique
, de figure cylindrique , & aufli lifles qu’il eft
poflible. Nous n’ajoûterions rien à leur égafd, fi ce
n’eft que devant, fervir à différentes expériences , il
eft à-propos xle parler de la grandeur qu’ils doivent’
avoir pour acquérir & conferver beaucoup: d’électricité.
'
C eft un principe de fa it, que plus ces fortes de
conducteurs font grands, plus les étincelles qu’on en
tire font fortes ; car il efteflentiel de remarquer que
quoique la quantité d’éleftricité tranfmife par un
corps foit la même , qu’il foit grand ou qu’il foit pe--
tit, 1 attraftion-, la repulfion, Sc tous les phénomènes.
de l’éleftricité paroiflent cependant plus confi-
derables dans le grand'que dans'le petit. Mais ces
phénomènes augmentent-ils félon l ’augmentation de
la mafle du conducteur , ou Amplement félon l’augmentation
de fa fiirface ? o u , en d’autres mots l’in-
tenfité.de l’éleftricité dans les corps augmente-t-elle
dans la raifon de leurs maflesou dans celle dé leurs
fûrfaces ? C ’eft unequeftionquiadéj’àbeaucoupexer-
céles Phyficiens, & fur laquelle ils font fort partagés.
Les uns, comme M. l’abbé Nolet, penfent que l’électricité
augmente avec les mafles, non pas à ia vérité
dans la raifon direfte de ces mafles, mais cependant
dans une plus grande raifon que celle qui devroit ré-
fulter de la fimple augmentation des fûrfaces ; enfin
qu’une|plus grande mafle eft fufceptible d’acquérir
plusxl’éléftricité qu’une plus petite .-ïes autres » comme
M. le Monnier le: médecin, penfent qu’élle aug-
mentefeulement comme les fûrfaces; & c’eft ce qui
a paru réfulter aufli un grand nombre d’expérien-.
ces que nous- avonsTaites M. d’Arcy & moi, rapportées
dans le mémoire déjà- cité ; voyeç la-dtffus l'article
Él e c t r ic it é ; Quoi qu’il en foit, il eft toûjours.
mieux d’avoir un grand conducteur jcyVmàric\ae -, comme
nous l’avons .diti; -& quand même il feroit creux
pourvû qu’il ait une certaine épaifleur, les étincelles
que Ton en tirera feront très-belles & très-fortes.
En Allemagne , en Hollande , & en Angleterre
on fe feft ordinairement pour conducteur d’un canon
de fùfil : mais de pareils conducteurs ne paroiflent pas
O O o o o