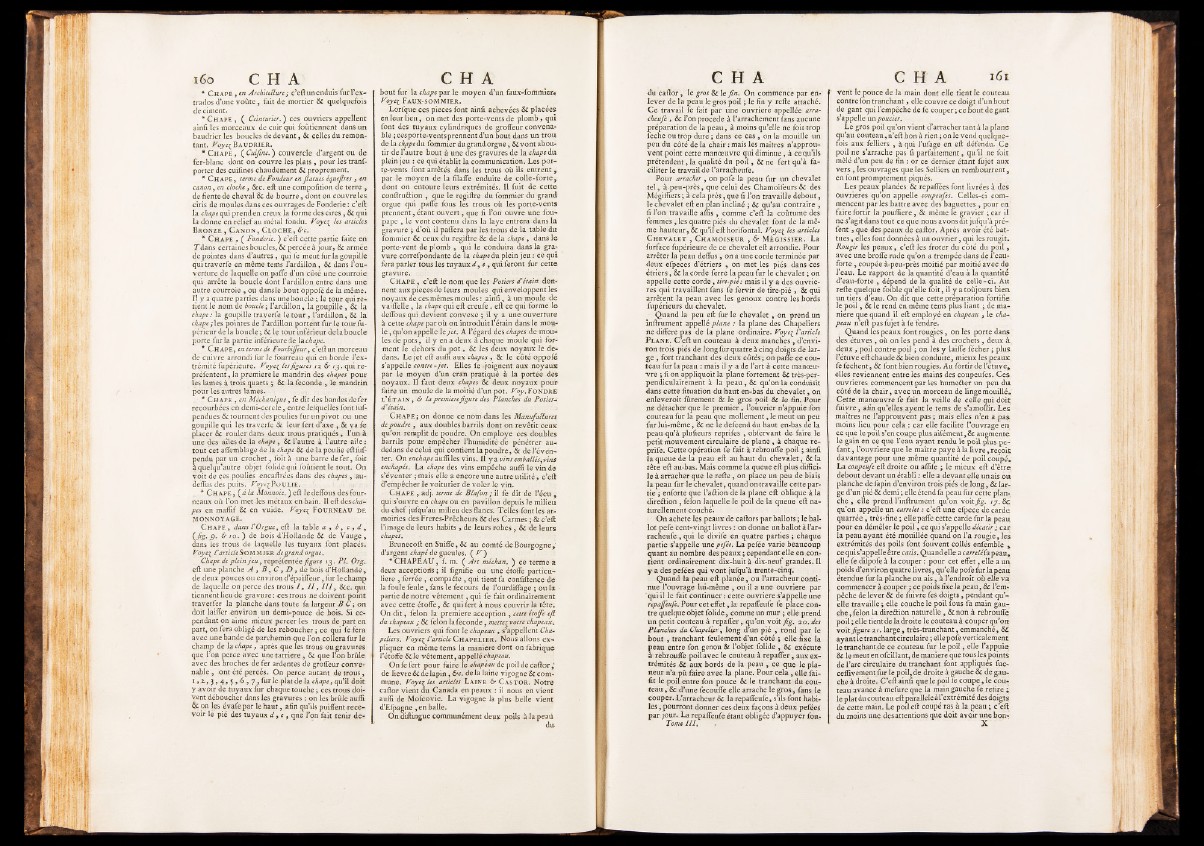
* C hape , en Architecture ; c’eft un enduis fur l’extrados
d’une voûte, fait de mortier 6c quelquefois
de ciment.
* C h a p e , ( Ceinturier. ) ces ouvriers appellent
ainfi les morceaux de cuir qui foûtiennent dans un
baudrier les boucles de devant, & celles du remontant.
Voye^ Baudrier.
* C hape , ( Cuifine. ) couvercle d’argent ou de
fer-blanc dont on couvre les plats , pour les transporter
des cuifines chaudement & proprement.
* CHAPE, terme de Fondeur en Jlatues équefires , en
canon, en cloche , &c. elt une compofition de terre ,
de fiente de cheval 6c de bourre, dont on couvre les
ciris de moules dans ces ouvrages de Fonderie : c’eft
la chape qui prend en creux la forme des cires, 6c qui
la donne en relief au métal fondu. Voye{ les articles
Bronze , C an o n , C lo ch e , & c.
* C hape , ( Fonderie. ) c’eft cette partie faite en
T dans certaines boucles, 6c percée à jour, 6c armée
de pointes dans d’autres , qui fe meut fur la goupille
qui traverfe en même tems l’ardillon, & dans l’ouverture
de laquelle on paffe d’un côté une courroie
qui arrête la boucle dont l’ardillon entre dans une
autre courroie , ou dansie bout Oppoféde la même.
Il y a quatre parties dans une boucle ; le tour qui retient
le nom de boucle ; l’ardillon, la goupille , & la
chape : la goupille traverfe le tou r, l’ardillon, 6c la
chape ; les pointes de l’ardillon portent fur le tour fu-
périeur de la boucle ; 6c le tour inférieur de la boucle
porte fur la partie inférieure de la chape.
* C hape, entermede Fourbiffeur, c’eftun morceau
de cuivre arrondi fur le fourreau qui en borde l’extrémité
fupérieure. V sye[ lesfigures 12 & 13.. qui re-
préfentent, la première le mandrin des chapes pour
les lames à trois quarts ; ôc la fécondé , le mandrin
pour les autres lames. -
. * C hape , en Méckanique, fe dit des bandes defer
recourbées en demi-cercle, entre lejquelles font fuC
pendues 6c tournent des poulies fur un pivot .ou une
goupille qui les traverfe & leur fert d’axe , & va fe
placer & rouler dans deux trous pratiqués, l’un à
une des ailes de la chape , & l’autre à l’autre aile:
tout cet affemblage de la chape 6c de la poulie eftfuf-
pendu par un crochet, foit à une barre de fer, foit
à qUelqu’autre objet folide qui foûtient le tout. On
voit de ces poulies encaftrées dans des chapes, au-
deftiis des puits. Voyt^ Po u l ie .
* C hape , ( à la Monnaie, ) eft le deffous des fourneaux
où l’on met les métaux en bain. Il eft des chapes
en mafîif 6c en vuide. Vqyc{ Fourneau de
MONNOYAGE.
C hape , dans VOrgue, eft la table a , b , c , d ,
(ƒ#. S - & 10. ) de bois d’Hollande 6c de Vauge ,
dans les trous de laquelle les tuyaux font placés.
Voye^ l'article SOMMIER de grand orgue.
Chape de plein je u , repréfentée figure 13. PI. Org..
eft une planche A , B I C , D , de bois d’Hollande,
de deux pouces ou environ d’épaiffeur, fur le champ
de laquelle on perce des trous I , I I , I I I , 6cc. qui
tiennent lieu de gravure : ces trous ne doivent pomt
traverfer la planche dans toute fa largeur B C-, on
doit laiffer environ un demi-pouce de bois. Si cependant
on aime mieux percer les trous de part en
part, on fera obligé de les reboucher ; ce qui fe fera
avec une bande de parchemin que l’on collera fur le
champ de la chape, après que les trous ou gravures
que l’op perce avec unetarriere, 6c que l’on brûle
avec des broches de fer ardentes de groffeur convenable
, ont été percés. On perce autant de trous,
1 , x , 3 ,4 , 5 , 6 , 7 , furie plat de la chape, qu’il doit
y avoir de tuyaux fur chaque touche ; ces trous doivent
déboucher dans les gravures : on les brûle aufli
& on les évafe par le haut, afin qu’ils puiffent recevoir
le pié des tuyaux d , e , que l’on fait tenir debout
fur la chape par le moyen d’un faux-fommicr«
Voye{ Faux-som m ier .
Lorfque ces pièces font ainfi achevées 6c placées
en leur lieu , on met des porte-vents de plomb, qui
font des tuyaux cylindriques de groffeur convenable
; ces porte-vents prennent d’un bout dans un trou
de la chape du fommier du grand orgue, & vont abou-,
tir de l’autre bout à une des gravures de la chape du
plein jeu : ce qui établit la communication. Les porte
vents font arrêtés dans les trous où ils entrent ,
par le moyen de la filaffe enduite de colle-forte,
dont on entoure leurs extrémités. Il fuit de cette
conftruûion , que le regiftre du fommier du grand
orgue qui paffe fous les trous où les portes-vents
prennent, étant ouvert, que fi l’on ouvre une fou-*
pape , le vent contenu dans la laye entrera dans, la
gravure ; d’où il paffera par les trous de la table du
fommier & ceux du regiftre 6c de la chape , dans le
porte-vent de plomb , qui le conduira dans la gravure
correfpondante de la chape du plein jeu : ce qui
fera parler tous les tuyaux d , e , qui feront fur cette
gravure.. .
C hape , c’eft le nom que les Potiers d'étain donnent
aux pièces de leurs moules qui enveloppent les
noyaux de ces mêmes moules: ainfi, à un moule de
vaiffelle , la chape qui eft creufe. eft ce qui forme le
deffous qui devient convexè ; il y a une ouverture
à cette chape par où on introduit l’étain dans le moule
, qu’on appelle le jet. A l’égard des chapes de moules
de pots, il y en a deux à chaque moule qui forment
le dehors du p o t , 6c les deux noyaux le dedans.
Le jet eft aufli aux chapes , & le côté oppofé
s’appelle contre-jet. Elles fe .joignent aux noyaux
par le moyen d’un cran pratiqué à la portée des
noyaux. Il faut deux chapes 6c deux noyaux pouü
faire un moule de la moitié d’un pot. Voy. Fondre
l’Ét a in , & la première figure des Planches du Potier*
d'étain.
C h a p e ; on donne ce nom dans les Manufactures
de poudre , aux doubles barrils dont on revêtit ceux
qu’on remplit de poudre. On employé ces doubles
barrils pour empêcher l’humidité de pénétrer au-
dedans de celui qui contient la poudre, & de l’éventer.
On enchape aufli les vins. Il y a vins emballés,vins
enckapés. La chape des vins empêche aufli le vin de
s’éventer ; mais elle a encore une autre u tilité, c’eft
d’empêcher le voiturier de voler le vin.
C hape , adj. terme de Blafon ; il fe dit de l’écu ,
qui s’ouvre en chape ou en pavillon depuis le milieu
du chef jufqu’au milieu des flancs. Telles font les armoiries
des Freres-Prêcheurs & des Carmes ; & c’eft
l’image de leurs habits , de leurs robes, 6c de leurs
chapes.
Brunecoft en Suiffe, & au comté de Bourgogne,'
d’argent chapé de gueules. (
* CHAPEAU, f. m. ( Art médian. ) ce terme a
deux acceptiorfs ; il fignifie où ime étoffe particulière
, ferrée, compacte , qui tient fa confiftence de
la foule feule, fans le fecours de l’ourdiffage ; ou la
partie de notre vêtement, qui fe fait ordinairement
avec cette étoffe, & qui fert à nous couvrir la tête.
On dit, félon la première acception , cette étoffe eft
du chapeau ; 6c félon la fécondé, mette^ votre chapeau.
Les ouvriers qui font le chapeau , s’appellent Chapeliers.
Voye{ L'article C hapelier. Nous allons expliquer
en même tems la maniéré dont on fabrique
l’étoffe & le vêtement, chapeau.
On fe fert pour faire le chapeau de poil de caftor
de lievre & de lapin, &c. de la laine vigogne & commune.
Voye[ les articles L aine 6* C a s to r . Notre
caftor vient du Canada en peaux il nous en vient
aufli de Mofcovie. La vigogne la plus belle vient
d’Efpagne, en balle.
On diftingue communément deux poils à la peau
dudu
caftor, le gros & le fin. On commence par enlever
de la peau le gros poil ; le fin y refte attaché.
C e travail fe fait par une ouvrière appellée arra-
cheufe , & l’on procédé à l’arrachement fans aucune
préparation de la peau, à moins qu’elle ne foit trop
leche ou trop dure ; dans ce cas , on la mouille un
peu du côté de la chair : mais les maîtres n’approuvent
point cette manoeuvre qui diminue, à ce qu’ils
prétendent, la qualité du p o il, 6c ne fert qu’à faciliter
le travail de l’arracheufe.
Pour arracher , on pofe la peau fur un chevalet
te l, à-peu-près, que celui des Chamoifeurs & des
Mégiflîers; à cela près, que fi l’on travaille debout,
le chevalet eft en plan incliné ; 6c qu’au contraire ,
fi l’on travaille aflis , comme c’eft la coûtume des
femmes , les quatre piés du chevalet font de la même
hauteur, 6c qu’il eft horifontal. Voye^ les articles
C hev alet , C hamoiseur , & Mé g is s ie r . La
furface fupérieure de ce chevalet eft arrondie. Pour
arrêter la peau deffus , on a une corde terminée par
deux efpeces d'étriers , on met les piés dans ces
étriers, & la corde ferre la peau fur le chevalet ; on
appelle cette corde, tire-pié: mais il y a des ouvrières
qui travaillent fans fe fervir de tire-pié , & qui
arrêtent la peau avec les genoux contre les bords
fupérieurs du chevalet.
Quand la peu eft fur le chevalet , on prend un
infiniment appellé plane : la plane des Chapeliers
ne différé pas de la plane ordinaire. Foyer l'article
P lane. C ’eft un couteau à deux manches , d’environ
trois piés de long fur quatre à cinq doigts de large
, fort tranchant des deux côtés ; on paffe ce couteau
fur la peau : mais il y a de l’art à cette manoeuv
re ; fi on appliquoit la plane fortement 6c très-perpendiculairement
à la peau, 6c qu’on la conduisît
dans cette fituation du haut en-bas du chevalet, on
enleveroit fûrement & le gros poil & le fin. Pour
ne détacher que le premier, l’ouvrier n’appuie fon
couteau fur la peau que mollement, le meut un peu
fur lui-même, & ne le defeend du haut en-bas de la
peau qu’à plufieurs reprifes , obfervant de faire le
petit mouvement circulaire de plane , à chaque re-
prife. Cette opération fe fait à rebrouffe poil ; ainfi
la queue de la peau eft au haut du chevalet, 6c la
tête eft au-bas. Mais comme la queue eft plus difficile
à arracher que le refte, on place un peu de biais
la peau fur le chevalet, quand on travaille cette partie
; enforte que l’a&ion de la plane eft oblique à la
direâion , félon laquelle le poil de la queue eft naturellement
couché.
On acheté les peaux de caftors par ballots ; le ballot
pefe cent-vingt livres : on donne un ballot à l’arracheufe
, qui le divife en quatre parties ; chaque
partie s’appelle une pefée. La pefée varie beaucoup
quant au nombre des peaux ; cependant elle en contient
ordinairement dix-huit à dix-neuf grandes. Il
y a des pefées qui vont jufqu’à trente-cinq.
Quand la peau eft planée, ou l’arracheur continue
l’ouvrage lui-même , ou il a une ouvrière par
qui il le fait continuer : cette ouvrière s’appelle une
rcpajfeufe. Pour cet effet, la repaffeufe fe place contre
quelque objet folide, comme un mur ; elle prend
un petit couteau à repaffer, qu’on voit fig. 20. des
Planches du Chapelier, long d’un pié , rond par le
b o u t , tranchant feulement d’un c ô t é e l l e fixe la
peau entre fon genou & l’objet folide , 6c exécute
à rebrouffe poil avec le couteau à repaffer, aux extrémités
6c aux bords de la peau , ce que le planeur
n’a pû faire avec la plane. Pour c e la , elle fai-
fit le poil entre fon pouce 6c le tranchant du couteau,
& ft’une fecouffe elle arrache le gros , Tans le
couper. L’arracheur 6c la repaffeufe, s’ils font habiles
, pourront donner ces deux façons à deux pefées
par jour. La repaffeufe étant obligée d’appuyer fou-
Toipe III.
vent le pouce de la main dont elle tient le couteau
contre fon tranchant, elle couvre ce doigt d’un bout
de gant qui l’empêche de fe couper ; ce bout de gant
s’appelle un poucier.
Le gros poil qu’on vient d’arracher tant à la plane
qu’au couteau, n’eft bon à rien ; on le vend quelquefois
aux felliers , à qui l’ufage en eft défendu. Ce
poil ne s’arrache pas fi parfaitement, qu’il ne foit
mêlé d’un peu de fin : or ce dernier étant fujet aux
v e r s , les ouvrages que les Selliers en rembourrent,
en font promptement piqués.
Les peaux planées & repaffées font livrées à des
ouvrières qu’on appelle coupeufes. Celles-ci commencent
par les battre avec des baguettes , pour en
faire fortir la poufliere, & même le gravier ; car il
ne s’agit dans tout ce que nous avons dit jufqu’à pré-
fen t, que des peaux de caftor. Après avoir été battues
, elles font données à un ouvrier, qui les rougit.
Rougir les peaux, c’eft les froter du côté du poil ,
avec une broffe rude qu’on a trempée dans de l’eau-
forte , coupée à-peu-près moitié par moitié avec de
l’eau. Le rapport de la quantité d’eau à la quantité
d’eau-forte , dépend de la qualité de celle-ci. Au
refte quelque foible qu’elle foit, il y atoûjours bien
un tiers d’eau. On dit que cette préparation fortifie
le p o il, & le rend en même tems plus liant ; de maniéré
que quand il eft employé en chapeau , le cha*
peau n’eft pas fujet à fe fendre.
. Quand les peaux font rougies, on les porte dans
des étuves , où on les pend à des crochets , deux à
deux , poil contre poil ; on les y laiffe fécher ; plus
l’étuve eft chaude & bien conduite, mieux les peaux
fefechent, 6c font bien rougies. Au fortir de l’etuve,
elles reviennent entre les mains des coupeufes. Ces
ouvrières commencent par les humeûer un peu du
côté de la chair, avec un morceau de linge mouillé.'
Cette manoeuvre fe fait la veille de celle qui doit,
fuivre, afin qu’elles ayent le tems de s’amollir. Les
maîtres ne l’approuyent pas ; mais elles n’en a pas
moins lieu pour cela : car elle facilite l’ouvrage en
ce que le poil s’en co.upe plus aifément, 6c augmente
le gain en ce que l’eau ayant rendu le poil plus pe-
fant, l’ouvriere que le maître paye à la livre, reçoit
davantage pour une même quantité de poil coupé.
La coupeufe eft droite ou aflife ; le mieux eft d’être
debout devant un établi : elle a devant elle unais ou
planche defapin d’environ trois piés de long, & large
d’un pié 6c demi ; elle étend fa peau fur cette planche
, elle prend l’inftrument qu’on voit fig. iy. 6c
qu’on appelle un carrelet : c ’eft une efpece de carde
quarrée, très-fine ; elle paffe cette carde fur la peau
pour en démêler le p o il, ce qui s’appelle décatir ; car
la peau ayant été mouillée quand on l’a rougie, les
extrémités des poils font fouvent collés enfemble ,
ce qui s’appelle être catis. Quand elle a carreléia peau,
elle fe difpofe à la couper : pour cet effet, elle a un
poids d’environ quatre livres, qu’elle pofe fur la peau
étendue fur la planche ou ais, à l’endroit où elle va
commencer à couper ; ce poids fixe la peau, 6c l’empêche
de lever & de fuivre fes doigts, pendant qu’elle
travaille ; elle couche le poil fous fa main gauche,
félon la dire&ion naturelle , &non à rebrouffe
poil ; elle tient de la droite le couteau à couper qu’on
voit figure 21. large, très-tranchant, emmanché, 6c
ayant le tranchant circulaire ; elle pofe verticalement
le tranchant de ce couteau fur le poil, elle l’appuie
6c le meut en ofcillant, de maniéré que tous les points
de l’arc circulaire du tranchant font appliqués fuc-
ceflivement fur le poil, de droite à gauche 6c de gauche
à droite. C ’eft ainfi que le poil Te coupe, le couteau
avance à mefure que la main gauche fe retire ;
le plat du couteau eft parallèle à l’extrémité des doigts
de cette main. Le poil eft coupé ras à la peau ; c ’eft;
du moins une des attentions que doit avçir une bon