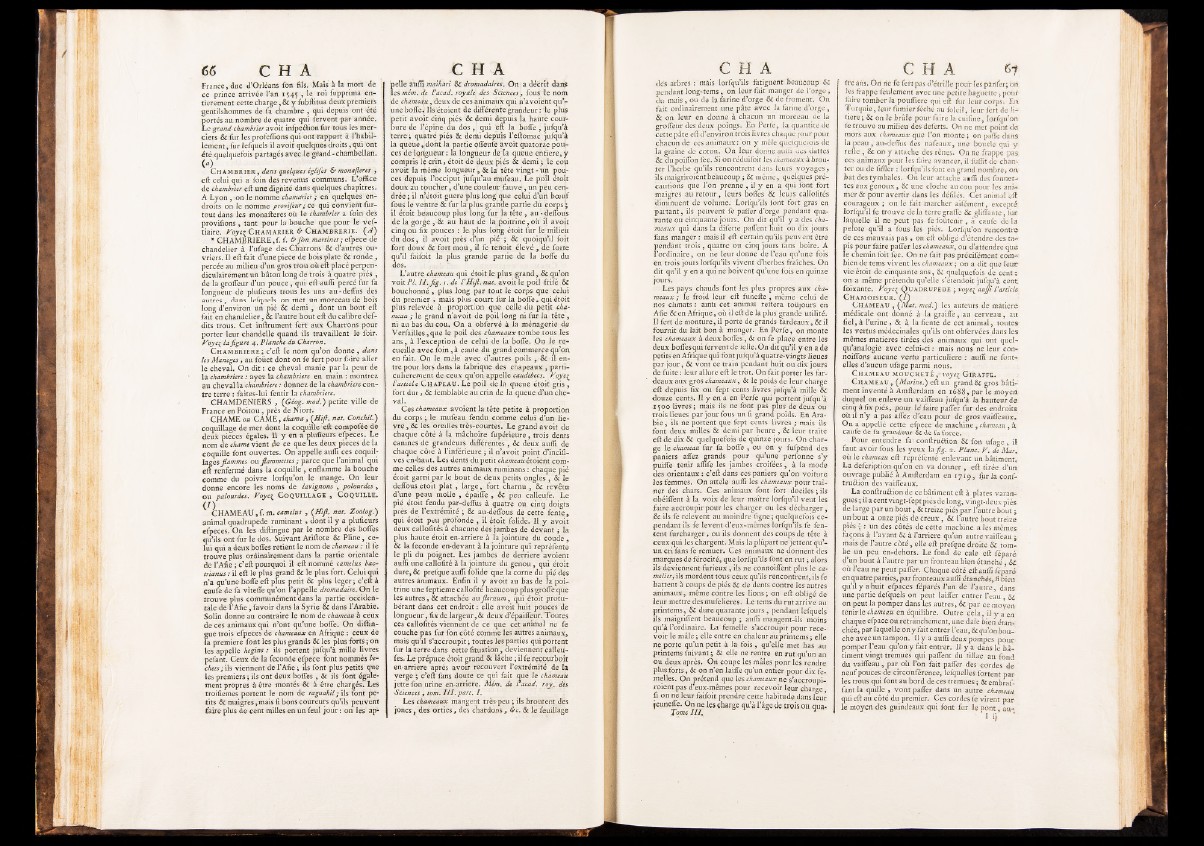
À
France, duc d’Orléans fon fils. Mais à la mort de ,
ce prince arrivée l’an i ç 45 , le rôi fupprimà entièrement
cette charge, & y fubftitua deux premiers
gentilshommes de fa chambre , qui depuis ont été
portés au nombre de quatre qui fervent par anrtee.
Le grand-chambritr a voit infpeâion fur1 tous les merciers
& fu r les profeffions qui ontïapport à l’habillement,
fur lefquels il avoit quelques droits ,qüi ont
été quelquefois partagés avecJe gt?and-chambellan.
(« ) ' • . ' . n
CHAMBRIER, dans quelques églifes & monafieres >
eft celui qui a foin des revenus communs. L’office
de chamhrier eft une dignité dans quelques chapitres.
A Lyon , ;on le nomme chamarier'; en quelques endroits
on le nomme provifeur ; ce qui conviènt fur-
tout dans les monafteres oit le chambrier a foin des
provifions , tant pour la bouche que pour le Vef-
tiaire. Voye^ C hamarier & C ham br e r ie .
* CHAMBRIERE,f. f. 8 fonmartinet ; efpece de
chandelier à l’ufage des Charrons 8c d’autres ouvriers.
Il eft fait d’une piece de bois plate 8c ronde ,
percée au milieu d’un gros trou oit eft placé perpendiculairement
un bâton long dë trois à quatre piés ,
de la groffeur d’un pouce, qui eft auffi percé fur fa
longueur dè plufieurs trous les uns au-deffus des
autres, dans lefquels on met un morceau de bois
long d’environ un pié & demi , dont un bout eft
fait en chandelier, 8c l’autre bout eft du calibre def-
dits trous. Cet inftrument fert aux Charrons pour
porter leur chandelle quand ils travaillent le foir.
Voye[ la figure 4. Planche du Charron.
C ham br ièr e ; c’eft le nom qu’on donne, dans
les Manèges, au foiiet dont on fe fert pour faire aller
le cheval. On dit : ce cheval manie par la peur de
la chambrière : ayez la chambrière en main : montrez
au cheval la chambrière : donnez de la chambrière contre
terre : faites-lui fentir la chambrière.
CHAMDENIERS , {Géog. mod.) petite ville de
France en Poitou, près de Niort.
CHAME ou CAME, chama 9 {Hifi. nat. Conchil.)
coquillage de mer dont la coquille 'eft compofée de
deux pièces égales. Il y en a plufieurs efpeces. Le
nom de chame vient de ce que les deux pièces de la
coquille font ouvertes. On appelle aufîi ces coquillages
fiammes ou fiammettes ; parce que l’animal qui
eft renfermé dans la coquille, enflamme la bouche
comme du poivre lorfqu’on le mange. On leur
donne encore les noms de lavignons , polourdes ,
ou palourdes. Voye£ COQUILLAGE , COQUILLE.
( / )
CHAMEAU, f. m. camelus , {Hifi. nat. Zoolog.)
animal quadrupède ruminant, dont il y a plufieurs
efpeces. On les diftingue par le nombre des boffes
qu’ils ont fur le dos. Suivant Ariftote & Pline, celui
qui a deux boffes retient le nom de chameau : il fe
trouve plus ordinairement dans la partie orientale
de l’Afie ; c’ eft pourquoi il eft nommé camelus bac-
trianus : il eft le plus grand & le plus fort. Celui qui
n’a qu’une boffe eft plus petit 8c plus léger; c’eft à
caufe de fa vîteffe qu’on l’appelle dromadaire. On le
trouve plus communément dans la partie occidentale
de l ’Afie, favoir dans la Syrie 8c dans l’Arabie.
Solin donne au contraire le nom de chameau à ceux
de ces animaux qui n’ont qu’une boffe. On diftingue
trois efpeces de chameaux en Afrique : ceux de
la première font les plus grands 8c les plus forts ; on
les appelle hegins : ils portent jufqu’à mille livres
pefant. Ceux de la fécondé efpece font nommés be-
chets; ils viennent de l’Afie ; ils font plus petits que
les premiers ; ils ont deux boffes , & ils font également
propres à être montés 8c à être chargés. Les
troifiemes portent le nom de raguahil ; ils font petits
8c maigres,mais fi bons coureurs qu’ils peuvent
faire plus de cent milles en un feul jour : on les appelle
aufîi maintiri 8c dromadaires. On a décrit dan?
lies mcm. de Cacad. royale des Sciences , fous;‘le nom
jde chameau, deux de ces animaux qui n’a voient qu’r
pne boffe, Ils étoient de différente grandeur : ’le plus
ipetit avoit cinq piés & demi depuis la haiitè courbure
de l’épine du d o s , qui eft la boffe , jufqu’à
terre ; quatre piés & demi depuis l’eftomac jufqu’à
la queue ,idoftt la partie (jffeufé àvoit quatorze pouÿ-
ces de lQûgueur : la longueur deda queue entière, y
compris lè c rin, étoit de deux piés & demi ; 'le cou
avoit la même longueur , & la“ tête vingt - Lin pouces
depuis l’occiput jufqu’au mufeau. Le poil étoit
doux au tbucher, d’une cbuleur'fauve, un peu cendrée
; il ntétdit guere plus long que celui d’üti boeuf
fous le ventre & fur la plus grande partie dû jêorps %
il étoit beaucoup plus* long fur la tête, au -défions
de la gorge au haut de la,poitrine,oit il avoit
cinq ou fix pouces : le plus long étoit fur le milieu
du dos, il avoit près d’un pié- ; & quoiqu’il foit
fort doux & fort moü, il fe tenoit élevé , de forte
qu’il failoit la plus grande partie de la boffe du
dos.
L’autre chameau qui étoit le plus grand, 8ç qu’on
voit PL. H.fig. 1. de C Hifi.nat. avoit le poil frifé 8c
bouchonné , plus long par tout le corps que celui
du premier , mais plus court fur la boffe, qui étoit
plus relevée à proportion que celle du petit chameau
; le grand n’avoit de poil long ni fur la tête ,
ni au bas du cou. On a obfervé à la ménagerie d,e
Verfailles,que le poil des chameaux tombe tous les
ans, à l’exception de celui de la boffe. On le recueille
avec foin, à cauiè du grand commerce qu’on
en fait. On le mêle avec d’autres poils , & il. entre
pour lors dans la fabrique des chapeaux , 'particulièrement
de ceux qu’on appelle caudebecs. Voyez
Vaiticle C h a p e au . Le poil de la queue étoit: gris ,
fort dur , 8c femblabie au crin de la queue d’un cheval
.C
es chameaux avoient la tête petite à proportion
du corps; le mufeau fendu comme celui d’un lièvre
, 6c les oreilles très-courtes. Le grand avoit de
chaque côté à la mâchoire fupérieure, trois dents
canines de grandeurs différentes , 6c deux aufîi de
chaque côté à l’inférieure ; il n’avoit point d’incifi-
ves en-haut. Les dents du petit chameau étoient comme
celles des autres animaux ruminans : chaque pie
écoit garni par le bout de deux petits ongles , & le
deffous étoit plat , large, fort charnu , & revêtu
d’une peau molle , épaiffe , 8c peu calleufe. Le
pié étoit fendu par-deffus à quatre ou. cinq doigts
près de l’extrémité ; 8c au-deffous de cette fente,
qui étoit peu profonde , il étoit folide. Il y avoit
deux callofités à chacune des jambes de devant ; la
plus haute étoit en-arriere à la jointure du coude ,
8c la fécondé en-devant à la jointure qui repréfente
le pli du poignet. Les jambes de derrière avoient
aufîi une callofité à la jointure du genou, qui étoit
dure, & prelque aufîi folide que la corne du pié des
autres animaux. Enfin il y avoit au bas de la poitrine
une l'eptieme callofité beaucoup plus'grôffe que
les autres, 8c attachée au flernum, qui étoit protubérant
dans cet endroit : elle avoit huit pouces de
longueur, fix de largeur,& deux d’épaiffeur. Toutes
ces callofités viennent de ce que cet animal ne fe
couche pas fur fon côté comme les autres animaux,
mais qu’il s’accroupit; toutes léS parties qui portent
fur la terre dans cette fituatiôn, deviennent calleii-
fes. Le prépuce étoit grand & lâche ; il fe recourboit
en-arriere après avoir recouvert l’extrémité de la
verge ; c’eft fans doute ce qui fait que le chameau
jette fon urine en-arriere. Mém. de Cacad. roy., dès
Sciences ; tom. TU. part. I.
Les chameaux mangent très-peu ; ils broutent des
joncs, des orties, des chardons ? &c. 8c le feuillage
des arbres : mâis lorfqu’ils fatiguent beaucoup 8c
pendant long-tems, on leur fait manger de l’orge,
du mais, ou de la farine d’orge & de froment. On
fait ordinairement une pâte avec la farine d’org e,
8c on leur en donne à chacun un morceau de la
groffeur des deux poings. En Perle, la quantité de
cette pâte eft d’environ trois livres chaque jqur pour
chacun de ces animaux : on y mêle quelque rois de
la graine de coton. On leur donne auiîi des dattes
8c dupoiffonfec. Si onréduifoit les chameaux àbrou-
iter l’herbe qu’ils rencontrent dans leurs voyages ,
ils maigriroientbeaucoup ; 8c même, quelques précautions
que l’on prenne , il y en a qui font fort
maigres au retour, leurs boffes 8c leurs callofités
diminuent de volume. Lorfqu’ils font fort gras en
partant, ils peuvent fe paffer d’orge pendant quarante
ou cinquante jours. On dit qu’il y a des chameaux
qui dans la difette paffent nuit ou dix jours
Fans manger : mais il eft certain qu’ils peuvent être
pendant trois , quatre ou cinq jours farts boire. A
l ’ordinaire, on ne leur donne de l’eau qii’uhe fois
èft trois jours lorfqu’ils vivent d’herbes fraîches. On
dit qu’il y en a qui ne boivent qu’une fois en quinze
jours.
LeS pays chauds font les plus propres aux cha±
meùux ; le froid leur eft funefte , même - celui de
nos climats : ainfi cet animal reftera toujours en
Afie 8c en Afrique, oii il eft de la plus grande utilité*
Il fert de monture, il porte de grands fardeaux, & il
fournit du lait bon à manger. En Perfe, on monte
les chameaux à deux boffes, & on fe place entre les
deux boffes qui fervent de lelle. On dit qu’il y en a de
petits en Afrique qui font jufqu’à quatre-vingts lieues
par jour, & vont ce train pendant huit ou dix jours
de fuite : leur allure eft le trot. On fait porter les fardeaux
aux gros chameaux, & le poids de leur charge
eft depuis fix ou fept cents livres jufqu’à mille 8c
douze cents. Il y en a en Perfe qui portent jufqu a
■ ï 500 livres ; mais ils ne font pas plus de deux ou
trois lieues par jour fous un fi grand poids. En Arabie
, ils ne portent que fept cents livres ; mais ils
font deux milles & demi par heure , 8c leur traite
eft de dix 8c quelquefois de quinze jours. On charge
le chameau fur fa boffe , ou on y fufpend des
paniers affez grands pour qu’une perfonne s’y
puiffe tenir amfe les jambes croifées, à la mode
des orientaux : c’eft dans ces paniers qu’on voiture
les femmes. On attele aufîi les chameaux pour traîner
des chars. _Ces animaux font fort dociles ; ils
obéiffent à la voix de leur maître lorfqu’il veut les
faire accroupir pour les charger ou les décharger,
8c ils fe relevent au moindre ligne ; quelquefois cependant
ils fe lèvent d’eux-mêmes lorfqu’ils fe fen-
tent furcharger, ou ils donnent des coups de tête à
ceux qui les chargent. Mais la plûpart ne jettent qu’un
cri fans fe remuer. Ces animaux ne donnent des
marques de férocité, que lorfqu’ils font en rut ; alors
ils deviennent furieux, ils ne connoiffent plus le ca•
melier, ils mordent tous ceux qu’ils rencontrent, ils fe
battent à coups de piés 8c de dents contre les autres
animaux, même contre les lions; on eft obligé de
leur mettre des mufelieres. Le tems du rut arrive au
printems, & dure quarante jours pendant lefquels
ils maigriffent beaucoup ; auffi mangent-ils moins
qu’à l’ordinaire. La femelle s’accroupit pour recevoir
le mâle ; elle entre en chaleur au printems ; elle
ne porte qu’un petit à la fois , qu’elle met bas au
printems fuivant ; & elle ne rentre en rut qu’un an
ou deux après. On coupe les mâles ponr les rendre
plus forts, & on n’en laiffe qu’un entier pour dix fe*.
melles. On prétend que les chameaux ne s’acçroupi-
roient pas d’eux-mêmes pour recevoir leur charge,
li on ne leur faifoit prendre cette habitude dans leur
jeuneffe. On ne les charge qu’à l’âge de trois ou qua-
Jome I II,
tte âns. Ort né fe feftpas d’étrillë pouf les pàrtfer; bit
les frappe feulement avec une petite baguette * pouf
faire tomber la pouffiere qui eft fur leur corps. En
Turquie, leur fumier féché au foleil, leur fert de litière
; 8c on le brûle pour faire la cuifine, lorfqu’on
le trouve au milieu des deferts. On ne met point dé
mors aux chameaux que l’on monte ; on paffe dans
la peau, au-deffus des nafeaux, une boucle qui y
relie , 8c on y attache des rênes. On ne frappe pas
ces animaux pour les faire avancer, il fuffit de chanter
ou de liftier : lorfqu’ils font en grand nombre? on
bat des tymbales. On leur attache aaffi des fonnet-
tes aux genoux, 8c une cloche au cou pour les animer
& pour avertir dans les défilés. Cet animal eft
courageux ; on le fait marcher aifément, excepté
lorfqu’il fe trouve de la terre graffe & gliffante, fur
laquelle il ne peut pas fe foûtenir, à caufe de la
pelote qu’il a fous les piés. Lorfqu’on rencontre
de ces mauvais pas , on eft obligé d’étendre des tapis
pour faire paffer les chameaux, ou d’attendre que
le chemin foit fec. On ne fait pas précifément combien
de tems vivent les chameaux ; on a dit que leur
vie étoit de cinquante ans, & quelquefois de cent;
on a même prétendu qu’elle s’étendoit jufqu’à cent
foixante. Voye[ QUADRUPEDE ; voye^ aujji P article
C ham o iseu r . (/)
C hameau , {Mat. med.') les auteurs de matières
médicale ont donné à la graiffe,.au cerveau, au
fiel, à l’urine ? & à la fiente de cet animal, toutesr
les vertus médecinales qu’ils ont obfervées dans les
mêmes matières tirées des animaux qui ont quel-
qu’analogie avec celui-ci : mais nous ne leur con-
noiffons aucune vertu particulière : aufiî ne font-
elles d’aucun ufage parmi nous; ‘
C hameau m o u c h e t é ,'*voÿe^ G iraffe.
C hameau , {Marine.') eft un grand & gros bâtiment
inventé à Amfterdam en 1688 , par le moyen
duquel on enleve un vaiffeau jufqu’à la hauteur de
cinq à fix piés, pour lé faire paffer fur des endroits
ou il n’y a pas affez d’eau- pour de gros vaiffeau y»
On a appellé cette efpece de machine, chameau, à
caufe de fa grandeur Sc de fa force. '
Pour entendre fin conftruétion & fon ufage, il
faut avoir fous les yeux la fig. a.. Plane. V. de Mar.»
où le chameau eft repréfenté enlevant un bâtiment.
La defeription qu’on en va donner , eft tirée d’un
ouvrage publié a Amfterdam en 17 19 , fur la conf-
truftion des vaiffeaux.
La conftruftion de ce bâtiment eft à plates varan*
gués ; il a cent vingt-fept piés de long, vingt-deux piés
de large par un bout, & treize piés par l ’autre bout ;
unbout a onze piés de c reux, 8c l’autre bout treize
piés ? : un des côtés de cette machine a les mêmes
façons à l’avant & à l’arriere qu’un autre vaiffeau ;
mais de l’aütre cô té, elle eft prefque droite 8c tombe
un peu en-dehors. Le fond de cale eft féparé
d’un bout à l’autre par un fronteau bien étanche, 8c.
où l ’eau ne peut paffer. Chaque côté eft auffi féparé
en quatre parties, par fronteaux auffi étanchés, fi bien
qu’il y a huit efpaces féparés l’un de l ’autre, dans
une partie defquels on peut laiffer entrer l’eau 8c
on peut la pomper dans les autres, 8c par ce moyen
tenir le chameau en équilibre. Outre cela, il y a en
chaque efpace ou retranchement, une dale bien étan*
ehée, par laquelle on y fait entrer l’eau, 8c qu’on bouche
avec un tampon. Il y a auffi deux pompes pour
pomper l ’eau qu’on y fait entrer. Il y a dans le bâ^-
riment vingt tremues qui paffent du rillac au fond
du vaiffeau, par où l’on fait paffer des cordes de
neuf pouces de circonférence, lefquelles fortent par
les trous qui font au bord de ces tremues ; & embraf-
fant la quille , vont paffer dans un autre chameau
qui eft au côté du premier. Ces cordes fe virent par
le moyen des guindeaux qui font fur le pont, au-»
ü j 4