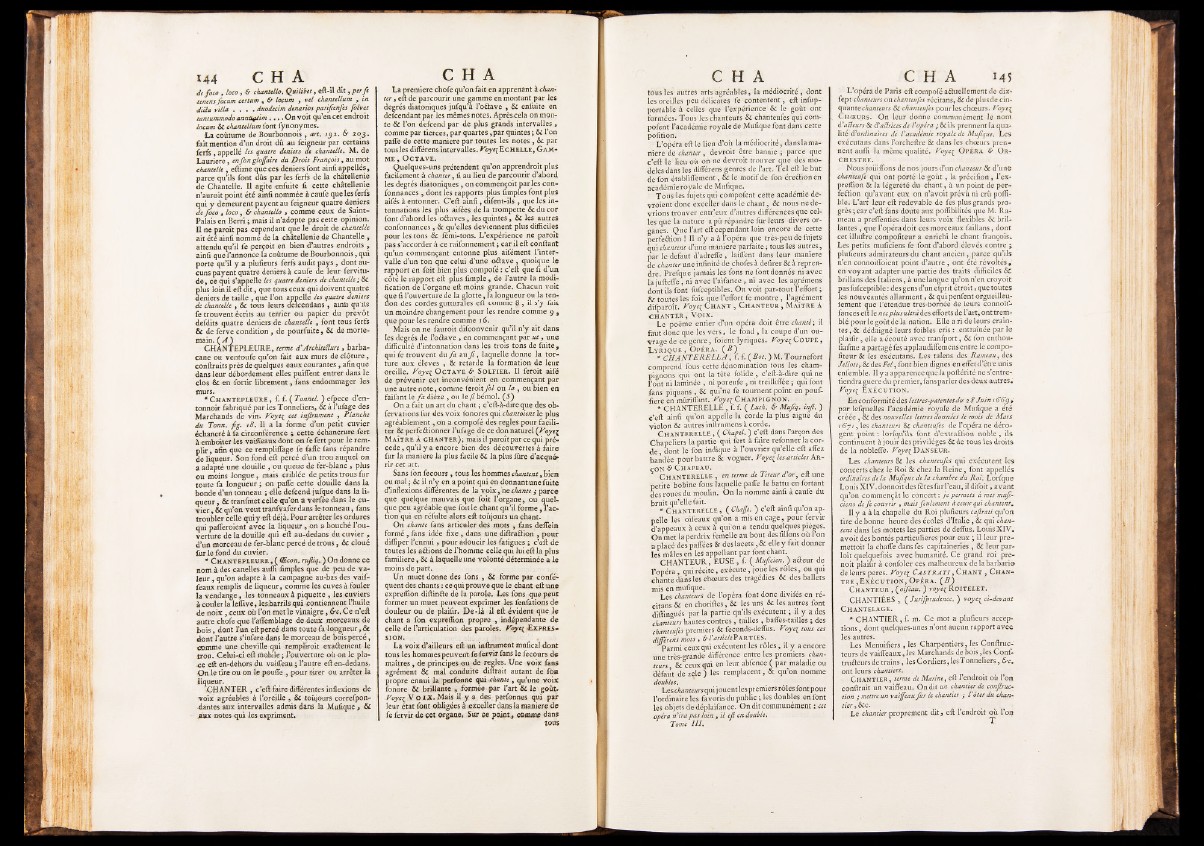
de foco , loeo, & chanttüo. Quilibct, eft-il d it , per f i
une ns focum certutti, # locutn » vtl chantellum , i/i
dicla villa . . . . duodecirn denarios parifienfis folvet
tantummodo annuçxim . . . . On voit qu’en cet endroit
locum & chantcllum font fynonymes.
L a coûtante de Bourbonnois , art. i$ z. & z 03.
fait mention d’un droit dû au feigneur par certains
ferfs , appelle les quatre deniers de chantelle. M. de
Lauriere, en fon glojfaire du Droit François, au mot
chancelle , eftime que ces deniers font ainfi appelles,
parce qu’ils font aus par les ferfs de la châtellenie
de Chantelle. 11 agite enfuite fi cette châtellenie
n’auroit point été ainfi nommée à caufe que les ferfs
qui y demeurent payent au feigneur quatre deniers
de foco , loto, & chantello , comme ceux de Saint-
Palais en Berri ; mais il n’adopte pas cette opinion.
Il ne paraît pas cependant que Je .droit de chantelle
ait été ainfi nommé de la châtellenie de Chantelle ,
attendu qu’il fe perçoit en bien d’autres endroits ,
ainfi que l’annonce la coutume de Bourbonnois, qui
porte qu’il y a plufieurs ferfs audit pays , dont aucuns
payent quatre deniers à caufe de leur fervitu-
d e , ce qui s’appelle les quatre deniers de chantelle; 8c
plus loin i l eft dit, que tous ceux qui doivent quatre
deniers de taille , que l’on appelle les quatre deniers
de chantelle , & tous leurs defeendans , ainfi qu’ils
fe trouvent écrits au terrier ou papier du prévôt
defdits quatre deniers de chantelle , font tous ferfs
& de ferve condition , de pourfuite, 8c de morte-
main. ( A )
CHANTEPLEURE, terme d.'Architecture , barba-
cane ou ventoufe qu’on fait aux murs de clôture,
conftruits près de quelques eaux courantes, afin que
dans leur débordement elles puiffent entrer dans le
clos 8c en fortir librement, fans endommager les
murs.
* Chantepleure , f. f. ( Formel. ) efpece d’entonnoir
fabriqué par les Tonneliers, 8c à l’ufage des
Marchands de vin. Voy.e[ cet inftrwnent , Planche
du Tonn. fig. 18. Il a la forme d’un petit cuvier
échancré à fa circonférence ; cette échancrure fert
à emboîter les vaiffeaux dont on fe fert pour le remplir
, afin que ce rempliffage fe faffe fans répandre
de liqueur. Son fond eft percé d’un trou auquel on
a adapté une douille , ou queue de fer-blanc , plus
©u moins longue , mais criblée de petits trous fur
toute fa longueur ; on paffe cette douille dans la
bonde d’un tonneau ; elle defcend jufque dans la liqueur
, 8c tranfmet celle qu’on a verfée dans le cuvier
, 8c qu’on veut tranfvafer dans le tonneau, fans
troubler celle q uiy eft déjà. Pour arrêter les ordures
qui pafferoient avec la liqueur , on a bouché l’ouverture
de la douille qui eft au-dedans du cuvier ,
d’un morceau de fer-blanc percé de trous, 8c cloué
fur le fond du cuvier.
* C hantepleure , ( (Scan, ruftiq.) On donne ce
nom à des eanelles aufli fimples que de peu de valeur
, qu?on adapte à la campagne au-bas des vaif-
feaux remplis de liqueur, comme les cuves à fouler
la vendange,, les tonneaux à piquette , les cuviers
à couler la leflive, lesbarrils qui contiennent l’huile
de noix ,oeux où l’on met le vinaigre, 6*c. C e n’eft
autre chofe que l’affemblage de deux morceaux de
bois, dont l’un eft percé dans toute fa longueur, 8c
dont l’autre s’iofere dans le .morçe.au de boispercé,
comme une cheville qui remplirait exactement le
trou. Celui-ci eft moteile; l’ouverture où on le plac
e eft en-dehors du vaiffeau ; l’autre eft en-dedans.
On,le tire ou on le pouffe., p our tirer ou arrêter la
liqueur.
-CHANTER , c ’eft faire différentes inflexions de
vo ix agréables à l’oreille , 8c toujours çorrefpon-
dantes aux intervalles admis dans la Mufique , 8c
dux notes qui les expriment.
La première chofe qu’on fait en apprenant à chanter
3 eft de parcourir une gamme en montant par les
degrés diatoniques jufqu’a l’o&ave , 8c enfuite en
descendant par les mêmes notes. Après cela on monte
8c l’on defcend par de plus grands intervalles ,
comme par tierces, par quartes ,par quintes ; & l’on
paffe de cette maniéré par toutes les notes, 8c par
tous les différens intervalles, Voye^ Echelle, G amme
, O c t a v e .
Quelques-uns prétendent qu’on apprendrait plus
facilement à chanter, fi au lieu de parcourir d’abord
les degrés diatoniques, oncommençoit parles con-
fonnances , dont les rapports plus fimples font plus
aifés à entonner. C’eft ainfi, difent-ils , que les in-
tonnations les plus aifées de la trompette & du cor
font d’abord les oftaves, les quintes , 8c les autres
confonnances, & qu’elles deviennent plus difficiles
pour les tons 8c fémi-tons. L ’expérience ne paraît
pas s’accorder à ce raifonnement ; car il eft confiant
qu’un commençant entonne plus aifément l’intervalle
d’un ton que celui d’une oélave, quoique le
rapport en foit bien plus compofé : c’eft que fi d’un
côté le rapport eft plus fimple, de l’autre la modification
de l’organe eft moins grande. Chacun voit
que fi l’ouverture de la glotte, la longueur ou la ten-
fion des cordes gutturales eft comme 8 , il s’y fait
un moindre changement pour les rendre comme 9 ,
que pour les rendre comme 16.
Mais on ne fauroit difconvenir qu’il n’y ait dans
les degrés de l’oélave, en commençant par u t , une
difficulté d’intonnation dans les trois tons de fuite ,
qui fe trouvent du fa au J i , laquelle donne la torture
aux éleves , & retarde la formation de leur
oreille. Voye^ O c t a v e # Solfier. Il ferait aifé
de prévenir cet inconvénient en commençant par
une autre note, comme (croitfo l ou l a , ou bien en
faifant le fa diéze , ou le/?bémol, (i")
On a fait un art du chant ; c’eft-à-direque des ob-
fervations fur des voix fonores qui chantoient le plus
agréablement, on a compofé des réglés pour faciliter
& perfeâionner l’ufage de ce don naturel (Voyez
Maîtr e à ch an ter); mais il paraît par ce qui précédé
, qu’il y a encore bien des découvertes à faire
fur la maniéré la plus facile 8c la plus fûre d’acquérir
cet art.
Sans fon fecours , tous les hommes chantent, bien
ou mal ; 8c il n’y en a point qui én donnant une fuite
d’inflexions différentes de la v o ix , ne chante ; parce
que quelque mauvais que foit l’organe, ou quelque
peu agréable que foit le chant qu’il forme, l’action
qui en réfulte alors eft toûjours un chant.
On chante fans articuler des mots , fans deffein
formé , fans idée fixe , dans une diftra&ipn , pour
diffiper l’ennui, pour adoucir les fatigues ; c’eft de
toutes les aélions de l’homme celle qui lui eft la plus
familière, 8c à laquelle une volonté déterminée a le
moins de part.
Un muet donne des fons , 8c forme par confé4
quent des chants : ce qui prouve que le chant eft une
expreffion diftinôe de la parole. Les fons que peut
former un muet peuvent exprimer les lénfations de
douleur ou de plaifir. D e - là il eft évident que Je
chant a fon expreffion propre , indépendante de
celle de l’articulation des paroles. Voye^ «Express
io n .
La voix d’ailleurs eft un inftrument mufical dont
tous les hommes peuvent fe fervir fans le fecours de
maîtres, de principes ou de réglés. Une voix fans
agrément 8c mal conduite diitrait autant de fûa
propre ennui la perfonne qui xchante , qu’une voix
fonore 8c brillante , formée par l’art & Jle goût.
Voyez;V o i x . Mais il y a des peribnnes qui par
leur état font obligées à exceller dans la maniéré de
fe fervir.de çet organe. Sur ce point., comme dans
tous
tous les autres arts agréables, la médiocrité , dont
les oreilles peu délicates fe contentent, eft infup-
portable à celles que l’expérience & le goût ont
formées. Tous les chanteurs 8c chanteufes qui corn-
pofent l’académie royale de Mufique font dans cette
pofition.
L’opéra eft le lieu d?où la médiocrité, dans la maniéréde
chanter, devrait être bannie ; parce que
c’eft le lieu où on ne devrait trouver que des modelés
dans les différens genres de l’art. T e l eft le but
de fon établiffement, & le motif de fon ére&ion en
académie royale de Mufique.
Tous les fujets qui compofent cette académie devraient
donc exceller dans le chant, 8c nous: ne devrions
trouver entr’eux d’autres différences que celles
que la nature apû répandre fur leurs divers organes.
Que l’art eft cependant loin encore de cette
perfe&ion ! Il n’y a à l’opéra que très-peu de fujets
qui chantent d’une maniéré parfaite ; tous les autres,
par le defaut d’adréffe , laiflènt dans leur maniéré
de chanter une infinité de chofes à defirer & à reprendre.
Prefque jamais les fons ne font donnés ni avec
la juftéffe ; ni avec l’aifance, ni avec les agrémens
dont ils font fufceptibïes. On voit par-tout l’effort ;
8c toutes les fois que l’effort fe montre, l’agrément
difparoît. Voye1 C hant , C hanteur , Maître à
ch an ter V o ix .
Le poëme entier d’un opéra doit être chanté ; il
faut donc que les Vérs, le fond , la coupe d’un ouvrage
de ce genre, foient lyriques. Voye{ C oupe ,
L yr iq u e , O péra. (Æ)
* CH ÀN TEREL LA , f. f. ( Bot. ) M. Tournefort
comprend fous cette dénomination tous les champignons
qui ont la tête folide , c’eft-à-dire qui ne
l’ont ni laminée , ni poreufe , ni treilliffée ; qui font
fans piquans , & quf ne fe tournent point en pôuf-
fiere en mûriffant. Voye{ C h am p ig n o n .
* CHANTERELLE, f. f. ( Luth: & Mufiq. infi. )
c’eft ainfi qu’on appelle là corde la plus aiguë du
violon 8c autres inftrumens à corde.
C hanterelle , ( Chapel. ) c’eft dans l’arçon des
Chapeliers la partie qui fert à faire refonner la corde
dont le fon indique à l’ouvrier qu’elle eft affez
bandée pour battre & voguer. Voye^ les articles A r-
ç o n # C hapeau.
C hanterelle , en terme de Tireur d'ory eft une
petite bobine fotis laquelle paffe le battu en fortant
des iSuës du moulin. On la nomme ainfi à caufe du
bruit qu’elle fait. • .
* C hanterelle , ( Chaffe. ) c eft ainfi qu on appelle
les oifeaux qtfon a mis en cage, pour fervir
d’appeaux à ceux à qui on a tendu.quelques pièges.
On met la perdrix femelle au bout des filions oit 1 on
a placé des paffées & des lacets, & elle y fait donner
les mâles en lès appellant par font chant.
■ CHANTEUR, EUSE, f. ( Muficien. ) adeur de
l’opéra , qui récite, exécute, joue les rôles, ou qui
chante dans les choeurs des tragédies & des ballets
mis en mufique.
Les chanteurs de l’opera font donc dtviles en re-
citans 8c en choriftes, 8c les tins 8c les-autres font
diftingùés par la partie qu’ils exécutent ; .il y a des
chanteurs hautes-contres , tailles , baffes-tailles ; des
chanteufes premiers & feconds-deffus. Voyc{ tous ces
différens mâts, &CarticlePa r t ie s . ., - «
Parmi ceux qui exécutent les rôles, il y a encore
une très-grande différence entre les premiers chanteurs,
& ceux qui en leur abfence ( par maladie ou
'défaut de zele ) les remplacent, & qu’on nomme
doubles. . A
Les chanteurs qui jouent les premiers rôles font pour
l’ordinaire les favoris du public ; les doubles en font
les objets de déplaifance. On dit communément : cet
opéra n'ira pas loin , il eft en double.
Tome I II.
L’ôpéra de Paris eft compofé aéhiellement de dix-
fept chanteurs ou chanteufes récitans, & de plus de cinquante
chanteurs 8c chanteufes pour les choeurs. Voye{
C hoeurs. Ort leur donne communément le nom
d’acteurs & d’actrices de l'opéra ; 8c ils prennent la qualité
d'ordinaires de l'académie royale de Mufique. Les
exécutans dans l’orcheftre & dans les choeurs prennent
auffi la même qualité. Voyeç O péra & O rch
e str e .
Nous joiiiffons de nos jours d’un chanteur & d’une
chariteufc qui ont porté le g o û t, la précifion, l’ex-
preffion & la légerété du chant, à un point de per-
feftion qu’avant eux on n’avoit prévu ni crû pofli-
ble. L’art leur eft redevable de fes plus grands progrès';
car c’eft fans doute aux poflibilités que M. Rameau
a preffenties dans leurs voix flexibles 8c brillantes
, que l’opéra doit ces morceaux faillans, dont
cet illuftre compoliteur a enrichi le chant françois.
Les petits muficiens fe font d’abord élevés contre ;
plufieurs admirateurs du chant ancien,.parce qu’ils
n’en connoiffoient point d’autre , ont été révoltés
envoyant adapter une pàrtie des traits difficiles 8c
brillans des Italiens, à une langue qu’on n’en croyoit
pas fufceptible : des gens d’un efprit étroit, que toutes
les nouveautés allarment, & qui penfent orgueilleu-
fement que l’étendue très-bornée de leurs connoif-
fances eft le necplus ultra dits efforts de l’art, ont tremblé
pour le goût de la nation. Elle a ri de leurs craintes
, & dédaigné leurs foibles cris : entraînée par le
plaifir, elle a écouté avec tranfport, 8c fon enthou-
fiafme a partagé fes applaudiffemeris entre le compo-
fiteur & les exécutans. Les talens des Rameau, des
Jeliote, 8cdes Fel, font bien dignes en effet d’être unis
enfemble. Il y a apparence que la poftérité ne s’entretiendra
guere du premier, fans parler des deux autres.'
Voye{ Ex é c u t io n .
En conformité des lettres-patentes du z8 Juin
par lefquelles l’académie royale de Mufique a été
créée, & des nouvelles lettres données le mois de Mars
7 67/, les chanteurs 8c chanteufes de l’opéra ne dérogent
point : lorfqu’ils font d’extraôion noble, ils
continuent à jouir des privilèges & d e tous les droits
de la nobleffe. Voye%_ D anseur.
Les chanteurs 8c les chanteufes qui exécutent les
concerts chez le Roi & chez la Reine, font appelles
ordinaires de la Mufique de la chambre du Roi. Lorfque
Louis XIV. donnoit des fêtes fur l’eau, il difoit, avant
qu’on commençât le concert : je permets à mes muficiens
de fe couvrir , mais feulement à ceux qui chantent.
Il y a à la chapelle du Roi plufieurs cafirati qu’on
tire de bonne heure des écoles d’Italie, & qui chantent
dans les motets les parties de deffus. Louis XIV.
avoif des bontés particulières pour eux ; il leur pre-
mêttoit la chaffe dans fes capitaineries , 8c leur par-
loit quelquefois avec humanité. Ce grand roi pre-
noit plaifir à confoler ces malheureux de la barbarie
de leurs peres. Voye£ Ca s t r a t i , C hant , C han-,
t r e , Ex é c u t io n , O p ér a . ( B )
C hanteur ,{oifiau.') voye^ Ro ite l e t .
CHANTIÉES , ( Jurifprudence. ) voye^ ci-devant
C hantelage.
* CHANTIER, f. m. Ce mot a plufieurs acceptions,
dont quelques-unes n’ont aucun rapport avec
les autres.
Les Menuifiers , les Charpentiers, les Conftruc-
teurs de vaiffeaux, les Marchands de bois, les Conf-
truâeurs de trains, les Cordiers, les Tonneliers, &c.
ont leurs chantiers.
_ C hantier , terme de Marine, eft l’endroit où l’on
conftruit un vaiffeau. On dit un chantier de conftruc-
tion ; mettre un vaiffeau fur le chantier ; Voter du chantier
, 8cc. _ .
Le chantier proprement dit, eft l’endroit où l’on