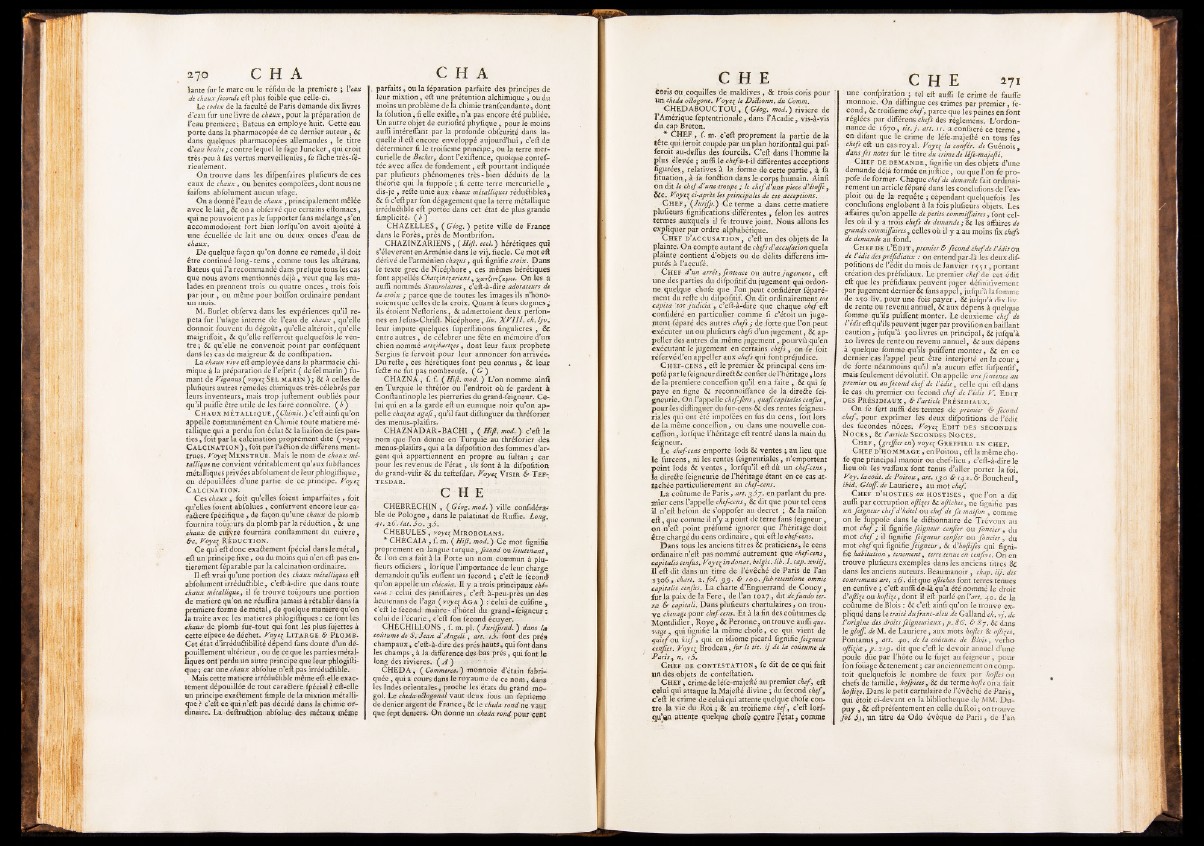
îante fur le marc ou le réfidu de la première ; Veau
de chaux fécondé eft plus foible que celle-ci.
Le codex de la faculté de Paris demande dix livres
d’eau fur une livre de chaux, pour la préparation de
l’eau première; Bateus en employé huit. Cette eau
porte dans la pharmacopée de ce dernier auteur, &
dans quelques pharmacopées allemandes , le titre
d'eau béni te; contre lequel le fage Juncker, qui croit
très-peu à fes vertus merveilleufes, fe fâche très-fé-
rieufement.
On trouve dans les difpenfaires plufieurs de ces
eaux de chaux, ou benites compofées, dont nous ne
faifons abfolument aucun ufage.
On a donné l’eau de chaux, principalement mêlée
avec le la it , & on a obfervé que certains eftomacs,
qui ne pouvoient pas le fupporter fans mélange, s’en
accommodoient fort bien îorfqu’on avoit ajouté à
tme écuellée de lait une ou deux onces d’eau de
chaux.
De quelque façon qu’on donne ce remede, il doit
être continué long-tems , comme tous les altérans.
Bateus qui l ’a recommandé dans prefque tous les cas
que nous avons mentionnés déjà, veut que les raà-?
lades en prennent trois ou quatre onces, trois fois
par jour, ou même pour boiffon ordinaire pendant
un mois.
M. Burlet obferva dans les expériences qu’il répéta
fur l ’ufage interne de l’eau de chaux, qu’elle
donnoit fouvent du dégoût, qu’elle altéroit, qu’elle
maigriffoir, & qu’elle refferroit quelquefois le ventre
; & qu’elle ne convenoit point par conféquent
dans les cas de maigreur & de conftipation.
La chaux vive eft employée dans la pharmacie chimique
à la préparation de l’efprit ( de fel marin ) fumant
de Figanus{ vaye^SEL marin ) ; & à celles de
plufieurs autres remedes chimiques très-célebrés par
leurs inventeurs, mais trop juftement oubliés pour
qu’il puiffe être utile de les. faire connoître. ( b )
C haux m é t a l l iq u e , (Chimie.') c’eft ainfiqu’on
appelle communément en Chimie toute matière métallique
qui a perdu fon éclat & la liaifon de fes parties
, foit par la calcination proprement dite ( voye%
C a l c in a t io n ) , foit par l’a&ion de différens menl-
trues. Voyc^ MENSTRUE. Mais le nom de chaux métallique
ne convient véritablement qu’aux fubftances
métalliques privées abfolument de leur phlogiftique,
ou dépouillées d’une partie de ce principe. Foye^
C a l c in a t io n .
Ces chaux, foit qu’elles foient imparfaites , foit
qu’ elles foient abfolues , confervent encore leur ca-
raûere fpécifique, de façon qu’une chaux de plomb
fournira toujours du plomb par la réduftion , & une
chaux de cUÿŸte fournira conftamment du cuivre,
&c. Voye^. Ré d u c t io n .
Ce qui eft’donc exactement fpécial dans le métal,
eft un principe fixe, ou du moins qui n’en eft pas entièrement
féparable par la calcination ordinaire.
Il eft vrai qu’une portion des chaux métalliques eft
abfolument irrédu&ible, c’eft-à-dire que dans toute
chaux métallique, il fe trouve toujours une portion
de matière qu’on ne réuftira jamais à rétablir dans fa
première forme de métal, de quelque maniéré qu’on
la traite avec les matières phlogiftiques : ce font les
chaux de plomb fur-tout qui font les plus fu jettes à
cette efpece de déchet. Foye^ Lit a r g e & Plom b .
Cet état d’irréduâibilité dépend fans doute d’un dépouillement
ultérieur, ou de ce que les parties métalliques
ont perdu un aiitre principe que leur phlogiftique;
car une chaux abfolue n’eft pas irrédu&ible.
Mais cette matière irréductible même eft-elle exactement
dépouillée de tout caraéteré fpécial? eft-elle
un principe exaftement fimple de la mixtion métallique
? c’eft ce qui n’eft pas décidé dans la chimie ordinaire.
La deftru&ion abfolue des métaux même
, parfaits, ou la féparation parfaite des principes de
leur mixtion, eft une prétention alchimique , ou du
moins un problème de la chimie tranfcendante, dont
la folution, fi elle exifte, n’a pas encore été publiée.
Un autre objet de curiofité phyfique, pour le moins
aufti intéreffant par la profonde obfcurité dans laquelle
il eft encore enveloppé aujourd’hui, c’eft de
déterminer fi le troifieme principe, ou la terre mercurielle
de Becher, dont l’exiftence, quoique contef-
tée avec affez de fondement, eft pourtant indiquée
par plufieurs phénomènes très - bien déduits de la
théorie qui la fuppofe ; fi cette terre mercurielle ,
dis-je , refte unie aux-chaux métalliques réductibles,
& fi c’eft par fon dégagement que la terre métallique
irréductible eft portée dans cet état de plus grande
fimplicîté. (£ )
CHAZELLES, ( Géog. ) petite ville de France
dans le Forés, près de Montbrifon.
CHAZINZARIENS, ( Hifi. eccl.) hérétiques qui
s’élevèrent en Arménie dans le vij. fiecle. Ce mot eft
dérivé de l’arménien chaçus, qui fignifie croix. Dans
le texte grec de Nicéphore , ces mêmes hérétiques
font appeilés Chatçint^ariens, x et'TÇtv'rKaLŸt0,‘ On les a
aufti nommés Staurolatres, c’eft-à-dire adorateurs de
la croix ; parce que de toutes les images ils n’hono»
roientque celles de la croix. Quant à leurs dogmes,'
ils étoient Nefloriens, & admettoient deux perfon-,
nés en Jefus-Chrift. Nicéphore, liv. 3CFII1. ch. Ijvé
leur impute quelques fuperftitions fingulieres , ÔC
entre autres , de célébrer une fête en mémoire d’un
chien nommé artfibart^es, dont leur faux prophète
Sergius fe fervoit pour leur annoncer fon arrivée.
Du refte, ces hérétiques font peu connus , & leur
feCte ne fut pas nombreufe. ( G )
CHAZNA , f. f. {Hifi. mod. ) L’on nomme ainfi
en Turquie le thréfor ou l’endroit oii fe gardent à
Conftantinople les pierreries du grand-feigneur. Celui
qui en a la garde eft un eunuque noir qu’on appelle
chaîna agafi, qu’il faut diftinguer du thréforier.
des menus-plaifirs.
CHAZN ADAR - B ACHI , ( Hifi. mod. ) c’eft le
nom que l’on donne en Turquie au thréforier des
menus-plaifirs, qui a la difpofition des fommes d’argent
qui appartiennent en propre au fultan ; car
pour les revenus de l’é ta t , ils font à la difpofition
du grand-vifir & du teftefdar. Foye^ V isir 6* T ef-
TESDAR.
C H E
CHEBRECHIN , ( Géog. mod. ) ville eonfidéra-
ble de Pologne, dans le palatinat de Ruflie. Long.
4 1 . 2 6 . la t . 3.o r . 3 6 .
CHEBULES i 'voyei Mirobo lans.
* CHÉCAIA, f. m. {Hifi. mod.') Ce mot fignifie
proprement en langue turque,r fécond ou lieutenant,
& l’on en a fait à la Porte un nom commun à plufieurs
officiers , lorfque l’importance de leur charge
demandoit qu’ils euflent un fécond ; c’eft le fecontl
qu’on appelle un chècaia. Il y a trois principaux ché-
caia : celui des janiffaires, c’eft à-peu-près un des
lieutenans dç l’aga ( voyeç A ga ) : celui de cuifine ,
c’eft le fécond maître - d’hôtel du grand-fpigneur;
celui de l’écurie, c’eft fon fécond écuyer.
CHÉCHILLONS , f. m. pl. (jJurifprud. ) dans la
coutume de S. Jean d'Angeli, art. iS. font des prés
champaux, ç’eft-à-dire des prés haüts, qui font dans
les champs, à la différence des bas prés, qui font le
long des rivières.1 ( A )
CH ED A , ( Commerce. ) mônnoie d’étain fabriquée
, qui a cours dans le royaume de ce nom, dans
les Indes .orientâtes-, proche les états du grand mo-
gol. Le cheda>oclogonal vaut deux fous un fëptiême
de denier argent de France, & le ckeda rond ne vaut
que fept deniers. On donne un ckeda rond, pour cent
fcoris ou, coquilles de maldives , & trois coris pour
Un cheda octogone. Voye{ le Diclionn, du Comm.
CH EDABOUCTOU, ( Géog. mod. ) riviere de
l ’Amérique feptentrionate;, dans l’Acadie, vis-à-vis
du cap Breton.
* CHEF, f. m. c’eft proprement la partie de la
tête qui feroit coupée par un plan horifontal qui paf-
feroit au-deftus des fourcils. C ’eft dans l ’homme la
plus élevée ; auflUe cA^a-t-ii différentes acceptions
figurées., relatives à la .forme de cette partie, à fa
fituation, à fa fonâion dans le corps humain. Ainfi
on dit. le chej^ d'une troupe ; le chef d'une piece d'étoffe ,
& c . Fpÿt{ ci-aprïs lesprincipales de ces acceptions.
C hef., '{Jurijp.) C e terme a dans, cette matière
plufieurs lignifications ^différentes , félon les autres
termes auxquels il.fe,trouve joint. Nous allons les
expliquer par ordre alphabétique.
C hef d’a c cu s a t io n , c’eft un des objets de la
plaintev On Compte autant de chefs d'accufation que la
plainte contient d’objets ou de délits differens imputés
à l’açcufé.
C hef d'un arrêt, fentence ou autre jugement, eft
une des parties du difppfitif du jugement qui ordonne
quelque chofe que l’on peut confidérer féparé-
ment du refte du dilpofitif. .On dit ordinairement tôt
cdpita tôt judicia , c’eft-à-dire que chaque chefeû
confidéré en particulier comme fi c’étoitun jugement
féparé des autres chefs ; de forte que l’onpeut
exécuter un ou, plufieurs chefs d’un jugement, & app
e lle r a s autres du même jugement ,,pourvû qu’en
exécutant le jugement en certains, chefs, on fe foit
téfervéd’en appeller aux chefs qui fontpréjudice.
C hef- cens , eft le premier & principal cens im-
pofé par le feigneur direft & cenfier de l’héritage, lors
de la première conceffion qu?il en a faite , & qui fe
paye en ligne & reconnoiffance de la direfte fei-
gneurie. On l’appelle chef-fens, quaficapitales cenfus,
pour les diftinguer du fur-çens & des rentes feigneu-
riales qui ont été impofées en fus du cens, foit lors
de ja même conceffion , ou dans une nouvelle con-
ceflion , lorfque l’héritage eft rentré dans la main du
feigneur.
Le chef-cens emporte lods & ventes ; au lieu que
le furcens, ni les rentes feigneuriales, n’emportent
point lods & ventes, lorfqu’il eft dû un chef-cens ,
la direfte.feigneurie de l’héritage étant en ce cas attachée
particulièrement au chef-cens.
La coûtume de Paris, art.3 5y . en parlant du premier
cens l’appelle chef cens, & dit que pour telcens
il n’eft befoin de s’oppofer au decret ; & la raifon
e f t , que comme il n’y a point de terre fans feigneur,
on n’eft point préfumé ignorer que l’héritage doit
être.chargé du cens ordinaire, qui eft le chef-cens.
Dans tops les anciens titres & praticiens, le cens
ordinaire n’eft pas nommé autrement que chef-cens,
capitaliscenfus. Voye^indonat.belgic. lib. I. cap. xviij.
Il eft dit dans un titre de l’évêché de Paris de l’an
3306, chart. 2. fol. g g . & ioo . fub retentione omnis
capitalis cerf us. La charte d’Enguerrand de C o u cy ,
fur la paix de la Fere, de l’an 10x7, dit defundo terra
& capital. Dans plufieurs ehartulaires, on trouv
e chevage pour chef-cens. Et à la fin des coûtumes de
Montdidier, R o y e , & Peronne , on trouve auffi que-
yage, qui fignifie la même chofe, ce qui vient de
quiefon ki.ef, qui en idiome picard fignifie feigneur
certifier. Voye{ Brodeau ,fur le tit. ij de la coûtume de
1Paris, n. iâ.
C h!ef de co n t e s t a t io n , fe dit de ce qui fait
tin des.objets de conteftation.
C h e f , crime de léfe-majefté au premier chef, eft
celui qui attaque la.Majefté divine ; du fécond chef,
c’eft le crime de celui qui attente quelque chofe contre
la vie du ,Roi .; & au troifieme chef, c’eft lorf-
qu’«n attente quelque chofe contre l’état, comme
une confpiration ; tel eft auffi le crime de fauffe
monrioie. On diftingue ces crimes par premier, fécond
, & troifieme chef » parce que les peines en font
réglées par différens chefs des réglemens. L’ordonnance
de 1670, tit .j. art. 11. a confacré ce terme ,
en difant que le crime de léfe-majefté en tous fes
chefs eft un cas1.royal. V ?ye^ la confér. de Guénois ,
dans fes notes fur le titre du crime de llfe-majefié.
C hef de demande, fignifie un des objets d’une
demande déjà formée en juftice, ou que l’on fe pro-
pofe déformer. Chaque chef de demande fait ordinairement
un article féparé dans les conclufions de l’exploit
ou de la requête ; cependant quelquefois les
conclufions englobent à la rois plufieurs objets. Les
affaires qu’on appelle de petits commiffaires, font celles
oii il y a trois chefs de demande ; & les affaires de
grands commiffaires, celles où il y a au moins fix chefs
de demande au fond.
C H EE DE l’Ed it , premier & fécond chef de l'édit ou
de Védit des préfidiaux : on entend par-là les deux dif-
pofitions de l’édit du mois de Janvier 15 5 1 , portant
création des préfidiaux. Le premier chef de cet édit
eft que les préfidiaux peuvent juger définitivement
par jugement dernier & fans appel, jufqu’à lafomme
de 250 liv. pour une fois payer , & jufqu’à dix liv.
de rente ou revenu annuel, & aux dépens à quelque
fomme qu’ils puîffent monter. Le deuxieme chef de
l'édit eft qu’ils peuvent juger par provifion en baillant
caution , jufqu’à 500livres en principal, & jufqu’à
xo livres de rente ou revenu annuel, & aux dépens
.à quelque fomme qu’ils puiffent monter, & en ce
dernier cas l’appel peut être interjetté en la cour ;
de forte néanmoins qu’il n’a aucun effet fufpenfif,
mais feulement dévolutif. On appelle une fentence au
premier ou au fécond chef de l'édit, celle qui eft dans
le cas du premier ou fécond chef.de l'édit F . Ed it
des Pr ésid iau x , & l'article Prés id iau x .
On fe fert auffi des termes de premier & fécond
chef, pour exprimer les deux difpofitions de l’édit
des fécondés noces: Foye{ E d it des secondes
N o c e s , & rl'article Secondes No ce s .
C h e f , {greffier en) voye^ GREFFIER EN CHEF.
C hef d’h om m ag e , en Poitou, eft la même chofe
que principal manoir ou chef-lieu, c’eft-à-dire le
lieu où les vaffaux font tenus d’aller porter la foi.
Foy. lacôât. de Poitou, art. 130 & 142. & Boucheu!
ibid. Gloff. de Lauriere, au mot chef.
C hef d’hosties ou ho stises , que l’on a dit
auffi par corruption offices & (fiches, ne fignifie pas
un feigneur chef d'hôtel ou chefde fa maifon , comme
on le fuppofe dans le diâionnaire de Trévoux au
mot chef ; il fignifie feigneur cenfier ou foncier , du
mot chef ; il fignifie feigneur cenfier ou foncier , du
mot chef qui fignifie feigneur, & d'hofiifes qui fignifie
habitation , tenement, terre tenue en cenfive. On en
trouve plufieurs exemples dans les anciens titres &
dans les anciens auteurs. Beaumanoir, chap. iij. des
contremans art. 26. dit que affiches font terres tenues
en cenfive ; c’eft auffi de-là qu’a été nommé le droit
à'office ou hofii^e, dont il eft parlé en Vart. 40. de la
coûtume de Blois : & c’eft ainfi qu’on le trouve expliqué
dans le traité dufranc-aleu de Galland ch. vj. de
l'origine des droits feigneuriaux, p. 86. & 87, & dans
le gloff. de M. de Lauriere, aux mots hofies & offices.
Pontanus, art. 40. de la coûtume de Blois, verbo
ojlifue, p. 21C). dit que c’eft le devoir annuel d’uné
poule dûe par l’hôte ou le fujet au feigneur, pour
fon foiiage & tenement ; car anciennement on comp-
toit quelquefois le nombre de feux par hofies ou
chefs de famille, hofpites, & du termehofie on a fait
hofliçe. Dans le petit cartulaire de l’évêché de Paris ,
qui étoit ci-devant en la bibliothèque de MM. Du-
puy , & eft préfentement en celle duRoi ; on trouve
fo l 3/. un titre de Odo évêque de Paris, de l’an