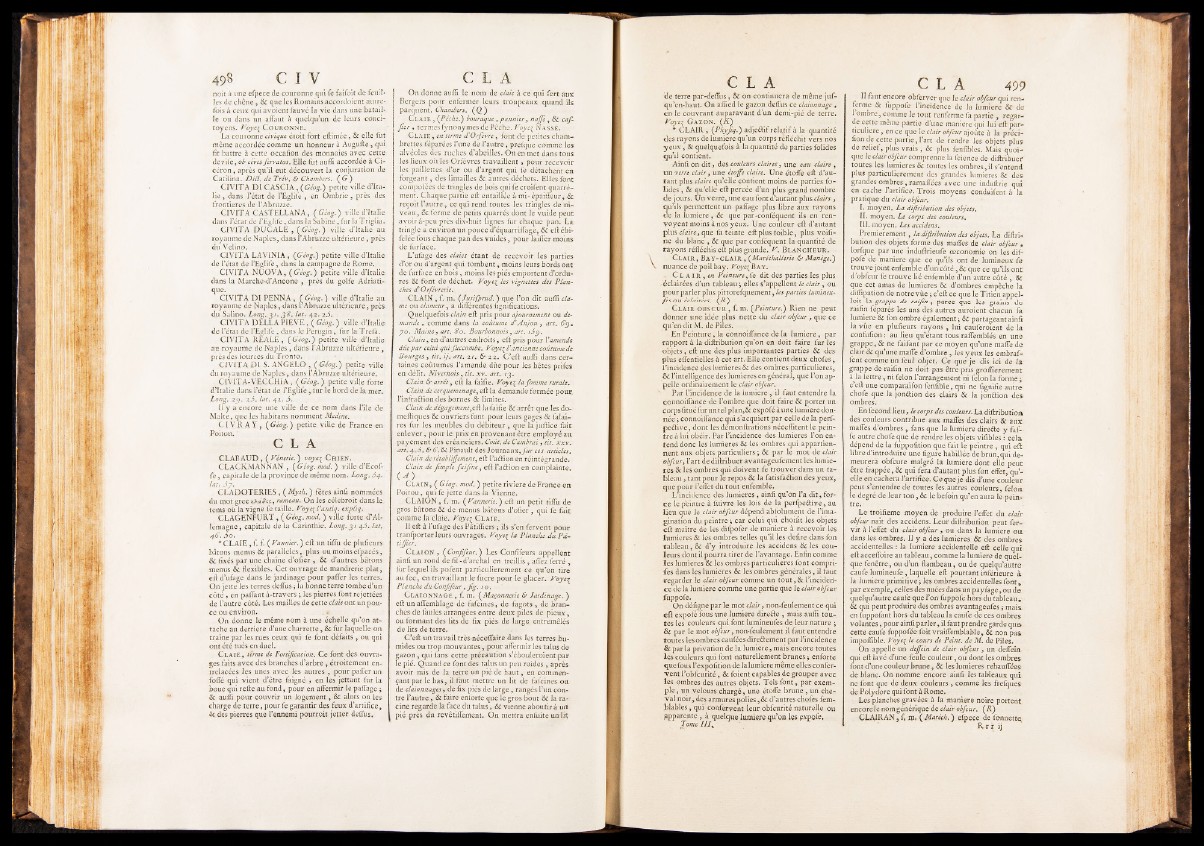
l i i f i i i H llSKflill
p l | p |
i l i i I I P 1 K ' i
U i i i s i | i | l | M |
f i n i ' H I IS
noit à une efpece de couronne qui fe faifoit de feuilles
de chêne, 6c que les Romains accordoient autrefois
à ceux qui avoient fauve la vie dans une bataille
ou dans un affaut à quelqu’un de leurs concitoyens.
Voyt^ C ouronne.
La couronne civique ésoit fort eftimée, & elle fut
même accordée comme un honneur à Augufte , qui
. fit battre à cette occafion des monnoies avec cette
devife, ob cives fervatos. Elle fut auffi accordée à Cicéron
, après qu’il eut découvert la conjuration de
Catilina. Dict. de Triv. & Chambers. { G )
CIVITA DI CA SC IA , {Gèog.) petite ville d’Italie
, dans l’état de l’Eglife, en Ombrie, près des
frontières de l’Abruzze.
CIVITA CASTELLANA, ( Gèog.) ville d’ Italie
dans l’état de l’Eglife, dans la Sabine, fur la Triglia.
CIVITA DUCALE , ( Gèog, ) ville d’Italie au
royaume de Naples, dans l’Abruzze ultérieure, près
du Velino.
CIVITA LAVINIA, {Gèog.') petite ville d’Italie
de l’état de l’Eglife, dans la campagne de Rome.
CIVITA NUOVA, {Gèog. ) petite ville d’Italie<
dans la Marche-d’Ancône , près du golfe Adriatique.
CIVITA DI PENNA, {Gèog.) ville d’Italie au.
royaume de Naples, dans l’Abruzze ultérieure, près
du Salino. Long. 3 / . 38. lat. 42. %5.
CIVITA DELLA PIE V E , ( Gèog. ) ville d’Italie
de l’état de l’Eglife, dans le Perugin, fur la Trefâ.
CIVITA REA LE, {Gèog.) petite ville d’Italie
au royaume de Naples , dans l’Abruzze ultérieure,
près des fources du Tronto. .
CIVITA D l S. ANGELO , ( Gèog.) petite ville
du royaume de Naples, dans l’Âbruzze ultérieure.
C 1VITA-VECCHIA , ( Gèog. ) petite ville forte
d’Italie dans l’état de l’Eglife, iur le bord de la mer.
Long. 23». 25. lat. 42. 6..
II y a encore une ville de ce nom dans Pîle de
Malte, que les habitans nomment Medine.
C IV R A Y , ( Gèog. ) petite ville de France en
Poitou. ‘
C L A
CLABÀUD, {Vénerie.) voyeç CHIEN.
CLACKMANNAN , ( Gèog. mod. ) ville d’Ecof-
f e , capitale de la province de même nom. Long. 64.
lat. Sy. ■ \ .
CLADOTERIES , ( Myth, ) fêtes ainfi nommées
du mot grec nxàS'oç, rameau. On les célebroit dans le,
tems où la vigne fe taille. Voye^L'antiq. expliq.
CLAGENFURT, ( Gèog. mod. ) ville forte d’Allemagne
, capitale de la Çarinthie. Long. 3 / 46. lat.
46'. 5o.
* CLAIE, f. f. ( Vannier. ) eft un tiflù de plulîeurs
bâtons menus 6c parallèles, plus ou moins efpacés,
& fixés par une chaîne d’ofier , 6c d’autres bâtons
menus 6c flexibles. Cet ouvrage de mandrerie plat,
eft d’ufage dans le jardinage pour paffer les terres.
On jette les terres deffus ; la bonne terre tombe d’un
cô té , en paffant à-travers ; les pierres font rejettées
de l’autre côté. Les mailles de cette claie ont un pouce
ou environ. . ♦
On donne le même nom à une échelle qu’on attache
au derrière d’une charrette, 6c fur laquelle on
traîne par les rues ceux qui fe font défaits , ou qui
ont été tués en duel.
C laie, ttrme de Fortification. Ce font des ouvrages
faits avec des branches d’arbre, étroitement entrelacées
les unes avec les autres , pour paffer un
foffé qui vient d’être faigné , en les jettant fur la
boue qui refte au fond » pour en affermir le paffage ;
& suffi pour couvrir un logement, 6c alors on les
charge de terre, pour fe garantir des feux d’artifice,
& des pierres que l’ennemi pourroit jetter deffus.
On donne auffi le nom de claie à ce qui fert aux
Bergers pour enfermer leurs troupeaux quand ils
parquent. Chambers. {Q )
Claie , {Pêche.) bouraque , pannier, naffe, 6c caf-
fie r , termes fynonymes de Pêche. Voye{ Nasse.
Claie , en terme d’Orfévre, font de petites cham-
brettes féparées l’une de l’autre, prefquê comme les
alvéoles des ruches d’abeilles. On en met dans tous
les lieux où les Orfèvres travaillent, pour recevoir
les paillettes d’or ou d’argent qui fe détachent en
forgeant, des limailles 6c autres déchets. Elles font
compofées de tringles de bois qui fe croifent quarré-
ment. Chaque partie eft entaillée à mi-épaiffeur, &
reçoit l’autre, ce qui rend toutes les tringles de niveau,
6c forme de petits quarrés dont le vuide peut
avoir à-peu près dix-huit lignes fur chaque pan. La
tringle a environ un pouce d’équarriffage, 6c eft ébi-
felée fous chaque pan des vuides, pour laiffer moins
de furface.
L’ufage des claies étant de recevoir les parties
d’or ou d’argent qui tombent, moins leurs bords ont
de furface en bois, moins les piés emportent d’ordures
6c font de déchet. Voye^ les vignettes des Planches
d’orfèvrerie.
CLAIN , f. m. {Jurifprud. ) que l’on dit auffi clame
ou clameur, a différentes lignifications.
Quelquefois.clain eft pris pour ajournement ou demande
y comme dans la coutume d'Anjou, art. 60.
yo. Maine, art. 80. Bourbonnois , art. i5g .
Clain, en d’autres endroits, eft pris pour Y amende
due par celui qui fuccombe. Voye[ l'ancienne coutume de
Bourges, tit. ij. art. 21. & 22. G’eft auffi dans certaines
coutumes l’amende due pour les bêtes prifes
en délit. Nivernais, tit. xv. art.113* .
Clain & arrêt,, eft la faifie. Voye[ la fomme rurale.
Clain. de cerquemenage, eft la demande formée pour,
l’infraûion des bornes & limites.
Clain de dégagement,eft la faifie & arrêt que les do-
meftiques & ouvriers font pour leurs gages & falai-
res fur les meubles du débiteur , que la juftice fait
enlever, pour le prix en provenant être employé au
payement des créanciers. Coût, de Cambrai, tit. xxv.
art. 4., J; &C.6c Pinault des Journaux,/«/- ces articles.
Clain de rètablifjement, eft l’aôion en réintégrande.
Clain de (impie faijîne, eft Faction en complainte.
Clain, ( Geog. mod. ) petite riviere de France en
Poitou, qui fe jette dans la Vienne.
. CLAION, f. m. {^Vannerie.) .eft un petit tiffu de
gros bâtons 6c de menus bâtons d’ofier , qui fe fait
comme la claie. Voye^ Claie.
Il eft à l’ufage des Pâtiffiers ; ils s’en fervent pour
tranfporterleurs ouvrages. Voye{ la Planche du P a-
. vv.-y ■:
Claion , {Confifeur.) Les Confifeurs appellent
ainfi un rond de fil-d’archal en treillis, allez ferré ,
fur lequel ils pofent particulièrement ce qu’on tire
au fec, en travaillant le fucre pour le glacer. Voye£
Planche du Confifeur, fig. 1.0.
C laionnage , f. m. {Maçonnerie & Jardinage. )
eft un affemblage de fafeines, de fagots , de branches
de faules arrangées entre deux piles de pieux ,
ou formant des lits de fix piés de large entremêlés
de lits de terre.
C ’eft un travail très-néceffaire dans les terres humides
ou trop mouvantes, pour affermir les talus de
gazon, qui fans cette précaution s’ébouleroient par
le pié. Quand ce font des talus un peu roides , après
avoir mis de la terre un pié de haut, en commençant
par le bas,, il faut mettre un lit de fafeines ou
de claionnages, de fix piés de large, rangés l’un contre
l’autre, & faire enforte que le gros bout 6c la racine
regarde la face du talus, & vienne aboutir à un
pié près du revêtiffement. On mettra enfuite un lit;
de terre par-deffus, & on continuera de même jùf-
qu’en-haut. On affied le gazon deffus. ce claionnage ,
en le couvrant auparavant d’un demi-pié de terre.
Voyei G a zo n . (À)
* CLAIR , {Phyfîq.) adjettif relatif à la quantité
des rayons de lumière qu’un edrps réfléchit vers nos
y e u x , & quelquefois à la quantité de parties folides
qu’il contient.
Ainfi on dit, des couleurs claires, une eau claire ,
un verre clair, une étoffe claire. Une étoffe eft d’autant
plus claire qu’elle contient moins de parties folides
, & qu’elle eft percée d’un plus grand nombre
de jours. Un verre, une eau font d’autant plus clairs.,
qu’ils permettent un paffage plus libre aux rayons
de la lumière , & que par-conféquent ils en ren-
voyent moins à nos yeux. Une couleur eft d’autant
plus claire, que fa teinte eft plus foible, plus voifi-
ne du blanc , 6c que par conféquent la quantité de
rayons réfléchis ëft plus grande. V. Blancheu r.
C l a ir , Ba Y-CLAIR , {Maréchdllerie & Manège.)
nuance de poil bay. Voye^Ea y .
- C l a i r , « Peinture, fe dit des parties les plus
/éclairées d’un tableau ; elles s’appellent le clair, ou
pour parier plus pittorefquement, les parties lumineu-
fes ou éclairées. {R)
C lair o bscu r , f. m. {Peinture.) Rien ne peut
donner une idée plus nette du clair obfcur , que ce
qu’en dit M. de Piles.
En Peinture, la connoiffance de la lumière, par
rapport à la diftribution qu’on en doit faire fur les
objets, eft une des plus importantes parties & des
plus effentielles à cet art. Elle contient deux chofes,
l’incidence des lumières & des ombres particulières,
6c l’intelligence des lumières en général, que l ’on appelle
ordinairement le clair obfcur.
Par l’incidence de la lumière , il faut entendre la
connoiffance de l’ombre que doit faire & porter un
corps fitué fur un tel plan,& expofé à une lumière donnée
; connoiffance qui s’acquiert par celle de la perf-
pe&ive, dont les demonftrations néceffitent le peintre
à lui obéir. Par l’incidence des lumières l’on entend
donc les lumières 6c les ombres qui appartiennent
aux objets particuliers; 6c par le mot de clair
obfcur, l’art dediftribuer avantageufement les lumières
& les ombres qui doivent fe trouver dans un tableau
, tant pour le repos 6c la fatisfaâion des yeux,
que poiir l’effet du tout enfemble.
L’incidence des lumières, ainfi qu’on l’a dit, force
le p'bintre à fuivre les lois de la perfpeftive, au
lieu que le clair obfcur dépend abfolument de l’ima-.
gination du peintre ; car celui qui choifit les objets
eft maître de les difpofer de maniéré à recevoir les
lumières & les ombres telles qu’il les defire dans fon
tableau, & d’y introduire les accidens 6ç les couleurs
dont il pourra tirer de l’avantage. Enfin comme
les lumières 6c les ombres particulières font compri-
fes dans les lumières 6c les ombres générales, il faut
regarder le clair obfcur comme un tout, & l’incideri-
ce de la lumière comiùe une partie que le clair objeur
fuppofe.
On défignè par le mot clair, non-feulement ce qui
eft expofé fous une lumière direûe , mais auffi toutes
lès couleurs qui font lumineufes de leur nature ;
6c par le mot obfcur, non-feulement il faut entendre
toutes les ombres caufées direâement par l’incidence
& par la privation de la lumière, mais encore toutes
les couleurs qui font naturellement brunes ; enforte
que fous l’expofition de la lumière même elles confer-
vent l’obfcurité, & foient capables de grouper avec
les ombres des autres objets. Tels font, par exemple,
un velours chargé, une étoffe brune , un cher
val noir, des armures polies ,6c d’autres chofes fem-
blables, qui confervent leur obfcurité naturelle ou
apparente, à quelque lumière qu’on les expofe,
Tome IIJ%
Il faut encore obferver que le clair obfcur qui renferme
& fuppofe l’incidence de la lumière & de
1 ombre, comme le tout renferme fa partie , regarde
cette même partie d’une maniéré qui lui eft particulière
, en ce que le clair obfcur ajoute à la préci-
fion de cette partie, l’art de rendre les objets plus
de relief, plus vrais , & plus fenfibles. Mais quoique
le clair obfcur comprenne la fcience de diftribuer
toutes les lumières 6c toutes les ombres,il s’entend
plus particulièrement des grandes lumières 6c des
grandes ombres, ramaffées avec une induftrie qui
en cache l’artifice. Trois moyens conduifent à la
pratique du clair obfcur.
I. moyen. La difiribution des objets.
II. moyen. Le corps des couleurs.
III. moyen. Les accidens.
Premièrement, la difiribution des objets. La diftribution
des objets forme des maffes de clair obfcur ,
lorfque par une induftrieufe oeconomie on les dif-
pofe de maniéré que ce qu’ils ont de lumineux fe
trouve joint enfemble d’un côté, 6c que ce qu’ils ont
d’obfcur fe trouve lié enfemble d’un autre côté , &
que cet amas de lumières 6c d’ombres empêche la
diffipation de notre vue ; c’eft: ce que le Titien appel-
loit la grappe de raijin,. parce que les grains de
raifin féparés les uns des autres auroient chacun fa
lumière 6c fon ombre également ; 6c partageant ainfi
la vue en plufieurs rayons , lui cauferoient de la
confufion : au lieu qu’étant tous raffemblés en une
grappe, & ne faifant par ce moyen qu’une maffe de
clair 6c qu’une maffe d’ombre, les yeux les embraf-
fent comme un feuI objet. Ce que je dis ici de la
grappe de raifin ne doit pas être pris groffierement à la lettre, ni félon l’arrangement ni félon la forme ;
c’eft une comparaifon fenfible, qui ne fignifie autre
chofe que la jonâion des clairs & la jonftion des
ombres. .
En fécond lieu, le corps des couleurs. La diftribution
des couleurs contribue aux maffes des clairs & aux
maffes d’ombres , fans que la lumière direéle y faft"
fe autre chofe que de rendre les objets vifibles : cela
dépend de la fuppofition que- fait le peintre , qui eft:
libre d’introduire une figure habillée de brun, qui demeurera
obfcure malgré la lumière dont elle peut
être frappée, & qui fera d’autant plus fon effet, qu’elle
en cachera l’artifice. Ce que je dis d’une couleur
peut s’entendre de toutes les.autres couleurs, félon
le degré de leur ton, 6c le befoin qu’en aura le >pein-
tre.
Le troifieme moyen de produire l’effet du clair
obfcur naît des accidens. Leur diftribution peut fer-
vir à l’effet du clair obfcur, ou dans la lumière ou
dans les ombres. Il y a des lumières 6c des ombres
accidentelles : la lumière accidentelle eft celle qui
eft acceffoire au tableau, comme la lumière de quelque
fenêtre, ou d’un flambeau, ou de quelqu’autre-
caufe lumineufe, laquelle eft pourtant inférieure à
la lumière primitive ; les ombres accidentelles font>
par exemple, celles des nuées dans un payfage, ou de
quelqu’autre caufe que l’on fuppofe hors du tableau,
6c qui peut produire des ombres avantageufes ; mais,
en fuppofant hors du tableau la caufe de ces ombres
volantes, pour ainfi parler, il faut prendre garde que»
cette caufe fuppofée foit vraiffemblable, & non pas
impoffible. Voye^ le cours de Peint, de M. de Piles.
On appelle un deffein de clair obfcur, un deffein
qui eft lavé d’une feule couleur, ou dont les ombres
font d’une couleur brune, 6c les lumières rehauffées
de blanc. On nomme encore ainfi les tableaux qui
ne font que de deux couleurs , comme les frefques
de Polydore qui font à Rome.
Les planches gravées à la maniéré noire portent
encore le nom générique de clair obfcur. {R)
CLAIRAN j f, m* { Maréck. ) efpece de fonnette
R rif ij