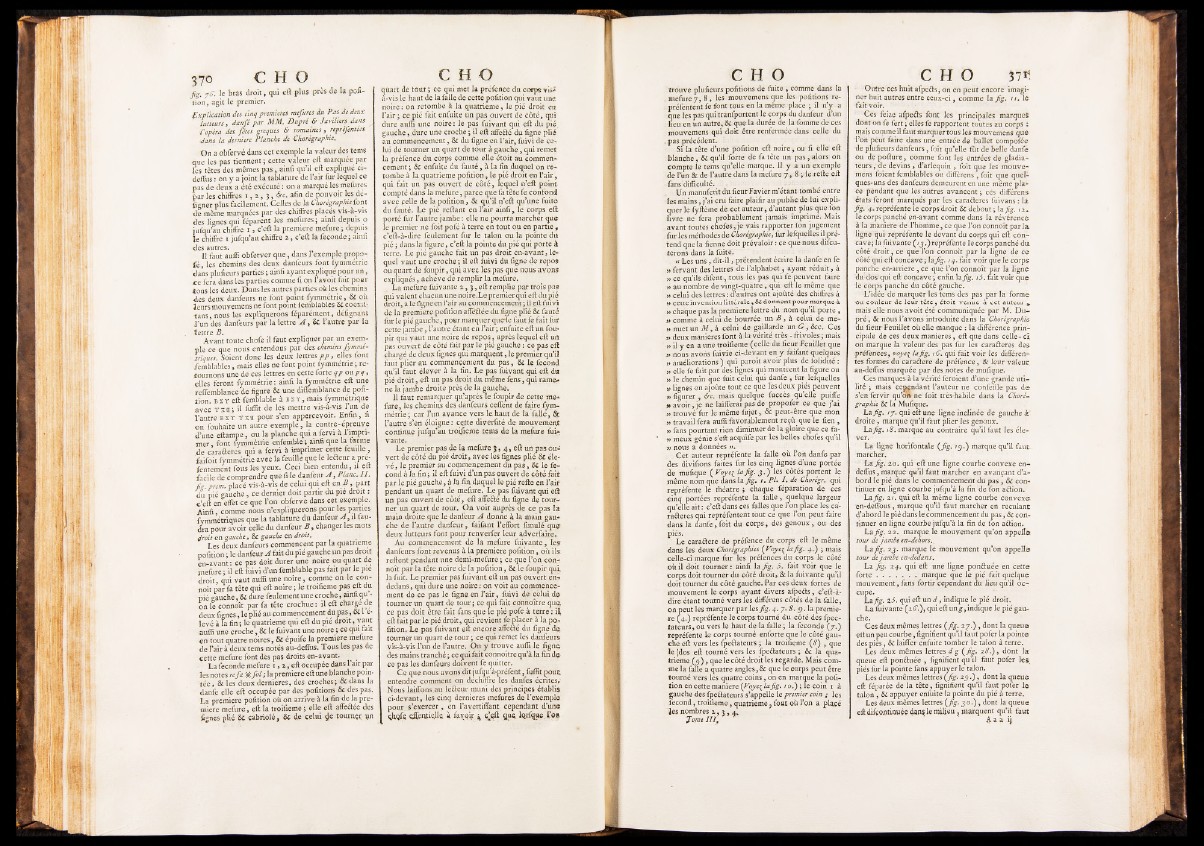
f i
fier. yS. le bras droit, qui eft plus près de la pofi-
tion, agit le premier.
Explication des cinq premières mefures du Pas de dcu£
lutteurs 3 danfé par MM. Dupré & Javiliers dans ^
popéra des fêtes greques & romaines , repréfentées
Hans la derniere Planche de Chorégraphie.
On a obfervé dans cet exemple la valeur des tems
que les pas tiennent ; cette valeur eft marquée par
les têtes des mêmes pas, ainfi qu’il eft expliqué ci-
deflus : on y a joint la tablature de l’air fur lequel ce
pas de deux a été exécuté : on a marqué les mefures
par les chiffres 1 ,2 ,3 » a^n pouvoir les de-
figner plus facilement. Celles de la Chorégraphie font
de même marquées par des chiffres placés yis-à-vis
des lignes qui réparent les mefures; ainfi depuis o
jufqu’au chiffre i : c’eft la première mefure ; depuis
le chiffre i jufqu’au chiffre î , c’eft la fécondé ; ainfi
■ des autres.
Il faut aufll obferver que, dans l’exemple propo-
f é , les chemins des deux danfeurs font fymmétrie
dans plufieurs parties ; ainfi ayant expliqué pour un,
jee fera dans les parties comme fi on l’avoit fait pour
tous les deux. Dans les autres parties où les chemins
-des deux danfeurs ne font point fymmétrie, §£ qù
leurs mouvemens ne font point femblables 8c coexif-
-tans, nous les expliquerons féparément, défignant
l ’un des danfeurs par la lettre A , 8c l’autre par la
lettre B.
Avant toute chofe il faut expliquer par un exemple
ce que nous entendons par des chemins fymmé-
-triques. Soient donc les deux lettres p p , elles font
iemblables, mais elles ne font point fymmetrie ; retournons
une de ces lettres en cette forte qp ou p q ,
elles feront fymmétrie ; ainfi la fymmetrie eft une
reffemblance de figure 8c une diffemblance de pofi-
tion. B2T eft femblable à B2 r , mais fymmétrique
avec r s :a ; il fuffit de les mettre vis-à-vis l’un de
l ’autre b x t r s a pour s’en appcrcevoir. Enfin, fi
on fouhaite un autre exemple, la contre-epreuve
d’une eftampe, ou la planche qui a fervi à 1 imprimer
, font fymmétrie enfemble ; ainfi que la tqrme
de caraderes qui a fervi à imprimer cette feuille,
faifoit fymmétrie avec la feuille que le leaeur a pré-
fenteihent fous les yeux. Ceci bien entendu, il, eft
facile de comprendre que: fi le danfeur A ,P la n c .J I .
prem. placé vis-à-vis de celui qui eft en B , part
du pié gauche, ce dernier doit partir du pré droit :
c ’eft en effet ce que l’on obferve dans cet exemple.
Ainfi, comme nous n’expliquerons pour les parties
fymmétriques que la tablature du danfeur A , il faudra
pour avoir celle du danfeur B , changer les mots
droit en gauche, & gauche en droit.
Les deux danfeurs commencent par la quatrième
pofition ; le danfeur A fait du pié gauche un pas droit
en-avant : ce pas doit durer une noire ou quart de
jnefure ; il eft fuivi d’un femblable pas fait par le pie
droit, qui vaut auffi une noire, comme on le con-
noît par fa tête qui eft noire ; le troifieme pas eft du
pié gauche, 8c dure feulement une croche, ainfi cju -
on le connoît par fa tête crochue : il eft charge de
deux fignes, le plié au commencement du pas, 8c1 e-
levé à la fin; le quatrième qui eft du pié droit, vaut
auffi une croche, & le fuivant une noire ; ce qui fait
en tout quatre noires , 8c épuife la première mefure
de l’air à deux tems notés au-deflits. Tous les pas de
cette mefure font dés pas droits en-avant.
La fécondé mefure 1 , 2 , eft occupée dans l ’air par
les notes refa %fol; la première eft une blanche pointé
e , & les deux dernieres, des croches; 8c dans la
danfe elle eft occupée par des pofitions 8c des pas.
La première pofition où on arrive à la fin de la première
mefure, eft la troifieme ; elle eft affedée des
fignes plié 8c cabriolé, 8c de celui ^e tournçr yn
quart de tour ; ce qui met la préfence du corps vis*
à-vis le haut de la falle de cette pofition qui vaut une
noire : on retombe à la quatrième, le pié droit en
l’air ; ce pié fait enfuite un pas ouvert de Côté, qui
dure auffi une noire : le pas fuivant qui eft du pié ,
gauche, .dure une croche ; il eft affedé du ligne plié
au commencement, 8c du figne en l ’air, fuivi de celui
de tourner un quart de tour à gauche, qui remet
la préfence du corps comme elle étoit au comment
cernent ; 8c enfuite du fauté, à la fin duquel on retombe
à la quatrième pofition, le pié droit en l’air,
qui fait un pas ouvert de côté, lequel n’eft point
compté dans la mefure, parce que fa tête fe. confond
avec celle de la pofition, & qu’il n’eft qu’une fuit©
du fauté. Le pié reliant en l’air ainfi, le corps eft
porté fur l’autre jambe : elle ne pourra marcher que
le premier ne foit pofé à terre en tout ou en partie,
c’eft-à-dire feulement fur le talon ou la pointe du
pié ; dans la figure, c’eft la pointe du pié qui porte à
terre. Le pié gauche fait un pas droit en-avant, le*
quel vaut une croche ; il eft l’uivi du figne de repos
ou quart de foupir, qui avec les pas que nous ayons-
expliqués, achevé de remplir la mefure.
La mefure fuivante 2 , 3, eft remplie par trois pas
qui valent chacun une noire .Le premier qui eft du pié
droit, a le ligne en l’air au commencement ; il eft fuivi
de la première pofition affrétée du figne plié & fauté
fur le pié gauche, pour marquer queie faut fe fait fur
cette ïambe, l’autre étant en l’air ; enfuite eft un fou*
pir qui yaut une noire de repos, après lequel eft un
pas ouvert de côté fait par le pié gauche : ce pas eft
chargé de deux fignes qui marquent, le premier qu’il
faut plier au commencement du pas, & le fécond
qu’il faut élever à la fin. Le pas fuivant qui eft da
pié droit, eft un pas droit du même fens, qui rame*
ne la jambe droite près de la gauche.
Il faut remarquer qu’après le foupir de Cette me-
fure, les chemins des danfeurs ceftent de faire fymmétrie;
car l’un avance vers le, haut de la falle, &
l’autre s’en éloigne : cette diverfité de mouvement
continue jufqu’au troisième tems de la mefure fuivante.
Le premier pas de la mefure 3, 4 , eft un pas ouvert
de côté du pié droit, avec les fignes plié 8c élev
é , le premier au commencement du p a s, & le fécond
à la fin ; il eft fuivi d’un pas ouvert de côté fait
par le pié gauche, à là fin duquel le pié refte en l’aif
pendant un quart de mefure. Le pas fuivant qui eft
un pas ouvert de côté, eft affedé du figne de tourner
un quart de tour. On voit auprès de ce pas la
main droite que le danfeur A donne à la main gau*
che de l’autre danfeur, faifant l’effort fimulé qu©
deux lutteurs font pour renyerfer leur adverfaire-
Au commencement de la mefure fuivante, lesf
danfeurs font revenus à la première pofition, où ils.
relient pendant une demi-mefure ; ce que l’on connoît
par la tête noire de la pofition, 8c le foupir qui.
la fuit. Le premier pas fuivant eft un pas ouvert en-»
dedans, qui dure une noire : on voit au commencement
de ce pas le ligne en l’air, fuivi de celui d©
tourner un quart de tour; ce qui fait connoître que,
ce pas doit être fait fans que le pié pofe à terre : H
eft fait par le pié droit, qui revient fe placer à la po->
fit ion. Le pas fuivant eft encore affedé du figne de;
tourner un quart de tour ; ce qui remet les danfeurs
vis-à-vis l’un de l’autre. On y trouve auffi le fignei
des mains tranché ; ce qui fait connoître qu’à la fin d$
ce pas les danfeurs doivent fe quitter.
Ce que nous avons dit jufqu’à-préfent, fuffit pour;
entendre comment on déchiffre les danfes écrites;
INous laiffons.au ledeur muni des principes établis ci-devant, les cinq dernieres mefures de l ’exemple
pour s’exercer , en l’avertiffant cependant d’une
qhqfç çffeiuiells à. faYoh * <£çft guq. Iqrfqu© l’o*
trouve plufieurs pofitions de fuite , comme dans la
mefure 7 , 8 , les mouvemens que les -pofitions re-
préfentent fe font tous en la même place ; il n’y a
que les pas quitranfportent le corps du danfeur d’un
lieu en un autre, & que la durée de la fomme de ces
mouvemens qui doit -être renfermée dans celle du
. pas précédent.
' Si la tête d’une pofition eft noire, ou fi èlle eft
blanche, 8c qu’il forte de fa tête un pas ; alors' on
compte le tems qu’elle marque. Il y a un exemple
de l’un & de l’autre dans la mefure 7 , 8 le-refte eft
fans difficulté. • -
Un manuferit du fieur Favier m’étant tombé entre
les mains, j’ai cru faire plaifir au publie de lui expliquer
le fyftème de cet auteur, d’autant plus.que ion
livre ne fera probablement jamais imprimé. Mais
avant toutes chofes, je vais rapporter fon jugement
fur les méthodes de Chorégraphie, fur lefquelles il prétend
que la fienne doit prévaloir : ce que nous dilcu-
terons dans la luité,
« Les uns, dit-il, prétendent écrire la danfe en fe
» fervant des lettres de l ’alphabet, ayant réduit, à
» ce qu’ils difent , tous lès pas qui fe peuvent faire
» au nombre de vingt-quatre, qui eft le même que
» celui des lettres: d’autres ont ajouté des chiffres à
» cette invention littérale, 8c donnent pour marque à
» chaque pas la première lettre du nom qu’il porte ,
» comme à celui de bourrée un B , à celui de me-
» nuet un M , à celui de. gaillarde un G , 8cc. Ces
» deux maniérés fout à la vérité très - frivoles ; mais
» il y en a une troifieme (celle du fieur Feuillet que
» nous avons fuivie .ci-devant en y fàifant quelques
» améliorations ) qui p3roît avoir plus de loliditc :
» elle fe fait par des lignes qui montrent la figure ou
» le chemin que fuit celui qui danfe , fur lelquelles
» lignes on ajoute tout ce que les deux piés peuvent
»figure r, &c. mais quelque fuccès qu’elle puilfe
» avoir, je ne bifferai pas de propofer ce que j’ai
» trouvé fur le même fujet , Sc peut-être que mon
» travail fera auffi favorablement reçu que le fien ,
» fans pourtant rien diminuer de la gloire que ce fa-
„ meux génie s’eft acquife par les belles chofes qu’il
» nous a données ». -
Cet auteur repréfente la falle où I on danfe par
des divifions faites fur les cinq lignes d’une portée
de mufique ( Voye{ lafig. 3 . ) les côtés portent le
même nom que dans la fig. 1. PL I. de Chorégr. qui
repréfente le théâtre ; chaque féparation de ces
cinq portées repréfente la lalle , quelque largeur
qu’elle ait : c’eft dans ces falles que l’on place les cà-
rafteres qui repréfenterit tout ce que l’on peut faire
dans la danfe, foit du corps, des genoux, ou des
piés.
Le carafrere de préfence du corps eft le même
dans les deux Chorégraphies ( Voyeç lafig. 4.) ; mais
celle-ci marque fur les préfences du corps le côté
où il doit tourner: ainfi la fig. i . fait voir que le
corps doit tourner du côté droit, & la fuivante qu’il
doit tourner du côté gauche. Par ces deux fortes de
mouvement le corps ayant divers afpefts, c’eft-à-
dire étant tourné vers les différens côtés de la lalle,
on peut les marquer par les fig. 4 .7 .8 .9 . la première
(4.) repréfente le corps tourné du côté des fpec-
lateurs, ou vers le haut de la falle ; la fécondé (7 .)
repréfente le corps tourné enforte que le côté gauche
ëft vers les fpe&ateurs ; la troifieme (<?) , que
le [dos eft tourné vers les fpe&ateurs ; & la quatrième
( 9 ) , que le côté droit les regarde. Mais comme
là falle a quatre angles,& que le corps peut être
tourné vers les quatre coins, on en marque la pofition
en cette maniéré (Voye^ lafig. / o.) ; le coin 1 à
gauche des fpeûateurs s’appelle le premier coin ; les
fécond, troifieme, quatrième, fout où l’on a placé
les nombres 2 ,3 ,4 *
fojne I I I ,
Outre ces huit afpe&s, on en peut encore imaginer
huit autre? entre ceux-ci, comme la fig. 11. le
faitvoir.
Cès feize afpefts font les principales marque*
dont on fe fert ; elles fe rapportent toutes au corps i
mais comme il faut marquer tous les mouvemens què
l ’on peut faire dans une entrée de ballet compofée
de plufieurs danfeurs , foit qu’elle fût de belle danfe
ou de pofture, comme font les entfées de gladiateurs
, de devins , d’arlequin , foit que les mouvemens
foient femblables ou différens , foit que quelques
uns des danfeurs demeurent en une même place
pendant que les autres avancent ; cés différens
états feront marqués par les carafteres fuivans: là
fig. '4. répréfente le corps droit & debout ; la fig. i z .
le corps pançhé en-avant comme dans la révérence
à la maniéré de l’homme, ce que l’on connoît par la
ligne'qui repréfente le devant du corps qui eft concave;
la fuivante ( / j .) repréfente le corps panché du
côté droit, ce que l’on connoît par la ligne de ce
côté qui eft Concave; la fig. 14. fait voir que le corps
panche en-arriere, ce que l’on connoît par la ligne
du-dos-' qui eft concave ; enfin la fig. i5. fait voir que
■ lé corps panche du côté gauche.
L’idée de marquer les tems des pas par la forme
ou couleur de leur tê te , étoit venue à cet auteur ;
mais elle nous avoit été communiquée par M. Dupré,
& nous l’avons introduite dans la Chorégraphie
du fieur Feuillet où elle manque : la différence principale
de çes deux maniérés, eft que dans celle- ci
on marque la valeur des pas fur les caraéleres des
préfences, voye^ lafig. )6. qui fait voir les différentes
formes du caradere de préfence, & leur valeuir
au-deflus marquée par des notes de muflque.
Ces marques à la vérité feroient d’une grande uti-
flïté ; mais cependant l’auteur ne confeiile pas de
s’en fervir qu’o» ne foit très-habile dans la Chorégraphie
& la Mufique.
La fig. 17. qui ell une ligne inclinée de gauche à
droite, marque qu’il faut plier les genoux.
La fig. 18. marque au contraire qu’il faut les élever.
La ligne horifontale (fig. 19.) marqué qu’ il faut-
marcher.
La fig• qui eft une ligne courbe convexe endefliis.,
marque qu’il faut marcher en avançant d’abord
le pié dans le commencement du pas , & continuer
en ligne courbe jufqu’à la fin de fon adion.
La fig. z i . qui eft là même ligne courbe convexe,
en-deflous, marque qu’il faut marcher en reculant
d’abord le pié dans le commencement du pas, & continuer
en ligne courbe jufqu’à la fin de fon adion.
La fig. z z . marque le mouvement qu’on appelle
tour de jambe en-dehors.
La fig. 23. marque le mouvement qu’on appelle
tour de jambe en-dedans.
La fig. Z4. qui eft une ligne ponduée en cette
fo r t e ......................marque que le pié fait quelque
mouvement, fans fortir cependant du lieu qu’il occupe.
La fig. iS . qui eft un d , indique le pié droit.
La fuivante (2(T.), qui eft un g , indique le pié gauche.
Ces deux mêmes lettres (fig. 2 7 .) , dont la queue
eit un peu courbe, fignifient qu’il faut pofer la pointe
des piés, & Iaifler enfuite tomber le talon à terre.
Les deux mêmes lettres d g (fig. 2 8 .), dont la
queue eft ponduée , fignifient qu’il faut pofer les
piés fur la pointe fans appuyer le talon.
Les deux mêmes lettres (fig. Z9. ) , dont la queue
eft féparée de la tête, fignifient qu’il faut poler le
talon , & appuyer enfuite la pointe du pié à terre.
Les deux mêmes lettres (fig. 3 0 .) , dont la queue
eft difçojitinuçç dan^ le milieu, marquent qu’il faut
A a a ij