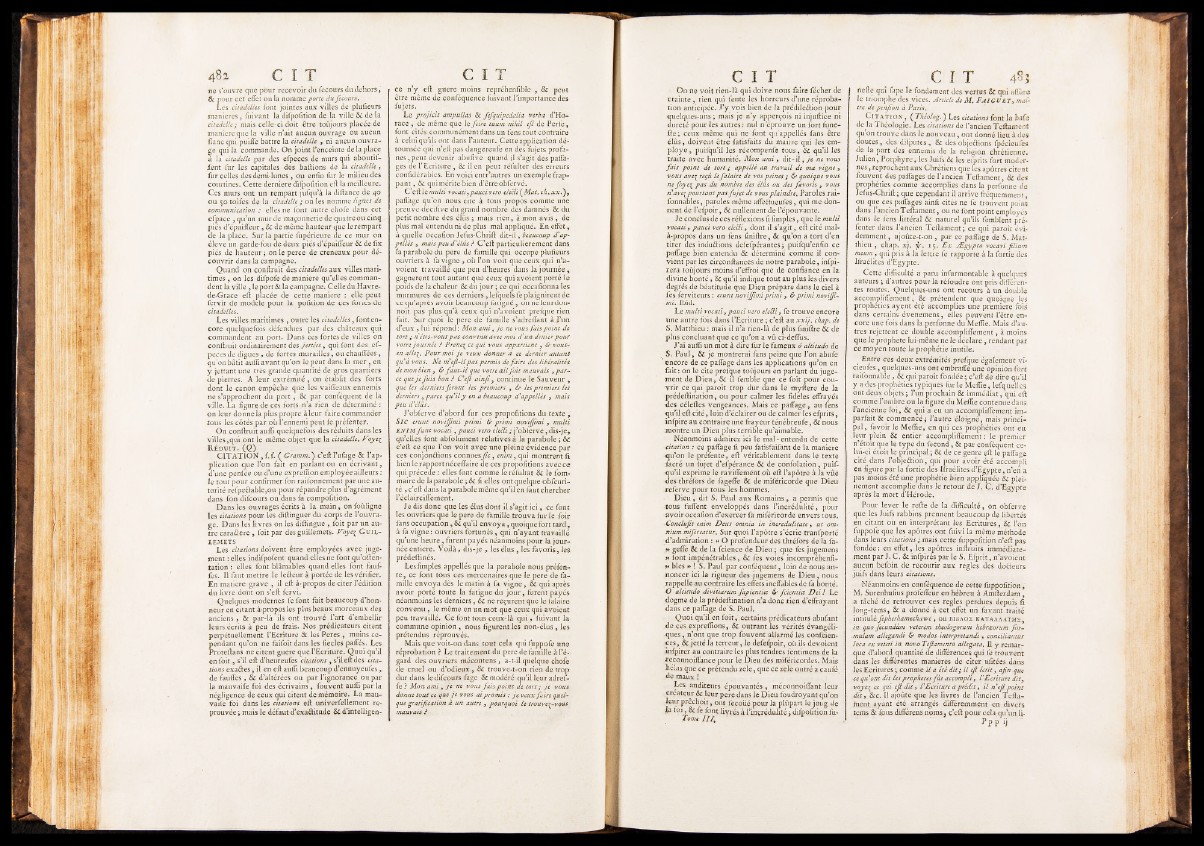
ne s’ouvre que pour recevoir du fecours du dehors,
& pour cet effet on la nomme porte du fecours.
Les citadelles font jointes aux villes de plufieurs
maniérés, fuivant la difpofition de la ville Sc de la
citadelle; mais celle-ci doit être toujours placée de
maniéré que la ville n’ait aucun ouvrage ou aucun
flanc qui puiffe battre la citadelle , ni aucun ouvrage
qui la commande. On joint l’enceinte de la place
à la citadelle par des efpeces de murs qui aboutif-
jfent fur les capitales des battions de la c ita d elle ,
fur celles des demi-lunes , ou enfin fur le milieu des
courtines. Cette derniere difpofition eft la meilleure.
Ces murs ont un rempart jufqu’à la diftance de 40
ou 50 toifes de la citadelle ; on les nomme lign es de
communication : elles ne font autre chofe dans cet
efpace , qu’un mur de maçonnerie de quatre ou cinq
pies d’épaiffeur, 8c de même hauteur que le rempart
de la place. Sur la partie fupérieure de ce mur on
éleve un garde-fou de deux piés d’épaiffeur 8c de fix
piés de hauteur ; on le perce de créneaux pour découvrir
dans la campagne.
Quand on conftruit des citadelles aux villes maritimes
, on les difpofe de maniere qu’elles commandent
la ville , le port & la campagne. Celle du Havre-
de-Grace eft placée de cette maniéré : elle peut
fervir de modèle pour la pofition de ces fortes de
citadelles.
Les villes maritimes , outre les c ita d elle s, font encore
quelquefois défendues par des châteaux qui
commandent au port. Dans ces fortes de villes on
conftruit ordinairement des je t t é e s , qui font des efpeces
de digues, de fortes murailles, ou chauffées,
qu’on bâtit auffi avant qu’on le peut dans la mer, en
y jettant une très-grande quantité de gros quartiers
de pierres. A leur extrémité, on établit des forts
dont le canon empêche que les vaiffeaux ennemis
ne s’approchent du p o r t, 8c par conféquent de la
ville. La figure de ces forts n’ a rien de déterminé :
on leur donne la plus propre à leur faire commander
tous les côtés par où l’ennemi peut fe préfenter.
On conftruit auffi quelquefois des réduits dans les
villes,qui ont le même objet que la citadelle. E iy e^
R é d u i t . ( Q )
CITATION ,f . f . ( Gramm.') c’eftl’ufage & l’application
que l’on fait en parlant ou en écrivant,
d’une penfee ou d’une expreffion employée ailleurs :
le tout pour confirmer fon raifonnëment par une autorité
refpeûable,ou pour répandre plus d’agrément
dans fon difeours ou dans fa compofition.
Dans les ouvrages écrits à la main, on foûligne
les citations pour les diftinguer du corps de l’ouvrage.
Dans les livres on les diftingue , foit par un autre
cara&ere, foit par des guillemets. Voy e£ G u i l l
e m e t s
Les citations doivent être employées avec jugement
: elles indifpofent quand elles ne font qu’often-
tation : elles font blâmables quand elles font fauf-
fes. Il faut mettre le Ietteur à portée de les vérifier.
En matière grave , il e,ft à-propos de citer l’édition
du livre dont on s’eft fervi.
Quelques modernes fe font fait beaucoup d’honneur
en citant à-propos les plus beaux morceaux des
anciens , 6c par-là ils ont trouvé l’art d’embellir
leurs écrits à peu de frais. Nos prédicateurs citent
perpétuellement l’Ecriture & les Peres , moins cependant
qu’on ne faifoit dans les fiecles paffés. Les
Proteftans ne citent guere que l’Ecriture. Quoi qu’il
en fo it , s’il eft d’heureufes citations , s’il eft des citations
exaéles, il en eft auffi beaucoup d’ennuyeufes,
de fauffes , 8c d’altérées ou par l’ignorance ou par
la mauvaife foi des écrivains , fouvent auffi par la
négligence de ceux qui citent de mémoire. La mauvaife
foi dans les citations eft univerfellement reprouvée
; mais le défaut d’exaétitude 8c d’intelligence
n’y eft guere moins repréhenfible , 8c peut
être même de conféquence fuivant l ’importance des
lujets.
Le projicit ampullas & fefquipedalia verba d’Hö-
race , de même que le feire tuum nihil eft de Perfe,
font cités communément dans un fens tout contraire
à celui qu’ils ont dans l’auteur. Cette application détournée
qui n’eft pas dangereufe en des fujets profanes
, peut devenir abufive quand il s’agit des pafi'a-
ges de l’Ecriture , & il en peut réfulter des erreurs
confidérables. En voici entr’autres un exemple frappant
, 8c qui mérite bien d’êtrëobfervé.
C ’eft le mulei vocati 9 pauci vero elecii [Mat. ch. xx.'),
pafl'age qu’on nous cite à tous propos comme une
preuve décifive du grand nombre des damnés & du
petit nombre des élus ; mais rien, à mon avis , de
plus mal entendu ni de plus mal appliqué. En effet,
à quelle occafion Jefus-Chrift dit-il, beaucoup d'appelles
, mais peu d'élus ? C ’eft particulièrement dans
fa parabole du pere de famille qui occupe plufieurs
ouvriers à fa vigne , où l’on voit que ceux qui n’a-
voient travaillé que peu d’heures dans la journée ,
gagnèrent tout autant que ceux qui avoient porté le
poids de la chaleur 6c du jour ; ce qui occafionna les
murmures de ces derniers, lefquels fe plaignirent de
ce qu’après avoir beaucoup fatigue, on neleurdon-
noit pas plus qu’à ceux qui n’avoient prefque rien
fait. Sur quoi le pere de famille s’adreffant à i ’un
d’eux , lui répond : Mon ami, je ne vous fais point de
tort ; n êtes-vous pas convenu avec moi d'tin.denier pour
Votre journée ? Prenez ce qui vous appartient , & vous-
en aile£. Pour moi je veux donner à ce dernier autant
qu'à vous. Ne mefi-il pas permis de faire des libéralités
de mon bien , & faut-il que votre ail foit mauvais , parce
que je fuis bon ? C'ejl ainjî, continue le Sauveur ,
que les derniers feront les premiers , & les premiers les
derniers , parce qu'il y en a beaucoup d'appellés , mais
peu d’élûs.
J’obferve d’abord fur ces propofitions du texte ,
S i C erunt novijjimi primi & primi novijjimi , multi
ENIM funt vocati, pauci vero elecii; j’obferve, dis-je*
qu’elles font abfolument relatives à la parabole ; 8c
c’eft ce que l’on voit avec une pleine évidence par
ces conjonctions connuesf i e , enim, qui montrent fi
bien le rapport néceffaire de ces propofitions avec cc
qui précédé : elles font comme le réfultat 8c le fom-
maire de la parabole ; 8c fi elles ont quelque obfcuri-
té , c’eft dans la parabole même qu’il en faut chercher
l’éclairciffement.
Je dis donc que les élus dont il s’agit i c i , ce font
les ouvriers que le pere de famille trouva fur le foir
fans occupation, 8c qu’il envoya, quoique fort tard ,
à fa vigne: ouvriers fortunés , qui n’ayant travaillé
qu’une heure, furent payés néanmoins pour la journée
entière. Voilà, dis-je , les é lus, les favoris, les
prédestinés.
Lesfimples appellésque la parabole nous préfente
, ce font tous ces mercenaires que le pere de famille
envoya dès le matin à fa vigne, 8c qui après
avoir porté toute la fatigue du jour, furent payés
néanmoins les derniers, 8c ne reçurent que le lalaire
convenu, le même en un mot que ceux qui avoient
peu travaillé. Ce font tous ceux-là q ui, fuivant la
commune opinion , nous figurent les non-élus , les
prétendus réprouvés.
Mais que voit-on dans tout cela qui fuppofe une
réprobation ? Le traitement du pere de famille à l’égard
des ouvriers mécontens, a-t-il quelque chofe
de cruel ou d’odieux, 8c trouve-t-on rien de trop
dur dans le difeours fage 8c modéré qu’il leur adref-
fe ? Mon ami, je ne vous fais point de-tort; je vous
donne tout ce que je vous ai promis : je veux faire quelque
gratification à un autre, pourquoi le trouvez-vous
mauvais ?
On ne Voit rien-là qui doive nous faire féçher de
crainte, rien qui fente les horreurs d’une réprobation
anticipée. J’y vois bien de la prédilection pour
quelques-uns ; mais je n’y apperçois ni injuftice ni
dureté pour les autres: nul n’éprouve un fort fune-
fte; ceux même qui ne font qu’appellés fans être
élus, doivent être fatisfaits du maître qui les employé
, puifqu’il les récompenfe tous, 8c qu’il les
traite avec humanité. Mon ami, dit-il 9je ne vous
fais point de tort ; appellé au travail de ma vigne ,
vous avez reçu le falaire de vos peines ; & quoique vous
ne foyez pas du nombre des élus ou des favoris , vous
n'avez pourtant pas fujet de vous plaindre. Paroles rai-
fonnables, paroles même affe&ueufes, qui me donnent
de l’efpoir, 8c nullement de l’épouvante.
Je conclus de ces réflexions fi fimples, que le multi
vocati f pauci vero elecii, dont il s’agit, eft cité malà
propos dans un fens finiftre, & qu’on a tort d’en
tirer des inductions defefpérantes ; puifqu’enfin ce
paffage bien entendu 8c déterminé comme il convient
par les circonftances de notre parabole, infpi-
rera toujours moins d’effroi que de confiance en la
divine bonté, 8c qu’il indique tout au plus les divers
degrés de béatitude que Dieu prépare dans le ciel à
fes ferviteurs : erunt novijjimi primi , & primi novijjimi.
Ibid.
Le multi vocati, pauci vero elecii, fe trouve encore
une autre fois dans l’Ecriture ; c’eft au xx ij. chap. de
S. Matthieu : mais il n’a rien-là de plus finiftre 8c de
plus concluant que ce qu’on a vu ci-deffus.
J’ai auffi un mot à dire fur le fameux ô altitudo de
S. Paul, 8c je montrerai fans peine que l’on abufè
encore de ce paffage dans les applications qu’on en
fait: on le cite prefque toujours en parlant du jugement
de Dieu, 8c il femble que ce foit pour couvrir
ce qui paroît trop dur dans le myftere de la
prédeftination, ou pour calmer les fideles effrayés
des céleftes vengeances. Mais ce paffage, au fens
qu’il eft cité, loin d?éclairer ou de calmer les efprits,
infpire au contraire une frayeur ténébreufe, 8c nous
montre un Dieu plus terrible qu’aimable.
Néanmoins admirez ici le mal-entendu de cette
citation : ce paffage fi peu fatisfaifant de la maniéré
qu’on le préfente, eft véritablement dans le texte
Sacré un fujet d’efpérance 8c de confolation, puifqu’il
exprime le raviffemént où eft l’apôtre à la vûe
des thréfors de fageffe 8c de miféricorde que Dieu
referve pour tous les hommes.
D ieu , dit S. Paul aux Romains, a permis que
■ tous fuffent enveloppés dans l’incrédulité, pour
avoir occafion d’exercer fa miféricorde envers tous.
■ Conclujît enim Deus omnia in incredulitate, ut omnium
mifereatur. Sur quoi l’apôtre s’écrie tranfporté
d’admiration : « O profondeur des thréfors de la fa-
» geffe 8c de la fcience de Dieu ; que fes jugemens
» lont impénétrables, 8c fes voies incompréhenfi-
» blés » î S. Paul par conféquent, loin de nous annoncer
ici la rigueur des jugemens de D ieu , nous
rappelle au contraire les effets ineffables de fa bonté.
O altitudo divitiarum fapientice & feientioe D e i! Le
dogme de la prédeftination n’a donc rien d’effrayant
dans ce paffage de S. Paul.
Quoi qu’il en foit » certains prédicateurs abufant
de ces expreffions, 8c outrant les vérités évangéliques,
n’ont que trop fouvent allarmé les confidences,
8c jetté la terreur, le defefpoir, où ils dévoient
infpirer au contraire les plus tendres l'entimens de la
ïeconnoiffance pour le Dieu des miféricordes. Mais
helas que ce prétendu zele, que ce zele outré a caufé>
de maux !
Les auditeurs épouvantés , méconnoiffant leur
créateur 8c leur pere dans le Dieu foudroyant qu’on
leur prechoit, ont fecoiié'ppur la plupart le joug c-le
la fo i, 8c fe font livrés à l’inçrédulité ; difpofition fu-
Tome IIP,
nette qui fape le fondement des vertus 8c qui affûro
le triomphe des vices. Article de M. F A l G VET, maître
de penjion à Paris.
C i t a t i o n , ( Théolog. ) Les citations font la bafe
de la Théologie. Les citations de l’ancien Teftament
qu on trouve dans le nouveau, ont donné lieu à des
doutes, des difputcs, 8c des objections fpécieufes
de la part des ennemis de la religion chrétienne.
Julien, Porphyre, les Juifs 8c les eiprits fort modernes
, reprochent aux Chrétiens que les apôtres citent
fouvent des paffages de l’ancien Teftament, 8c des
prophéties comme accomplies dans la perfonne de
Jefus-Chrift ; que cependant il arrive fréquemment,
ou que ces paffages ainfi cités ne fe trouvent point
dans l’ancien Teftament, ou ne font point employés
dans le fens littéral 8c naturel qu’ils fcmblent préfenter
dans l’ancien Teftament; ce qui paroît évidemment
, ajoûte-t-on , par ce paffage de S. Matthieu
, chap. xj. . 1 y E x Ægypto vocavi filiurn
meum, qui pris à la lettre fe rapporte à la fortie des
Ifraélites d’Egypte.
Cette difficulté a paru infurmontable à quelques
auteurs ; d’autres pour la réfoudre ont pris différentes
routes. Quelques-uns ont recours à un double
accompliffement, 8c prétendent que quoique les
prophéties ayent été accomplies une première fois
dans certains évenemens, elles peuvent l’être encore
une fois dans la perfonne du Meffie. Mais d’au*
très rejettent ce double accompliffement, à moins
que le prophète lui-même ne le déclare, rendant par
ce moyen toute la prophétie inutile.
Entre ces deux extrémités, prefque égalemeut vi-
cieufes, quelques-uns ont embraffe une opinion fort
raifonnable, 8c qui paroît fondée ; c’eft de dire qu’il
y a des prophéties typiques fur le Meffie, lefquelles
ont deux objets ; l’un prochain 8c immédiat, qui eft
comme l’ombre ou la figure du Meffie contenue dans
l’ancienne loi, 8c qui a eu un accompliffement imparfait
8c commencé; l ’autre éloigné, mais principal,
favoir le Meffie, en qui ces prophéties ont eu
sleur plein 8c entier accompliffement : le premier
n’étoit que le type du fécond, & par conféquent celui
ci étoit le principal ; 8i de ce genre eft le paffage
cité dans l’objeétion, qui pour avoir été accompli
en figure par la fortie des Ifraélites d’Egypte, n’en a
pas moins été une prophétie bien appliquée 8c pleinement
accomplie dans le retour de J. C. d’Egypte
après la mort d’Hérode.
Pour lever le refte de la difficulté, on obferve
que les Juifs rabbins prennent beaucoup de libertés
en citant ou en interprétant les Ecritures, 8c l’on
fuppofe que les apôtres ont fuivi la même méthode
dans leurs citations ; mais cette fuppofition n’eft pas
fondée: en effet, les apôtres inftruits immédiatement
par J. C. 8t infpires par le S. Efprit, n’avoient
aucun befoin de recourir aux réglés des docteurs
juifs dans leurs citations.
Néanmoins en conféquence de cette fuppofition,
M. Surenhufius profeffeur en hébreu à Amfterdam ,
a tâché de retrouver ces réglés perdues depuis fi
long-tèms, & a donné à 'cet effet un favant traité
intitulé fepherhamechawe, ou BIBAOZ KATAAAATH2,
in quo fecundum veterem iheologorum hebrceorum for-
mulam allegandi & modo s interpretandi , çonciliantur
loca ex veteri in novo Teflamento allegata. Il y remarque
d’abord quantité de différences qui fe trouvent
dans les différentes maniérés de citer ufitées dans
les Ecritures ; comme il a été dit; il efi écrit, afin que
ce qu'ont dit les prophètes fut accompli , l'Ecriture dit9
voyez ce qui efi d it, l'Ecriture a prédit, il n efi point
dit y &c. Il ajoute que les livres de l’ancien Teftament
ayant été arrangés différemment en divers
tems 8c finis différens noms, ç’eft pour cela qu’un li