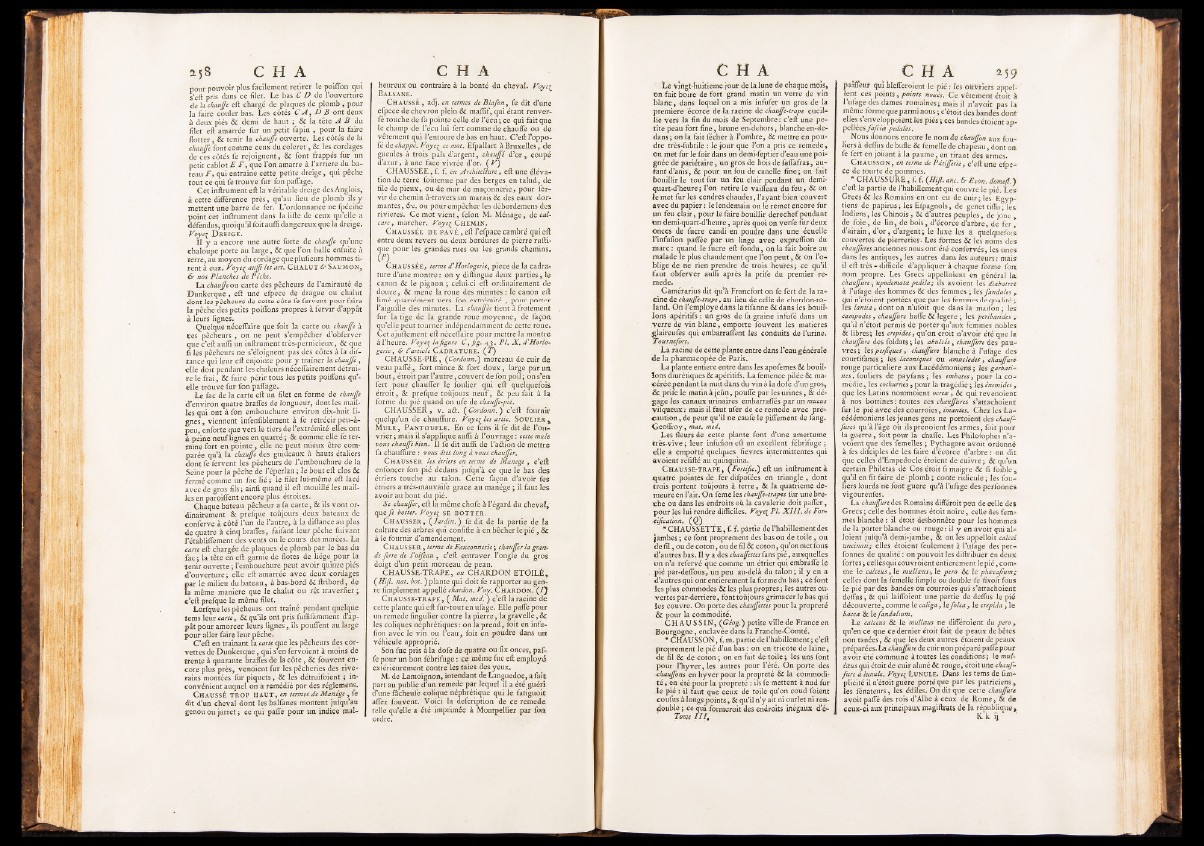
pour pouvoir plus facilement retirer le poiffon qui
s’eft pris dans ce filet. Le bas C D de l’ouverture
de la chauffe eft chargé de plaques de plomb , pour
la faire couler bas. Les côtés C A , D B ont deux
à deux piés 6c demi de haut ; 6c la tete A B du
filet eft amarrée fur un petit fapin , pour la faire
flotter, 6c tenir la chauffe ouverte. Les côtés de la
chauffe font comme ceux du coleret, & les cordages
de ces côtés fe rejoignent, 6c font frappés fur un
petit cablot E F , que l’on amarre à l’arriéré du bateau
F , qui entraîne cette petite dreige, qui pêche
tout ce qui fe trouve fur fon paffage.
Cet infiniment eft la véritable dreige des Anglois,
à cette différence près, qu’au lieu de plomb ils y
mettent une barre de fer. L ’ordonnance ne fpécifie
point cet infiniment dans la lifte de ceux qu’elle a
défendus, quoiqu’il foit aufli dangereux que la dreige.
Voye^ Dreige.
Il y a encore une autre forte de chauffe qu’une
chaloupe porte au large, 6c que l’on halle enfuite à
terre, au moyen du cordage que plufieurs hommes tirent
à eux. Voye^ auffi les art. C h a lu t & SAUMON,
6* nos Planches de Pêche.
La chauffe ou carte des pêcheurs de l’amirauté de
Dunkerque, eft une’ efpece de drague ou chalut
dont les pêcheurs de cette côte fe fervent pour faire
la pêche des petits poiffons propres à feryir d’appât
à leurs lignes.
Quelque néceffaire que foit la carte ou chauffe à
Ces pêcheurs , on ne peut s’empêcher d’obferver
que c’eft aufli un infiniment très-pernicieux, 6c que
li les pêcheurs ne s’éloignent pas des côtes à la distance
qui leur eft enjointe pour y traîner la chauffe ,
elle doit pendant les chaleurs néceflairement détruire
le frai, 6c faire périr tous les petits poiffons qu’elle
trouve fur fon paffage.
Le fac de la carte eft un filet en forme de chauffe
d’environ quatre brafles de longueur, dont les mailles
qui ont à fon embouchure environ dix-huit lignes,
viennent infenfiblement à fe rétrécir peu-à-
peu, enforte que vers le tiers de l’extrémité elles ont
à peine neuf lignes en quarré ; & comme elle fe termine
fort en pointe, elle ne peut mieux être comparée
qu’à la chauffe des guideaux à hauts étaliers
dont fe fervent les pêcheurs de rembouchure de la
Seine pour la pêche de l’éperlan ; le bout eft clos 6c
fermé comme un fac lié ; le filet lui-même eft lacé
avec de gros fils; ainfi quand il eft mouiHé les mailles
en paroiffent encore plus étroites.
Chaque bateau pêcheur a fa carte, & ils vont ordinairement
& prefque toujours deux bateaux de
conferve à côté l’un de l’autre, à la diftance au plus
de quatre à cinq brafles, faifant leur pêche fuivant
l ’établiffement des vents ou le cours des marées. La
carte eft chargée de plaques de plomb par le bas du
fac ; la tête en eft garnie de ilotes de liège pour la
tenir ouverte ; l’embouchure peut avoir quinze piés
d’ouverture; elle eft amarrée avec deux cordages
par le milieu du bateau, à bas-bord 6c ftribord, de
la même maniéré que le chalut ou rêt traverfier ;
ç ’eft prefque le même filet.
Lorfque les pêcheurs ont traîné pendant quelqüe
tems leur carte,. 6c qu’ils ont pris fuflifamment d’appât
pour amorcer leurs lignes, ils pouffent au large
pour aller faire leur pêche.
C ’eft en traînant la carte que les pêcheurs des corvettes
de Dunkerque, qui s’ën fervoient à moins de
trente à quarante brafles de la côte, & fouvent encore
plus près, venoient fur les pêcheries des riverains
montées fur piquets, 6c les détruifoient ; inconvénient
auquel on a remédié par des réglemens.
CHAUSSÉ TROP HAUT, en termes de Manège , fe
dit d’un cheval dont les balfanes montent jufqu’au
genou ou jarret ; çe qui patte pour un indice malheureux
ou contraire à la bonté du cheval. Voye^
Balsane.
CHAUSSÉ, adj. en termes de Blafon, fe dit d’une
efpece de chevron plein 6c maflif, qui étant renver-
fé touche de fa pointe celle de l’écu ; ce qui fait que
le champ de l’écu lui fert comme de chauffe ou de
vêtement qui l’entoure de bas en haut. C’eft l’oppo-
fé de chappé. Voye.£ ce mot. Efpallart à Bruxelles, de
gueules à trois pals d’argent, chauffé d’o r , coupé
d’azur, à une face vivrée d’or. ( V")
CHAUSSÉE, f. f. en Architecture , eft une élévation
de terre foûtenue par des berges en talud, de
file de pieux, ou de mur de maçonnerie, pour fer-
vir de chemin à-travers un marais 6c des eaux dormantes,
&c. ou pour empêcher les débordemens des
rivières. Ce mot vient, félon M. Ménage, de cal-
care, marcher. Voyet C hemin.
C haussée de pav é , eft l’efpace cambré qui eft
entre deux revers ou deux bordures de pierre rufti-
que pour les grandes rues ou les grands chemins*
E H
C haussee, terme d.'Horlogerie, piece de la cadra-
ture d’une montre : on y diftingue deux parties, le
canon 6c le pignon ; celui-ci eft ordinairement de
douze, & mene la roue des minutes : le canon eft
limé quarrément vers fon extrémité , pour porter
l’aiguille des minutes. La chauffée tient à frotement
fur la tige de la grande roue moyenne, de façon,
qu’elle peut tourner indépendamment de cette roue.
Cet ajuftement eft néceffaire pour mettre la montre
à l’heure. Voye£ la figure C ,fig. 43. PI. X , d.'Horlogerie,
& L’article C adrature. (T)
CHAU5SE-PIÉ, ('Cordonn.) morceau de cuir de
veau pafle, fort mince & fort doux, large par un
bout, étroit par l’autre, couvert de fon poil ; on s’en
fert pour chauffer le foulier qui eft quelquefois
étroit, & prefque toujours neuf, 6c peu fait à la
forme du. pié quand on ufe de chauffe-pié.
CHAUSSER, v . a£l. ( Cordonn. ) c’eft fournir
quelqu’un de chauffure. Voye^ les artic. Soulier %
Mule , Pantou f le. En ce fens il fe dit de l’ouvrier
; mais il s’applique auffi à l’ouvrage : cette mule
vous chauffe bien. Il fe dit auffi de l’aétion de mettre
fa chauffure : vous êtes long à vous chauffer.
CHAUSSER les étriers en terme de Manege , c’eft
enfoncer fon pié dedans jufqu’à ce que le bas des
étriers touche au talon. Cette façon d’avoir fes
étriers a très-mauvaife grâce au manège ; i l faut les
avoir au bout du pié.
Se chauffer, eft la même chofe à l’égard du cheval,'
que fe botter. Voye[ SE b o t t e r .
C hausser, {Jardin. ). fe dit de la partie de la
culture des arbres qui confifte à en bêcher le pié , 6c
à le fournir d’amendement.
C hausser , terme de Fauconnerie ; chauffer la grande
ferre de l ’oifeau , c’eft entraver l’ongle du gros
doigt d’un petit morceau de peau.
CHAUSSE-TRAPE, ou CHARDON ÉTOILÉ,
( Hiß. nat. bot. ) plante qui doit fe rapporter au genre
Amplement appellé chardon. Voy, C hardon. {F)
C hausse-tr ape , ( Mat. med. ) c’eft la racine de
cette plante qui eft fur-tout en ufage. Elle pafle pour
un remede fingulier contre la p ierre, la gravelle, 6c
les coliques néphrétiques : on la prend, loit en infu-
fion avec le vin ou l’eau, foit en poudre dans urt
véhicule approprié.
Son fuc pris à la dofe de quatre ou fix onces, paffe
pour un bon fébrifuge : ce même fuc eft employé
extérieurement contre les taies des yeux.
M. de Lamoignon, intendant de Languedoc, a fait
part au public d’un remede par lequel il a été guéri
d’une fâcheufe colique néphrétique qui le fatiguoit
aflcz fouvent. Voici la defcription de ce remede
telle qu’elle a été imprimée à Montpellier par fon
ordre.
Le vingt-huitiemè jour de la lune de chaque mois,
ton fait boire de fort grand matin un verre de vit!
blanc, dans lequel on a mis infufer un gros de la
première écorce de la racine de chauffe-trape cueillie
vers la fin du mois de Septembre : c’eft une petite
peau fort fine, brune en-dehors, blanche en-dedans;
on la fait fécher à l’ombre, 6c mettre en poudre
très-fubtile : le jour que l’on a pris ce remede,
on met fur le foir dans un demi-feptier d’eau une poignée
de pariétaire, un gros de bois de faflafras , autant
d’anis , & pour un fou de canelle fine ; on fait
bouillir le tout fur un feu clair pendant un demi-
quart-d’heure ; l’on retire le vaiffeau du feu, & on
le met fur les cendres chaudes, l’ayant bien couvert
avec du papier : le lendemain on le remet encore fur
un feu clair, pour le faire bouillir derechef pendant
ton demi-quart-d’heure, après quoi on verfe fur deux
onces de fucre candi en poudre dans une écuelle
l’infufion paffée par un linge avec exprefîion du
marc : quand le fucre eft fondu , on la fait boire au
malade le plus chaudement que l ’on p eut, & on l’oblige
de ne rien prendre de trois heures; ce qu’il
faut obferver aufli après la prife du premier remede.
Camérarius dit qu’à Francfort on fe fert de la racine
de chauffe-trape, au lieu de celle de chardon-ro-
land. On l’employe dans la tifanne 6c dans les bouillons
apéritifs : un gros de fà graine infufé dans un
.verre de vin blanc, emporte fouvent les matières
glaireufes qui embarraffent les conduits de l’urine^
Tournéfort.
La racine de cette plante entre dans l ’eau générale
îde la pharmacopée de Paris.
La plante entière entre dans les apofemes 6c bouillons
diurétiques & apéritifs. La femence pilée 6c macérée
pendant la nuit dans du vin à la dofe d’un gros,
& prife le matin à jeun, pouffe par les urines, & dégage
les canaux urinaires embarrafles par un mucus
vilqueux^ mais il faut ufer de ce remede avec précaution
, de peur qu’il ne caufe le piffement de fangt
Geoffroy, mat. med.
Les fleurs de cette plante font d’une amertume
très-vive ; leur infufiôn eft un excellent fébrifuge ;
elle a emporté quelques fievres intermittentes qui
àvoient réfifté au quinquina.
C hausse-tr a p e , ( Fortifie.) eft un infiniment à
quatre pointes de fer difpofées en triangle , dont
trois portent toujours à terre, & la quatrième de>-
meureen Pair. On fente les chauffe-trapts fur une brèche
ou dans les endroits où la cavalerie doit paffer,
pour les lui fendre difficiles. Vye^ PL X I I I . de For»
xïfication. (Q.)
* CHAUSSETTE, f. f. pàrtie de l’habillement des
Jambes ; ce font proprement des bas ou de toile, ou
de fil, ou de coton, ou de fil 6c coton, qu’on met fous
d’autres bas. Il y a des chauffettes fans p ié, auxquelles
on n’a refervé que comme un étrier qui embraffe le
pié par-deflous, un peu au-delà du talon ; il y en a
d’autres qui ont entièrement la forme du bas ; ce font
les plus commodes & les plus propres ; les autres ouvertes
par-derriere, font toujours grimacer le bas qui
les couvre. On porte des chauffettes pour la propreté
6c pour la commodité.
C H A U S S IN , (Géog.) petite ville de France en
Bourgogne, enclavée dans la Franche-Comté.
* CHAUSSON, f. m. partie de l’habillement ; c’eft
proprement le pié d’un bas : on en tricote de laine ,
de fil & de coton ; on en fait de toile ; les uns font
pour l’hyver, les autres pour l’été. On porte des
"chauffons en hyver pour la propreté 6c la commodité
, en été pour la propreté : ils fe mettent à nud fur
le pié : il faut que ceux de toile qu’on coud foient
coufus à longs points^, & qu’il n’y ait ni ourlet ni ren-
double ; ce qui formeroit des endroits inégaux d’é*-
Tomc I I I ,
pamèlir qui bleflefoieht le pié ; les ouvriers appellent
ces points, points noiiès. C e vêtement étoit à
l ’ufage des dames romaines; mais il n’a voit pas la
même forme que parmi nous ; c’étoit des bandes dont
elles s’en veloppoiènt les piés ; ces bandes étoient ap-
pellées fafcice pédales.
Nous donnons encore le nom d'e chaüffon aux foù-
liers à deflus de bufle 6c femelle de chapeau, dont oit
fe fert en joiiant à la paume, en tirant des armes.
C hausson , en terme de Pâtifferie , c’eft une efpe—
£e de tourte de pommes.
} * CHAUSSURE, f. f. {Hïfl. anc. & Ecôh. domefi.')
C’eft la partie de l’habillement qui couvre le pié. Les
Grecs 6c les Romains en ont eu de cuir; les Egyptiens
de papirus; les Efpagnols, de geriet tiflü; les
Indiens, les Chinois, 6c d’autres peuples, de jonc ,
de foie, de lin, de bois, d’écorce d’arbre, de fer
d’airain, d’o r , d’argent ; le luxe les a quelquefois
couvertes de pierreries. Les formes & les noms des
chàuffures anciennes nous ont été eonfervés, les unes
dans les antiques, les autres dans les auteurs: mais
il eft très - difficile d’appliquer à chaque forme fon
nom propre. Les Grecs appelloient en général la
chauffure-, upodemata pedila; ils avôient les diabatres
à l’ufage des hommes 6c des femmes ; les fandales ,
qui n’étoiênt portées que par les femmes de qualité ;
les latitia, dont on n’ufoit que dans la maifon ; les
campodes, chauffure baffe 6c legere ; les peribàrides >•
qu’il n’étoit permis de porter qu’aux femmes nobles
& libres; les crepides, qu’on croit n’avoir été que la
chauffure des foldats ; les abulcés, chauffure des pauvres;
lesperfiques , chauffure blanche à l’ufage des
courtifànes; les laconiques Ou amucltdes, chauffure
rouge particulière aux Lacédémoniens ; les garbati-
hes, foilliets de payfans ; les embates > pouf la comédie
, les cothurnes , pour la tragédie ; les ènemides ,
que les Latins nommoient ocrece, 6c qui revenoient
à nos bottines : toutes ces chàuffures s’atta choient
fur le pié avec des courroies, imantes. Chez les Lacédémoniens
les jeunes gens ne portoient des chauf-
fures qu’à l’âge où ilsprenoient les armes, foit pour
la guerre, foit pour la chatte. Les Philofophes n’a-
voient que des femelles ; Pythagore avoit ordonné
à fes dilciples de les faire d’écôrce d’arbre : on dit
que celles d’Empedocle étoient de cuivre; 6c qu’un
certain Philetas de Cos étoit fi maigre 6c fi foible ,
qu’il en fit faire de plomb ; conte ridicule ; les fou-
liers lourds ne font guere qu’à l’ufage des perfonnes
vigoureitfes-.
La chauffure des Romains différoit peu de celle des
Grecs ; celle des hommes étoit noire, celle des femmes
blanche : il étoit deshonnête pour les hommes
de la porter blanche Ou rouge : il y en avoit qui al-
lôient jufqu’à demi-jambe, & on les appelloit calcei
uncinatl; elles étoient feulement à l’ufage des perfonnes
de qualité : on pouvoit les diftribuer en deux
fortes ; celles qui couvroient entièrement le pié, com*
me le calc'eus, le mullæus > lé pero 6c le phoecafiumf
celles dont la femelle fimple ou double fe fixoit fous
le pié par des bandes ou courroies qui s’atrachoient
demis, & qui laiffoient une partie de deflus le pié
découverte, comme lé caliga , lefolea, le crepida, le
bacca & le fandalium.
Le calceus 6t le Uiuîloeus ne différoient du pero ,
qu’en ce que Ce dernier étoit fait de peaux de bêtes
non tanées, 6c que les deux autres étoient de peaux
préparées. La chauffure de cuir non préparé patte pour
avoir été commune à toutes les conditions ; le muL
læus qui étoit de cuir aluné 6c rouge, étoit une chauffure
à lunule. Voye1 Lunule. Dans les tems de fim-
plicité il n’étoit guere porté que par les patriciens ,
les fénateurs, les édiles. On dit que Cette chauffure
avoit patte des rois d’Albe à ceux de Rome, & de
ceux-ci aux principaux magiftrats de la république*